| (Retour au menu principal) |

Avec André Billy et Marie Laurencin
(Photographie donnée à RG Cadou par Marie Laurencin.)
Consulter l'oeuvre poétique d'Apollinaire: http://apollinaire-guillaume.org/
Table des matières:
Le Testament d'Apollinaire
| (Retour au menu principal) |

Avec André Billy et Marie Laurencin
(Photographie donnée à RG Cadou par Marie Laurencin.)
Consulter l'oeuvre poétique d'Apollinaire: http://apollinaire-guillaume.org/
Table des matières:
Un frais ruissellement
René Guy Cadou commence à écrire ce « Testament d'Apollinaire » en octobre 1943. Le poète de « La vie rêvée » a alors 23 ans, et le poète « d'Alcools », lui, est mort depuis un quart de siècle. Guillaume nous a quittés, en effet, la veille de l'Armistice (celui de 1918), et son jeune exégète est, en 1943, l'un de ces poètes français qui essayent de maintenir dans leur cœur, dans leur chant et dans l'âme de qui les écoute, l'amour de la vie, du monde, de l'homme, comme un frêle et pourtant irréductible démenti au triomphe monstrueux de la guerre et de la tyrannie nazie.
Lorsque Cadou terminera son ouvrage, en février 1944, la guerre, elle, n'aura pas encore cessé. Et quand il le publiera - en fin avril 1945 -, la France sera délivrée, mais d'autres poètes amis auront encore eu, hélas, le temps de mourir (comme jadis Apollinaire) avant que ne sonne la victoire sur une Europe transformée par Hitler en geôle et en charnier. Ainsi, l'ami prestigieux de Cadou et de ses camarades de l'Ecole de Rochefort, celui même qui fut le compagnon fraternel d'Apollinaire, Max Jacob, sublime porteur de l'étoile jaune, meurt, déporté à Drancy, le 5 mars 1944.
Il convient de savoir que cet ensemble de circonstances datées n'est pas sans liens avec l'écriture, le ton et le sens du « Testament d'Apollinaire », ce livre qui porte en sous-titre non pas « essai » ni « biographie » mais « témoignage ».
C'est bien là, en effet, avant tout, le témoignage de reconnaissance passionnée, le témoignage d'amour que porte, en pleine guerre, un jeune poète pour la mémoire d'un grand aîné, victime héroïque et glorieuse de la précédente bataille universelle.
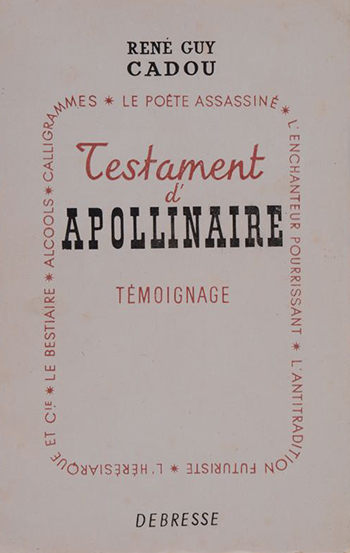
Jaquette de la première édition
Dans son « avertissement » René Guy Cadou nous prévient : « Il s'agit pour moi de concrétiser un élan, une flamme, d'élever dans vos yeux la claire statue de mon amour. » Et ailleurs, dans une lettre (1) adressée le 19 juin 1945 à Marcel Béalu, Cadou, annonçant l'envoi de son livre, déclare : « Je n'ai voulu mettre là-dedans que mon amour. »
Voilà bien ce qui me touche dans « le Testament d'Apollinaire » : cet « éclair », cette « flamme », et aussi cette tendresse que l'œuvre et l'exemple de Guillaume inspirent au jeune instituteur de Louisfert, si totalement, si purement poète.
Quand René Guy Cadou écrivait son livre, les subtiles, acharnées, fructueuses recherches d'un Marcel Adéma, d'une Marie-Jeanne Durry, d'un Michel Décaudin et de ses élèves (entre autres) n'avaient pas encore apporté tant et tant de précieuses publications qui nous permettent de connaître, à présent, les racines de l'œuvre apollinarienne presque vers par vers, et presque jour par jour la vie du poète. Aussi ne faut-il pas demander à René Guy Cadou de nous révéler la biographie de son modèle. Ici, la plupart des données « biographiques » (par exemple sur les ascendants de Wilhelm de Kostrowitsky ou sur ses amours) relèvent en fait de la « fable ». Après tout, cela n'eût pas déplu à celui qui, parlant de son itinéraire, écrivait : « je lègue à l'avenir la fable de Guillaume Apollinaire ». De toute évidence, Guillaume qui, dans son enfance, avait dû longuement fabuler à partir de l'image du père inconnu et posent, sinon mort, Guillaume, sa vie durant, aura nourri un secret penchant pour les figures mythiques de son propre destin. Sans doute n'eût-il pas condamné cette phrase de son exégète passionné : « ce qu'on ne sait pas d'une vie on l'invente, toujours sûr, n'est-ce pas, d'être plus près de la vérité... »
Au vrai, ce qui fait le charme et l'intérêt du livre du cher Cadou, c'est de nous faire entendre la résonance profonde qui s'établit entre la sensibilité émerveillée émerveillante des deux poètes.
Dans sa conclusion Cadou écrivait : « Pour rejoindre (Apollinaire) au fond, de ses cavernes bleues, dans son domicile de « Roi-Lune », il faudrait être soi-même poète et retrouver les mots depuis longtemps oubliés. Mais les hommes se souviennent-ils encore du frais ruissellement de l'herbe sous la main, de leur première enfance ? »
Oui, René Guy Cadou, sur les traces de Guillaume, et comme celui-ci, a su se souvenir et nous faire nous souvenir du « frais ruissellement » où prend sa source la poésie : qu'elle soit celle de « La vie rêvée » ou celle d' « Alcools ».
Georges-Emmanuel Clancier.
(1) Marcel Béalu - René Guy Cadou : Correspondance, (1941-1951 Rougerie).
Chapitre 1 - L’ange et la bête ou la vie d’un poète
Il s'est trouvé un matin sur la plage du monde entouré d'enchanteurs et de fées, parlant déjà à l'âge où les enfants ne savent pas encore rire, les yeux pleins d'étranges migrations, les mains remuantes porté par « son beau nom de marbre qui vole ».
Certains l'ont fait descendre en corbeille un nouveau Nil, d'autres ont ramené sur son front la paille fraîche de Bethléem. Quand il était si simple d'en faire un homme, on en a fait un dieu.
Guillaume Apollinaire, « dit d'un nom slave pour son vrai nom », est né le 26 août 1880 dans la ville des villes. Sa mère, Madame de Kostrowitski, arrachée à ses neiges de Pologne et à ses loups par un désir de lumière, hivernait depuis la fin de l'année 1879 dans la province romaine. C'est à Rome, raconte la légende, qu'elle fit la connaissance au cours de réunions mondaines de certain prélat au sang vagabond dont elle voulut bien écouter le prêche. Le Monsignor s'exprimait galamment et neuf mois plus tard la belle voyageuse pouvait annoncer à ses amis qu'un fils lui était miraculeusement né et qu'elle lui avait donné le nom de Wilhelm-Apollinaris. Elle était à la fois comtesse et mère.
Ce début de roman à la Paul Féval est bien fait pour séduire tout le premier Apollinaire. Qu'il n'ait été renseigné sur l'identité de son père, je ne le crois pas. On s'imagine difficilement le poète adoptant le premier palefrenier venu ; mais l'originalité de cette entrevue avec les dieux inférieurs, le côté déconcertant de cette prise de pouvoirs lui donne confiance en son destin. Aussi prendra-t-il plaisir à enjoliver sans cesse, à entourer de mystère ses premiers pas, sachant bien par surcroît qu'on fait beaucoup plus pour la vérité par le mensonge que par la plus touchante réalité. Ceci étant sans doute l'opinion de Max Jacob qui rapporte volontiers, lorsqu'on l'interroge sur son enfance, qu'il a été enlevé par des Bohémiens qui le désossèrent à l'âge de trois ans pour le déposer quatorze ans plus tard sur les marches de l'Ecole Normale Supérieure d'où il prit son vol vers l'Institut.
Et puisque j'en suis à Max Jacob, il me souvient d'une altercation qu'eut celui-ci avec André Rouveyre lors d'une exposition consacrée à Apollinaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, justement à propos de la naissance du poète. Après avoir dit l'amitié qui l'unissait à l'auteur des Calligrammes, « il est temps, ajouta Max Jacob, de détruire la légende qui donne pour père à Guillaume Apollinaire un prélat romain : nous sommes quelques personnes à Paris à savoir la vérité sur cette naissance. Il n'y a pas d'inconvénients à porter un témoignage certain à l'histoire, à laquelle appartient ce grand poète et maître. Mme de Kostrowitski, la mère de Guillaume, me présenta un jour au père de ses enfants. Elle me conduisit sous un baldaquin aux rideaux de velours où trônait un petit vieux qu'elle nomma « Monsieur Weil ».
C'est alors que dans l'assistance M. André Rouveyre, pâle et tremblant, se leva pour protester.
- Monsieur, fit-il, je n'admets pas la tournure que votre conférence a prise. Vous deviez parler de Guillaume Apollinaire et non de sa mère.
- Tout ce que j'ai dit, répondit Max, a été absolument vrai, je le jure.
- Au nom des amis d'Apollinaire, je proteste encore une fois, répéta André Rouveyre.
- Eh bien, Monsieur, protestez mais votre interruption me fait songer à cette altercation qui, en 1785, eut lieu entre un député légitimiste et ün républicain dans une petite ville de Bretagne : le légitimiste avait reproché au républicain d'être sorti d'une épicerie, à quoi celui-ci répondit : « vous Monsieur vous n'en seriez jamais sorti ».
Apollinaire va recevoir en entrant dans la vie le grand coup d'aile de la Méditerranée dont il gardera longtemps un profond amour. C'est au bord de cette mer bleue, dans l'exubérante lumière cependant tamisée par les vitraux des collèges qu'il fera connaissance avec la nature.
A Monaco, où il ouvrira ses premiers livres, il apprendra aussi à regarder ailleurs que dans livres. Deux rencontres le bouleverseront. La première personnifiée par le jeune René Dalize, élève des pères comme lui, donnera tout de suite à sa voix le ton grave de l'amitié. De bonne heure il saura qu'il existe entre les hommes des liens secrets, de chaudes salives et qu'un seul regard, une seule pression de la main sont plus encourageants que toutes les promesses.
L'autre rencontre, dont on se demande si n'a point été préparée par les éducateurs de l’enfant, puisqu'il s'agit de Dieu ne sera pas moins importante pour lui.
« Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalize
Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Eglise.
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette
Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège
Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ »
s'écrira-t-il plus tard dans l'admirable poème sur lequel s'ouvre Alcools.
Toutefois je ne crois pas qu'il faille s'exagérer, à ce moment surtout, les sentiments religieux du jeune Guillaume.
Il s'agit bien plus pour lui de trouver un dérivatif à la banalité des jours que d'atteindre un sommet refusé aux plus grands. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il est séduit par les « pompes de l'Eglise », c'est-à-dire par tout un déploiement d'oriflammes, de paroles mystérieuses et de fumées d'encens. Et puis sortir du dortoir en cachette n'est-ce pas plutôt là l'attrait du fruit défendu ?
La piété d'Apollinaire me laissera toujours un peu sceptique. Il écoute d'une oreille par trop complaisante les propos du passant de Prague, de ce Juif errant, voyageur heureux et sans but, surtout quand celui-ci déclare :
« Des remords ? Pourquoi ? Gardez la paix de l'âme et soyez méchant. Les bons vous en sauront gré. Le Christ ! je l'ai bafoué. Il m'a fait surhumain. »
« J'entends par Dieu écrira-t-il, ce sur quoi l'homme n'a nul pouvoir. »
Après Monaco, ce sera Cannes et puis Nice et toujours le collège où le poids des livres devient plus lourd. Guillaume semble délaisser les jeux et se donner plus sérieusement à l'étude. C’est déjà le fouineur, celui qui cherche non pas pour le plaisir de savoir mais pour trouver... Jalousement il soupèse dans ses mains les tablettes romaines et en savoure la patiner. Avec une fièvre juvénile il déchire âprement les tuniques de marbre curieux qu'il est de battre à nouveau les belles poitrines glacées. Et qui dira que le soleil ne facilite pas tout !
Malheureusement Guillaume allait avoir dix-huit ans et les portes du collège s'ouvrirent un beau jour tandis que se refermaient sur lui celles de la lumière orientale. Il est vraiment paradoxal de regretter une libération toute légitime et pour ma part je n'eus pas à me plaindre de la fin de bail scolaire, mais pour Apollinaire cette porte qui s’ouvrait donnait directement sur la vie, et il allait faire ses premiers pas à peu près comme un enfant perdu.
On ne s'est encore pas expliqué l'attitude de Mme de Kostrowitski à l'égard de son fils. Guillaume lui rappelait-il douloureusement son péché ? Ce serait voir en elle une femme bien sensible, ce qui n'était pas. Mieux vaut lui attribuer un désir d’indépendance, un hautain détachement du passé qui lui firent oublier jusqu'aux plus élémentaires devoirs maternels. D'ailleurs, sa vie durant elle continuera à considérer Guillaume comme un parent pauvre de province dont on tolère de temps en temps la présence parce qu'il est difficile de faire autrement. Ramon Gomez de la Serna dira d'elle dans la préface à Il y a : « Madame de Kostrowitski n'avait lu d'Apollinaire que l'Hérésiaque et Compagnie, œuvre qu'elle avait achetée dans une libraire par curiosité et qu'elle trouvait complètement idiote ».
A cela il n'y a rien à ajouter.
Voilà donc le jeune Kostrowitski appréhendé brutalement par ce Nice trop fleuri, avec ses yeux agrandis par le cerne magique de la mer, la tête pleine de troublants fantômes.
Que va-t-il faire ? Il a entendu parler de Paris comme d'une huitième merveille, il a dû même y aller alors qu'il était encore recouvert du mol duvet de l'enfance. Peut-être bien qu'on l'attend là-bas ? Il part, Il passe, croit-on, par Lyon « un jour violent d'été, à l'heure de midi dont Pan, caché dans les moissons symbolise le rut effrayant ».
Et c'est la capitale où « le troupeau des ponts bêle ce matin-là »
Apollinaire n'y reste pas longtemps, assez toutefois pour que le côté gothique de la cité lui apparaisse, assez pour demander à Notre Dame le secret azuré de ses tours. Il devine derrière les hautes flammes de pierre une merveilleuse civilisation ; il apprend qu'il est un pays où toute la lumière tombe des cathédrales. Tenté par la vieille Allemagne, il entreprend le voyage.
Comment s'est-il procuré l'argent nécessaire an long cours ? Voilà ce qui intrigua longtemps ses amis. En admettant qu'il ait fait pédestrement la route, comme il l'a dit lui-même, il aurait fallu tout au moins supposer que Mme de Kostrowitski, satisfaite sans doute de se débarrasser momentanément de son fils, lui fournit de quoi dîner honnêtement. La vérité est plus simple. Il est chargé d'enseigner la littérature française à Mlle de Milhau d'itinérante famille.
Le voici donc à Cologne où il fait la rencontre de la charmante Marizibill.
« Dans la haute rue à Cologne
Elle allait et venait le soir
Offerte à tous en tout mignonne
Puis buvait lasse des trottoirs
Très tard dans les brasseries borgnes. »
Et c'est la Forêt Noire, mystérieux domaine de Shinderhannes dont il se souviendra en écrivant dans les Rhénanes :
« Dans la forêt avec sa bande
Schinderhannes s'est désarmé
le brigand près de sa brigande
Hennit d'amour au joli mai. »
Maintenant il visite la Bohême. Rien ne peut plaire davantage à un esprit aussi curieux de tout que les mœurs bizarres des Tziganes. C'est sans étonnement qu'il s'entendra dire :
« Les jours les plus heureux pour l'homme sont celui où il se marie et celui où sa femme crève », sans étonnement qu'il verra danser la « khaliandra » où, au son d'une guitare, on saute et on se bat les semelles sur les fesses en se tenant d'une main par l'oreille et de l'autre par l’organe génital.
L’Allemagne ne lui suffit pas, il gagne alors la Hollande, peut-être à la recherche du matelot d’Amsterdam dont il racontera la tragique histoire dans l'Hérésiarque.
Puis c'est le retour par la vallée du Rhin où le vieux fleuve soulève sa face ruisselante et se détourne pour sourire. Aperçoit-il la Lorerey ou plutôt est-ce bien lui qu'elle aperçoit :
« Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle
Et mon amant s'y tient il m'a vue il m'appelle »
De ce voyage qui dure bien près de trois ans Apollinaire rapporte un bric-à-brac de souvenirs. Il n'est pas prêt d'oublier la saveur des bières fraîches, l'ardent parler des Juifs et des Tziganes,la sorcellerie des longs couchants au bord du Rhin et cette prenante mélancolie qui se dégage des vieilles pierres. C'est un peu ses d'apprentissage à lui aussi.
Wilhelm Meister Apollinaire retrouve la capitale ensoleillée et déserte. Les vacances sont arrivées et les Parisiens sont allés aux provisions de miels dans les campagnes. Patiemment donc il attend octobre et en profite pour mettre un peu d'ordre dans sa mémoire. A cette époque il ne semble pas qu'Apollinaire soit persuadé de sa destinée poétique. A l'âge où Rimbaud et Lautréamont ont déjà achevé leur œuvre il n'a encore rien publié sinon rien écrit d'important. Certes, chaque journée apporte son flux et son reflux d'images, à chaque tournant de rue se dresse un signe étoilé, mais le poète attend toujours la grande révolution qui s'emparera de son cœur.
C'est André Billy et surtout André Salmon qui vont se charger de mettre à nu cette belle âme qui se cache, qui se dérobe et ne demande au fond qu'à s'épanouir.
Sept ans plus tard, au mariage de son ami Salmon, il dira dans un poème aujourd'hui célèbre :
« Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit
Au temps de notre jeunesse
Fumant tous deux et mal vêtus attendant l'aube
Epris épris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens
Trompés trompés pauvres petits et ne sachant pas encore rire. »
Avec Salmon, Apollinaire fonde alors Le Festin d'Esope, revue littéraire qui, malgré son titre prometteur et le bon vouloir des deux poètes, ne tarde pas à sombrer dans les eaux noires du Styx.
C'est alors qu'Apollinaire fait connaissance de Picasso et quelques temps après de Max Jacob. Max m'a raconté cette première entrevue et je sais la mémoire si fidèle de mon ami que j'ai bien garde d'y changer un mot :
« En 1904 Picasso me dit : « J'ai vu au Bar Osten Fox un type extraordinaire. Nous irons le voir ce soir. » Austen Fox était un bar de jockeys et de gens d'écurie, rue d'Amsterdam, mis à la mode par le livre de Huysmans A rebours, je crois. Je cite ce fait car il éclaire un genre d'esprit d'Apollinaire. On retrouvera un jour une anecdote analogue dans la vie d'Henri Bataille qui devait aller dans une ville d'eaux et pris seulement une chambre à l'Hôtel d'Orsay, quai d'Orsay, qu'il déclara admirable et suffisante.
« Me voici donc dans ce bar, très exigu et divisé en deux comme tous les bistrots ; le zinc était plein de vieux petits hommes maigres à casquettes. La salle avait une ligne de marbres blancs occupés par des gobelets de fer de pale-ale et un groupe d'employés de commerce attentifs sur la banquette de velours qui écoutaient Apollinaire. Picasso me présente et Apollinaire sans cesser un discours doux et violent sur Néron et sans me regarder me tendit distraitement sa main courte et forte (on pensait patte de tigre). Le discours achevé, il se leva et nous entraîna dans la nuit avec de grands éclats de rire. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. »
A cette époque, Apollinaire est employé de banque rue Le Pelletier et rentre tous les soirs au Vézinet chez sa mère par le dernier train. Max Jacob et Picasso l'accompagnent jusqu'à la gare Saint Lazare. C'est là qu'il leur dira un jour : « Ce qui ne disparaîtra pas de notre civilisation ce sont les plaques tournantes des gares ou les rails. Les savants se disputeront sur la signification des inscriptions. »
Malgré un travail imbécile Apollinaire ne récrimine pas. D'ailleurs son ami Max Jacob n'est guère mieux partagé que lui quand il s'écrie :
« M'as-tu connu marchand d'journaux
A Barbès ou sous le métro. »
Mais la banque ne tarde pas à faire faillite et le poète reprend ainsi sa liberté. Il débute alors dans le journalisme, journalisme spécial, s'il en est puisqu'on lui confie la rédaction du « Guide du Rentier », Rentier, ô ironie du sort, lui qui n'a pas un liard en poche ! Et puis les grands journaux lui ouvrent leurs portes. Il est rédacteur au Matin, à Paris-Midi, à l'Excelsior et au Gil Blas et dirige de plus son activité vers les arts. Apollinaire a maintenant vingt-cinq ans. C'est un grand gaillard au teint pâle, de la pâleur du Pierrot ou du Christ ? Il a d'assez gros yeux noisette toujours noirs et ses cheveux sont encore blonds et bouclés bien qu'ils semblent taillés en brosse. Son corps chargé de membres gros et musclés ne donne nullement l'idée de l'athlétisme mais plutôt l'idée de l'hamlétisme. Quand il marche, il a de grosses hanches parce que toujours pleines de livres qu'il ramasse partout chez les brocanteurs et sur les quais. Il est vêtu de vêtements gris chinés genre anglais, une chaîne de montre en platine barre sa vaste poitrine osseuse, il porte un rubis au doigt, ce qui fait dire à Max Jacob : « On le croyait avare parce qu'il avait l'air d'un prince. » Comme le journalisme ne lui apporte pas tous les subsides nécessaires, Apollinaire accepte des travaux à la Bibliothèque Nationale. Il y va même par plaisir. C'est là qu'il apprend à connaître Gobineau, le dictionnaire de Bayle, le dictionnaire japonais où un seul petit mot signifie quinze lignes de dénomination. Après cela les malins affirment qu'il déverse sur ses amis tout ce que la Bibliothèque a enseigné dans la journée. Ce qui est vrai, c’est qu'il sait beaucoup de choses ; il lit les journaux comme on apprend quelque chose par cœur et les retient, mais il connaît aussi le passé. « Apollinaire vous apprend tout le contraire de ce qu'on nous a dit à l'école » disait l’acteur Olin.
Quand il est avec un ami, il le prend par le bras et le promène d'un trottoir à l'autre. Il s’arrête devant une boutique et commente. Un jour il montra à Max Jacob une mansarde au coin de la place Saint-Michel et de la Seine et déclara : « Bonaparte a habité là. » C'est faux ! Jamais Bonaparte n’a eu de mansarde à Paris, mais Max Jacob qui m’a conté l'anecdote, d'ajouter : « mais c’est vrai ce jour-là ! »
A la Nationale, aidé par Fernand Fleuret qui a l’air « d’un archer de la tapisserie de Bayeux » Apollinaire entreprend de dresser la liste des œuvres licencieuses de la Bibliothèque, ce qui l'amène tout naturellement à en écrire lui-même. D'abord il se contente de préfacer pour la collection les Maîtres de l'Amour, l'Œuvre du divin Arétin, l'Œuvre du Marquis de Sade, l’Œuvre libertine des poètes du XIX° Siècle et bientôt, se reposant entièrement sur son ami René Dalize pour la rédaction, il signera seul des livres nettement licencieux vendus sous le manteau tels Les onze mille verges ou Les exploits d'un Don Juan.
Mais doit-on s'émouvoir de cette activité singulière. Il est en effet pour le moins curieux qu’ancien élève du collège catholique de Monaco se livre, même par besoin d'argent, à ces travaux de « voyeur ». Apollinaire a-t-il hérité de ses voyages, de ses nouvelles fréquentations et pourquoi pas de sa personnalité physique, le goût des mots gaillards et lourds comme les vins qu'il aime ? Dans sa conversation il est dans la lignée de Rabelais et des contes drolatiques. La verdeur d'esprit est nécessaire à sa santé morale au même titre que le tabac et l'alcool. Semblable en cela à de nombreux poètes, il dépense en paroles l'ardeur des amours interdites. Les mots obscènes le sauvent de la banalité du quotidien en recréant justement un nouveau quotidien.
Et puis quand il s'agit d'Apollinaire ne peut-on parler d'un certain souci d'étonner, de mystifier et de jouir secrètement lui-même.
Quelle étrange volupté ne ressent-il pas quand il écrit La Chanson du mal aimé ces vers pleins d'un érotisme fermé :
« L'époux royal de Sacontale
Las de vaincre se réjouit
Quand il la retrouvera plus pâle
D'attente et d'amour yeux pâlis
Caressant sa gazelle mâle »
Grâce aux travaux de librairie ses soirées sont souvent pleines d'alcools. Apollinaire retrouve ses amis soit rue Cavalotti, derrière le Mont-de-Piété, soit au 13 de la rue Ravignan dans cet étrange « Bateau lavoir » où habitent déjà Salmon, Picasso et Max Jacob et où il va bientôt les rejoindre.
C'est dans la chambre de Picasso où « la destinée mettait au plafond des punaises en guise d'étoiles » qu'ils se réunissaient le plus souvent. « Dans l'atelier, dira Apollinaire, il y avait des joies de toutes les couleurs. Une grande fenêtre tenait tout le côté du nord et l'on ne voyait que le bleu du ciel pareil à un chant de femme... Il y avait encore dans l'atelier une chose fatale, ce grand morceau de miroir brisé, retenu au mur par des clous à crochet. C'était une insondable mer morte, verticale et au fond de laquelle une fausse vie animait ce qui n'existe pas. » Et d'ajouter : « Ainsi en face de l'art, il y a son apparence dont les hommes ne se défient point et qui les abaisse lorsque l'art les avait élevés. »
Dans La Femme assise Apollinaire peindra son ami Picasso sous les traits de Pablo Canouris, « le peintre aux mains bleues ». Il dira que le Gréco renaissait en lui, « non que Canouris imita le Gréco, mais le côté mystérieux de son génie touchait avec cette violence angélique qui angoisse délicieusement les amateurs de Théocopouli ».
La lampe brûle tard dans la nuit. Picasso en rallumant sa pipe discute polygamie. « La polygamie, dit-il, c'est une théorie bonne pour les pipes mais pas pour les femmes », et Apollinaire énonce une petite recette de magie moderne comme cette « conjuration pour gagner à la bourse » : « Mangez chaque matin un hareng-saur en prononçant quarante fois avant et après l'opération : « mange et chique, trinque et vois », et au bout du dixième jour le diable sortira de la Bourse. »
Toutefois il ne faut pas croire que toutes les nuits se passent aussi innocemment. Quand on ne dégringole pas la rue Lepic en hurlant . « A bas Laforgue, vive Rimbaud ! » cri bien nouveau à cette époque, et en tirant des coups de revolver, alors on discute des graves problèmes de l'Art. Avec Braque et Picasso le cubisme vient de naître et « aucune école depuis le romantisme n'a autant remué le monde que la nouvelle école de peinture où seuls ont joué un rôle des artistes ressortissant à la civilisation méditerranéenne, des artistes appartenant à une race latine. »
Les anecdotes sur le début du cubisme ne manquent pas mais, outre que l'accumulation en serait fastidieuse, elles ne nous apprennent rien d'essentiel.
Mieux vaut écouter Apollinaire dire à ses amis : « La vraisemblance n'a plus aucune importance, car tout est sacrifié par l'artiste à la composition de son tableau. Le sujet ne compte plus ou s'il compte, c'est à peine. »
Cependant Apollinaire lâche un peu ses amis, ce qui les chagrine. « Une pareille lumière, dit Max Jacob, ne pouvait rester sous le boisseau des hangars rue Ravignan. » On se l'arrache ! pas dans le monde, il n'a jamais fréquenté le « monde », mais dans le monde littéraire. On ne parle pas encore de Montparnasse, ni des Deux Magots, ni de Flore, ni de Lipp, mais il y a boulevard Saint-Michel le Soufflot, le Vachette, Paul Fort a la Closerie des Lilas, Moréas le Soufflot. Apollinaire est partout le même, discutant avec douceur et prenant des colères quand on le contredit.
C'est au cours d'une de ces réunions d'amis qu'il entend parler pour la première fois d'Henri Rousseau, de celui qui n'est pas encore le magnifique Douanier mais l'obscur retraité d'octroi et le non moins obscur héros de la guerre du Mexique. Il fait sa connaissance et la touchante simplicité du bonhomme le séduit sur-le-champ. Lorsqu'il lui arrivera de poser pour le tableau La Muse inspirant le poète Apollinaire se verra soumis à un nouveau conseil de révision. En effet à l'intention d'une ressemblance frappante, le peintre lui mesurera le nez, la bouche, le front et le corps tout entier et reportera scrupuleusement les mesures sur la toile. C'est de lui qu'Apollinaire dira : « Il avait un sentiment si fort de la réalité que quand il peignait un sujet fantastique, il s'épouvantait parfois et tremblant, il était obligé d'ouvrir la fenêtre. »
Rousseau découvert par Jarry, va trouver en Apollinaire un ardent défenseur de son art. Comment celui qui déclare qu'on peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des faux-cols, des candélabres, etc... pourvu qu'on n'emploie pas de la couleur, n'aurait-il pas été de prime abord touché par la fraîcheur paradisiaque (comme on dit oiseau de paradis) du Douanier ? C’est à Apollinaire que reviendra de droit l'honneur de tracer son épitaphe :
« Gentil Rousseau, tu nous entends ?
Nous te saluons
Delaunay, sa femme, Monsieur Quénal et moi
Laisser passer nos bagages en franchise
A la porte du ciel!
Nous t'apportons
Des pinceaux, des couleurs, des toiles
Afin que tes loisirs sacrés, dans la lumière réelle,
Tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait
La face des étoiles. »
Mais Apollinaire a peut-être de plus secrètes raisons de délaisser certains soirs les camarades rue Ravignan.
Celui qui reprend à son compte la parole de César : « On conquiert les femmes et les peuples : les premières conquêtes vous rendent chauves les autres nous font perdre l'estime des hommes », est le plus sentimental des collégiens. Ecoutons-le parler lui-même de son amour : « En 1907, j'ai eu pour une jeune fille qui était peintre un goût esthétique qui confinait à l'admiration... Elle m'aimait ou je le croyais, et je crus ou plutôt je m'efforçai de l'aimer, car je ne l’aimais pas alors. »
C'est bien cela en effet. Cet homme qui ne recule devant rien quand il s'agit de prendre la défense de l'art - ne va-t-il pas jusqu'à dire qu'on doit peindre avec de la vraie merde - a devant l'être aimé une pudeur, une réserve qui touche de bien près à l'innocence. Il fait un peu songer à un grenadier qui aurait peur d'être surpris avec sa bergère.
Sa bergère, c'est Marie Laurencin, cette sœur-épouse plus vive et plus espiègle qu'un oiseau, dont la grâce et le talent toucheraient des cœurs de pierre. Marie Laurencin dont l'amour du poète va faire un grand peintre.
Ne nous trompons pas. C'est elle dans Le poète assassiné qui sous les traits de Tristouse Bellerinette (la ballerine triste pourrait-on dire) remercie de cette façon son ami : « J'étais inconnue et voilà qu'il m'a faite illustre entre toutes les vivantes. On me tenait pour laide en général avec ma maigreur... Me voilà belle à cette heure, et tous les hommes me le disent. On se moquait de ma démarche virile et saccadée, de mes coudes pointus qui remuaient dans la marche comme des pattes de poule. On me trouve maintenant si gracieuse que les autres femmes m'imitent. »
Et Marie d'ajouter : « Quel miracle n'enfante pas l'amour d'un poète, mais qu'il pèse lourd l'amour des poètes ! quelles tristesses l'accompagnent, quels silences à subir ! » On voudrait comme Carco que, plutôt qu'à Annie, s'adressât à elle cette admirable Chanson du mal-aimé qui la ferait rejoindre d'un coup les grandes amoureuses.
« Mais en vérité je l'attends
Avec mon cœur avec mon âme
Et sur le pont des Reviens-t'en
Si jamais revient cette femme
Je lui dirai je suis content »
Ce poème, Apollinaire le remet à Paul Léautaud pour le Mercure de France où il sera publié en 1909. Bien davantage que l'Enchanteur pourrissant, son premier livre, qui paraît la même année. La Chanson apporte à Guillaume Apollinaire l’admiration de ses amis connus et inconnus. Heureux peut-être, il se répand de plus en plus dans Montparnasse où il se voit partout fêté. De toutes les repues franches, il participe par le verbe et par le geste aux plus délicieuses mystifications. Ses propos sur l'Art séduisent et déroutent. Il apparaît comme cet Allemand dont Jacob a dit dans le Cornet à dés qu'il était « fou d'art, de foulards et de poulardes. » Plus sérieux Carco remarquera que « dès qu'il parlait, Guillaume prêtait un langage à la foule des poètes et des peintres qui, l'écoutant, pensaient s'entendre et liaient à ses paroles leur destin. »
Une nuit qu'il se promène avec des amis boulevard de Courcelles, il improvise un pastiche de la Vie unanime de Romains qui venait de paraître. Un agent l'interpelle alors que sur un banc ses jambes refusent d'avancer : « Je baise sur ton front toute la race humaine », lui répond-il. Romains, à qui l'histoire fut racontée, avoua que ce vers était magnifique et qu'il n'aurait pu le trouver.
C’est à cette époque que se place également l’anecdote devenue célèbre et que Carco a le premier rapporté dans ses souvenirs « de Montmartre au Quartier Latin :
« Coiffé d'un chapeau haut de forme, un froid carreau dans l'œil et des gants frais aux mains, l'admiration, que dis-je... le culte que Louis de Gonzague-Frick vouait à Apollinaire le conduisait tous les matins chez lui. Louis de Gonzague Frick sonnait. Guillaume venait ouvrir et il apercevait son admirateur assidu qui s'inclinait et demandait
- Monsieur Guillaume Apollinaire ?
- C'est moi, répondait le poète.
Alors Louis de Gonzague-Frick présentait à Guillaume une pomme qu'il lui tendait en symbole de son choix le plus pur et Guillaume prenait la pomme et la croquait joyeusement. »
Certes il ne faut pas s'exagérer l'importance de ce geste, qui répété, ne dépasse guère le cadre des simples plaisanteries. Il témoigne toutefois d'une réelle ferveur et pour qu'un poète de moins de trente ans parvienne ainsi à s'imposer à ses contemporains, c'est que sa personnalité dispense véritablement une grande chaleur.
En 1910, Apollinaire réunit tous ses souvenirs de voyages (souvenirs d'un homme qui ne perçoit que l'original) et les peuple de ses fantômes. Le tout fait un gros livre de contes qu'il donne chez Stock sous le titre de l'Hérésiarque et Compagnie. Le succès est tel qu'il l'a pressenti lui-même quand il se fait dire par le passant de Prague « Allons, riez ! ne craignez ni l'avenir, ni la mort. On n'est jamais sûr de mourir ; vous-même vous ne mourrez peut-être pas. »
On parle encore de « la disparition d'Honoré Subrac », aussi bien que de l'étrange « Baron d'Ormesan », quand paraît l'année suivante son premier recueil de poèmes : Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée.
Il ne semble pas que ce livre soit celui qu'attendaient ses amis. Quand on a été bercé par La chanson du mal-aimé on se contente mal en effet d'un romantisme attardé et très peu des roueries du symbolisme à son déclin.
Si l'attention se fixe cette année-là sur Apollinaire c'est qu'il vient de se passer une chose tout-à-fait indépendante de la volonté du poète : on a volé la Joconde. Or il est établi par rapport de police que le sieur Wilhelm de Kostrowitski a hébergé chez lui, et s'est fait ainsi complice, un belge du nom de Guy Piernet présumé coupable du vol. Le 7 septembre on arrête Guillaume qui est aussitôt incarcéré à la Santé. Alors commencent pour lui ces heures de captivité que connurent en d’autres temps Marot, Villon, Chénier et son cher Verlaine.
Comme l'auteur de Sagesse, Apollinaire écoute au loin tinter les heures
« Que lentement passent les heures
Comme passe un enterrement
Tu pleureras l'heure où tu pleures
Qui passera trop vitement
Comme passent toutes les heures. »
Mais le poète goûte peu la plaisanterie ; la cellule n'est pas à la mesure de son grand corps et il est bien près de sangloter comme autrefois :
« Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire. »
Heureusement, grâce au dévouement de ses amis, il comparaît six jours plus tard devant le juge d’instruction et est acquitté au bénéfice du doute. Il ne reste de l'aventure que le fade relent d’une publicité dirigée par les sots et les ennemis du poète, et une certaine amertume dans le cœur de Guillaume.
Toutefois cette publicité a eu le mérite de savoir à Apollinaire et à ses frères d'armes d’où venait le danger. Afin de reprendre, comme on dit, l'initiative des opérations, on décide de fonder une nouvelle revue de combat poétique : Les soirées de Paris. Apollinaire se charge de la défense de l'art cubiste et en donne cette définition : « création de nouvelles illusions ». « En effet, dit-il, tout ce que nous ressentons n'est qu'illusion et le propre de l'artiste est de modifier les illusions du public dans le sens de leur création. »
Mais les soirées de Paris se passent la plupart du temps ailleurs que dans les bureaux de la revue et il faudrait pouvoir demander aux bistrots de Montmartre et du Quartier de nous retracer les itinéraires du poète.
Au fond des verres de gin, dans les bolées du père Frédé, les nuits coulent lentement. Apollinaire ne vient-il pas de découvrir les premières publications de Fantômas et n'a-t-il pas entrepris de faire partager à ses amis les émotions du policier Juve et du journaliste Fandor. Certes il n'admire pas l'œuvre de Souvestre et d'Allain comme un roman policier mais pour les inventions lyriques qui s'y trouvent telles que les fontaines chantantes, les taches lumineuses sous la Seine, etc. et qu'il ne peut pas ne pas apprécier.
Il est certain qu'un esprit curieux comme le sien est charmé de voir cette jeune actrice se chloroformer elle-même avec son vaporisateur en croyant se parfumer, ou encore d'assister Fantômas quand pour signer ses crimes celui-ci enfile comme un gant les propres mains d'un mort.
A côté de Fantômas, d'autres lectures ne sont pas moins passionnantes. « Je ne vais pas te faire un catalogue des livres que nous apportait Apollinaire, me dit Max Jacob, mais t'en donner simplement une idée : nous lisions un livre d'un Anglais collectionneur qui n'achetait des objets d'art que pour les corriger : son livre contenait la photo de l'objet avant et après. Il corrigeait aussi bien Michel-Ange que Léonard de Vinci. Je me souviens aussi d'un livre d'une dame anglaise qui énumérait tous ses amis et les raisons qu'elle avait de les aimer : Miss X fait admirablement le thé, Mistress X joue bien du piano. Il y avait plusieurs centaines de pages sur ce ton. »
On lit également les œuvres des camarades avec une certaine cruauté moqueuse, mais surtout, Apollinaire prépare au milieu des paradoxes et des jongleries ce manifeste qui fera tant de bruit dans le monde des Arts : l'Antitradition futuriste.
Depuis plusieurs mois il s'intéresse en effet à l’évolution des peintres italiens tant en France qu’en Italie.
« Il y a maintenant tant d'étrangers en France rapportera-t-il plus tard dans une nouvelle du Poète Assassiné, qu'il n'est pas sans intérêt d’étudier la sensibilité de ceux d'entre eux qui, étant nés ailleurs, sont cependant venus ici assez jeunes pour être façonnés par la petite civilisation française. Ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance, les plus vives de toutes, et enrichissent le patrimoine spirituel de leur nouvelle nation comme le chocolat et le café, par exemple, ont étendu le domaine du goût. »
Il n’est pas douteux en effet que Picasso ait rapporté de son Espagne natale la couleur acide des agrumes et la façon démoniaque des inquisiteurs de s’approprier les secrets. C'est ainsi qu'il cherchera même au moyen de la déformation, j’allais dire de l'inquisition, à représenter le monde qui lui est suggéré par une nécessité intérieure.
L’antitradition futuriste publiée à Milan s’adresse d’une façon véhémente aux adversaires de l’art nouveau, critiques, pédagogues et autres cuistres qui font profession de savoir et de faire savoir. Pour les convaincre il emploie en dernier ressort de la vieille garde qui est le seul qu’ils puissent comprendre.
Plus importants sont sans doute les propos parus dans Peintres cubistes cette même année.
« L'Art des peintres nouveaux prend l'Univers comme idéal, et c'est à cet idéal qu'on doit une nouvelle mesure de la perfection qui permet à l'artiste-peintre de donner à l'objet des proportions conformes au degré de plasticité où il souhaite l'amener. »
Ce qui confirme ce qu'il disait quelques mois auparavant : « Le peintre veut exprimer la grandeur des formes métaphysiques. »
1913 ! Et tandis que le manifeste futuriste fait miroiter ses paillettes à la lumière italienne, le Mercure de France lance sur ses presses les pages brûlantes d'Alcools.
Ce livre distillé au cours de quinze années de travail, quinze patientes années d'amour, donne à Apollinaire la première place, celle qu'il occupe depuis longtemps déjà dans le cœur de ses amis.
Malgré le succès, Apollinaire reste toujours le joyeux compagnon, le frère aîné dont Francis Carco a dans Nostalgie de Paris laissé ce portrait remarquable : « Son humeur, sa vivacité d'esprit et de langage, sa fantaisie, sa gentillesse n'ont été, que je sache, égalés par personne. Il possédait ce goût de plaire et de convaincre qu'on découvre chez certaines femmes dont c'est la grande affaire, ou chez certains prêtres qui s'en servent à des fins plus utiles peut-être mais non moins désintéressées, tant ils les ont toujours présentes devant les yeux. »
Apollinaire a besoin de l'amitié, de ces mains qui tendent leurs doigts comme « des blancs rayons de lumière. » Il lui faut « des amis en toute saison » et c'est « du plus profond de la tranchée » - comme dira Jean-Marc Bernard - qu'il faudra l'entendre les appeler :
« Où sont-ils Braque et Max Jacob
Derain aux yeux gris comme l'aube
Où sont Raynald Billy Dalize
Dont les noms se mélancolisent
Comme les pas dans une église »
Pour le moment les amis se retrouvent encore dans quelque bistrot devant un saladier de vin ou un bœuf gros sel. Guillaume, gourmand « semblable à quelque dieu hilare », ne quitte guère la fourchette et le gobelet que pour lancer une aimable plaisanterie ou pour mystifier, ce qui est plus fréquent, les curieux qui l'entourent, finissant d’ailleurs lui-même par prendre au sérieux ses propres mystifications.
Toutefois si Apollinaire goûte fort la plaisanterie, celles qui se retournent contre lui, lui sont terriblement désagréables. Il est d'une susceptibilité féminine et a une peur exagérée du ridicule, le ridicule moral j'entends. Celui dont chacun a reconnu la douceur et a pu l'éprouver, n'hésitera pas à demander réparation par les armes d'une parole trop vive ou déplacée.
Cette sensibilité presque maladive s'explique par la haute idée qu'il a de son art et de sa mission. Il a confiance en lui, en la vérité qu'il représente. Il ne veut pas qu'on puisse en douter.
« Plus tard, écrira-t-il, ceux qui étudieront l’histoire littéraire de notre temps s'étonneront que semblables aux alchimistes, des rêveurs, des poètes aient pu, sans même le prétexte d'une pierre philosophale, s'adonner à des recherches, des notations qui les mettaient en butte aux railleries de leurs contemporains, des journalistes, des snobs. Mais leurs recherches seront utiles, elles constituerons les bases d'un nouveau réalisme qui ne sera peut être pas inférieur à celui si poétique et si savant de la Grèce antique. »
Mais les jours passent et déjà l'on entend en ce début d’été de 1914 le pas traînant des hommes en route pour les casernes, la rumeur sourde des frontières.
Apollinaire, dans l'auto de son ami Rouveyre, fait un ultime voyage sur la côte de la Manche. Longtemps il se souviendra de cette randonnée nocturne où chacun se taisait parce que l'air ne pouvait plus supporter les paroles ; il se souviendra de cette dernière nuit d'avant la guerre, de ces villages traversés où les hommes se préparaient à répondre à l'appel. Lisieux, Versailles et jusqu'au souvenir d'un pneu trois fois éclaté qui ne le quitte plus :
« Le 31 du mois d'août 1914
Je partis de Deauville un peu avant minuit
Dans la petite auto de Rouveyre
Avec son chauffeur nous étions trois
Nous dîmes adieu à toute une époque. »
Pendant ce temps les Parisiens, confiants dans le destin, envahissent les cafés, dévalisent les fleuristes. De jeunes hommes enthousiastes parcourent les rues de la ville aux cris de « A Berlin ». Les gares qui sentent la poussière et le suint, les baisers à bon marché, les graves étreintes, dirigent en hâte vers l'Est leurs wagons de bétail humain, tandis que de bouche en bouche les litres de vin lourd passent comme des trompettes étincelantes.
Apollinaire est de retour et Vlaminck qui le verra le lendemain de la mobilisation déclarera : « La guerre ne le surprenait pas. - « Elle durera trois ans, me dit-il, et le mieux c'est d'être soldat. »
Du fait de sa nationalité, Guillaume Apollinaire n'est pas mobilisable. C'est donc comme volontaire qu'il partira. Il considère qu'il faut faire place nette pour une nouvelle France « à la fois jalouse de ses traditions et extrêmement audacieuse dans ce qui concerne le progrès. »
Révolutionnaire dans l'art celui qui a écrit :
« J'ai soif villes de France et d'Europe et du monde
Venez toutes couler dans ma gorge profonde. »
demande sans hésiter à participer au sacrifice général.
L'aventure est trop nouvelle pour lui : curieux de tout, il devine sous les paupières du monde de longs regards sanglants, il devine déjà les obus miaulant comme des chattes en amour, il sait que la poésie n'est pas perdue et que « le plus beau des arts » ressortira grandi de tant de nuits brûlantes.
A Nîmes où il fait ses classes, Apollinaire déclare joyeusement à ses amis : « J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. » L'amour même est incapable de le retenir ; il attend avec impatience le printemps qui le mélangera à la pourpre des frontières, caressant « le petit canon gris comme l'eau de la Seine » qui le fait encore songer à Paris, écoutant ce camarade blessé qui lui raconte les splendeurs de la nuit traversée de mitraille, inquiet des compagnons déjà partis :
« Tous les souvenirs de naguère
O mes amis partis en guerre
Jaillissent vers le firmament
Et vos regards en l'eau dormant
Meurent mélancoliquement »
Libre enfin et fier, l'artilleur Kostrowitski est envoyé sur le front en tant que canonnier-conducteur. Dans ce nouveau ciel qu'il traverse, le bras de l'officier est devenu son « étoile polaire ». Un lièvre qui détale, une jeune femme sur le seuil d'une ferme, un soldat qui passe au galop « comme un ange bleu dans la pluie grise », c'est assez pour que le poète soit heureux de vivre et d'être là. Partout les obus fleurissent en gerbes merveilleuses.
« La guerre même, dira-t-il, a augmenté le pouvoir que la poésie exerce sur moi. »
Et puis à quoi bon pleurer sur les horreurs de la guerre
« De la terre et des mers
Avant elle nous n'avions que la surface
Après elle nous aurons les abîmes
Le sous-sol et l'espace aviatique. »
Nommé brigadier en avril 1915 sa joie est rougissante comme celle d'un collégien inscrit au palmarès. Il prend part alors aux attaques de Champagne, dans ce pays où la vie est si dure et où le courage, l'entrain, le sacrifice y sont d'autant plus grands.
Longtemps il parlera à ses amis de ce petit coin de Beauséjour « qui devrait être un si charmant séjour avant la guerre ». C'est près de là, qu'un jour d'été de la même année, André Derain se trouvera en face de son village natal détruit. Il en dressera une silhouette transfigurée qui le fera plus grand, plus beau qu'auparavant, plus beau qu'au temps de son enfance et apportera une vision de ce qu'il deviendra après la guerre.
Apollinaire qui connaît ce merveilleux dessin écrira : « Il faudrait que dans tous les esprits s'accomplît le miracle patriotique de la double vue. Partout en France la guerre peut amener des changements magnifiques ; il faut les apercevoir dès aujourd'hui afin de pouvoir les réaliser ».
Pendant les longs loisirs que lui laisse son métier de soldat, Apollinaire se livre à la fabrication, des bagues, des ronds de serviette, des coupe-papiers, des vases :
« C'était un temps béni jours vagues et nuits vagues
Les marmites donnaient aux rondins des cagnats
Quelque aluminium où tu t'ingénias
A limer jusqu'au soir d'invraisemblables bagues. »
Ces bagues, il les adresse à son amie Madeleine, une jeune beauté, presqu'une enfant puisqu'elle est encore écolière, qu'il a connue au cours d'une permission à Nice alors qu'il faisait son apprentissage de soldat. A ces envois sont joints quelques vers :
« ... Aubes que chaque jour
J'admire ô hanches si blanches
Il y a le reflet de votre blancheur
Au fond de cette aluminium
Dont on fait les bagues
Dans cette zone où règne la blancheur... »
Le bureau de la compagnie fournit même à Apollinaire papier et pâte à polycopie et le poète s'empresse de tirer pour ses amis quelques exemplaires des poèmes qu'il a écrits au cours de ces derniers mois et auxquels il a donné le titre général de Case d'Armons.
Puis, celui qui a couché sur le sol, mordu par le gel et la vermine, celui qui ne sait plus la rondeur familière d'une table, l'épaule consolante d'un meuble de bois blanc, s'endort dans la douceur d'un wagon de première en marche vers ce « noble Paris seule raison qui vit encore ». C'est la première permission depuis le commencement de la guerre.
Apollinaire a besoin de soleil, d'un vrai soleil, autre que celui qui saigne sur les barbelés, dans les vitres brisées, à la pointe des arbres fracassés par les tirs. Il se souvient du frai lumineux ruisselant sur les toits de son enfance. La gare de Lyon est déserte. Il passe sur le quai. II est déjà loin vers Marseille.
A Marseille, il n'attend pas longtemps le bateau qui doit le transporter en Algérie, quelques jours seulement dont il profite pour visiter les camps anglais et pour aller jusqu'au Jas de Bouffan, à Aix, où peignit Cézanne.
A Oran, le permissionnaire se repose des tirs de barrage avec la phosphorescence des vagues. Ses yeux s'apaisent dans les couchants semblables à ces femmes voilées dont il cherche vainement à pénétrer le masque. Il s'amuse d'entendre les petites Mauresques chanter des rondes nouvelles en sautant à la corde.
« Ah ! mon Dieu ! quelle triste année !
Tout le monde mobilisé,
Y a des morts et des blessés,
Il y a même des prisonniers. »
Mais il faut bientôt songer au retour, reprendre le bateau, s'arracher aux bras de Paris comme à ceux d'une maîtresse trop soumise et retrouver les compagnons qui attendent dans le gourbi et la tranchée.
Pendant son absence, le cours de la rivière qui passait là a été modifié. Un petit village a été déplacé. Il ne s'y reconnaît plus. Le fleuve que verront désormais les observateurs ennemis est en toile peinte, de même que le village est une sorte de décor en planches.
Alors il pense avec mélancolie à ceux dont il se demande s'il les reverra, « car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité ».
Les heures d'attente imbécile reprennent paisiblement leurs cours, le poète reprend ses habitudes déjà anciennes et se murmure :
« Ah Dieu, que la guerre est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Cette bague que j'ai polie
Le vent se mêle à vos soupirs. »
A Léo Larguier qu'il a connu un dimanche de mars 1915 alors qu'il déjeunait à Nîmes au petit restaurant de la Grille et qui ressemblait, dit-il, à un Victor-Hugo sans barbe et plus encore à un Balzac, il écrit
« Je suis gai, pas malade
Et comme fut Ronsard, le chef d'une brigade
Agent de liaison, je suis bien aguerri
J'ai l'air mâle et fier, j'ai même un peu maigri. »
Gai ! c'est bien vrai qu'il l'est toujours le joyeux frère en ironie de Max Jacob.
Un bon mot, une bonne histoire, il n'en faut pas davantage pour dérider cette âme simple, car on est devenu très simple depuis la guerre.
« Celui qui n'a pas vécu en hiver dans une tranchée où ça barde, ne sait pas combien la vie peut être une chose simple ».
« Celui qui n'a pas vu des musettes suspendues à un pied de cadavre pourrissant sur le parapet de la tranchée ne sait pas combien la mort est une chose simple ».
Partout c'est l'épouvantable aspect des ondulations de terrain zébrées de boyaux, l'enfer des grands entonnoirs crayeux qui furent le théâtre d'effrayants corps à corps, partout ce sont les croix, croix françaises, croix ennemies et la grande nuit qui recouvre tout.
« Le berger qui mènera plus tard paître ses moutons sur ces crêtes qui furent les volcans de cette grande guerre se baissera parfois pour ramasser quelques débris d'obus ou quelques fragments de cuir et regardera curieusement ces débris informes de notre époque ».
Il y a aussi, « dressé comme un lys », le buste de son amour, de cette Madeleine dont les yeux sont comme des sources fraîches et les seins deux colombes prêtes à s'envoler.
Dans la neige et le sang, dans la boue, c'est à elle qu'il songe toujours, sans tristesse, comme à une terre depuis longtemps promise. L'amour lui fait supporter les pires des privations, les jours sans pain, sans lettres amies, les nuits d'attaque traversées d' « obus couleur de lune ». Tout est prétexte à se souvenir des anciennes étreintes dans ce corps à corps effrayant et aveugle avec la mort. Le poète dira : « l'amour a remué ma vie comme on remue la terre dans la zone des armées ».
Mais est-ce bien Madeleine qui lui commande de se livrer avec une si totale soumission, d'aller au-devant du danger avec cette désinvolture qui n'appartient qu'aux gentilshommes et aux héros ? A cet écrivain mobilisé dans un bureau de l'armée, qui refusait de faire des écritures sous prétexte qu'il ne voulait pas donner à l'armée des autographes qu'on aurait pu vendre plus tard, Apollinaire donne une réponse de pleine poitrine. Il est celui qui est offert.
Combien de fois pour faire plaisir aux camarades est-il allé par ces matins d'avril bourgeonnant de rosée à la cueillette des escargots entre les lignes !
Certes, ce n'est pas la France qui lui commande de s'exposer bêtement à la fantaisie meurtrière de l'ennemi, mais plutôt son humeur buissonnière, vagabonde et ce goût de l'aventure poussé à l'extrême, peut-être le souci qu'il a toujours eu d'étonner.
Comme ce héros de Remarque, il se ferait ter pour avoir voulu rapporter un papillon à Madeleine.
Malgré l'amour, malgré la guerre, malgré le froid et dans des conditions de confort que seuls connaissent ceux qui ont dormi sur la couche limoneuse des tranchées, Apollinaire à la lueur d'une pâle flamme qui sent le bœuf rance et l’ennui, continue ses chroniques du Mercure de France.
« Il faut, dit-il, que la guerre aboutisse non seulement au triomphe d'une idée ou d'un Système qui est celui du droit et de la justice, mais qu'elle aille jusqu'au triomphe des revendications qui existaient avant cette lutte gigantesque et, celles qui sont nées tandis qu'elle se déroule ».
Ces revendications ne sont pas dans son esprit, uniquement politiques, mais se posent également pour les problèmes de l'art, et il faut voir avec quelle belle encre il prend la défense de ses amis, c'est-à-dire la défense de la poésie et de la peinture.
Lui-même dans son abri-caverne a repris, le plus souvent sous forme de Calligrammes, ses patientes recherches.
« Ecris un mot si tu l'oses,
Les points d'impacts dans mon âme toujours en guerre. »
Et la guerre continue.
Apollinaire est un peu jaloux de la vie du fantassin. Le tac tac de la mitrailleuse rythmerait mieux son cœur et le temps. Dans cette attente de la mort il se fait un peu l'effet d'un embusqué, il rougit lorsque la France lui parle. Alors son parti est pris. Il demande à permuter dans l'infanterie. Cette joie lui est enfin donnée.
Courte joie ! Le 17 mars 1916 alors qu'il lit dans la tranchée un numéro du Mercure de France que le vaguemestre vient de lui apporter, un éclat d'obus de gros calibre le frappe à la tête d'où il sort « comme un sang pur une Minerve triomphale ».
« Une belle Minerve est l'enfant de ma tête
Une étoile de sang me couronne à jamais
La raison est au fond et le ciel est au faîte
Du chef où dès longtemps Déesse tu t'armais. »
Le blessé est aussitôt dirigé sur le Val de Grâce où il est trépané.
« Instamment, jour par jour, avec sang-froid, rapporte André Rouveyre, il informe Madeleine. II l'apaise, la rassure. »
Mais bientôt la menace de paralysie partielle nécessite une nouvelle opération. Il est évacué sur Paris et trépané à nouveau à la villa Molière.
Dans son délire, il revoit « la splendeur des obus éclatés, le regard éveillé des guetteurs épuisés de fatigue ; l'infirmier donnant à boire au blessé ; le maréchal-des-logis attendant avec impatience la lettre de son amie ; le chef de section prenant le quart dans la nuit couverte de neige ».
Enfin le poète ressuscité, la tête encore bandée, peut faire quelques pas dans le jardin au bras de ses amis.
Il se renseigne sur les absents qui combattent toujours à l'Est et sur ceux qui combattent « aux frontières de l'illimité et de l'avenir » : les poètes.
Il n'a pas perdu sa verdeur d'esprit et la blague vient encore comme une fleur à ses lèvres. Toutefois, il se montre plus impatient, impressionnable, irascible et la mémoire qu'il avait prodigieuse commence à le quitter. Madeleine qu'il a tant aimée se confond déjà avec cette blessure qui se referme.
Il a beau dire qu'il faut se souvenir de cette guerre invétérée, qu'il n'y a pas moyen de s'en défendre, que chaque fois qu'il croit avoir échappé à cette hantise elle le reprend avec une douceur toujours croissante, on sent bien que quelque chose de terrible s'est abattu sur lui et l'a marqué à jamais.
A l'hôpital, où il reste encore quelque temps, Picasso vient lui rendre visite ; il apporte ses crayons, ses pastels et trace de sa « tête étoilée » un portrait remarquable. Cela donne au poète le désir de s'aventurer dans le dessin, de rechercher par le graphique la forme mystérieuse de son devenir. Aux conseils de l'ami vient se joindre sa haute conception de l'art et c'est un nouveau témoignage de beauté et de probité qu'il nous laisse.
Enfin les portes s'ouvrent sur cet oiseau sans ailes. Comme un aveugle, il tâte de sa canne les pavés. II s'attend à les voir s'enfoncer sous ses pas comme la boue des tranchées. Ecœuré par toutes les figures jeunes qu'il rencontre, il songe déjà à remonter au front.
C'est l'époque où il entreprend d'achever son drame surréaliste commencé en 1903. Et puisqu' « ils ont même assassiné les constellations, il est grand temps de rallumer les étoiles ».
La rédaction de la préface et du prologue des Mamelles de Thirésias l'occupe donc un moment. Il tient à faire savoir par cette préface l'idée originale qu'il se fait de l'art théâtral et pour tenter sinon une rénovation, du moins un effort personnel, il a pensé qu'il fallait « revenir à la nature même, mais sans l'imiter à la manière des philosophes ».
Sa pièce une fois jouée, il s'en désintéresse. Mais comme toute inactivité lui pèse, il se décide à rechercher sur ses carnets de route, dans les feuillets épars, les poèmes susceptibles d'être publiés. Il envisage déjà de réunir sous le titre de Calligrammes ceux de Case d'Armons, les vers plus anciens d'Ondes et d'Etendards, Lueurs des tirs, Obus couleur de lune et les pages encore rouges du sang de sa Tête étoilée.
Au milieu de ce travail une nouvelle lui apprend qu'il n'est pas encore réformé et qu'il doit se mettre à nouveau à la disposition des autorités militaires.
Affecté d'abord à la Maison de la Presse, puis à la Censure, il est définitivement installé au Ministère des Colonies. Comme ses activités n'y sont pas débordantes, il entre en même temps à Paris-Midi où il doit traduire les journaux anglais. Le goût de la mystification semble lui revenir. Souvent il s'amuse à inventer de toutes pièces des communiqués qu'il date le plus sérieusement du monde de la capitale des brumes, ce qui fait dire à André Billy qu' « il n'y a pas de meilleure façon d'influencer les événements ».
Alors une dernière fois l'amour ouvre ses ailes. Il y a Jacqueline cette « adorable rousse » qu'il a connu à la clinique Molière, alors qu'elle y tenait l'emploi d'infirmière et qu'il épouse le 2 mai 1918.
« Ne sors plus de chez moi diamant qui parlais
Dors doucement tu es chez toi tout t'appartient
Mon lit ma lampe et mon casque troué. »
Oui ! Tout lui appartient, sauf peut-être la vie du poète qu'il sent lui-même glisser entre ses doigts. Sa nature de blond géant du Nord a supporté difficilement les opérations successives et tout le sang perdu ne se renouvelle pas assez vite pour défendre son corps contre les attaques de la grippe espagnole.
Au début de novembre il est obligé de s'aliter. Huit jours de lente agonie au cours desquels Jacqueline essaie vainement de le disputer à la mort ; et celui qui n'est plus depuis mars 1916 que le poète ressuscité, le 9 novembre, vers 6 heures du soir s'en va doucement dans la nuit.
« J'ai vu et veillé avec sa jeune femme Jacqueline, quelques amis, raconte Jacques Dyssord, le poète d'Alcools sur son lit de mort en son pigeonnier du boulevard Saint-Germain. Il tenait un crucifix dans ses mains et une peinture galante était accrochée au chevet de son lit. Il ne paraissait pas reposer, mais guetter plutôt. Il était sur ses gardes. Ce grand secret, il allait le connaître, lui qui, pour se divertir, eût recréé le monde ».
Le 11 novembre 1918, tandis que la France tout entière pavoise, comme elle pavoisait déjà le 13 juillet 1909 pour le mariage d'André Salmon, tandis que les cloches sonnent à la volée et qu'au bord du jet d'eau, la colombe poignardée sent rebattre son cœur, Guillaume Apollinaire prend rendez-vous avec la gloire.
Ceux qui l'ont conduit au Père Lachaise savent bien que ce jour-là ce n'est pas seulement le poète Apollinaire qu'on enterre, mais toute une jeunesse. Au passage du convoi, la foule qui célèbre l'armistice aux cris de « A bas Guillaume ! » a l'air de blasphémer.
Blasphèment certainement ceux qui trouvent qu'Apollinaire est mort à temps, que ce poète d'exception muré à trente-huit ans eût été incapable de se renouveler davantage. Max Jacob leur répond en parlant gravement du Siècle d'Apollinaire.
Chapitre 2 - Du classicisme au cubisme, ou le Flâneur des deux rives
Je ne sais pas si je l'ai dit au début de cet ouvrage, mais il faut avoir vingt ans pour parler d'Apollinaire. Passé cet âge on ne peut plus guère que l'aimer sans rien en dire, ou bien discuter son œuvre, ce qui est encore une façon de rien dire. Croyez-moi, la critique ne fait rien à l'amour. On ne fera jamais aimer une femme, on ne l'avilira jamais complètement en la déshabillant ou en la couvrant de toutes ses caresses, de toute sa haine. Une œuvre ne se jauge pas, ne se pèse pas, ne s'immatricule pas. La poésie en particulier ne passera jamais par les conseils de révision. Aussi je m'excuse de toutes mes maladresses, celles que j'ai pu faire en essayant de vous donner un visage parleur d'Apollinaire, en le tuant au milieu de ses amis dont il aimait la parole et le rire, parmi ces femmes tant de fois évoquées et jusque dans cette tranchée ou l'étoile le marqua de son rouge poinçon. Maintenant il s'agit de l'œuvre de cette arche frissonnante de lumière, et si j'éveille sa faune, c’est encore à l'homme qu'il faut rendre des comptes. Il me semble que j'ai connu Apollinaire, que nous nous sommes déjà rencontrés, peut-être dans un « caveau maudit », peut-être au bord de la Seine, certainement pas sur ces tréteaux qui sentent la brocante et l'exercice forain où parade une partie des poètes d'aujourd'hui. Quand j'ouvre Alcools ou Calligrammes, ou même Le Poète assassiné, c'est comme si Guillaume et moi nous descendions au jardin, sous une tonnelle pleine de bocks et de pipes fraîches, parler d'un ami, d'une heure perdue, d'une fumée et de tout ce qui fait la présence. |
Jaquette de l'édition Rougerie de 1981
|
Je lis Apollinaire, comme le veut pour lui-même Max Jacob dans la préface de son Cornet à dés, non pas longtemps, mais souvent. Je l'appréhende au moment où il s'y attend le moins et son vers se prolonge de longues heures en moi.
Il y a des rues interdites où il est impossible de ne pas pénétrer, des chambres d'hôtels pleines de crimes, pleines de fleurs qui chantent et de belles jeunes filles prisonnières des rameaux, des colombes, des balles dont on entend le fredon sous les treilles dans une petit village de l'arrière. C'est à tout cela que je pense en lisant Apollinaire. Je pense à bien d'autres choses encore, à l'étonnement des générations futures devant cette somme de beautés, devant cette haute stature dont on ne peut dire si elle est celle d'un dieu, d'un héros ou d'un homme.
Les premiers poèmes qu'on possède d'Apollinaire datent de 1895, de cet âge mouvant et émouvant où le corps commence à supporter tout le poids de ses liens terrestres, où les mains élèvent jalousement pour un cœur leur bûcher.
A vingt ans, Apollinaire ne diffère pas des adolescents dont la puberté s'est formée au hasard des livres ; sentimental, mais déjà avec cette réserve mélancolique qui n'appartient qu'à lui !
« Chaque fleur qui se fane
C'est un amour qui meurt. »
J'aurais aimé connaître cette charmante Linda, princesse changée en trésor qui ne retrouvera sa forme humaine qu'au jour où un poète faisant fi de cet or la sauvera.
Dans une carte postale adressée le 24 juin 1901, son jeune ami a trouvé pour elle les premiers accents de La chanson du mal aimé.
« Moi qui sais des lais pour les reines
Et des chansons pour les sirènes. »
Quelques jours après, il lui écrit
« Lorsque grâce au printemps vous ne serez plus belle
Vieillotte, grasse ou maigre avec des yeux méchants
Mère Gigogne grave en qui rien ne rappelle
La fille aux traits d'Infante immortelle en mes chants. »
Et pour en finir avec cette liaison uniquement spirituelle sans doute
« Tous les dons sont impurs et les royaux sont tristes
Et l'amour est maudit pour ce qu'il peut donner
Il n'y a pas encore de cadeaux anarchistes. »
Non pas encore ! Ceux-là viendront plus tard, au temps de la « Raison ardente » ; pour le moment Apollinaire se contente de recueillir et d'adapter aux nécessités quotidiennes l'héritage encombrant du passé.
Ses vers de la vingt-et-unième année sont significatifs. Comment ne pas reconnaître dans ses Dicts d'amour à Linda la voix nostalgique et prenante du malheureux Villon, le désenchantement de Ronsard et de tous les romantiques et déjà la joaillerie triste du professeur Mallarmé.
S'il en est qui croient encore à la réincarnation des âmes, il faut dire que celle de Villon s'est retrouvée en Apollinaire, mais singulièrement décantée, lavée de ses sanies, de ses turpitudes et comme agrandie par une douleur plus vaste.
Je m'imagine le jeune Kostrowitski dans la petite chambre du chapelain de Saint-Benoist le Bétourné, transformée en cellule au collège de Monaco et lisant par-dessus l'épaule du jeune François
« Hé Dieu ! si j'eusse estudié
Au temps de ma jeunesse folle,
Et à bonne mœurs dédié,
J'eusse maison et couche molle. »
Déjà chantent dans sa tête ces vers de Vitam impendere amori :
« O ma jeunesse abandonnée
Comme une guirlande fanée
Voici que s'en vient la saison
Des regrets et de la raison. »
Jehan Le Loup, Régnier de Montigny, Salmon, Billy, La Pomme de Pin, le Soleil d'Or, tous ces noms se rejoignent à travers les siècles. L'ombre du maigre escholier a bien un peu engraissé, mais c'est toujours une ombre dans les ruelles sans joie de Paris, à la recherche de sa lumière.
Villon demandait :
« La royne Blanche comme lis
Qui chantait à voix de seraine,
Berte au grant pie, Bietris, Allis
Haremburgis qui tint le Maine
Et Jehanne, la bonne Lorraine
Qu'Englois brûlèrent à Rouan
Où sont ilz, où, Vierge souveraine ?
Mais où sont les neiges d'antan. »
Près de quatre siècles et demi plus tard, alors a tout abandonné, pour la plus illusoire des aventures, Guillaume Apollinaire s'écrit à son tour :
« Douces figures poignardées
Chères lèvres fleuries Mia Mareye Yette Lorie
Annie et toi Marie
Où êtes-vous ô jeunes filles
Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie
Cette colombe s'extasie. »
Il n'est pas douteux qu'il y ait là, sinon une réincarnation, du moins une rencontre de deux âmes éprises de la même beauté neigeuse, du même amour vagabond.
Rechercher dans l'œuvre d'Apollinaire l'influence de Villon ferait la joie d'un critique besogneux. Vous le verriez battre les mains à tel passage de La Chanson du mal aimé, ou se frapper le front en lisant
« Soldats passés où sont les guerres
Où sont les guerres d'autrefois. »
Mais c'est méconnaître l'esprit apollinarien que de le croire incapable, même dans ses écrits de jeunesse, de dépasser singulièrement le cercle des influences.
A vingt-deux ans, il a déjà conscience de son devenir poétique et quand il parle de son œuvre future, il dit .
« Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même
Je te crée à jamais pour qu'après mon départ
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard. »
Alors à quoi bon lui reprocher d'avoir aux premiers jours demandé à l'amant d'Hélène des recettes contre la douleur, et si dans l'Épithalame il débute une invitation à l'amour par « ô enfant, ô sueur », pourquoi lui appliquer aussitôt le masque de Baudelaire sur le visage.
Certes, Apollinaire n'a pas traversé les livres, malfaisants comme les buissons, sans en rapporter quelques égratignures. Le sang noir des romantiques éclairci par les symbolistes a servi pendant un certain temps de fond de teint à ses tableaux.
Mais ne perdons pas de vue l'esprit mystificateur du poète et contentons-nous de sourire quand il écrit
« Mes rêveuses pensées pieds nus vont en soirée. »
A la même époque Saint-Matorel ne s'inquiète-t-il pas du « cortège brillant de (ses) défunts écrits ».
Plus importante que ces influences passagères, - je parle ici de celles de Hugo, de Rimbaud, de Mallarmé et même de Corbière et de Laforgue - et puisqu'il faut avec le parrain Villon trouver une marraine à Guillaume, adressons-nous au cher Verlaine, il en sera content.
Lorsqu'en septembre 1911, Apollinaire est inculpé dans l'affaire de la Joconde et incarcéré à la Santé, le souvenir du pauvre Lélian à Mons le poursuit tristement et tandis qu'il regarde par-dessus le toit le ciel « si bleu, si calme » il se prend à murmurer
« J'écoute les bruits de la ville
Et prisonnier sans horizon
Je ne vois rien qu'un ciel hostile
Et les murs nus de ma prison. »
ou bien c'est au Crépuscule,
« dans un grand arc solitaire et glacé », les masques chers à Verlaine
« Sur les tréteaux l'arlequin blême
Salue d'abord les spectateurs
Des sorciers venus de Bohême
Quelques fées et les enchanteurs. »
Automne malade venu après l'admirable poème de Laforgue s'achève sur la musique des « sanglots longs des violons ».
« Les feuilles
Qu'on foule
Un train
Qui roule
La vie S'écoule. »
Mais c'est bien plus une nécessité physique de chanter qu'un emprunt malhonnête et ce serait mal d'en vouloir à Apollinaire d'avoir eu pour l'automne des sanglots dans la voix.
Dans son œuvre en prose, Apollinaire s'est sans aucun doute souvenu des leçons d'Edgar Poe et des romantiques allemands. Nous verrons comment des nouvelles telles que Le Matelot d'Amsterdam et surtout Que-vlo-ve ? se situent dans ce climat de la rue Morgue si magistralement évoqué par l'auteur des Histoires extraordinaires.
Les faits divers, les publications dans le genre de Nick Carter, ne sont pas sans retenir l'attention du poète et il s'en souviendra : jusqu'à l'étrange aventure de Paul-Louis Courier survenue une nuit en Calabre qui lui donnera la trame de son conte de l'Hérésiarque, la lèpre ou comment le baron d'Ormesan craignit de contracter cette terrible maladie en apprenant l'italien (lèpre dans le langage des Toscans signifie en effet lièvre).
Sur un plan qui embrasse à la fois la vie, l'œuvre poétique, le roman et la nouvelle, Apollinaire devient le successeur de Rabelais et de l'illustre Jarry. Est-ce l'Ermite qui parle ici ou l'heureux bénéficiaire de la cure de Meudon,
« Seigneur que t'ai-je fait
Vois je suis unicorne
Pourtant malgré son bel effroi concupiscent
Comme un poupon chéri mon sexe est innocent
D'être anxieux seul et debout comme une borne. »
A côté de ces influences tremblotantes comme des feux follets, il y a la grande influence d'Apollinaire lui-même, cette self-influence toujours dirigée vers une plus haute lumière.
Né à Rome, à lui seul Rémus et Romulus, une louve aux innombrables mamelles l'a nourri. Aux pays froids qui dérivent dans sa mémoire sont venus s'ajouter les décors de pierres brûlantes et de marbres d'une civilisation gréco-latine révélée, par un Dieu « circulaire et bon ».
Rien d'étonnant alors qu'Apollinaire ait eu, pour ainsi dire à son insu, le goût de l'angle droit, de l'ordre artistique, de la verticale. On peut même dire que rien ne fut davantage ordonné que son désordre apparent. Et c'est en cela qu'il rejoint les grands classiques.
Certains esprits, aussi prompts que définitifs dans leurs jugements, ont voulu voir entre les poèmes d'Alcools et ceux de Calligrammes une cassure très nette, comme si la guerre avait creusé sa tranchée dans l'œuvre même du poète. Il n'est pas douteux, en effet, que la grande aventure ait apporté au poète une connaissance nouvelle des hommes et des choses, une géométrie plus immédiatement nécessaire. Mais si l'on gratte tant soit peu le vernis des mots nouveaux, il n'est pas difficile de retrouver la profonde et grave résonance des premiers âges.
« En rentrant à Auteuil j'entends une voix
Qui chantait gravement se taisant quelquefois
Pour que parvint aussi sur les bords de la Seine
La plainte d'autres voix limpides et lointaines. »
Sur les ailes de son lyrisme Apollinaire traverse les siècles à la rencontre de son image, de son amour. La trouvera-t-il jamais cette image torturée par les démons de la nuit, par les hautes flammes du sang qui la brûlent sans cesse? Comme Villon, comme Lamartine, comme les grands, le temps qui fuit le désespère :
« Tandis que nous n'y sommes pas
Que de filles deviennent belles
Voici l'hiver et pas à pas
Leur beauté s'éloignera d'elles. »
S'il était seulement sûr de trouver Dieu, les dieux, de pénétrer les secrets de cette Nature que Vigny connaît « trop bien pour n'en pas avoir peur ». Hélas !
« Beaucoup de ces Dieux ont péri
C'est sur eux que pleurent les saules
Le grand Pan l'amour Jésus-Christ
Sont bien morts et les chats miaulent
Dans la cour je pleure à Paris. »
Celui qui est resté toujours jeune, jeune comme le vent de mer, ne peut se résoudre à vieillir et il a beau demander à Marie : « Quand donc finira la semaine ? » il serre plus fort les poings comme s'il voulait retenir les liens des jours qui se défont.
« Où sont ces têtes que j'avais
Où est le Dieu de ma jeunesse
L'amour est devenu mauvais
Qu'au brasier les flammes renaissent
Mon âme au soleil se dévêt. »
Je pense en transcrivant ces vers aux honnêtes gens qui se complaisent à voir dans Apollinaire un solide garçon, jouisseur incapable de se prendre au sérieux, même dans la douleur. Villon qui riait en pleurs apercevait lui aussi à travers ses larmes la croix tragique de la potence et les « cadavres de (ses) jours ».
Croyez-vous que ce soit avec un prétentieux souci d'étonner et la désinvolture d'une âme légère qu'on écrit
« Tu es à Paris chez le juge d'instruction
Comme un criminel on te met en état d'arrestation
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages
Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge
Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans
J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps
Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter
Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté. »
Qui de nous serait capable d'une si émouvante confession publique, si dénuée de littérature, d'emphase et de « donner à voir ». Il y a des mots destinés aussi bien aux hommes qu'à Dieu et qui bouleversent le cœur comme une page de la vie des Saints.
« Jeunesse, adieu jasmin du temps. »
Quand il tente d'échapper à cette hantise, Apollinaire, semblable en cela à tous les grands poètes, se réfugie chez Dieu.
Déjà dans la chapelle du collège de Monaco il venait demander au Seigneur cet amour dont sa mère n'avait pas su assez chaudement l'entourer. Le Christ ?
« C'est le beau lys que tous nous cultivons
C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent
C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières
C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité
C'est l'étoile à six branches
C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. »
Dans les contes de l'Hérésiarque on peut voir à quel point Apollinaire a l'esprit occupé de la présence de Dieu.
« Ils étaient trois hommes
Sur le Golgotha
De même qu'au ciel
Ils sont en Trinité. »
D'après lui la Trinité se fit homme et il y eût trois incarnations. Le Christ qui mourut entre les larrons était le Verbe et, l'étant, fut le législateur, le larron de gauche était le Saint-Esprit, autrement dit l'éternel amour, celui de droite était tout simplement Dieu le père.
Quand il songe à un secours possible, c'est toujours à Dieu qu'il s'adresse parce que
« La religion est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port Aviation. »
Devant la douleur il est comme ces femmes « qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico ».
Parfois, surtout pendant ces heures de guet aux créneaux des tranchées alors que :
« Dans le ciel à peine bleuté
Une canonnade éclatante
Se fane avant d'avoir été »
Le poète commence à douter de l'infinie miséricorde de Dieu et s'écrie
« Le Christ n'est donc venu qu'en vain parmi les hommes
Si des fleuves de sang limitent les royaumes... »
C'est un mince filet de sang qui en mars 1916 limitera son amour pour la France, pour cette France qu'il n'a cessé de chérir et de servir et dont Paris tout entier personnifie la grâce un peu féminine.
« Les raisins de nos vignes on les a vendangés
Et ces grappes de morts dont les grains allongés
Ont la saveur du sang de la terre et du sel
Les voici pour ta soif ô Paris
Chénier, Hugo, Péguy, Apollinaire !
O France
Nous nous pâmons de volupté
A ton cou penché vers l'Est. »
Reprenant les thèmes éternels, mais les recréant à son usage, Guillaume Apollinaire va faire de l'amour la trame légère de toute sa poésie. Jeunesse, religion, patrie, forces obscures, tout lui sera prétexte à amour et surtout la femme dont il sait qu'il est l'amant depuis toujours.
Certes, l'amie aux multiples visages est bien différente de la douce Cassandre, de la délicate Elvire, de l'idole charnelle de Baudelaire, mais c'est toujours l'aimée, l'unique, la « sœur-épouse », celle qui transfigure chaque minute du quotidien.
« Ses regards laissaient une traîne
D'étoiles dans les soirs tremblants
Dans ses yeux nageaient les sirènes
Et nos baisers mordus sanglants
Faisaient pleurer nos fées marraines »
Avec les mots de tous les jours, les sentiments de tous les hommes, Apollinaire opère à la façon d'un magicien dans la Brocéliande littéraire. Penché sur le Pont Mirabeau, le cœur éclaboussé par ses passions violentes, il regarde l'eau qui coule et emporte vers la mer celles qui ne sont plus qu'un trop beau souvenir.
« L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'espérance est violente. »
C'est en particulier à son amour pour Marie Laurencin, « le vrai degré d'Alcools » a dit André Rouveyre, un amour dégagé de tous les tourments charnels et douloureux en son essence, qu'il doit d'être arrivé à cette pureté poétique, à cette transparence de source qui donne à ses poèmes l'éclat des chefs-d’œuvre. Parce qu'il a écrit
« J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t ‘en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends. »
André Gide a pu parler des « miracles ingénus d'Apollinaire ».
Le poète d'Alcools retrouve dans sa mémoire le premier vers d'une chanson, une bribe de complainte qui persévère, la note grave d'un chant liturgique, c'est assez pour le transfigurer, pour le bouleverser à tel point qu'il n'aura de tranquillité d'esprit avant d'avoir accompli sa fonction de poète.
Dans les quatrains du Bestiaire ou cortège d'Orphée et certains poèmes oubliés, Apollinaire s'en tient encore à l'évocation simple, à une poésie descriptive, pleine de fantaisie qui séduit bien davantage qu'elle n'émeut :
« Je soupe d'un peu de foie gras
De chevreuil tendre à la compote
De tartes flans etc.
Un peu de kirsch me ravigote. »
Parfois, cette poésie charmante atteint facilement au sublime, j'entends le sublime des choses simples comme la mort par exemple :
« Jeanne Houhou la très gentille
Est morte entre des draps très blancs
Pas seule Bébert dit l'anguille
Narcisse et Hubert le Merlan
Près d'elle faisaient leur manille. »
Voilà qui séduira très vite des poètes tels que Toulet, Carco, Pellerin Derème, et qui fera aussitôt école tant en poésie que dans le roman.
Il est à remarquer dans ces premiers poèmes que si Apollinaire conserve encore la rime où tout au moins l'assonance, il a banni à tout jamais la ponctuation. Il s'est d'ailleurs expliqué là-dessus dans une lettre à Henri Martineau en date du 19 juillet 1913 : « Pour ce qui concerne la ponctuation, je ne l'ai supprimée que parce qu'elle m'a paru inutile et elle l'est en effet, le rythme même et la coupe des vers, voilà la véritable ponctuation et il n'en est pas besoin d'une autre ».
Si par cette fantaisie de circonstance, Apollinaire rejoint la lignée des poètes badins, de Marot à Voiture et même dans certains quatrains le Mallarmé des Petits Airs, c'est qu'il n'a pas trouvé cette vigueur hauturière qui le lancera tout seul vers le grand large. Il se livre encore à des évocations romantiques dans le style de Heine et de Hugo
« A Bacharach il y avait une sorcière blonde
Qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde »
ou bien, et le jeu est plus dangereux, à des compositions symbolistes qui ne font rien pour sa gloire.
« Les veuves précédaient en égrenant des grappes
Les évêques noirs révérant sans le savoir
Au triangle isocèle ouvert au mors des chappes
Pallas et chantaient l'hymne à la belle mais noire »
Mais déjà le vrai visage d'Apollinaire apparaît sous le masque. Un rire heureux comme une sonnaille fait craquer le plâtre du poème et juste au moment où on s'apprêtait à s'émouvoir devant une « bouche aux agapes d'agneau blanc », on en est empêché par la rapidité de l'action.
« Sur les genoux pointus du monarque adultère
Sur le Mai de son âge et sur son trente et un
Madame Rosemonde roule avec mystère
Ses petits yeux tout ronds pareils à ceux des Huns. »
L'ironie, le calembour même, sauvent ainsi plusieurs poèmes d'Apollinaire. Mais c'est surtout la musique, une musique qui se situe entre Mozart et Debussy, qui achève de donner à cette poésie une grâce, un maintien inimitables qui n'appartiennent qu'aux charmeurs.
Il faut avoir entendu les cors d'automne chers à Laforgue, la vêpre blonde des guêpes sous la treille et le refrain des mers tranquilles pour saisir toutes ces « correspondances » qui traversent le poème.
« Et Thomas de Quincey buvant
L'opium poison doux et chaste
A sa pauvre Anne allait rêvant
Passons passons puisque tout passe
Je me retournerai souvent. »
L'alexandrin, et surtout l'octosyllabe, sont restés longtemps pour Apollinaire le moule idéal de toute poésie.
Quand il abandonne ces rythmes qui sont comme la respiration de l'homme, c'est pour employer une phrase assez courte qui tient du vers et du verset et suit bien davantage la marche que la parole. On sait d'ailleurs qu'Apollinaire improvisait la plupart de ses poèmes en marchant.
Mais bientôt celui qui fut l'héritier de ces « Mille peuplades blanches dont chaque homme tenait une rose à la main » va pouvoir écrire :
« Pardonnez-moi mon ignorance
Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers
Je ne sais plus rien et j'aime uniquement. »
Il faut bien lâcher le mot, Apollinaire se désintéresse du passé.
« A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. »
Le rêve fait place à l'action, le souvenir à l'avenir. La poésie de Virgile, de Shakespeare, de Hugo n'est plus rien en regard des promesses de l'affiche, du prospectus et des « livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières ».
Apollinaire va se saisir de l'immédiat et comme il le déclarera lui-même dans Esprit nouveau, un manifeste futuriste publié dans le Mercure du 1er décembre 1918, son but sera « d'exalter la vie sous quelque forme qu'elle se présente »
Une hâte le prend de tout aimer, d'épuiser les richesses qui tremblent sous sa main, de deviner dans le germe la future moisson. S'il songe par exemple que bientôt les chemins de fer seront démodés et abandonnés, c'est pour jouir secrètement du présent et de l'idée qu'il se fait de l'avenir.
Sa possession ne sera pas l'affaire d'un moment, mais de longues journées :
« La victoire avant tout sera
De bien voir au loin »
De tout voir
De près
Et que tout ait un nom nouveau. »
Ce sera justement le mérite d'Apollinaire d'avoir su donner à chaque chose un nom nouveau, de là une émotion nouvelle. Aventurier dans le sens noble du mot, il a pour effectuer ses longs cours, non point falsifié les passeports, mais déplacé les courants qui soulèvent le monde. II s'est construit une géographie personnelle où certains continents ont été appelés à disparaître pour laisser à d'autres une place plus grande, une lumière plus rayonnante.
« Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde
Où est le Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli d'un continent Perdre
Mais perdre vraiment
Pour laisser place à la trouvaille. »
Ce qui peut être considéré véritablement comme une trouvaille, c'est ce qu'Apollinaire lui-même appelle poèmes-conversations ou poèmes-promenades. Cette dissociation de la matière poétique, cet éparpillement d'images lumineuses pour un mystérieux regroupement constitue à proprement parler un attentat aux mœurs artistiques régnantes.
Champion de la plus grande liberté, il en profite pour se dépayser en dépaysant le monde ambiant.
« Je voyais une chasse tandis que je montais
Et l'ascenseur s'arrêtant à chaque étage
Entre les pierres
Entre les vêtements multicolores de la vitrine
Entre les charbons ardents du marchand de marrons
Entre deux vaisseaux norvégiens amarrés à Rouen
Il y a ton image. »
Le lecteur qui n'est pas averti, une fois l'effet de surprise dissipé, songe à la mystification. N'empêche que restera longtemps dans sa mémoire l'image de cette femme qui se balance comme une brume légère entre deux navires à l'ancre.
Car Apollinaire a le pouvoir de recréer l'émotion par une orientation inattendue du mot, par une jeunesse nouvelle de l'ordre, parce que je serais tenté d'appeler l'angoisse cubiste.
Celui que j'ai nommé Le Flâneur des deux rives, non pour rendre hommage à un livre sans grands trésors, mais pour cerner une âme en quête perpétuelle de son destin, trouve dans ses promenades à Paris, dans ses conversations d'entresols et de bistrots les possibilités de reconstruire un monde à la mesure de l'humain.
Lundi rue Christine, qui selon André Billy n'est fait que de bouts de phrases proférées un soir dans une petite brasserie de la rue Christine, va loin dans la voie des confidences. Il ne peut être évidemment question de réussite poétique en soi, mais je crois qu'on peut découvrir là un des aspects de la beauté apollinarienne, de cette beauté qui se propage depuis trente ans déjà.
Comment ne pas admettre que deux vers comme ceux-ci :
« La fontaine coule
Robe noire comme ses ongles »
atteignent sans peine à la grandeur. Demandez donc à Eluard s'il n'a pas ressenti toute la beauté tragique de cette image.
Certes, il entre une bonne part de mystification dans ces poèmes. On ne sait par exemple si ce « pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche » pour cacher son émotion, son rire ou un rhume de cerveau.
C'est une mystification qui laisse un sentiment de malaise, car Apollinaire a poussé si loin la recherche du fruit défendu, de ce « beau fruit de la lumière », que lorsque « la fenêtre s'ouvre comme une orange » on se demande s'il n'en est pas le premier surpris.
« Tu te moques de toi et comme le feu de l'Enfer ton rire pétille
Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie
C'est un tableau pendu dans un sombre musée
Et quelquefois tu vas le regarder de près. »
Il ne s'intéresse plus à la vie que parce qu'elle peut avoir d'accidentel, de dangereux et surtout d'évocatoire.
« Il y a un poème à faire sur l'oiseau qui n'a qu'une aile ». On conçoit tout de suite l'arbitraire d'un tel souci et quel déchirement ce doit être pour le poète d'abandonner les anciennes beautés parce que désormais stériles.
Malgré son audace, son désir de mettre tous les atouts dans son jeu, il n'échappe pas à la malignité des mots. Il se heurte à leur cuirasse épineuse et ne donne bien souvent de sa vision qu'une image déformée qui provoque les rires du public.
« Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières
De l'illimité et de l'avenir
Pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés. »
dira-t-il dans cet admirable poème de La jolie rousse.
Mais Apollinaire va porter encore plus loin son feu vendangeur. Après avoir révolutionné le mot, le vers, le rythme, il va s'en prendre à la typographie et faire du poème une image parlante, un calligramme. Mallarmé semble avoir eu des soucis du même genre, encore que l'image ne l'intéresse guère, en composant (c'est le mot) son Coup de Dés.
Je voudrais pouvoir représenter ici cette architecture qui est la plupart du temps (je ne parle pas de La Colombe poignardée et le jet d'eau, qui est un magnifique poème classique dans l'ordre du Grand Testament) la seule raison du poème. On y voit la Maison où naissent les étoiles et les divinités, Un cigare allumé qui fume et les avenues qui partent de la Tour Eiffel figurées par des inscriptions bizarres où se fait jour toute la fantaisie du poète :
« Je me suis levé à deux heures du matin et j'ai déjà bu un mouton. »
Les aiguilles de la Montre sont recouvertes d'une matière lumineuse qui éclaire tragiquement la destinée du poète :
« Il est moins cinq enfin
Et tout sera fini. »
Certains calligrammes, Il pleut, Voyage, semblent porter en eux une véritable nécessité. Le premier étendu sur la page comme une longue main féminine laisse tomber goutte à goutte ses lettres et oblige ainsi à une lente lecture.
« Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
C'est vous aussi qu'il pleut merveilleuses rencontres de ma vie, ô gouttelettes... »
Voyage figure un train de nuit à la poursuite de l'espace étoilé.
« Où va donc ce train qui meurt au loin
Dans les vals et les beaux bois-frais
Du tendre été si pâle ? »
et dans le ciel où les mots ont pris la place des astres on peut lire
« La douce nuit lunaire et pleine d'étoiles
C'est ton visage que je ne vois plus. »
Souvent Apollinaire se borne à des jeux plus simplement enfantins, envoyant cartes postales à celui-ci, souvenirs dessinés à celle-là, gardant pour lui une mandoline, un bambou, une cravate, un miroir où il est « enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les reflets ».
En l'honneur de ses marches il écrit sous forme de botte cavalière
« Sacré nom de Dieu quelle allure
Nom de Dieu quelle allure
Cependant que la nuit descend. »
Certains ont cru voir dans ces Calligrammes l'aboutissement de l'art cubiste. Ce serait donner à Apollinaire des limites qu'il n'avait pas. L'origine de ces images parlantes sans remonter à Simmias de Rhodes, Rabelais ou même Panard, je la vois dans ces graffiti que peut lire le poète sur les murs de la Santé ou dans la caverne du Roi Lune. Voici une de ces inscriptions, tracée à la craie et accompagnée de trois ctéis ailés d'ampleur différente qui n'a pas été sans le laisser rêveur
« J'ai eu le même soir la même
Jolie tyrolienne du XVII° siècle
A ses âges de 16, 21 et 33
A son âge de 70 ans mais
J'ai passé la main à Nicolas. »
Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'Apollinaire se livre à cette débauche graphique, il est canonnier-conducteur, c'est-à-dire une proie facile pour l'oisiveté. Tandis que les uns sculptent des cannes, liment des bagues, polissent des culots d'obus, lui, qui n'est pas un manuel, préfère le plus souvent tailler largement dans l'alphabet. Il est probable que s'il était resté au 202 du faubourg Saint-Germain, Apollinaire n'aurait jamais tracé des calligrammes. La réussite réside bien davantage dans un texte comme Souvenirs avec
« Deux lacs nègres
Entre une forêt
Et une chemise qui sèche. »
C'est tout au moins ce que nous a appris à aimer le douanier Rousseau, ce primitivisme, cette fraîcheur du premier matin du monde, car cet esprit jacobin, je parle d'Apollinaire, savait retrouver sous les lourdes tentures du monde l'aile douce d'une fleur et le chant d'un oiseau.
Ce qu'il dit de Picasso est valable pour lui, il suffit de lire Zone et les meilleurs poèmes de Calligrammes pour s'en convaincre :
« Voyez ce peintre, il prend les choses avec leur ombre et d'un coup d'œil sublimatoire.
Il se déchire en accords profonds et agréables à respirer tels l'orgue que j'aime entendre. »
Dans cette œuvre on ne sait déjà plus si l'on a affaire à la poésie ou à la vie ; leurs hautes flammes se croisent sur sa poitrine, lui déchirent la gorge à tel point que son dernier livre de poèmes se referme sur ce cri douloureux comme la nuit :
« Ayez pitié de moi »
C'est, bien davantage qu'une saison en enfer, toute une vie traversée par les coups de grisou du génie, une mine sombre pleine de gemmes étincelantes qu'il s'agit de conquérir.
Apollinaire est préoccupé par sa joie douloureuse d'aventurier, par son désir de voir grand et loin et de soulever dans ses mains le chaos admirable du monde.
On l'a accusé de manquer d'imagination, d'user de procédés pour échapper à une inspiration uniquement livresque et René Lalou a pu dire que « la muse d'Apollinaire, quand elle s'en va à Montparnasse, sort de la Bibliothèque Nationale ».
Si Apollinaire s'en tient à un petit nombre de thèmes, c'est peut-être que la vie n'en comporte pas davantage.
Quand on écrit
« O vieux monde du XIXe siècle plein de hautes cheminées si belles et si pures
Virilités du siècle où nous sommes
O canons. »
ou encore
« Deux fusants
Rose éclatement
Comme deux seins que l'on dégrafe
Tendent leurs bouts insolemment
Il sut aimer
Quelle épitaphe. »
Il est possible que l'on s'inquiète fort peu de littérature.
Savoir aimer ! visiblement tout est là. Et peut-on reprocher à Apollinaire d'avoir su aimer comme Villon, comme Baudelaire et en même temps comme un soldat du 38° régiment d'artillerie de campagne. Les mêmes images, les mêmes sentiments reviennent parce qu’on n’en a jamais fini avec son amour. Il faut y revenir comme aux faims quotidiennes, le dominer par un nouvel amour.
Alors on peut dire d'Apollinaire qu'il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé. L'ironie n'aura été que le tulle léger jeté sur sa belle âme pour nous voiler de trop grandes douleurs.
D'ailleurs, écoutez bien
« Nous ne sommes pas vos ennemis
Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines
Où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir.
Il y a là des jeux nouveaux des couleurs jamais vues
Mille phantasmes impondérables
Auxquels il faut donner de la réalité
Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait. »
Considérant l'œuvre en prose d'Apollinaire, on doit avouer que l'héritage est beaucoup plus mince, encore que le nombre des volumes soit plus nombreux.
L'Hérésiarque et Compagnie qui parait en 1910 est un recueil de contes qui retiennent notre attention à des degrés bien différents. Apollinaire s'y montre un voyageur curieux, mais de bonne curiosité, pas de celle qui s'attarde aux boniments des guides ou des concierges. Philippe Soupault écrit : « Lorsqu'il voyait passer dans la rue un être qui lui semblait « désaxé », qui par ses tics et son allure trahissait une anomalie, il s'arrêtait parfois pour le regarder, parfois le suivait. Mais autour de ce passant il construisait presque toujours une destinée ».
Revenu depuis peu d'Europe Centrale, il se souvient de maints détails charmants et en farcit ses contes comme Rabelais savait truffer la peau grasse de son Pantagruel. Rappelons-nous de ce que lui dit un jour à Prague le Juif errant : « Mon péché, Monsieur, fut un péché de génie, et il y a bien longtemps que j'ai cessé de m'en repentir ». Lui-même pourrait en dire autant.
L'ambition du conteur semble bien plutôt être de créer des mythes que des personnages. Il enveloppe ses héros d'une telle lumière, lumière atroce souvent, qu'on est bien obligé de s'intéresser à eux.
Poë, et peut-être aussi certaines livraisons policières dont il aimait à boursoufler ses poches lui montrent le chemin des macabres découvertes.
Deux hommes se battent au couteau pour conquérir la même femme : fait courant. L'un d'eux est tué : nouveau fait courant. Alors le vainqueur pousse un cri de satisfaction et sectionnant le bras de sa victime à la jointure il l'enfonce dans la pochette de son veston : voilà l'inattendu. Et Apollinaire pousse plus loin le tragique crapuleux de cette « histoire extraordinaire » en concluant ainsi :
« Elle (la femme) s'approche de Que Vlove ? Le cadavre les séparait. Ils s'embrassèrent. Mais le bras droit du mort étant remonté dans la pochette, droit et pareil à une tige fleurie de cinq pétales, se trouva entre eux ».
Parfois ces inventions de grand guignol ne sont pas exemptes de beauté. On n'oubliera pas la triste fin de cette petite « danseuse » qui s'étant égarée un jour d'hiver au bord du Danube fut tentée par la glace bleuâtre et s'élança dessus en dansant. « Soudain la glace se brisa sous elle qui s'enfonça dans le Danube, mais de telle façon que, le corps étant baigné, la tête resta au-dessus des glaces rapprochées et ressoudées... Sa tête semblait tranchée et posée sur un plat d'argent ».
Il ne faut pas croire toutefois qu'Apollinaire soit incapable d'une beauté beaucoup plus mesurée. Ainsi, même au cours d'une nouvelle horrifiante comme Que Vlo-ve ? il sait retrouver la grâce d'un Watteau ou des impressionnistes pour perpétuer un paysage très longtemps dans le souvenir
« Et comme c'était le coucher du soleil, un long troupeau de vaches, mené par une petite fille aux pieds nus, passa lentement et longtemps devant l'auberge ».
Car Apollinaire n'est pas une âme perpétuellement en quête de nourritures malsaines. Si le malsain le séduit c'est parce qu'il a une saveur véritable parmi les insipidités quotidiennes. Que chaque jour soit désormais un chaos d'immondices et Apollinaire se dirigera vers la source comme son double Croniamental.
« O source ! Toi qui jaillis comme un sang intarissable... Tu es ma divinité non pareille. Tu me désaltéreras. Tu me purifieras. Tu me murmureras ton éternelle chanson et tu m'endormiras le soir ».
Je l'ai dit : Apollinaire, cet esprit étonnamment séducteur, se laissera le premier séduire par tout ce qui sort de l'ornière, par tout ce qui surprend, peu importe que la surprise soit agréable ou non. Rien de surprenant après cela que l'œuvre de Poë ait eu sur lui un étrange pouvoir attractif.
Le divin Rabelais n'est pas sans avoir également influencé Apollinaire. On connaît les propos grivois de la rue Ravignan et du Vachette et certain calligramme où sont évoqués les charmes pernicieux de la fameuse Nancéenne. C'est sur un ciel « plein de couilles lumineuses qu'on appelle astres, planètes, étoiles », que se profile l'œuvre d'Apollinaire. On y voit des personnages dont le moins bien situé n'est pas cette Elvire Goulot qui tout enfant rêvait « d'épingles, de pieux ou de barrières, ce qui au témoignage d'une certaine école, indique des destinées charnelles nettement accusées », ou encore ce moine qui voulant accomplir un acte naturel qu'il est inutile de nommer « exposait un pilon à mortier, un bâton pastoral, une flûte à Robin, et mieux, un rossignol tel que beaucoup de dames l'eussent voulu entendre chanter Kyrie eleison ».
C'est peut-être dans ces pages pleines de verve et de gaillardises qu'on peut déceler l'influence de la Bibliothèque Nationale, tant reprochée au poète, et dans l'enfer de laquelle il a étudié pour la collection les Maîtres de l'Amour l'œuvre du Marquis de Sade, de l'Aretin, de l'Abbé de Grécourt et la « très plaisante et récréative histoire du preux et vaillant chevalier Perceval le Galloys ».
« Le mysticisme, dira l'Hérésiarque, touche de près l'érotisme » et le père Séraphin démontrera que les extases de la vénérable Marie de Bethléem étaient des crises d'hystérie. Alors il faut croire qu'Apollinaire fut un bien grand mystique.
Sans aller jusque-là il est à remarquer cependant qu'il donne à ses premiers contes de l'Hérésiarque et Compagnie un souci d'ordre religieux et parfois même métaphysique - un trop gros mot pour lui. - Il va jusqu'à se préoccuper de l'Infaillibilité en matière papale et déclare :
« L'effroi de régner au moyen de mensonges séculaires voilà le vrai fardeau de la papauté ». Comme si cela pouvait en quoi que ce soit l'intéresser lui qui s'est écrié, si douloureusement d'ailleurs :
« A la fin les mensonges ne me font plus peur. »
Il ne peut en effet en rester là. Pour si intéressants qu'ils soient, ces récits ne répondent pas à une nécessité en quelque sorte organique, ils ne participent pas à la démarche de l'âme toujours en quête de son destin, ils sont en deçà d'une beauté dont se désintéresse déjà le poète.
Le Poète assassiné va donner à Apollinaire toutes les vraies joies de la création et d'abord avec Viersélin Tigoboth, le musicien ambulant, celles de la procréation.
Ce livre écrit entre 1910 et 1915 sert en quelque sorte de moyen terme entre les poèmes d'Alcools et ceux de Calligrammes, et montre assez bien les nouvelles préoccupations d'Apollinaire. Certes la verdeur rabelaisienne y est toujours à l'honneur et non plus comme moyen de surprise, mais parce qu'elle est nécessaire à l'action.
Si Macarée lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle a conçu de Viersélin s'écrie : « Tu n'es qu'un sac plein, à cette heure, ô mon ventre souriant du nombril, ô mon ventre élastique, barbu, lisse, bombé, douloureux, rond, soyeux, qui anoblis... » c'est afin de nous faire envisager comme certaine la naissance du futur Croniamental.
Apollinaire a voulu tout mettre dans ce livre : sa naissance obscure, ses amours, ses amis, ses voyages, ses aspirations artistiques et jusqu'à sa blessure à la tempe.
Le tout sans plan préconçu, sans action rigoureuse avec simplement le plaisir de revivre en Croniamental et de dorer sa légende. Rien d'étonnant alors que Duhamel ait pu à propos de ce livre écrire qu'il sentait « la boutique du brocanteur ».
Mais si Le Poète assassiné contient encore un semblant de logique, on peut bien dire que La Femme assise est un fouillis inextricable de sensations, d'idées, de sentiments plus ou moins acceptables.
Apollinaire a essayé dans le cours même de ce livre de justifier ou tout au moins d'expliquer cette confusion : « la guerre continue. Il s'agit avant d'y retourner d'achever, le roman et la prose est ce qui convient le mieux à ma hâte ».
Ici l'influence de Poë est à peu près inexistante, celle de Rabelais s'estompe, mais celle de Jarry se fait de plus en plus sentir.
On sait qu'elle était l'admiration d'Apollinaire pour l'auteur d'Ubu-Roi ; « ces débauches de l'intelligence, a-t-il écrit en novembre 1909, où les sentiments n'ont pas de part, la Renaissance seule permit qu'on s'y livrât, et Jarry par un miracle a été le dernier de ces débauchés sublimes. »
Peut-être pas le dernier, on en doute parfois en lisant certaines pages de La Femme assise où la cocasserie d'Apollinaire ne le cède en rien à celle du Père Ubu. Il faut écouter l'histoire d'Evariste Roudiol, cocher de fiacre qui attendit bien près de trois ans le retour de son client, parti en Amérique, sans lui régler sa course et se présenta à l'arrivée de celui-ci pour lui réclamer son dû, soit 56.322 fr 50.
« Monsieur Paudevin vérifia le calcul : trois ans moins une heure à deux francs l'heure, tarif de jour et deux francs cinquante l'heure tarif de nuit, en modifiant les totaux quotidiens selon les horaires d'hiver ou d'été et sans oublier d'ajouter une journée pour l'année bissextile 1908 ».
Mais Apollinaire va étendre encore plus loin sa domination, aux frontières mêmes « de l'illimité et de l'avenir ».
Il tente en 1917 avec les Mamelles de Thirésias, drame en deux actes et un prologue, musique de Germaine Albert-Birot, de rénover le théâtre en revenant à la nature, mais sans l'imiter à la manière des photographes. Cet art, il le veut dans la simplicité des premiers âges, c'est-à-dire moderne, assez rapide pour frapper le spectateur, car il est bien entendu qu'on va au spectacle pour se divertir, en un mot il veut faire de cet art un nouveau réalisme qui sera un « surréalisme ».
Lorsque la pièce est éditée en 1918 aux éditions Sic Apollinaire, la dote d'une préface qui éclaire singulièrement les ambitions du poète.
« Quand l'homme a voulu imiter la marche, dit-il, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. »
Et puisque le théâtre n'est pas plus la vie que la roue est une jambe, il n'y a aucune raison de ne pas porter au théâtre des « esthétiques nouvelles et frappantes qui accentuent le caractère scénique des personnages et augmentent la pompe de la mise en scène sans modifier toutefois le pathétique ou le comique des situations qui doivent se suffire à elles-mêmes ».
Déjà dix ans plus tôt dans un long poème en prose intitulé Onirocritique, Apollinaire s'était plu à créer cette ambiance qui se situe entre le rêve et la veille, et qui a fait depuis la fortune, ou la faillite du surréalisme.
« Cent matelots m'accueillirent et m'ayant mené dans un palais, ils m'y tuèrent quatre-vingt-dix-neuf fois. J'éclatai de rire à ce moment et dansai tandis qu'ils pleuraient. Je dansai à quatre pattes. Les matelots n'osaient plus bouger, car j'avais l'aspect du lion. »
Le sujet des Mamelles de Tirésias, car on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y eut pas de sujet, est en soi très louable. Le poète l'a choisi assez général afin qu'il puisse avoir une influence vaste sur les esprits et sur les mœurs : « Il s'agit des enfants dans la famille ». Apollinaire a en effet remarqué que la France court à sa perte parce qu'on n'y fait plus assez d'enfants, et on ne fait plus assez d'enfants parce qu'on ne fait plus assez l'amour. C'est en somme, il le dit, un sujet domestique et comme tel il sera traité sur un ton familier.
Familier, en effet, mais comme pouvait l'être Jarry qui, accusé par sa voisine de vouloir lui tuer ses enfants en s'essayant à la carabine sur les pommes de son verger, répondait superbement: « Nous vous en ferons d'autres, Madame ».
On se demande jusqu'où ira l'amour de Thérèse pour son mari quand elle conseille à celui-ci de se manger les pieds « à la Sainte-Menehould ». Le seul étonnement qu'on n'ait pas, c'est de la voir à sa scène III jeter successivement par la fenêtre un pot de chambre, un bassin et un urinal.
« La mari ramasse le pot de chambre
Le piano
Il ramasse l'urinal
Le violon
Il ramasse le bassin
L'assiette au beurre, la situation devient grave. »
Je ne connais pas la musique de Germaine Albert-Birot, mais je crains fort qu'elle ne soit capable de soulever le spectateur à tel point qu'il en oublie la raison même de la pièce.
Certes, maintes occasions lui sont offertes de sourire.
« Eh ! fumez la pipe Bergère
Moi je jouerai du pipeau
Et cependant la Boulangère
Tous les sept ans changeait de peau
Tous les sept ans elle exagère. »
Mais est-ce là la seule satisfaction qui lui était promise ?
Apollinaire n'a-t-il pas dit dans le prologue :
« La pièce doit être un univers complet avec son créateur et non pas seulement la représentation d'un petit morceau de ce qui nous entoure ou de ce qui s'est jadis passé ».
Il est évident que les rôles sont renversés et que l'auteur jouit secrètement, en spectateur, des réactions de la salle. La scène n'est plus qu'un prétexte et le véritable jeu se joue à l'écart des tréteaux. L'esprit mystificateur du poète s'est donné libre cours une fois de plus et cette fois-là c'est un public qui dépasse celui des admirateurs qui en a fait les frais.
Toutefois il faut louer Apollinaire d'avoir su pressentir « le grand déploiement de notre art moderne qui marie souvent sans lien apparent comme dans la vie les sons, les gestes, les couleurs, les cris, les bruits, la musique, la danse, l'acrobatie, la poésie, la peinture, les actions et les décors multiples » : toutes les richesses du cinéma.
Quant à l'échec de ce théâtre, aussi lamentable que celui de La Femme assise, je le crois tout entier en la faveur du poète et comme correspondant à sa nature véritable.
Il serait paradoxal que cet homme d'action qui a tant de peine à faire tenir dans toute une vie sa haute carrure vacillante, puisse dans le cadre étroit et sans chaleur d'un drame ou d'un roman donner le souffle à d'inquiétants personnages.
Apollinaire ne pactise pas avec le public pour les minces bénéfices d'une gloire hypothétique et contraire à la joie. S'il est artiste, c'est comme l'est le flot qui sculpte seul la falaise, en proie à une volonté supérieure ; mais de son plein gré, il ne peut accepter l'art pour l'art, c'est-à-dire de composer avec lui.
Je vois en lui l'homme des saisons avec ce que cela comporte de mystérieuses palpitations, de tressaillements, de germes et de beautés cardinales. Je vois en lui l'homme de l'amour.
« Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire
Qui fut à la guerre et sut être partout
Dans les villes heureuses de l'arrière
Dans tout le reste de l'univers
Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé
Dans les femmes dans les canons dans les chevaux ,
Au Zénith au Nadir aux 4 points cardinaux... »
L'Amour : voilà bien l'unité de l'œuvre apollinarienne.
De la période des influences aux explosions surréalistes c'est lui qui dirigea cette main royale faite pour l'ordre et la caresse. Il suffira au poète de dire un mot en apparence banal pour que des milliers de mots se groupent au bord de sa poitrine, tant est forte l'attirance, l'aimantation qui promène le monde jusqu'aux sommets de la beauté.
Le Cubisme, je le prends pour une vertu majeure, celle qui se satisfait de peu et fait du peu un tout. Apollinaire en a usé comme d'une dimension commode, capable de supporter une plus grande somme de merveilleux.
Si l'on ôte à cette œuvre la part de procédés, il ne reste plus qu'une immense beauté classique ou du moins en passe de le devenir, celle qui s'adresse à l'homme par une présence secourable, qui lui fait mesurer l'étendue d'une épaule : beauté du cri, bouleversante beauté de trop d'amour.
Chapitre 3 – Le cœur et la tête étoilée

Je pense que si le 9 novembre 1918, dans la haute volière du 202 boulevard Saint-Germain, on avait voulu enchâsser le cœur d'Apollinaire, comme on fit pour celui d'Anne de Bretagne, sa belle flamme n'aurait pas tardé à briser la coquille d'or.
Il n'y eut jamais assez d'une seule poitrine pour contenir ses bondissements. Alors, extrêmement jaloux de sa santé, Guillaume avait recours aux amis, aux aimées et chacun lui trouvait en soi la place la meilleure.
On entendait aussi ses sourdes palpitations sous la mer, dans la neige noire des tranchées, en plein ciel. Son tic-tac éveillait en hâte les continents, rassemblait les enfants sur les marches, dirigeait les oiseaux. Le sang de cet homme irriguait tant de mains.
Enchanteur d'une Brocéliande de cheminées et de toits, il traversait son Paris précédé de l'amour et toutes les portes s'ouvraient devant lui.
J'ai dit ce beau visage, ses grands yeux noirs d'une mobilité inouïe, ses sourcils qui lui donnaient, selon Marie, l'air « des masques de tragédie grecque ».
Né pour l'amour et bien davantage pour donner que pour recevoir, il était de la race des enfants blonds gaspilleurs d'images. Toute la joie dans un geste de sa main.
Vous l'avez vu vivre dans cette délicieuse ubiquité qui n'appartenait qu'à lui, tête étoilée aux quatre points cardinaux. Je vous ai dit les chemins parcourus depuis le collège jusqu'aux barbelés qui sont comme la couronne d'épines du monde. Je vous ai dit ses sources au pied des hautes montagnes de l'histoire littéraire : Villon, Hugo, Verlaine, Whitman, je vous ai dit ses affluents : cubisme, surréalisme, dadaïsme et comme il s'en allait tranquillement vers la gloire.
Il me reste maintenant à vous le faire aimer et comment ne pas aimer celui qui est semences, qui se partage à chaque carrefour et donne une chaleur particulière aux saisons.
En d'autres temps, il aurait fallu construire des temples pour cet homme et lire ses poèmes à haute voix avec l'inflexion grave de la mer. La plaie rouge de son front saigne dans l'aube.
Je sais, et certains de mes plus chers compagnons seront contre moi, qu'on ne prouve rien par l'amour et qu'une femme naturellement amoureuse n'est peut-être pas belle. Il suffit de lire Apollinaire pour se convaincre de la beauté.
Du fait de sa naissance, il y a en Guillaume Apollinaire de la beauté grecque et nordique et ce mystérieux tressaillement qu'on éprouve en découvrant une orange sous la neige.
Sa vie tenant du merveilleux il n'est donc point étonnant que son œuvre s'en ressente. C'est le merveilleux des choses simples : un verre vide, une lampe éteinte, un ami perdu, les hautes fleurs qui se balancent tout autour des usines. Et quand j'écris cela je pense au Souvenir du Douanier
« Un tout petit oiseau
Sur l'épaule d'un ange
Ils chantent la louange
Du gentil Rousseau »
Autre Douanier, deux rosiers grimpent aussi le long de son âme. Il a l'innocence des rosiers et des âmes et comme on dit : « Aux innocents les mains pleines ».
Je crois bien en effet, que le seul péché d'Apollinaire fut un péché d'innocence. S'il mystifiait c'était pour retrouver la fraîcheur des premiers sentiments, ceux d'avant la chute, pour la joie de secouer la crinière du rire, heureux comme une bête poulinière. Cela n'allait d'ailleurs jamais très loin et ne dépassait pas les limites de la fantaisie d'un enfant gauche. Et puis tant de larmes avaient besoin d'être voilées.
Dans son œuvre, il ne cherche ni à étonner ni à s'étonner lui-même, mais simplement à marcher droit dans l'étroite bande de lumière qui est dévolue aux poètes, et ce qu'on prend pour des divagations n'est rien d'autre que le balbutiement des pas sur un chemin difficile. Il faut croire celui qui écrivait à son ami Rouveyre
« Je n'ai jamais fait de farce et ne me suis livré à aucune mystification touchant mon œuvre et celle des autres ».
A pleines mains donc il distribue ses richesses et d'abord ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire la bonne laine qui gonfle sa poitrine et lui donne tout son poids aérien.
Peut-être est-ce dans le petit cimetière de Munich qu'il a compris pour la première fois ce qu'on pouvait atteindre par l'amour.
« ... Il n'y a rien qui vous élève
Comme d'avoir aimé un mort ou une morte
On devient si pur qu'on en arrive
Dans les glaciers de la mémoire
A se confondre avec le souvenir
On est fortifié pour la vie
Et l'on n'a plus besoin de personne. »
Il est certain que l'amour a fortifié Apollinaire, qu'il lui a donné son tonnage, son tirant d'eau et l'a mis sur la route des grandes découvertes : celles de soi-même et de l'homme. Mais bien plus que les morts, les vivants se sont emparés de lui pour en faire ce perpétuel vogueur, cet aventurier capable de découvrir un visage là où n'apparaissaient que des ronces. Très jeune il a eu cette divination des pas en marche vers lui.
« O gens que je connais
Il me suffit d'entendre le bruit de leurs pas
Pour pouvoir indiquer à jamais la direction qu'ils ont prise. »
Apollinaire a aimé ses amis comme on aime une femme, avec exigence. Jamais il n'est assez près d'eux, en eux. A chaque instant, il lui faut le contact d'une main pour que la présence se prolonge. Ainsi s'entoure-t-il des compagnons les plus bizarres parce qu'il a éprouvé l'épaule de celui-ci, la voix de celui-là et que tous ces yeux le tourmentent comme une galerie d'ancêtres.
On n'oubliera pas le Poème lu au mariage d'André Salmon qui est une déclaration d'amour et d'amour le plus pur comme jamais peut-être femme n'en reçut :
« Je le revis faisant ceci ou cela en l'honneur des mêmes paroles
Qui changent la face des enfants et je dis toutes ces choses
Souvenir et avenir parce que mon ami André Salmon se marie. »
Sans l'amitié, il est probable qu'Apollinaire n'aurait pas été ce qu'il fut. Dédaigneux des applaudissements, il recherchait cependant les encouragements d'une parole amie et ce contentement que donne au cœur l'écho grave des poitrines.
Dans un charmant poème du Bestiaire ou cortège d'Orphée, il a énoncé clairement ses désirs :
« Je souhaite dans ma maison
Une femme ayant sa raison
Un chat passant parmi les livres
Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne peux pas vivre »
es malins, ceux qui vont à la source non pour se désaltérer, mais pour tout expliquer, verront dans ces vers la confession d'un idéal bourgeois digne du bonhomme Chrysale. Il est exact en effet qu'Apollinaire a agi sa vie de telle sorte qu'une assurance de bonheur lui soit enfin donnée, et je crois que lorsqu'il épousa en mai 1918 sa femme Jacqueline, il était bien près du grand secret.
Ses amis, ceux sur lesquels ils peut compter pour une action commune en faveur de la poésie sont peu nombreux. Aussi Max Jacob et André Salmon sont-ils les plus chers.
« ... Rails qui ligotez les Nations
Nous ne sommes que deux ou trois hommes
Libres de tous liens
Donnons-nous la main... »
Durant toute la guerre, plus peut-être que la présence de la femme aimée, c'est la fidèle chaleur de l'ami qui lui manquera. Le vaguemestre dont la musette promène lettres et gibiers reçoit ses bénédictions. Apollinaire le considère un peu comme un braconnier qui irait tendre ses collets aux portes des amis. En retour il le charge de missives.
Le 17 mars 1915, il écrit à Louis de Gonzague Frick :
« Le pâle crayon de ta carte
Est pâle comme un souvenir
Et que le sort bientôt écarte
La guerre pour nous réunir... »
Sa nature est telle qu'il a besoin de se confier. Il ressort d'une lettre allégé, avec de nouvelles forces, une nouvelle flamme et Dieu sait s'il a besoin de clarté dans la nuit où certains le laissent.
Le 12 septembre de la même année, alors qu'il est maréchal-des-logis à la 45° batterie du 38° régiment d'artillerie, il fait part toujours à Louis de Gonzague-Frick de ses désillusions.
« M. P. Halary, secrétaire de la Société des Poètes français m'a fait l'honneur de m'envoyer le programme d'une séance consacrée aux œuvres des poètes-soldats. Vous êtes au programme et vous n'êtes pas seulement dans ce programme un des rares poètes, mais encore un des rares soldats. Quant à moi qu'on connaît fort bien puisqu'on m'envoie le programme on a jugé sans doute que je n'étais ni poète ni soldat... »
Si seulement il savait ce que sont devenus tous les bons compagnons de la première heure. On change de secteur et le courrier s'égare. Il ne reste plus pour combler, le vide du temps que la douceur d'un souvenir. S'il s'interroge lui-même la réponse lui fait peur :
« Peut-être sont-ils morts déjà. »
Et le 7 mai 1917 le plus ancien de ses camarades, René Dalize tombe au champ d'honneur.
Alors tous ceux qui sont morts revivent d'une façon mystérieuse en lui, ils participent à sa démarche profonde, à ses moussons et sont les hautes branches de son printemps.
« Vous voilà de nouveau près de moi
Souvenir de mes compagnons morts à la guerre...
Ombres vous rampez près de moi
Mais vous ne m'entendez plus
Vous ne connaîtrez plus les poèmes divins que je chante
Tandis que moi je vous entends je vous vois encore. »
ais Apollinaire ne se contente pas de pleurer ses amis, d'évoquer leur souvenir dans des poèmes d'une merveilleuse nostalgie ou de leur envoyer lettres et calligrammes en signe de présence quotidienne, d'associer leur nom à sa gloire dans les dédicaces de ses contes, il sait aussi les défendre et les aider de sa plume fraternelle. Les articles sur les peintres cubistes parus de 1907 à 1918 en témoignent assez. Matisse, Picasso, Van Dongen et surtout le Douanier sont ainsi présentés au public dans la toute primeur de leur art.
Mieux encore, il met en scène son ami Picasso sous les traits de l'oiseau du Bénin dans le Poète assassiné, en fait l'amant d'Elvire dans La Femme assise et trace de lui ce portrait admirable
« Pablo Canouris, le peintre aux mains bleues, a des yeux d'oiseaux. D'origine albanaise, il est né en Espagne à Malaga, mais son art et son cerveau, qui comportent la force réaliste qui caractérise les productions et l'esprit de la Péninsule ibérique, ont gardé cette pureté et cette vérité helléniques qui lui viennent de ses ancêtres... »
A la fin des Mamelles de Tirésias, Guillaume trouve d'ingénieux moyens pour faire connaître ses compagnons les plus chers. En effet, d'Ottawa nous parvient ce télégramme : « Incendie établissement Jacob - stop - 20.000 poèmes en prose consumés - stop - Président envoie condoléances ». Puis de Rome « Henri Matisse directeur villa Médicis achève portrait sa Sainteté. » D'Avignon : « Grand artiste Georges Braque vient inventer procédé culture intensive pinceaux ».
Car personne peut-être avant lui n'a possédé à un tel degré ce sens violent de l'amitié, qui donne de cet homme l'impression d'un hall immense où se pressent les épaules et les visages de toutes couleurs.
Il faut lire Le Flâneur des deux rives qu'on peut en bien des points considérer comme un documentaire de l'amitié avec ses rencontres de la rue de Buci, du « Napo », du Bouillon Michel Pons et de la cave de Monsieur Vollard.
Ainsi apprendra-t-on que Fernand Fleuret, le précieux collaborateur d'Apollinaire à la Nationale, avait un penchant décidé pour la mystification, « ce qui le poussa un jour, alors qu'il allait encore au collège à faire croire à la cuisinière de ses parents qu'un certain fourreau qui emprunta jadis son nom à la paisible ville de Condom était une bourse de nouvelle sorte et fort commode pour les gros sous. A la boucherie ce fut un éclat de rire qui se propagea par toute la ville ».
Cremnitz, Berthier, Léo Larguier, Emest la Jeunesse sont évoqués au cours de pages pleines d'anecdotes et de remarques familières. Il n'est pas jusqu'à Paul Birault, l'imprimeur de l'Enchanteur Pourrissant, dont Apollinaire nous raconte l'histoire devenue fameuse. On se souvient en effet que M. Paul Birault était parvenu à former un comité composé de députés et de sénateurs pour élever une statue à l'imaginaire démagogue Hégésippe Simon et qu'aucun d'eux ne s'esclaffa en lisant l'épigraphe tirée des œuvres supposées dudit Simon qui ornait la circulaire destinée à l'érection du monument : « Quand le soleil se lève les ténèbres s'évanouissent ».
Et celui qui savait parler de ses amis avec des délicatesses de grand frère leur devait d'écrire ce conte qui est un des plus admirables de l'Hérésiarque et où l'amitié est portée au paroxysme dans son décor de pauvreté et d'amour. J'ai parlé de la Serviette des poètes.
Quatre poètes viennent dîner à tour de rôle chez leur ami le peintre Justin Prérogue qui vit avec sa maîtresse.
Leurs vers sont admirables et les repas n'en finissent pas. Et la même serviette sert tour à tour aux quatre convives sans qu'ils n'en sachent rien. Or, il se trouve que cette serviette petit à petit devient sale. L'amie de Justin Prérogue s'excuse en alléguant que la blanchisseuse a oublié de rapporter le linge.
L'un des convives Léonard Délaisse est tuberculeux. Il crache dans la serviette « sa vie d'inspiré, avec des mines à mourir de rire », et bientôt la serviette vénéneuse infeste tour à tour les trois autres poètes. Au commencement de l'automne tous quatre « secoués par la toux comme des femmes par la volupté » meurent à quelques jours d'intervalle dans différents hôpitaux.
Alors la serviette devient inutile.
L'amie de Justin Prérogue veut la mettre au sale et la déplie, mais la serviette dépliée, ô miracle, grâce à la saleté coagulée et de diverses couleurs, les traits d'un des amis défunts apparaissent. Bouleversés le peintre et sa maîtresse font tourner la serviette, mais pâlissent aussitôt en voyant apparaître « l'épouvantable aspect à mourir de rire de Léonard Délaisse s'efforçant de cracher ».
Les quatre coins de la serviette offrent le même prodige : « Justin Prérogue et son amie tournèrent longtemps comme des astres autour de leur soleil et cette sainte Véronique de son quadruple regard, leur enjoignait de fuir sur la limite de l'art aux confins de la vie ».
Mais si nombreuses que soient les amitiés, elles ne parviennent pas à combler un cœur aussi vaste, aussi remuant et toujours en quête de semences fertiles. Il faut le miracle de l'amour et son cortège de larmes et de baisers pour donner à Guillaume Apollinaire son équilibre d'homme, sa démarche étoilée qui le fait reconnaître entre tous.
A vingt ans, il apparaît déjà comme quelque héros de légende scandinave, amoureux de la fleur des neiges, et aussi comme ce preux et vaillant chevalier Perceval le Galloy dont il publie la « très plaisante et récréative histoire » en 1913. Car Apollinaire est ainsi fait que deux natures se contredisent et se complètent en lui. A certains moments, il est cet enfant perdu, avide de caresses dont le plus grand bonheur est de les inventer ; il rêve d'une claire jeune fille transparente comme l'été, insaisissable comme la pluie, toujours plus belle avec ses yeux plus désirables que la mer. A d'autres, son sang renverse la première femme entrevue, il la marque de ses dents, la déchire et ne trouve le repos de son esprit et de sa chair que dans l'assouvissement des sauvages étreintes.
Son premier amour date de 1900, année durant laquelle il visite l'Allemagne. Annie est une jeune Anglaise fine et gaie, un peu déconcertée par sa nature fantasque de poète, l'aimant bien cependant et que lui désire charnellement.
Rentré seul à Paris, « jaloux sans raison, et cela par l'absence, vivement ressentie », il ira la voir deux fois à Londres.
« Un soir de demi-brume à Londres
Un voyou qui ressemblait à
Mon amour vint à ma rencontre
Et le regard qu'il me jeta
Me fit baisser les yeux de honte... »
écrira-t-il dans la Chanson du Mal aimé en souvenir de la blonde amie de ses vingt ans.
Déjà il songe au mariage, mais celui-ci s'avère aussitôt impossible et Annie prépare hâtivement son départ pour l'Amérique.
Apollinaire a beaucoup souffert de cette rupture et malgré certaines expressions de la Chanson du Mal aimé qu'il considère trop sévères et même injurieuses pour cette jeune fille, il a donné dans ce poème toute la mesure de son amour. L'Emigrant de London Road commémore la déchirante séparation
« Puis dans un port d'automne aux feuilles indécises
Quand les mains de la foule y feuillolaient aussi
Sur le pont du vaisseau il posa sa valise
Et s'assit
Les vents de l'Océan en soufflant leurs menaces
Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés
Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses
Et d'autres en pleurant s'étaient agenouillés. »
C'est le retour vers la France, vers la terre, et la révélation décevante de l'amour. Il se sent plus seul que jamais, plus humain aussi d'avoir beaucoup pleuré. La succession des jours lave à grande eau ce souvenir et le polit, si bien que Guillaume en ressort transfiguré et plein d'une secrète angoisse, mais d'une angoisse qui chante, qui se fait rythme et porte déjà les mystérieuses vibrations du poème.
Où est-elle Annie ? Le poète l'imagine dans un coquet village d'Amérique à la ressemblance de sa beauté et cette évocation donne lieu à un charmant poème :
« Sur la côte du Texas
Entre Mobile et Galveston il y a
Un grand jardin plein de roses
Il contient aussi une villa
Qui est une grande rose. »
Toutefois Apollinaire est encore trop jeune pour savoir se contenter de souvenirs ; sa bonté, sa verve, « son rayonnement », comme dit André Rouveyre, le désignent à tous les regards. C'est alors qu'il rencontre une grande jeune fille auréolée de cheveux blonds, rieuse et pleine de gentillesse : Marie Laurencin.
C'est elle que l'oiseau du Bénin lui conseille d'aller voir : « Elle te connaît et semble folle de toi. Tu la trouveras au bois de Meudon jeudi prochain à l'endroit que je te dirai. Tu la reconnaîtras à la corde à jouer qu'elle tiendra à la main ».
Tout de suite Apollinaire se sent attiré par Marie ! « sa gaîté, sa grâce, son talent eussent touché des cœurs de pierre » écrit Carco dans ses souvenirs de Montmartre. Elle est peintre, mais aussi inconnue que lui en ce temps-là, et peintre comme le sont les enfants avec ce génie de la trouvaille qui fait que les fleurs se rejoignent dans le ciel avec les astres, que le poisson vole, que l'oiseau boite et que l'homme est pareil aux monstres familiers. Je m'imagine Marie comme La Femme assise dessinant des fleurs, des petits cochons, des chevaux qu'elle enlumine ensuite.
Les sentiments du Mal aimé à son égard tiennent d'ailleurs bien davantage de l'admiration que de l'amour. Son esprit de poète est séduit par toute cette lumière qu'elle dispense à pleines mains. Il ressent profondément la générosité et la grandeur du don et ce sang printanier qui borde désormais sa vie imprime à son cœur un mouvement plus large.
Pendant six ans, de 1907 à 1913, Apollinaire va être véritablement soulevé par cet amour. Il sait déjà la vanité de l'élan qui les jette l'un vers l'autre, il refuse même l'union que Marie lui propose parce que là n'est pas leur destin. Mais c'est justement cette prescience, cet instinct animal du devenir qui donne à sa poésie une angoisse, une mélancolie et cette douloureuse musique qui la rendent incomparable.
« Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le font Mirabeau coule la Seine. »
Chaque jour qui naît lui fait regretter la veille. Il est couvert de remords comme de plaies, il saigne, il abonde dans le sens de la douleur tant celle-ci lui semble la seule vertu de l'homme sur terre.
Apollinaire fait avec Marie l'apprentissage des larmes - avec Annie c'était bien plus de la déconvenue que du désespoir - c'est là son véritable chemin de croix, chemin d'autant plus douloureux qu'il est pavé de roses. Il va souriant, cachant sous les pétales du rêve la rosée rouge de son cœur.
Ecoutez-le demander à « Marie »
« Sais-je où s'en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s'en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l'automne
Qui jonchent aussi nos aveux... »
Il ne sait rien justement sinon qu'elle est là, que sa chevelure est sur sa joue comme une vigne sauvage, et que pourtant toute la solitude du monde les sépare. Il est trop près d'elle pour qu'elle soit jamais à lui. Il faudrait l'éloignement qui donne aux choses et aux êtres leur vrai visage. Il ne peut dans la serre chaude de ses bras embrasser toute l'étendue de son amour.
« Le pré est vénéneux mais joli en automne
Les vaches y paissant
Lentement s'empoisonnent
La colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là
Violâtre comme leur cerne et comme cet automne
Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne... »
Apollinaire souffre beaucoup de cet amour impossible par trop de pureté. Vainement, il tente de l'aimer charnellement. Mais lui qui sait pourtant humilier « à une pauvre fille horrible, sa bouche » n'est capable que de faire partager son admiration à l'univers. Connu maintenant par ses écrits esthétiques, il donne, dans les présentations qu'il fait de son amie toute la mesure de son cœur. C'est trop et c'est trop peu pour l'amour.
Alors, un an environ avant la guerre, tandis que Guillaume est définitivement seul, emporté par « le galop des souvenirs » Marie épouse un hobereau allemand et cette Parisienne « laide, mais charmante » qui était arrivée à imposer son type de femme à tout Paris et de là au monde entier, doit, à la mobilisation, du fait de sa nouvelle nationalité, s'enfuir pour échapper aux camps de concentration.
Réfugiée à Malaga avec son mari qui n'a pas voulu porter les armes contre la France, c'est de là qu'elle envoie, d'ailleurs avec l'assentiment du mari, ces lettres qui font tant de mal au poète.
Apollinaire écrira plus tard
« Le Pont Mirabeau est aussi la chanson triste de cette longue liaison triste avec celle qui ayant inspiré Zone dessina pour la couverture de la traduction allemande du poème mon portrait à cheval - et de ce poème-là elle saisissait bien l'amertume, en outre, au point d'en sangloter - et qui, si c'avait été possible, si elle avait bien connu mon cœur, aurait tout renoué. Et cependant elle aura toujours en moi un ami, un admirateur, un défenseur même. Elle le sait bien et bien des gens le savent à Paris, qui m'en ont écrit, rares gens de cœur qui ne lui ont point jeté la pierre ».
Et Francis Carco dans de Montmartre au Quartier latin a noté :
« Chère Marie ! elle le savait bien, elle le voyait bien, que nous ne lui gardions pas rancune d'avoir rendu Guillaume si malheureux... Il y avait en elle, autour d'elle tant de souvenirs tendres qui se mettaient à vivre que, malgré tout, elle demeurait l'amie trop aimée du poète et notre sueur pour cette miraculeuse souffrance qu'elle avait fait jaillir ».
Zone bien qu'il soit placé en tête d'Alcools a été composé en 1913 et résume toutes ces années d'apprentissage de la douleur.
L'émotion qui se dégage de ce poème, la détresse poignante de cet homme tant de fois déçu empêche toute analyse. Dans ce monde où « même les automobiles ont l'air d'être anciennes » il ne reste plus guère de place pour l'amour.
« L'angoisse de l'amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé. »
Et c'est la grande crainte de Guillaume. Sa longue liaison avec Marie lui a prouvé que le cœur n'était rien s'il ne parvenait à forcer l'amour du monde, qu'il fallait découvrir sa propre beauté, sa propre taille et qu'on n'en avait jamais fini de grandir.
Aussi tente-t-il désespérément de s'élever. Mais comme il a beaucoup souffert, le miracle intervient : il s'élève sans peine.
Dans Zone Apollinaire est véritablement porté par la douleur, il a perdu son poids terrestre, son lourd fardeau de larmes pour retrouver dans un autre pays un autre poids et d'autres larmes qui, loin de le courber, le grandissent. Invitation à une vie nouvelle, à une vie jaillie, Zone est le poème des temps à venir.
Il faut remercier Marie d'avoir su révéler son ami à lui-même, de l'avoir rendu conscient de son audace. A partir de ce moment, il peut écrire, dans Cors de chasse par exemple :
« Notre histoire est noble et tragique
Comme le masque d'un tyran
Nul drame hasardeux ou magique
Aucun détail indifférent
Ne rend notre amour pathétique... »
Il est certain de son destin.
Les premiers mois de la guerre vont hâter la convalescence amoureuse du poète. Certes, les plaies promènent encore leurs soleils tout le long de son corps et les lettres qui passent les Pyrénées ne sont guère faites pour les cicatriser, mais le dialogue pourpre des frontières lui apprend qu'il est une nouvelle raison d'exister. Il a hâte de partir au feu, d'apporter l'ardente réponse de sa poitrine et peu à peu l'image des sanglants corps à corps du petit jour se substitue à celle de plus suaves étreintes. Sa chair remue maintenant dans le sens des collines de l'Est, c'est sa vie qui se joue sur la tapis vert des prairies, il est bien temps qu'il songe à la défendre.
Il est dit toutefois que son cœur ne restera jamais vacant. A Nîmes où il fait ses classes, il rencontre une charmante et malheureuse jeune femme, dont on sait seulement qu'elle était belle et que la vie lui réserva toutes les douleurs.
« Son caractère est exquis autant que sa naissance est élevée » et Apollinaire l'aimerait si le souvenir de Marie n'était encore brûlant dans sa mémoire.
Il est envoyé au front la veille de Pâques ; à peine installé, celle qui à Nîmes parvenait tout au plus à chasser sa douleur, lui manque comme le plus élémentaire trésor. Car le cœur d'Apollinaire est ainsi fait qu'il suffit que l'aimée soit tout à coup loin de lui pour être plus présente que jamais. Deux jours après son arrivée, le 6 avril, il lui adresse ce poème :
« Il y a des petits ponts épatants
Il y a mon cœur qui bat pour toi
Il y a une femme triste sur la route
Il y a un beau petit garçon dans un jardin
Il y a six soldats qui s'amusent comme des fous
Il y a des yeux qui cherchent ton image
Il y a un petit bois charmant sur la colline
Et un vieux territorial pisse quand nous passons
Il y a un poilu qui rêve au petit Lou
Il y a un petit Lou exquis dans ce grand Paris
Il y a une batterie dans une forêt
Il y a un berger qui paît ses moutons
Il y a ma vie qui t'appartient
Il y a mon porte-plume réservoir qui court qui court
Il y a un rideau de peupliers délicat délicat
Il y a toute ma vie passée qui est bien passée
Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés
Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades
Il y a des wagons belges sur la voie
Il y a mon amour
Il y a toute la vie. »
Je cite en entier ce poème assez peu connu parce qu'il est singulièrement représentatif des nouvelles préoccupations d'Apollinaire. La vie est devenue une telle faveur que le détail le plus banal prend de l'importance. Il y a la beauté déchirante des choses qui ne meurent pas d'elles-mêmes et qui pourtant vont mourir comme ces « petits ponts épatants », il y a aussi cette femme triste sur la route dont on se demande si elle représente le présent ou l'avenir.
Apollinaire ne peut plus isoler son amour. Il fait partie du décor quotidien, de cette avant-scène encombrée de cadavres, du petit bois de sapins si joli dans le soir, de cette nuit pleine d'étranges constellations jaseuses. Qu'une fusée grignote lentement le ciel et le poète reconnaît les yeux de son amie. Il y a aussi la peur si semblable à l'amour, le bruit d'une balle perdue comme une toux trop fraîche. Les premiers obus éclatent et la terre commence sa mystérieuse migration. Alors il se rattache à son amour. Pourtant tout semblait bien fini après ces quatre mois de dépôt et la lettre qu'il vient d'envoyer à Lou ce 11 avril n'ajoute rien à ce qu'elle sait déjà « Je reste ton ami, mais je sais tout. Je sais quand tu m'aimes moins, je sais même que dans peu tu ne m'écriras même plus. D'ailleurs tu me l'as laissé entendre suffisamment à Marseille. J'y suis fait, ne te gêne pas. D'ailleurs, je sais bien moi aussi que je t'aurai un jour. Je suis têtu comme un âne quand je m'y mets. En tout cas, pour le moment je profite de mon reste, bien maigre, et tes lettres seront toujours les bienvenues. »
Apollinaire ne déteste pas que l'amour le fasse souffrir, c'est certainement pour lui une source intarissable de poésie et, comme il le dit dans la Nuit d'avril 1915 qui met un point final à cette liaison
« Un amour qui se meurt est plus doux que les autres. »
S'il a continué à aimer son amie après le départ de Nîmes, alors qu'elle était à jamais perdue pour lui, si même il a commencé à l'aimer vraiment, non plus dans sa chair mais dans le souvenir, c'est qu'il avait besoin d'un tourment autre que celui qui lui était offert, d'un tourment qui fut en quelque sorte pour son cœur ce que la guerre était à ses muscles et à ses nerfs. Lou est la seule passerelle qui le rattache encore au soleil
« Il est des loups de toute sorte
Je connais le plus inhumain
Mon cœur que le diable l'emporte
Et qu'il le dépose à sa porte
N'est plus qu'un jouet dans sa main. »
Mais à son insu peut-être et tandis qu'il arrache à Lou ses dernières caresses un autre visage se lève dans l'aube guerrière du poète : celui d'une jeune fille entrevue dans un compartiment de chemin de fer, un jour de décembre 1914 alors qu'il regagnait Nîmes, sa permission sur la côte d'Azur achevée.
Quelques mois après, sur le front, il se souvient de ces trois heures d'enchantement. Le nom de la passagère est comme une alouette dans sa tête, dans ses yeux l'ardente mélancolie de son regard. Des mots inventés pour elle seule viennent sur ses lèvres. Et Lou tombe de lui comme un beau fruit trop mûr. Il lui restera à dire : « Je garde à cette héroïne de la Fronde une amitié véritable et complète car elle est digne d'amitié, de pitié, de vénération, d'indulgence parce qu'elle a beaucoup aimé, beaucoup souffert, et que je voudrais que sa vie fut très douce. »
Maintenant Lou a définitivement pris place dans le cabinet noir des souvenirs. Au début Guillaume ne savait plus très bien quel était son amour de Lou ou de Madeleine, il cherchait à fixer un nom qui soit le sien sur ce visage aux deux sourires.
Mais tout est bien changé. Elle est là, Madeleine. Elle tient dans ses doigts tremblants sa photographie qui est
« Le champignon brun
De la forêt
Qu'est sa beauté. »
Quand il ne la trouve plus il l'invente à nouveau, car il lui est nécessaire de sentir son amour présent à ses côtés, de pouvoir à n'importe quel moment se réfugier sous ses épaules plus douces que les siennes, de vivre une vie qui ne soit pas ce déchirement de toutes les secondes.
Une photographie, quelques lettres, l'image d'une écolière attentive à ses propos, c'est tout ce que possède Apollinaire pour faire tenir dans ses bras le fantôme de son amour ; c'est bien assez.
Le 24 novembre 1915, alors qu'il vient d'être nommé officier d'infanterie, il lui écrit
« Ce qui prime tout, c'est que ma victoire à moi c'est toi et qu'un amour comme le nôtre exige un très grand sacrifice. Tu es la plus belle du monde, tu es mon tout et je t'adore mon Madelon. Cet amour s'accroît sans cesse, je ne sais comment c'est possible mais c'est comme ça. Chaque jour nous unit plus. »
Ainsi, au cours de ses lettres journalières, Guillaume Apollinaire parvient à se persuader de la réalité de son amour et mieux à en persuader Madeleine. Ce qui n'était en somme qu'un jeu, un passe-temps et on peut le dire un exercice littéraire, une excitation mentale, semble être devenu un sentiment envahissant.
Tous les poèmes de cette époque portent l'empreinte du dieu Madeleine :
« Et cette petite voyageuse alerte inclina brusquement
La tête sur le quai de la gare de Marseille
Et s'en alla
Sans savoir
Que son souvenir planerait
Sur un petit bois de Champagne où un soldat s'efforce
Devant le feu d'un bivouac d'évoquer cette apparition... »
Apollinaire est en effet tenu d'imaginer, de créer à partir de lui-même cet amour qu'il ne saisit qu'en transparence, de communiquer à son cœur l'incessante agitation de son esprit. On pourrait donc craindre pour cet élan en quelque sorte mystique qu'il ne souffre de l'indigence des sentiments vraiment éprouvés, d'un manque de réalité charnelle et n'atteigne jamais le but qu'il se propose.
Mais pour conquérir Madeleine, pour la faire semblable à son image, Apollinaire dispose de tous ses trésors d'enfant bavard, de son intelligence féline, des mystérieux courants qui le parcourent et donnent à ce qu'il touche le tremblement poétique.
Le poète a pour lui sa complète innocence, son ingénuité. Aussi se livre-t-il sans contrôle à ses évocations et pour cela il se sert de tout ce qu'il a sous la main en ce moment, c'est-à-dire des Merveilles de la guerre
« Que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent pour regarder
Ce sont des dames qui dansent avec leur regard pour yeux bras et cœurs J'ai reconnu ton sourire et ta véracité. »
Dans les heures noires de « l'abri-caverne », la nuit, quand il n'y a pas une balle qui rôde, quand le silence est sur tout, même dans les mémoires, la solitude à la place majeure dans la poitrine, le poète se prend à douter de la réalité vivante de son amour. Et qu'importe après tout puisqu'il existe en lui, puisqu'il est devenu une personnalité encombrante qui se nourrit de tous ses mots
« ... Existes-tu mon amour
Ou n'es-tu qu'une entité que j'ai créée sans le vouloir
Pour peupler ma solitude
Es-tu une de ces déesses comme celles que les Grecs
Avaient douées pour moins s'ennuyer
Je t'adore ô ma déesse même si tu n'es que dans mon imagination. »
C'est dans la turbulence de l'attaque, à travers les déchirements de la terre amoureuse qu'il perçoit vraiment les battements de cœur de l'aimée. Elle est vivante alors comme cette guerre, comme ce soldat qui porte une main rouge à son front. Elle est là semblable à un arbre couvert de hautes feuilles, présence rafraîchissante tant attendue
« La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor
Ma pensée te rejoint et la tienne la croise
Tes seins sont les seuls obus que j'aime
Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit
Et voyant la large croupe de mon cheval j'ai pensé à tes hanches... »
Tandis que certains de ses camarades de combat ne vivent que par crainte de la mort et se contraignent à espérer, Apollinaire continue de mener logiquement - si l'on peut parler de logique à propos de la guerre - son métier de soldat. L'image de Madeleine flotte sur ces yeux et lui cache les taches rouges de la plaine. Au-dessus de toutes ces blessures il y a celle si fraîche de ses lèvres.
L'inaction, qui rend son amour immobile, lui pèse. Chaque jour il cherche à s'approprier un nouveau coin du paysage non seulement parce que c'est un peu de France qui lui revient mais parce qu'il est lancé toujours plus en avant par « les longues mains souples » de son amour
« Mon désir c'est la butte du Mesnil
Mon désir est là sur quoi je tire
De mon désir qui est au-delà de la zone des armées
Je n'en parle pas aujourd'hui mais j'y pense... »
Des ballons d'observation dans le ciel, des sapins brisés par les éclats d'obus, un fantassin qui passe aveuglé par les gaz, des prisonniers à la mine inquiète, les servants d'une batterie qui s'agitent autour des pièces, l'espion « qui rôde par ici, invisible comme l'horizon dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond », des soldats qui scient des planches pour les cercueils, tout cela, mais aussi
« Il y a un vaisseau qui a emporté ma bienaimée...
Il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour...
Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur... »
Chaque pensée le ramène à Madeleine, ramène Madeleine au bord de sa couche de glaise, dans l'étendue sans bord où il se meut. Il est prêt à croire que les barbelés vont fleurir au printemps comme les roses, que les chevaux de frise vont l'emporter lui et sa Lénore dans quelque lieu enchanté, que c'est en l'honneur de son amour que brillent dans le ciel toutes ces fausses étoiles. Il est confiant et les rigueurs de la guerre lui font ressentir davantage le confort de sa poitrine, la bonne chaleur de son sang. Poète, enfant, soldat, il est facile à émerveiller
« O phare-fleur mes souvenirs
Les cheveux noirs de Madeleine
Les atroces lueurs des tirs
Ajoutent leur clarté soudaine
A tes beaux yeux ô Madeleine. »
A mesure que les jours passent, les souvenirs s'épaississent et Apollinaire en vient très vite à les préférer à la présence même de l'aimée. N'oublions pas qu'il est un créateur d'idéal et qu'une Madeleine dépossédée des attributs merveilleux dont il l'entoure risquerait de le décevoir. Telle qu'il la porte en lui, elle est vraiment son « cher ouvrage » et il ne lui cache pas que c'est ainsi qu'il la désire
« Je serre votre souvenir comme un corps véritable
Et ce que mes mains pourraient prendre de votre beauté
Ce que mes mains pourraient en prendre un jour
Aura-t-il plus de réalité ?... »
Et cette réalité du moment n'est-elle pas assez cruelle pour qu'il ait le droit de rêver, de nommer l'oiseau qui chante tendrement, là-bas, on ne sait où, sur le dernière marche du ciel ? A la fenêtre du guetteur il écoute et le chant vient vers lui avec une telle douceur qu'il s'écrie
« Oiseau bleu comme le cœur bleu
De mon amour au cœur céleste
Ton chant si doux répète-le
A la mitrailleuse funeste... »
Apollinaire a conscience de l'immense apport moral de son amour. Il a dû pour conquérir Madeleine rechercher sous sa bogue épaisse de soldat la pulpe fraîche de l'enfance. Il est revenu à la source, à la première neige des mots, aux incantations du premier homme et a pu écrire sans paraître ridicule dans ce siècle de forçats :
« Ma bouche aura des ardeurs de géhenne
Ma bouche te sera un enfer de douceur et de séduction
Les anges de ma bouche trôneront dans ton cœur
Les anges de ma bouche te prendront d'assaut
Les prêtres de ma bouche encenseront ta beauté... »
Maintenant on est en mars 1916, depuis le 30 juillet de l'année précédente Guillaume est fiancé. Trois jours avant d'être blessé, avec cette singulière prescience qui le caractérise, il envisage la mort comme une éventualité possible et écrit à Madeleine
« Mon amour,
Je reçois deux lettres de toi. On va en ligne tout à l'heure. Je t'écris en hâte, car je ne sais pas bien ce qu'on va faire. En tout cas je te lègue tout ce que je possède et que ceci soit considéré comme testament s'il y avait lieu.
Enfin j'espère que pour le moment il n'y aura rien. Je t'adore. Il fait un temps très beau.
Je veux que tu sois forte en ce moment et toujours. »
D'hôpital en hôpital, Apollinaire va tenter de retrouver son ancienne vigueur en Madeleine. Presque journellement il lui écrit, la tient au courant de sa santé et lui recommande de ne pas s'inquiéter. Mais sa mémoire commence déjà à lui faire défaut et comment pourrait-il sans elle continuer à aimer celle dont il n'aime que le beau souvenir.
Les tristes lettres que son amie lui envoie lui font peur, il en vient à redouter sa présence tant désirée jadis et le lui dit. D'ailleurs il ne veut voir désormais personne et surtout personne qu'il connaisse. Le temps est bien passé où il pouvait écrire :
« La fusée s'épanouit fleur nocturne
Quand il fait noir
Et elle retombe comme une pluie de larmes amoureuses
De larmes heureuses que la joie fait couler
Et je t'aime comme tu m'aimes
Madeleine. »
Novembre 1916 ! Et ce qui fût un immense bûcher, le haut gerbier de sa joie, s'éparpille en pâles cendres au vent d'automne. La lettre du 23 marque le dernier adieu :
« Ma chère petite Madeleine,
Je suis fatigué, et il y a si peu d'amitié pour moi en ce moment à Paris que j'en suis navré.
L'égoïsme est partout.
Je vais beaucoup mieux.
Mais avec de grands étourdissements encore et une impotence fonctionnelle du bras gauche.
Je ne suis plus ce que j'étais à aucun point de vue et - si je m'écoutais je me ferais prêtre ou religieux. Je suis si éloigné. Et mon livre qui vient de paraître que je ne sais même pas si je te l'ai fait envoyer.
Sinon avertis-m'en je le ferai envoyer aussitôt.
Je t'embrasse mille fois. »
Désormais c'est un souvenir de souvenirs qui le hante. Annie, Marie, Lou, Madeleine, il ne sait plus très bien. Les visages se confondent et les noms se répondent. La douleur des séparations sans retour fait place à un lancinante nostalgie.
C'est alors que Jacqueline apparaît.
Plus que jamais le poète a besoin de tendresse mais d'une tendresse pratique, stable, qui n'ait plus à souffrir de la distance et se suffise du quotidien. Il rêve de calmes épaules où rouler sa tête étoilée. Il rêve et c'est ainsi qu'il passe le porche de Saint-Thomas-d'Aquin un beau jour de mai 1918.
Hélas ! Il vivra trop peu de temps avec son admirable épouse et durant ces quelques mois il sera trop près d'elle pour que son amour accomplisse le miracle de la révolution poétique. Toutefois les derniers vers de Calligrammes, les plus beaux sans doute, ceux de La jolie rousse éternisent Jacqueline en l'assimilant à la poésie
« ... Voici que vient l'été la saison violente
Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps
O soleil c'est le temps de la Raison ardente Et j'attends
Pour la suivre toujours la forme noble et douce
Qu'elle prend afin que je l'aime seulement
Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant
Elle a l'aspect charmant
D'une adorable rousse... »
Apollinaire a su donner à ses poèmes la jeunesse qu'il portait en lui. Il n'a connu de l'amour que le printemps, que la forme végétale, mais à travers laquelle il perçoit les rouges éclosions de l'été. Marqué au front depuis la première heure, il sait que la faux du soleil dès demain ensanglantera les plaines et qu'il ne sera plus là pour moissonner. L'avertissement de mars 1916 ne fait qu'ajouter à sa certitude et s'il ne parle pas de la mort, c'est que sa pudeur d'homme le retient. Il la voit, elle le serre à la gorge, le contraint à crier et cette angoisse qui monte donne à sa poésie ce sentiment d'amour unique, de poignante beauté.
Prodigue envers les femmes comme envers ses amis, Apollinaire n'a jamais marchandé son amour à la France.
Cet homme sans véritable patrie qui dit « je suis Romain » comme on dit : je suis du côté de la lumière, est avant tout le poète de Paris. Et comme il a « plus que les trois cœurs des poulpes pour souffrir » il en a également davantage pour aimer. Sa tendresse déborde sur les provinces.
« Noble Paris seule raison qui vis encore
Qui fixes notre humeur selon la destinée
Et toi qui te retires Méditerranée
Partagez-vous nos corps comme on rompt les hosties. »
Polonais, Italien, Français, homme des grands larges il est peut-être, après Goethe, le premier poète européen, il est à coup sûr le premier à avoir reculé les frontières jusqu'aux limites extrêmes du ciel bleu. Semblable au mystérieux Aldavid de l'Amphion faux-Messie, il apparaît en même temps à Prague, à Cracovie, à Amsterdam, à Vienne, à Berlin, à Livourne, à Mayence et à Rome. Sa haute taille lui, permet de niveler sans peine les montagnes. Il tresse les fleuves de sa grosse main d'enchanteur et les jette à poignées sur la terre, irriguant follement toutes les chairs qui ont soif.
« ... La Moselle et le Rhin se joignent en silence
C'est l'Europe qui prie nuit et jour à Coblence
Et moi qui m'attardais sur le quai à Auteuil
Quand les heures tombaient parfois comme des feuilles
Du cep lorsqu'il est temps j'entendis la prière
Qui joignait la limpidité de ces rivières... »
Mais avant que tous les peuples chevaliers de la terre prennent place à la table ronde, il y aura beaucoup de larmes et de déchirements. Aussi la mobilisation ne l'étonne pas. Lorsque le 31 août 1914 il rejoint Paris dans l'automobile de Rouveyre il peut dire usant du ton prophétique de Goethe à Valmy que la petite auto les a conduits dans une époque nouvelle.
Si le désespoir d'avoir perdu Marie le pousse à s'engager - c'est aussi cette volonté de sacrifice, cet amour forcené qui ne trompe pas. Sauver la France et tout devient possible. C'est elle qui dictera son amour, du moins le croit-il.
De la batterie de tir il écrit :
« Nous sommes ton collier France
Venus des Atlantides ou bien des Négrities
Des Eldorados ou bien des Cimmeries
Rivière d'hommes forts et d'obus dont l'orient chatoie
Diamants qui éclosent la nuit. »
Il ne se contente d'ailleurs pas d'aimer et de défendre, il admire. Les soupirs du servant de Dakar, s'ils déchirent le cœur, forcent l'admiration. Le jeune tirailleur a quitté son village africain, son père qui se battit déjà pour les Anglais, sa mère la sorcière, sa sœur « au rire en folie, aux seins durs comme des obus », et il ignore encore pourquoi il est là, quel est son âge :
« Mais au recrutement
On m'a donné vingt ans
Je suis soldat français on m'a blanchi d'un seul coup... »
II sait gré à tous ceux qui viennent l'aider dans sa tâche de défenseur. L'Italien, qui en août 1915 partage son quart de pinard, a d'avance toute sa reconnaissance. II y a tant de poitrines, maintenant et de tant de couleurs pour protéger la France qu'on ne peut plus douter de la victoire. On ne peut plus douter de la vie :
« ... Nous reprendrons les villes les fleuves et les collines
De la frontière helvétique aux frontières bataves
Entre toi et nous Italie
Il y a des patelins pleins de femmes
Et près de toi m'attend celle que j'adore... »
Sa foi est telle et son amour si grand que tout devient possible. Il lève les yeux et voit :
« ... Le glaive antique de la Marseillaise de Rude
S'est changé en constellation
Il combat pour nous au ciel... »
En tout temps Apollinaire sait se montrer plein de courage et de bonté, formes originales de l'amour. Il s'offre aux reconnaissances périlleuses ; on le voit, officier, coucher avec lui ses deux sergents pour que la ration de charbon de ceux-ci puisse servir aux soldats qui ont froid, son propre feu étant suffisant pour trois et pouvant même être utilisé pour réchauffer la soupe de ses hommes.
Humain, comme il est poète, c'est-à-dire nécessairement, il songe dans sa cagnat à ce qu'on a fait du peuple depuis 89. Il compare l'effort de son pays d'adoption à celui de l'Amérique et écrit dans La Femme assise :
En Amérique « le peuple s'appelle tout-le-monde : millionnaires, cultivateurs, journalistes, aventuriers et marchands de bestiaux... Ici, le peuple n'est formé que par les criminels, les pauvres gens, les ouvriers, les étudiants, les représentants, les artistes et les gens de lettres. Alors pourquoi s'étonner qu'il ait parfois de terribles révoltes ».
La guerre finie il faudra bien que cette grande voix se lève et demande sa part de champs verts et de fruits. Que la couronne d'épines sente enfin ses roses refleurir ! Que la joie soit partout !
Pour le moment il ne peut être question de cela. On ne peut parler de la joie sans que la honte vous monte aussitôt le long du visage comme des tiges de feu. Devant la morne désolation des plaines de l'Est et de ses hâves pèlerins, au bord des ruines et des vergers massacrés par les balles, il n'y a place que pour une immense compassion :
« Une femme qui pleurait
Eh! Oh! Ha!
Des soldats qui passaient
Eh! Oh! Ah!...
Et tout
A tant changé
En moi
Tout
Sauf mon amour
Eh! Oh! Ah! »
Apollinaire aime la terre à cause de l'homme et de la douleur qui y ont germé, mais aussi parce qu'elle est l'occasion de se souvenir, d'écouter dans ses veines ses sauvages torrents, sur son épaule le ruissellement de ses clairières. Son cœur est soulevé par les forces obscures qui dirigent le monde et le bercent. Il frémit d'aise aux accouplements monstrueux des continents. Le tressaillement d'un arbre se prolonge très longtemps dans sa chair. « Ivre d'avoir bu tout l'univers » il se souvient dans sa griserie des noces énormes de la terre
« L'Europe étend frénétiquement la rigide péninsule
Et l'Amérique s'étale largement ouverte
Où l'isthme humide tressaille aux tropiques
Amour sublime ! des nations naissent du couple démesuré
Dont les éléments favorisent les épousailles. »
Vêtu de fleuves, de drapeaux, de prairies, il participe lui-même à l'ardente migration. Il a ses tempêtes, sa neige, sa flore et la brume matinale de ses yeux. Sa main porte les villes. Il est un élément de plus dans les saisons. Car c'est un amour agissant qui le mène.
Comme son ami Max Jacob qui écrit : « le bruit de mes années ce sont des bruits d'avions » il peut dire que le bruit de ses années ce sont les lourdes exclamations du vent, l'appel des avalanches et la crécelle d'or qui secoue les vergers. Profondément chrétien par son éducation il adopte pourtant les dieux des anciennes tribus, les noirs bergers du monde. L'univers est en lui :
« Actions belles journées sommeils terribles
Végétation accouplement musiques éternelles
Mouvements adorations douleur divine
Mondes qui vous ressemblez et qui nous ressemblez
Je vous ai bus et ne fus pas désaltéré
Mais je connus dès lors quelle saveur a l'univers. »
Sa poésie placée sous le signe astral de la tête étoilée évolue selon le rythme des saisons. A certains vers, on reconnaît l'influence des équinoxes, des hautes lames, à d'autres celle de l'apaisante lune de juin. Telle image coïncide avec le passage des oiseaux froids, telle autre avec le retour des hirondelles. Comme sous l'herbe rase il y a le cœur brûlant de la terre, sous ses mots on découvre l'infinie tendresse de l'homme.
Apollinaire n'a de cesse avant d'avoir comblé. Il use de son amour sans mesure, il l'éparpille comme une rose des vents, mais n'est-il pas le dépositaire de tout l'amour du monde, de
« L'amour qui emplit ainsi que la lumière
Tout le solide espace entre les étoiles et les planètes. »
Il peut donner. Quand il aura tout donné il lui restera encore son cœur, sa main et son étonnante mémoire si prompte au souvenir :
« Il y a le chant de l'amour de jadis
Le bruit des baisers éperdus des amants illustres
Les cris d'amour des mortelles violées par les dieux
Les virilités des héros fabuleux érigées comme des pièces contre avions
Il y a aussi les cris d'amour des félins dans les jungles
La rumeur sourde des sèves montant dans les plantes tropicales
Le tonnerre des artilleries qui accomplissent le terrible amour des peuples
Les vagues de la mer, où naît la vie et la beauté
Il y a le chant de tout l'amour du monde. »
D'une vie tout entière remplie d'effusions, de débordements, de risques, d'une vie jaillie, Apollinaire a su tirer une poésie de haut vol qui monte loin jusqu'aux neigeux refuges de la beauté. S'il demande beaucoup au monde c'est qu'il est bien certain de rendre davantage.
Homme végétal, il étend son corps multiplié au ras des plaines, il est la grave semence du sillon. Son cœur nuit et jour le dispute à la terre.
De celui qui s'est offert ainsi à la souffrance, qui ajouta sans cesse aux constellations, on peut dire qu'il est bien près de la joie.
Maintenant je demande à ceux qui ne sauront jamais aimer, de s'introduire en ce domaine où gît la destinée d'un homme. Peut-être y trouveront-ils quelque raison nouvelle d'espérer :
« Habituez-vous comme moi
A ces prodiges que j'annonce
A la bonté qui va régner
A la souffrance que j'endure
Et vous connaîtrez l'avenir... »
Chapitre 4 – Croniamental ou Variations d’un esprit curieux
Depuis vingt ans tous ceux qui fréquentèrent plus ou moins Apollinaire et lustrèrent leurs épaules à son poil sanglier ont tenu à témoigner de leur ferveur en laissant de lui mille portraits saisissants. Il est à remarquer d'ailleurs qu'ils se sont davantage attachés à la personnalité physique du poète, à sa démarche byzantine qu'aux lourds charrois de son âme.
Apollinaire était ainsi fait qu'il devenait très vite une amitié encombrante ; on ne se passait pas facilement de sa présence, je veux dire qu'il demeurait dans l'entourage bien après son départ.
Je me l'imagine, non pas différent des autres hommes, mais partageant leurs vertus secrètes et leurs défauts. Seulement tout prenait chez lui des proportions singulières. Gros plutôt que grotesque il personnifiait la vie dans ce qu'elle a de déhanché et de vagabond. Il était sans frontières comme les torrents et se confondait avec la rue où il hantait.
.Curieux garçon, si l'on veut trouver de la curiosité aux gares maritimes pleines de trafic, mais à coup sûr garçon curieux, de cette bonne curiosité que dispensent pour nous un rideau qui se lève, une lampe qui bat, les signes mystérieux d'un livre.
Tout jeune le destin lui fournit l'occasion de s'inquiéter. La Méditerranée porteuse d'épaves des plus anciennes civilisations, les brèves apparitions d'une mère impénétrable comme les forêts nordiques, les cloches de Saint-Pierre-de-Rome qui agitent peut-être le secret de sa naissance, c'est assez pour lui donner le goût de saisir. Il est curieux comme un enfant, sans cesse en quête de féeries. S'il casse ses jouets c'est afin de créer de nouvelles beautés.
On s'est plu à propos d'Apollinaire à le représenter comme un bizarre chercheur de gargouilles et de fruits défendus. Certains ont voulu en faire un maniaque et même un malade. C'est un peu plus simple. Je le vois à l'heure des laitiers descendant le boulevard de Courcelles ou la rue Ravignan, une lanterne sourde à la main, un crochet de l'autre, sur le dos la vieille hotte du chiffonnier, fouillant avec patience les boîtes à ordures, plus tard au bord d'un terrain vague vérifiant son butin.
La curiosité est chez lui une habitude matinale, elle participe à son éveil, elle n'est jamais un souci. Comme Rimbaud, il aurait pu écrire
« J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires : la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. »
La rue, les bistrots, voir même les salons l'attirent. Il passe à travers les visages comme à travers les murs, il s'installe dans la vie pour la réinventer.
Il est capable de s'intéresser, sans toutefois y prendre part aux banalités de la vie quotidienne, de béer d'admiration devant le travail d'un charpentier ou d'un maçon ; curieux jusqu'à la gourmandise il rôde autour des fourneaux des bonnes cuisinières. A ce propos Vlaminck raconte qu'il n'hésite pas à essayer la recette des poires à la moutarde et des pissenlits à l'eau de Cologne, sa prédilection allant toutefois à la cuisine italienne, au riz aux pâtes, aux plats assaisonnés savamment, aux fruits, surtout les melons, les oranges et les raisins.
Comme « l'Ami Méritarte » qui voyait dans l'homme un animal artistique, il s'efforce de créer un art culinaire qui satisfasse non seulement l'appétit et la gourmandise, mais s'adresse encore à l'intelligence comme font les autres arts. On le voit mettre sur pied tout à tour un drame comestible, un régal de comédie, un repas lyrique, un banquet philosophique où sont servis des têtes de lapin qu'il faut briser pour en sucer la cervelle, des amendes, des noix et comme c'est le jour des Rois un gâteau dont la fève ne sert point à désigner un monarque, mais évoque simplement la sagesse pythagoricienne. Il va même jusqu'à préparer un grand dîner satirique avec potage funèbre et viandes saignantes.
En compagnie, il s'intéresse aussi bien aux ouvrages de dames qu'aux peintures de ses amis, il en discute avec érudition, mais aussi avec naturel prenant autant de plaisir à s'étonner lui-même qu'à étonner. De la littérature à la gastronomie tout lui est bon.
Souvent on le rencontre sur les quais de la Seine, « cette délicieuse bibliothèque publique », les poches bourrées de vieux livres et de livraisons policières, visiblement satisfait de ses trouvailles. Il lit énormément et aussi bien les faits divers des journaux que les lourds traités des anciens, avec passion. Après cela, durant toute une soirée il parlera du Chili avec abondance et précision tout comme il parlerait du Japon ou de Singapour. Il racontera par exemple que le savant Edison fait sa lecture favorite des romans d'Alexandre Dumas père, ou encore qu'à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg des gamines de douze ans viennent lire du Schopenhauer, ce qui détermine à tout moment des descentes de police.
Parfois sa curiosité le conduit à des découvertes qui font la joie de ses amis, témoin celle du « Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Ed. C » dont voici tirées quelques mentions facétieuses :
« Abélard
Incomplet coupé.
Ange Benigne
Perdit le courrier de ces dames - Av. notes.
Beaumont (A.)
Le beau colonel - Parf. état de conserv.
Courteline
Un client sérieux - rare - recherché.
Dumas fils (A.)
L'amie des femmes - complètement épuisé.
Fleuriot (Z.)
Un fruit sec - couronné par l'Académie française. »
L'esprit encombré de lectures, connaissant Virgile autant par ses commentateurs et ses traducteurs depuis Ascencius jusqu'à l'Abbé Delille que par ses textes mêmes, lisant Littré aussi facilement qu'une gazette, on pouvait craindre pour Apollinaire que son œuvre ne supporta longtemps, et de funeste façon, l'héritage de tous les siècles.
La plupart des poèmes du Bestiaire n'échappent guère au mécanisme trop frais de la mémoire et il suffit d'écouter Orphée pour s'en convaincre :
« Admirez le pouvoir insigne
Et la noblesse de la ligne
Elle est la voix que la lumière fit entendre
Et dont parle Hermès Trismégiste dans son Pimandre. »
Apollinaire connaît aussi bien Simmias de Rhodes que Walt Withman, Rémi Belleau que Jules Laforgue, mais il s'attache bien davantage à la trouvaille qu'à la beauté en soi. Ainsi ignore-t-il à peu près tout des grands classiques grecs tandis qu'il connaît les dieux et les légendes de l'antique Hellène. Le moyen âge tant français qu'allemand, Brocéliande, Viviane, La Table Ronde, Roland le séduisent comme une nouvelle enfance ; Vulcain, Carabosse et les fées forgent pour lui sept épées flamboyantes.
Il a le goût des mots barbares, des archaïsmes et ceux-ci viennent naturellement sur ses lèvres
« Mort d'immortels argyraspides
La neige aux boucliers d'argent
Fuit les dendrophores livides
Du printemps cher aux pauvres gens
Qui resourient les yeux humides... »
A cause de cela on l'a accusé de pédantisme, d'avoir recours aux souvenirs livresques pour suppléer à une indigence totale d'imagination et de pécher par excès de culture.
Il est sans doute exact qu'Apollinaire s'est trouvé maintes fois emporté dans le terrible remous des réminiscences, mais c'était bien plus contre son gré qu'une tentative astucieuse de s'élever sur des ruines. Il fut le premier à souffrir de son érudition comme de sa trop grande intelligence.
Véritablement soulevé, il ne contrôle pas assez son débit. Rien d'étonnant alors qu'à son propre flot se mêlent toutes les eaux souterraines de sa mémoire, que sa belle transparence soit parfois troublée par les limons venus des antans.
Dans La Femme assise on le voit sous les traits de l'officier Anatole de Saintariste évoquer le spectacle merveilleux de l'Ennéade et le cri des neufs de la Renommée pour échapper à la pensée obsédante de la guerre. Souvent il lui arriva dans la vie de puiser aux fraîches fontaines des légendes les plus pures raisons d'espérer. Faut-il donc voir encore là un nouvel effet de littérature
« Vieux rois, qui ne partez pas en guerre, souvenez-vous de Moïse qui fabriqua un anneau d'oubli pour amortir les voeux impudiques que Thaïba nourrissait pour lui... Souvenez-vous de Moïse qui fabriqua un anneau de mémoire pour Séphora, sa femme, lorsqu'il se sépara d'elle pour aller à la cour de Pharaon... »
Causeur intarissable, Apollinaire n'hésite pas, quand l'occasion s'en présente, à faire étalage de son érudition. Il procède de telle sorte que seuls les initiés ne se laissent pas jouer et savourent en connaisseurs l'inimitable parodie. Celui qui fut de longs mois le compagnon de Jarry prend plaisir à mystifier et à surprendre. Il a un sens étonnant du comique et je ne vois guère que Chaplin pour l'égaler. Citant, ajoutant ou retranchant à son gré maints détails à l'Histoire, transformant tout et discutant sur un ton volontairement emphatique, il ne craint pas de passer pour un cuistre. Que le fait se produise et c'est pour sa plus grande joie. Venant de citer de mémoire tel passage d'Ovide ou de Pindare si quelqu'un prononce devant lui le nom de Bossuet, il dira : « Mais, qui est-ce ? » Car s'il existe dans l'esprit d'Apollinaire des parties plus ou moins éclairées c'est que le poète en a décidé ainsi.
A propos de Gérard de Nerval qui disait avec désinvolture : « Vous vous rappelez ce passage de Bhavabouti... ». Apollinaire a écrit, trouvant l'occasion trop belle pour ne pas se juger lui-même : « Esprit charmant ! je l'eusse aimé comme un frère. Et qu'on ne s'y trompe point, une telle conversation n'indique pas ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler de l'érudition et qui n'en est pas, c'était tout simplement l'indice d'une imagination ardente qu'il essayait de mettre à portée de son interlocuteur en choisissant parmi les notions que tout le monde peut avoir acquises, les plus rares ».
C'est par l'entremise des livres (on ne se méfie jamais assez des mauvaises fréquentations) et peut-être aussi par celle de son ami Max Jacob que va te développer en lui un goût de plus en plus prononcé pour les sciences occultes. Certes il ne va pas comme le célèbre docteur jusqu'à pactiser avec Satan, mais n'hésite pas néanmoins à franchir les trois degrés ténébreux et les sept parvis de l'enfer proprement dit pour invoquer l'apôtre Pierre sous les traits de « Simon Mage ». Alors il voit, « silencieux comme le vol des chauves-souris s'avancer à califourchon sur des zèbres, des hémiones, des onagres, ou debout sur des éléphants portant de belles citadelles, ou bien assis sur des panthères, ou encore à pied, menant des ours, des onces enchaînées, les quatre-vingt-dix-mille démons présents à l'exode de l'Egypte ».
Cet engouement pour la magie le rend plein de respect pour les cartomanciennes et il consulte le marc de café d'autant plus volontiers que son esprit est naturellement porté à la superstition. Il raconte, au cours d'une nouvelle qui suit Le Poète assassiné, qu'ayant décidé, un jour, d'offrir un bijou à son amie, il entra avec elle dans la boutique du juif Baka et que celui-ci leur confia, d'après ses croyances qui sont certaines, que l'ombre quittait le corps trente jours avant qu'il ne meure. En sortant, il s'aperçut « avec un plaisir singulièrement atroce » que l'ombre de sa compagne l'avait quittée.
Il faut voir dans La Femme assise avec quelle fidélité il rapporte toutes les superstitions que les heures vides de la guerre ont fait naître sur le front : superstition relative à l'allumette unique donnant du feu à trois cigarettes, superstition de l'autobus du rêve, de l'or monnayé. Une semaine avant sa mort tandis qu'il déjeunait avec des amis, du sel fut renversé sur la nappe et il en demeura toute la journée attristé, même inquiet.
Apollinaire aime à s'entourer de statues nègres, de fétiches, de lampes et de ces livres pleins de faubourgs ensanglantés, de cris et de morts subites. Curieux Lazare, il ressuscite dans les personnages les plus divers. Ses voyages, ses rêves sont peuplés de silhouettes mystérieuses, fantômes de tous les âges ; il y a une porte qui claque, un chien qui hurle très tard dans sa nuit.
Alors qu'il se trouve en Autriche, il rencontre dans une ruelle de Schönbrunn un vieillard masqué dont la face s'orne d'un épouvantable bec d'aigle. Il parvient à grand peine à surmonter son effroi et va se résoudre à écouter le vieillard quand une troupe de soldats et de laquais envahit la rue, mettant l'étrange promeneur en fuite. Il assiste à la poursuite, à l'arrestation et à la mise à mort de l'infortuné. Par la suite il apprend, dans une réunion mondaine, que ce vieillard serait le fils du Duc de Reichstadt, fils issu d'un mariage secret avec une demoiselle de grande noblesse allemande.
Le 23 février 1912 parcourant à pied cette partie du Tyrol qui commence presque aux portes de Munich, il est surpris par la nuit, s'égare et cherchant quelque anfractuosité de rocher pour s'abriter du vent jusqu'à l'aube, découvre une caverne où il perçoit bientôt comme un bruit lointain de musique. Etonnement, terreur, mais la curiosité est plus forte, il s'achemine résolument dans le but d'explorer cette caverne de sorcellerie. Un peu de lumière qui filtre, un loquet qui grince sous la main et le voici dans une grande salle dont les parois sont recouvertes de marbres multicolores et de coquillages. Au fond, une porte entr'ouverte par laquelle il peut voir une cinquantaine de jeunes gens de quinze à vingt-cinq ans bavardant avec animation. Quelques instants se passent et Apollinaire assiste tour à tour à un repas d'animaux vivants et à une singulière orgie où des jeunes hommes ceints d'une ceinture réunie à un appareil assez semblable au cylindre des phonographes, étalant leur vigueur, lui paraissent ressembler « à Ixion lorsqu'il caressait le fantôme des nuées, l'invisible Junon ». Lui-même assouvit sa passion et s'étant perdu à nouveau dans le souterrain débouche soudain dans une petite salle où se tient vêtu comme un grand seigneur français du règne de Louis XVI, le Roi-Lune qui n'est autre que le roi malheureux et fou Louis II de Bavière, qui, ainsi que le croit l'opinion populaire des Bavarois, n'est point mort dans les eaux sombres du Starnbergersee.
Le roi est assis devant un clavier, il appuie sur une touche qui actionne un microphone et tout un paysage musical s'éveille. Apollinaire est ainsi transporté du Japon à Papeete, de Mexico à-Saint-Pierre de la Martinique, mais le monarque s'étant aperçu de sa présence il est obligé de s'en fuir sous la menace de se voir couper les testicules. Après avoir erré deux heures dans cette étonnante caverne, il se retrouve enfin dehors. La forêt s'illumine, des fanfares éclatent, le vieux roi et sa cour apparaissent. Gracieusement le Roi-Lune s'envole et va se percher dans un arbre où il continue de parler, puis il reprend son vol et avec lui toute sa compagnie qui disparaît bientôt dans les airs « comme une troupe d'oiseaux migrateurs ».
Apollinaire a fait de ces aventures de rêve des nouvelles débordantes d'imagination et d'amour. Il s'est emparé de personnages aujourd'hui légendaires pour les situer dans une nuit stellaire où seule la beauté est capable de s'y reconnaître. Leur démarche s'inscrit sur un tapis de brumes et de mémoires désolées, ils ressuscitent plus mystérieux que jamais sous le voile délicat de la fantaisie tel ce merveilleux chevalier d'Airain, étincelant et magnifique, qui, bien qu'il fut mort depuis longtemps, parcourait, un beau matin du mois de janvier 2105, les rues de Londres.
Ce n'est pas tant l'action que les personnages et les présences familières qui les entourent qui créent le mystère. Chaque visage a été soigneusement lavé, de telle sorte qu'il ne reste plus aucune trace des vieux sourires et des larmes. Repeint, il offre une figure rayonnante ou sertie dans les griffes de l'ombre. L'émotion vient alors de la lenteur que met l'esprit à reconnaître son objet. On n'est jamais tout à fait sûr de se trouver en face d'un ami ou d'un étranger. Il y a bien un vague air de ressemblance, mais si lointain, si improbable qu'on en est réduit à chercher là où elle est la raison même de la beauté, celle-ci résidant pour une bonne part dans des procédés d'éclairage indirect.
Mais le mystère est ailleurs que dans l'imagination du poète. Au bord d'une route : une roulotte fatiguée, des filles aux longs pendants d'oreille, un chien maigre, le sifflement d'un fouet, quelques notes de tambourin, c'est assez pour qu'Apollinaire se souvienne du petit village bosniaque où tournait une ronde échevelée et chantante. Il revoit tout :
« Une vieille tzigane à face desséchée avait tiré de sa poche une longue chevelure noire, coupée par surprise à quelque misérable gardeuse d'oies, endormie dans une prairie avec un vieux peigne cassé, elle peignait cette chevelure triste comme une relique de morte, en marmonnant inintelligiblement ».
Les coutumes, la couleur, le côté volontairement délibéré de ce peuple tzigane le séduisent et s'il osait il prendrait part à « l'otmika ». Il a envie de cette bouche violente comme un fruit sauvage, tandis que les guitares résonnent et que sous les jupons courts roulent les croupes « lourdes et bulbeuses ». Bohême ! pays merveilleux
« où l'on doit passer mais non séjourner sous peine d'y demeurer envoûté, ensorcelé, incanté ».
Qui saura jamais les secrets de cette race errante, de ces filles vagabondes comme le feu. Désormais tant de sangs sont mêlés sous leur écorce qu'elles ont oublié le nom de leur premier pays, elles ne désirent rien d'autre que la beauté, le hâle et les grands horizons, elles s'approchent des sources ; la simplicité de leur vie fait crier au miracle et leur confère assez d'autorité pour diriger nos destins
« La Tzigane savait d'avance
Nos deux vies barrées par les nuits
Nous lui dîmes adieu et puis
De ce puits sortit l'espérance... »
Lors de son voyage en Europe centrale, Apollinaire a fréquenté ces tavernes enfumées où coule la bière amère de Pilsen, ces ruelles où pour la nuit chaque maison s'est changée en lupanar. Souvent il s'est retrouvé entouré de femmes en peignoir au fond d'un quartier réservé, sollicité d'amour et craignant pour sa vie avec dans sa poitrine la chaude haleine de l'angoisse ; il s'est réveillé dans sa petite chambre d'hôtel borgne aux cris de Juifs batailleurs achevant un partage derrière la cloison.
Peut-être encore plus que les Tziganes ces petites gens au front têtu font impression sur lui. Il les considère avec une sorte de crainte poussée jusqu'à l'admiration comme si chacun d'eux attestait aux hommes « la réalité du drame divin et rédempteur qui se dénoua sur le Golgotha ». Il trouve du mystère dans toute leur personne, dans leur façon de refermer les doigts et d'affronter l'ombre, dans ce ricanement qui les secoue parfois avec un bruit de vertèbres, dans ce maintien grave des vieux béliers.
Longtemps il se souviendra des quelques heures passées à Prague en compagnie de ce vieillard encore vert dont il ne tarde pas à apprendre qu'il se nomme Isaac Laquedem autrement dit le Juif errant. Avec lui, il parcourt les petites rues pustuleuses aux étalages de vieux habits, de ferrailles et de choses sans nom, il s'amuse aux spectacles des enfants qui s'apostrophent en tchèque ou en jargon hébraïque, il pénètre dans la synagogue pour baiser la thora. Et lorsque fatigué d'errer à travers ces banlieues interdites il retrouve sa couche, c'est pour rêver de consoler la charmante Marizibill, Juive ardente de quinze ans !
« ... Elle se mettait sur la paille
Pour un maquereau roux et rose
C'était un Juif il sentait l'ail
Et l'avait venant de Formose
Tirée d'un bordel de Changaï... »
Si Apollinaire se sent ainsi attiré vers les descendants de David ce n'est pas uniquement par vaine curiosité. Certes il est toujours curieux de l'âme et la devine sous ces vêtements rapiécés, dans ces gestes mal habillés et ces jurons qu'on ose à peine traduire, il la soulève au bord de cette vie grouillante dans laquelle ces gens venus de toutes parts « s'agitent agréablement ». Il est surtout plein de pitié pour ces éternels proscrits qui n'en ont pas fini de porter la faute de leur Judas, sa pensée les accompagne dans tous leurs exils, dans tous leurs ghettos. On peut le croire sincère quand il écrit :
« Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants
Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages
Ils espèrent gagner de l'argent en Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune. »
Esprit prompt à se souvenir il associe à ces départs tous les émigrants. Il est avec eux sur les embarcadères au fond d'un port en automne, plus tard dans les fourgons recouverts de toile rude, à pied parmi les hennissements des chevaux, sur ces routes de l'ouest qui ne mènent nulle part, vers nulle auberge. Il a beaucoup maigri. Voici qu'on ne reconnaît même plus son visage tant la pluie et le vent ont raviné ses joues. Il marche l'œil inquiet comme une boussole errante, regard obstinément fixé sur l'horizon.
Il semblerait à la lecture de La Femme assise qu'Apollinaire ait partagé dans sa chair l'existence de cette troupe d'émigrants débarquée en Californie pour se joindre aux sectaires polygames de l'Amérique. C'est bien lui sur la place de ce curieux village, entouré d'enfants vicieux, examinant avec étonnement les boutiques de modistes, de luthiers, de marchands de tabac, souriant aux enseignes multicolores dont la plupart pour montrer que le commerçant est mormon portent la figure d'un œil peint en bleu.
Une nouvelle vie qui n'est pas celles des Tziganes, non plus celle des quartiers pauvres de Cologne ou de Prague lui est soudain révélée. Voici des Indiens coiffés de bonnets en fourrure de vison et chaussés de mocassins précieux, des personnages vêtus de longues robes blanches, les Danites, des Scandinaves, des Russes, des Anglais, des Allemands, Mormons de toutes races et de tous âges, « les uns engoncés dans leurs cols évasés avec des cravates élégamment nouées et des redingotes bien coupées et d'autres pauvrement mais proprement vêtus. » De d'autre côté de la place ce sont les Gentils auxquels se sont mêlés les hommes inférieurs, les nègres, les jaunes et toute la population farouche des aventuriers. Entre ces deux assemblées, l'assemblée des Mormonnes, toutes plus élégantes les unes que les autres avec leur ventre qui se balance devant elles et leur donne une noble apparence.
Il est bien évident qu'Apollinaire n'a jamais entrepris de voyage en Utah et par conséquent n'a point connu les douceurs de la vie mormonne, mais il s'est plu à imaginer, peut-être à travers les livres, ce paradis terrestre où l'homme atteint enfin sa joie qui est de « pouvoir procréer comme divinité. »
« La polygamie, écrira-t-il, est la santé pour l'homme et pour la femme, elle supprime la prostitution, les malheurs et les maladies qu'elle entraîne, elle augmente la majesté de l'homme, en satisfaisant son goût inné pour la domination. »
Qu'un prophète, en l'occurrence lui-même, se mette à parler, l'émotion de la foule devient si forte que les femmes enceintes ne pouvant plus supporter le poids de leur ventre secoué tombent sur le sol et que le prêche s'achève dans une détente fanatique.
C'est ce que voulait l'auteur. Ainsi voilà satisfait une fois de plus son goût de l'étrange, du jamais vu, de l'original.
Mais tandis qu'Apollinaire s'attache à tout ce qui n'est pas construit selon des règles d'évidente beauté, tandis qu'il se rapproche un peu plus du soleil, il ne tarde pas à son tour à exciter la curiosité. Tous ses amis d'alors se souviennent de ce grand garçon un peu pâle dont on ne pouvait dire à première vue s'il était le type du parfait gentleman ou du cocher de bonne maison. Il est plein de bizarreries et cela, non par attitude, mais parce que son esprit est incapable d'envisager quoique ce soit de prémédité. L'agitation de sa vie est telle qu'il doit se saisir de l'immédiat et faire en sorte que rien ne puisse le dépayser.
En 1915 il écrit à Madeleine : « Vous aimez le décor, Madeleine, moi aussi, mais sans doute n'avez-vous pas encore les idées que j'ai là
dessus. Moi j'aime les décors de notre temps... Ainsi j'ai vu hier dans une cagnat un jambon superbe et entaillé, c'était ravissant, un violon à
un mur est une merveille et j'ai pensé qu'un des plus jolis décors dans une chambre serait de bien faire tendre, comme papier de tenture, des journaux de toutes sortes. » La réalité de la guerre est si forte qu'elle ne lui laisse pas le temps de construire un cadre à son bonheur futur. Il sait seulement que Madeleine est là, qu'elle sera toujours là et que par conséquent l'avenir saura bien se contenter du rude confort des temps de feu.
L'étrangeté de son esprit apparaît d'ailleurs bien davantage dans ses écrits littéraires, en particulier dans les contes de l'Hérésiarque où la fantaisie ne le cède qu'à un débordement d'imagination sadique, et ce n'est pas sans un secret frémissement qu'on écoute par exemple le baron d'Ormesan narrer sa dernière aventure.
Alors qu'il est devenu par le plus mystérieux des hasards barman dans la cité du chercheur d'or Chislam Cox, d'Ormesan apprend, un jour d'hiver où la température est tombée à cinquante degrés au-dessous de zéro, qu'il ne reste plus aucune provision à la cité et que, dans l'impossibilité où celle-ci se trouve d'en recevoir, Cox conseille aux cinq mille personnes qui composent la population de se suicider en même temps sur la place publique. D'Ormesan se rend au lieu-dit accompagné de sa maîtresse Marie-Sybille ; on se suicide en chœur, mais le baron se manque et demeure l'unique survivant. Il quitte alors la ville maudite, emportant pour se nourrir en route deux cuisses de femme fraîchement coupées
« Le corps des femmes est plus grasset, leur chair est plus tendre. J'en cherchai un et lui coupai les deux jambes. Ce travail me prit plus de deux heures. Mais je me trouvai à la tête de deux jambons qu'au moyen de deux lanières je suspendis à mon cou. Je m'aperçus alors que j'avais coupé les deux jambes de Marizibiil. »
Toutefois il ne faut pas croire Apollinaire uniquement préoccupé de réussites de ce genre. Le macabre n'intervient la plupart du temps que pour créer un effet de surprise, il est rarement une fin et toujours un élément de plus pour la beauté. Et puis n'oublions pas que nous avons affaire à un maître ironiste qui n'hésite devant rien pour mieux confondre le lecteur. Déjà celui-ci s'attendrit lorsqu'il apprend qu'on a découvert voici près de soixante ans dans la région de Szepeny en Hongrie une châsse contenant un corps embaumé qu'on croit être celui d'une martyre chrétienne et que Rome a canonisé sous le nom de sainte Adorata, mais Apollinaire n'hésite pas longtemps à lui révéler la vérité : tandis qu'il visitait lui-même la petite église de Szepeny qui contient la châsse très vénérée, il se trouva soudain en présence d'un vieillard et celui-ci lui avoua que cette sainte avait été sa maîtresse et que c'est lui, alors étudiant en médecine, qui l'embauma, l'ayant trouvé morte un matin près de lui. Il semble par moment qu'Apollinaire prenne plaisir à ridiculiser les plus pures émotions, jusqu'à celles qu'il a lui-même tant de fois éprouvées. A-t-il donc oublié ces heures durant lesquelles il polissait gravement des bagues d'aluminium pour la fiancée? Une bague ! comme si ce misérable chaînon était capable de réaliser le miracle de la fidélité en amour ! Désormais il ne pense plus qu'à celle qu'il découvrit un jour chez un chiffonnier et dont il sut qu'elle fut offerte par un vieillard à sa maîtresse avec ces paroles « Cette bague, ma chère enfant, doit t'être à jamais précieuse. Qu'elle soit à jamais le souvenir de notre amour. Cette bague porte à l'intérieur la date gravée du jour où nous connûmes et la pierre qui l'orne est un calcul de ma vessie. »
Mais peut-on dire avec assurance qu'Apollinaire se moque. Ne souffre-t-il pas plutôt de toutes les bizarreries de la vie et de son caractère. On peut tout au moins supposer qu'il surprend pour donner prétexte à réfléchir, pour apprendre aux hommes à considérer leurs faims qui sont terribles, leurs vertus qui ne sont rien en regard du suprême abandon de Dieu. Rappelons-nous ce qu'il écrivait à propos de Cyprienne Vandar dont le crépuscule assombrissait lentement l'existence : « Riait-elle ? on sentait bien qu'elle ne se doutait pas de la tristesse qui l'enveloppait. »
Parce qu'il sait, parce qu'il a toujours encaissé le coup de poing de la douleur avec le sourire, il a le droit de se montrer ironique et de répondre aux rigueurs du sort par le sarcasme ou la plaisanterie. Comme un de ses amis il serait capable de dire à quelqu'un qui pleurait sa mère enterrée du matin : « on ne pleure pas ces choses-là. »
Il faut pour le bien saisir le dépouiller de son vocabulaire byzantin, des accessoires de grand guignol dont il s'embarrasse volontairement afin de ne pas affliger le lecteur de ses larmes. Il a des pudeurs de femme, une maîtrise de soi étonnante et on ne l'atteint dans ses eaux vives que lorsqu'il veut bien ouvrir ses vannes, alors c'est le débordement. Mais avant de pouvoir toucher ce cœur-source, avant qu'il nous soit donné de pénétrer dans cette abysse de lumière où toutes les dimensions sont bouleversées, où tout a repris l'aspect des choses simples et des charités de la première heure, que de pièges sont sous nos pas recouverts de toutes les séductions de l'intelligence ! Il nous persuade de son amour pour le haschich, l'opium et les regards empoisonnés quand il fait ses délices de la verdure et des bons fourrages de l'été.
De même il aime induire en erreur ceux qui s'intitulent déjà ses disciples. Ce qu'il veut bien confier de son art poétique doit mener fatalement à la faillite ceux dont l'esprit est inapte à saisir l'aspect fugace de la beauté. Il s'emploie d'ailleurs à dérouter sans méchanceté aucune, par fantaisie et peut-être avec le secret espoir d'avoir par la suite à prêter main-forte.
Le plus souvent les plaisanteries auxquelles il se livre sont innocentes et ne cherchent à attirer que les regards complices. Alors que Jean Royère lui a confié à La Phalange la chronique des romans il en profite pour rédiger des comptes rendus de livres qui n'ont jamais existé.
La première fois que Jacques Dyssord le rencontre, Apollinaire installé à une table du café des « Deux Magots » corrige les épreuves d'un poème intitulé Hier et destiné aux Marges :
« Hier, c'est ce chapeau fané
Que j'ai longtemps traîné.
Hier, c'est cette pauvre robe
Qui n'est plus à la mode...
Hier, c'est mon cœur mal donné... »
Ce poème est signé : Louise Lalanne, et Guillaume présente ainsi son auteur ; « Un certain talent, mais embêtante comme tous les bas bleus. »
« J'appris par la suite, raconte Dyssord, que Louise Lalanne et lui ne faisaient qu'un. Mais pendant un certain temps cette signature intrigua fort les lecteurs de la revue kaki d'Eugène Montfort. Et ce ne fut qu'en janvier 1910 que cessa cette innocente plaisanterie. Les Marges nous apprirent que Louise Lalanne venait d'être enlevée par un officier de cavalerie. »
Apollinaire n'hésite pas à faire lui-même les frais de la plaisanterie. On le voit se rendre en soirée avec une cravate dessinée sur sa chemise par son ami Picabia, un autre jour procéder à la réorganisation de son home en brisant ses meubles afin de les introduire plus commodément par la porte trop étroite de sa chambre. Pour l'amusement de ses amis il inventera de toutes pièces le discours de réception à l'Académie, de tel auteur à la mode ou encore entreprendra de donner une valeur marchande aux monuments publics de Paris. Il ira même, pour l'ébahissement des naïfs, jusqu'à s'écrier devant le plus lamentable des chromos : « C'est plus beau que Cézanne » et proclamer hautement que Fantômas est la plus grande épopée du XXème siècle, ce qui après tout n'est peut-être pas tant que ça une boutade.
Sa prodigieuse culture lui permet dans ces divertissements familiers de donner à des énormités l'apparence du sérieux.
Il présente d'ailleurs la plaisanterie au milieu d'un amas d'anecdotes et un peu comme la fève du gâteau des rois, de telle sorte que celui qui tombe dessus ne sait s'il doit l'avaler en douce ou remercier la fortune.
J'ai déjà raconté ces nuits de la rue Ravignan pleines de bouffonnerie et de gravité où Apollinaire fait figure à la fois de pitre et de prélat. Picasso apporte ses propos d'atelier et les souvenirs de la brûlante Espagne, Max Jacob les potins du quartier, Salmon des manuscrits « trouvés dans un chapeau », Apollinaire son verbe, sa flamme, son rire.
Chacun est là pour faire part. Et ces soirées se prolongent non seulement très avant dans l'aube mais encore longtemps dans les souvenirs. En fait rien n'est perdu de tout ce qui a été dit. Apollinaire rentre de la Nationale où il a noté pour ses amis quelques légendes des lithographies de Gavarni. Plus tard lorsqu'il entreprendra la rédaction de La Femme assise il se rappellera l'expression amusée des compagnons et n'hésitera pas à nous révéler ses trouvailles
« Eh bien ! on dit que certain colonel se marie... Te voilà veuve ma pauvre bayadère.
« Hélas ! oui mon pauvre baron, et ta femme aussi. »
De la rue Ravignan et aussi de quelques cafés comme le Vachette et les Deux Magots est née une littérature qu'on pourrait appeler celle de l'anecdote et du souvenir. Apollinaire a été sans doute un des premiers à s'entourer de ses amis dans son œuvre et cela à la place la plus inattendue.
La Petite Auto des Calligrammes par exemple nous ramène à cette nuit d'avant la guerre où trois ombres quittent en hâte Deauville pour Paris. Les poèmes-conversations eux-mêmes sont nés d'un besoin toujours plus grand de raconter et de revivre par la pensée ces après-midis de bistrot où rien n'était peut-être dit d'essentiel mais où la beauté était cent fois effleurée. Quant au Flâneur des deux rives c'est la longue promenade à travers Paris d'un homme à qui rien n'échappe, chronique d'Auteuil et des amitiés soudaines, vol avec effraction dans les bibliothèques les plus fermées, descente à la cave de M. Vollard où lors de la rédaction du Grand Almanach Illustré Jarry « épouvanta ceux qui ne le connaissaient pas, en demandant après-dîner la bouteille aux pickles qu'il mangea avec gloutonnerie. »
Cette littérature ne va d'ailleurs pas tarder à faire fortune. Carco avec De Montmartre au Quartier Latin, Fargue et Le Piéton de Paris, Rouveyre, Salmon, Dorgelès, Vlaminck vont s'essayer dans le genre et atteindre aussitôt à la plus parfaite réussite.
L'habitude qu'il a prise de raconter et de se raconter va servir énormément Apollinaire pour l'écriture. On a toujours l'impression qu'il intervient directement dans le drame, qu'il n'assiste pas en spectateur attentif mais agit et n'hésite pas à payer de sa personne. Quand il nous rapporte les Souvenirs bavards de cette petite chambre d'hôtel à Londres nous sommes persuadés qu'il était là lorsque le ventriloque Chislam Borrou se disait à lui-même :
« Chislam, vous avez été la joie universelle, le rire même du monde tout entier. C'était trop pour une femme. Ce qui est pour tous peut bien, par l'énormité, effrayer un seul. »
Ce penchant un peu trop prononcé pour l'anecdote donne parfois à Apollinaire les trucs d'un commis-voyageur. Il ne manque jamais l'occasion de placer un bon mot ou un calembour et cela aussi bien dans sa vie que dans son œuvre, ce qui n'est pas toujours du meilleur effet
Ainsi l' « Ermite » d'Alcools s'écrie :
« Les humains savent tant de jeux l'amour la mourre
L'amour jeu des nombrils ou jeu de la grande oie
La mourre jeu du nombre illusoire des doigts
Seigneur faites Seigneur qu'un jour je m'enamoure. »
Et les diables dans les abîmes levant la tête pour regarder le Christ :
« Ils disent s'il sait voler qu'on l'appelle voleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur. »
Il n'est pas jusqu'au baron des Ygrées qui ne se réveille auprès du lit macabre où se carre « le macchabée de Macarée » pour sangloter
« Ah ! La Napoule aux cieux d'or, j'ai perdu ma poule aux yeux d'or. »
S'il est avec ses amis, Apollinaire transforme vite un honnête café en salle de garde et peuple les échos de ses gaillardises. Il apparaît comme ce grenadier de Flandres descendu dans une auberge pour y boire du vin nouveau. Sa voix, sa haute carrure, sa main faite pour tout prendre achève de donner la ressemblance. Il scande les refrains grivois en frappant des deux poings sur la table et briserait volontiers les verres à la façon scandinave.
Amoureux de la vie comme il l'est, il trouve dans ces chansons les grasses nourritures qui conviennent aux hommes de bord, à ceux qui sont venus pour exprimer tout le suc de la terre. Interprétées par lui ce ne sont presque plus des grossièretés mais des souvenirs qu'il raconte et chacun se retrouve sur une route poudreuse avec le sac, sous une tonnelle avec le rire éclatant des servantes, au fond d'un port de l'ouest, un soir d'escale. Le génie du poète a tout transformé.
Aucunement musicien, celui qui avoue ne pas distinguer « Au clair de la lune » de la « Marseillaise » se laisse prendre à ces rythmes courts et évocateurs, ils l'accompagnent dans ses promenades et il construit sur ces airs entraînants aussi bien que sur les chants liturgiques ses poèmes souvent les meilleurs.
Ainsi, il ne faut pas s'étonner de voir le « deuxième canonnier conducteur » saluer à son réveil « la fameuse Nancéenne que je n'ai pas connue » et demander sous forme de calligramme :
« As-tu connu la putain de Nancy
Qui a foutu la v... à toute l'artillerie
L'artillerie ne s'est pas aperçu
Qu'elle avait mal au... »
Il est naturellement gaulois, mais gaulois de la bonne époque, je veux dire avec sagesse. Il considère qu'à tout prendre il est préférable de railler et de gaillardiser que de mener en secret une vie parfaitement dissolue et que la morale n'exclut pas une certaine hardiesse de langage. Certes, je n'irai pas conseiller à toutes les jeunes filles de pensionnat d'apprendre l'Artilleur de Metz mais je ne vois pas non plus pourquoi rougir devant une vérité élémentaire aussi simplement exprimée. Au fait comprennent ceux qui veulent bien comprendre et Apollinaire ni moi ne sommes chargés d'expliquer par exemple pourquoi la cagnat dont il s'agit dans Du coton dans les oreilles s'appelait : « Les cénobites tranquilles ».
Une des chansons favorites d'Apollinaire est celle qui célèbre les vertus génésiques de Monseigneur Dupanloup dont la légende a fait on ne sait trop pourquoi, une sorte de Priape ou de Kharagheuz chrétien et « qu'on rencontre, rapporte-t-il dans le Flâneur des deux rives, tour à tour en ballon, en chemin de fer, à l'Institut, à l'Opéra, et par un naïf anachronisme, au passage de la Bérésina. »
Il savoure également en connaisseur les histoires de table d'hôte et les bons mots. Lorsque Croniamental décide de faire son éducation de dramaturge, M. Lacouff, érudit, lui confie qu'il importe de connaître des anecdotes théâtrales qui alimentent agréablement la conversation d'un jeune auteur et sur-le-champ lui conte celle-ci :
Ibsen couchait une fois avec une jeune Espagnole qui s'écria au bon moment
- Tiens !... tiens !... auteur dramatique !
Pour faire plus expressif Apollinaire ne dédaigne pas employer parfois la langue chère à Rictus. L'argot est plein de possibilité. C'est d'abord un parler savoureux dont on ne sait trop les origines et par surcroît le sésame mystérieux qui permet de forcer le cœur du peuple plus sûrement que n'importe quel compliment. Le Lundi, rue Christine, c'est le langage du poète :
« Je dois près de 300 francs à ma probloque
Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner. »
Et encore :
« Cher Monsieur
Vous êtes un mec à la mie de pain ».
Guillaume Apollinaire doit à sa nature, à sa personnalité physique l'étrange ardeur de son tempérament. Certes il n'a rien de ce Silène burlesque qu'on a bien voulu dire, mais néanmoins étonnamment sensuel, sensualité d'ailleurs assez complexe puisqu'elle semble le porter plus à admirer qu'à convoiter et à s'arrêter davantage au modèle qu'aux sensations mêmes. J'y vois un des premiers effets de sa prodigieuse culture. Il désire intellectuellement sans que ce désir se manifeste par la possession, comme s'il craignait de rompre la parfaite harmonie du corps féminin. La turbulence de sa chair lui est presque douloureuse.
Sa sensualité se révèle surtout dans ses écrits et nous avons lu ces admirables poèmes où l'innocence de l'auteur n'a d'égale que la fraîcheur de son amour. Rien n'est dit des choses de la chair mais on devine à l'atmosphère brûlante du poème l'étonnante chaleur qui se dégage de cette poitrine, la tension toujours plus grande des nerfs vers l'impossible étreinte. C'est qu'il passe à travers les mots, le poète ; son souffle réchauffe les visages comme l'haleine des chiens et communique sa passion, il aime en rêve et c'est la grande affaire de la possession :
« Un rossignol meurtri par l'amour chante sur
Le rosier de ton corps dont j'ai cueilli les roses. »
Mais, à côté de cette sensualité charmante qui s'accorde fort bien du sentiment, il en est une autre moins avouable qu'Apollinaire utilise à des fins cachées et comme si le dévergondage de sa pensée était nécessaire à son équilibre. Je veux parler de ce débordement sexuel, de cette débauche de l'esprit non exempte de grandeur dont on peut dire qu'elle est à l'origine d'une beauté nouvelle. Ainsi Apollinaire nous trace-t-il le portrait d'un Juif errant débraillé et jouisseur dont le sexe circoncis évoque « un tronc noueux, ou ce poteau de couleurs des Peaux-Rouges, bariolé de terre de Sienne, d'écarlate et du violet sombre des ciels d'orage. »
Les mots les plus concrets, les rapprochements les plus audacieux aident désormais à un réalisme violent et nous nous trouvons en face d'une nature charnelle semblable à ces grasses nudités que peignit Renoir
« Le soleil ce jour-là s'étalait comme un ventre
Maternel qui saignait lentement sur le ciel. »
Il me paraît que le poète doit éprouver à des images de cette force un véritable contentement physique, une satisfaction sensuelle que réclame instamment son organisme. De même lorsqu'il s'aperçoit que
« Les nuages coulaient comme un flux menstruel »
sa supériorité sur la femme lui apparaît et c'est en lui comme un trop plein de sang qui voudrait s'échapper.
Il y a chez Apollinaire de l'obsédé sexuel, de l'inassouvi et il n'est peut-être pas exagéré de voir dans ce verbalisme à peine contrôlé les effets de ce que Freud a nommé le refoulement. Tandis qu'il transfigure la créature de ses rêves dans des poèmes d'une grande pureté, il est pour l'être de chair d'un cynisme et d'une cruauté qui ne laissent pas de surprendre.
« Après l'accouchement, écrit-il, les femmes sont comme des dépouilles de hannetons qui craquent sous les pieds des passants. Après l'accouchement les femmes ne sont plus que des boîtes à maladies, coquilles d'œufs emplies de sorts, d'incantations et autres féeries. »
Dans la rue, Apollinaire affecte volontiers de la sympathie pour le monde des pierreuses, il répond à l'appel des carrefours, des porches, des lampadaires, mais il ne faut pas s'y tromper le jeu des prostituées ne l'intéresse que parce qu'il trouve dans le comportement de cette faune mystérieuse de la mi-nuit mille raisons de se montrer curieux, parce qu'il lui permet de se livrer à d'intéressantes constatations psychologiques qui servent son métier d'écrivain. Quant à partager quelques instants seulement la couche d'une de ces filles, il n'y songe même pas ; ces sortes d'amour lui répugnent et certaines mésaventures survenues à ses amis lui inspirent par surcroît une crainte salutaire.
Qui ne connaît par lui l'histoire de Lili de Mercoeur, un grand nom, et puis assez vilain pour une femme chic puisqu'il faut prononcer Mercure. Justement elle a fini par là, on l'a remplie de mercure comme un thermomètre, et maintenant quand elle demande le matin « quel temps fera-t’il aujourd'hui ? » sa propriétaire lui répond toujours : « Vous devez le savoir mieux que moi. »
Voulant poétiser cette femme idéale qu'il porte en lui, l'auteur d'Alcools a parfois d'étranges trouvailles qui ne sont peut-être pas celles qu'on attendait d'un aussi chaste amour :
« Dame de mes pensées au cul de perle fine
Dont ni perle ni cul n'égale l'orient... »
dit-il et nous pensons aussitôt à Rimbaud évoquant une Vénus anadyomène « Belle, hideusement d'un ulcère à l'anus. » C'est la même attitude désinvolte et ce parti-pris de créer une beauté scandaleuse, dont il est d'ailleurs le premier à se fatiguer.
Quand la douleur le saisit trop fort à la poitrine, quand il est las de porter ce fardeau de sèves et de vigueurs et considère les faibles possibilités de l'homme en proie aux tentations, quand il soulève en lui le poids mort des journées et des larmes, alors il peut bien dire
« Et moi j'ai le cœur aussi gros
Qu'un cul de dame damascène »
conduit inconsciemment à établir un parallèle entre son mal et ce qui est à l'origine de son mal. Celui qui garde au plus profond de lui-même un immense butin de tendresse, amassant toujours et se donnant avec patience, celui qui aime avec l'innocence des simples et des enfants, péchant plus par nécessité, j'allais dire par sagesse, que par goût, a pour parler des brûlantes passions la fantaisie et l'irrespect qui le caractérisent.
Il n'a d'égard pour personne, pas même pour les grandes amoureuses du temps passé, et dans la chambre à la petite semaine où il vit actuellement une table de nuit qui boite lui fait irrémédiablement songer à la belle maîtresse de Louis XIV
« O La Vallière
Qui boit et rit
De mes prières
Table de nuit. »
Pour ce qui est de la majestueuse reine de Lydie qui épousa Hercule après l'avoir forcé de filer à ses pieds, elle doit enfin subir la revanche du mâle :
« Le cul
D'Omphale
Vaincu
S'affale. »
Cette dernière irrévérence achève de donner d'Apollinaire une image qui n'est pas sans analogie avec certaines figures de l'histoire littéraire. Je veux parler de celles de Scarron, de Saint-Amant et de tous ces poètes burlesques pour qui la vie n'est rien d'autre que ce qu'elle est, c'est-à-dire une aventure qui mérite d'être courue.
Afin de contenter ceux qui aiment à trouver dans les livres les sensations que leur pudeur ou leur hypocrisie leur refuse, je tiens à rappeler que Guillaume Apollinaire a fait œuvre d'écrivain licencieux, soit en entreprenant avec son ami Dalize la rédaction de romans laborieux tels que La Rome des Borgia ou La fin de Babylone parus sous le manteau, soit en publiant sous son propre nom Le Cortège priapique, sous les pseudonymes de l'abbé de Thélème et de Germain Amplecas des vers dans l'Œuvre libertine des poètes du XX° siècle. Cette activité lui convient parce qu'elle affine son esprit critique et le rend propre à percevoir les rayons noirs qui soulèvent la nuit et aussi parce qu'elle l'habitue à des hardiesses de langage dont la poésie ne peut désormais faire fi. Dédaignant l'art facile, il est ainsi à l'origine d'un nouveau classicisme, celui des choses rudes et des vertus animales, des mouvements désordonnés de l'âme, simple transposition de la vie sur le plan de la beauté.
Ce que j'exprime si mal, Croniamental l'a résumé dans cette exclamation décisive
« Luth
Zut »
qui est la réponse d'un nouveau Cambronne aux adjudants de toutes les littératures.
A tout prendre, Apollinaire a considéré que l'ancienne beauté avait les yeux trop bleus et qu'on s'y perdait aussi facilement que dans un ciel sans nuage, i1 les a vidés « comme des coques de moule » et dans ces deux trous noirs qui saignent sur la face il a jeté à pleines mains les étoiles.
Son but n'a pas été, en effet, de faire table rase mais de conquérir : « Je ne me suis jamais présenté comme un destructeur dit-il, mais comme un bâtisseur » et c'est à la recherche de matériaux solides qu'il s'aventure dans ce vieux monde tant de fois exploré. Il a des trouvailles de chiffonnier et pas un jour ne se passe sans qu'il ne ramène à la surface un mot, une idée, une image, en apparence usés, mais qui par le miracle d'une intelligence créatrice ne tardent pas à revivre d'une vie nouvelle autonome et pleine de merveilleuses possibilités.
J'ai déjà présenté Apollinaire comme un aventurier de la pensée, un émigrant de ces siècles de servitude où rien ne répond plus aux exigences de l'homme nouveau, qu'il me soit permis d'y revenir.
Les bizarreries, la curiosité vagabonde et cette luxuriante jeunesse qui personnifient si bien Apollinaire, cet appétit sans cesse renouvelé d'exotisme et de fruits verts, voilà qui devait admirablement servir le poète dans sa quête difficile de beauté. Et ce serait restreindre étrangement cet esprit original que de limiter son action à des réussites particulières comme il nous est donné d'en constater si souvent dans son œuvre, car telle n'est pas l'ambition d'Apollinaire de satisfaire plus ou moins son lecteur mais de créer autour de sa personnalité physique, autour de sa vie, un halo de lumineuse beauté telle qu'on puisse dire en parlant de lui : « Voilà la poésie. »
Il est l'homme d'un idéal, ce qui implique passablement de sacrifices et de renoncements, et comme tous les aventuriers il œuvre pour lui-même. C'est sa tête menacée par l'ennui et la honte qu'il cherche à sauver en se donnant tout entier à la poésie. Sa démarche hagarde n'est pas la conséquence d'une inaptitude à marcher droit mais l'affolement d'un homme pressé par le temps et la longueur de la course. Il bute à chaque mot et c'est l'occasion d'une plainte ou d'un déchirement.
Rarement poète eut une croix aussi lourde à porter, rarement elle fut portée avec autant de noblesse. Apollinaire a sur le dos le poids de toutes les générations studieuses qui se sont succédé jusqu'à lui, masse remuante de férules impossibles à secouer, il a assez de liberté d'esprit pour n'y porter pas plus d'attention qu'à un goitre, pour vivre détaché de ces anciens prodiges. II va, l'œil fixé sur cette aube qui point entre les cheminées d'usine, sur les buildings du soleil qui montent lentement de ces terres sauvages, sur ce ventre qui roule en ses plis un enfant, sur toutes choses à venir :
« Certains hommes sont des collines
Qui s'élèvent d'entre les hommes
Et voient au loin tout l'avenir
Mieux que s'il était le présent
Plus net que s'il était passé. »
Cet avenir répondra à des exigences secrètes, à une nécessité violente de l'âme et ne sera jamais accepté tel quel, mais agrandi, démesuré par le poète suivant les données d'une quatrième dimension, il participera à la démarche brûlante de la pensée, car telle est la volonté d'Apollinaire de créer à partir des vérités immédiates une vérité première toute de grandeur et de simplicité.
Rimbaud disait déjà : « Il faut se faire voyant ». Maintenant il s'agit de bien voir. C'est-à-dire de discerner l'objet dans son réseau de perspectives étoilées, de le situer et en quelque sorte de le déminéraliser afin qu'il commence à vivre d'une vie à la fois intérieure et extérieure à lui-même, afin qu'il soit une chose parlante.
C'est le mérite d'Apollinaire d'avoir su faire tenir dans son œil ce monde sans bord qu'il a conçu comme un aveugle, préférant imaginer qu'accommoder, faisant gémir ce qui semblait condamné à rester une matière insensible.
Un homme ayant perdu dans un accident d'automobile jambe gauche, bras gauche, œil et oreille gauches perd la notion du temps : c'est l'histoire de l'Infirme divinisé et la propre histoire du poète. Qu'une jeune femme lui demande alors : « l'Eternel, que pensez-vous de moi ? » celui-ci répondra : « Million d'êtres que tu es, de toutes tailles et de tant de visages : d'enfant, de jeune fille, de femme et de vieille, vous vivez et tu es morte, vous riez et vous pleurez, vous aimez et vous haïssez, et tu n'es rien et vous êtes tout. »
Ce qui est une admirable réponse et sans doute le secret de la beauté.
Servi par un don véritablement prophétique, par une foi toujours plus grande en lui et en l'amour, Apollinaire a pu nous donner ce grave contentement des poitrines, cette réponse que nous portions en nous depuis des siècles sans oser la formuler nettement, il nous a appris à ne plus pouvoir nous passer de nous-mêmes et à descendre en nous pour connaître le monde.
Ainsi donc Apollinaire ne s'est pas contenté d'avoir un idéal lâchement égoïste, il en a fait celui de tous les hommes dignes de ce nom, il en a tiré l'essentiel d'une méthode poétique qui consiste à mieux aimer pour mieux vivre. Sa vie même a été une lutte de tous les instants, un corps-à-corps furieux avec la bêtise et il n'a pas hésité à porter la révolution jusque dans les plus lointaines bergeries. Belles journées d'un homme de combat, d'un homme aux avant-gardes de la pensée, dont les conversations, les manifestes et les poèmes apportent la meilleure réponse qu'on pouvait attendre de lui. Il y a d'ailleurs chez ce poète davantage que du bon vouloir, comme une chaude saison qui anime la moindre parcelle de son corps. Il apparaît échappé d'un moyen âge de dragons et de voûtes gothiques, de ce moyen âge de la Table ronde et de la Forêt Noire, avec ses belles épaules faites pour abriter et pour défendre son cœur qui n'en finit jamais de consoler. Peut-être rejoint-il à travers le blanc fantôme de sa mère ces chevaliers polonais dont les légendes nous rapportent le parler de neige et la vaillance ou ces pèlerins en marche vers quelque Jérusalem des cieux ?
Il a le geste des donateurs et des prêtres, si large qu'il porte la bonne nouvelle en nous. On veut soulever un coin du paysage, on s'apprête à l'effort, et le ruban des sources se dénoue d'un seul coup, les grains de blé crépitent sur la peau de la plaine, les perdrix chantent, Guillaume apparaît retenant des deux mains, les sillons, les colonnes de fumée, les houles, mystérieux visiteur du soir, joueur de flûte capable de fasciner tous les enfants de la terre.
C'est au moment où l'on s'y attend le moins qu'il surgit de quelque Brocéliande de gratte-ciel et de port d'automne, d'un pays d'hirondelles, de papillons du gaz, porteur de roses et de grenades au plus dur de l'hiver.
Pour le rejoindre au fond de ses cavernes bleues, dans son domicile de « Roi-Lune », il faudrait être soi-même poète et retrouver les mots depuis longtemps oubliés. Mais les hommes se souviennent-ils encore du frais ruissellement de l'herbe sous la main, de leur première enfance ?
Le même esprit qui pousse Apollinaire à se donner tout entier à la poésie, qui le rend si multiple et à la fois si semblable à lui-même, va le conduire au début de septembre 1914 dans les bureaux d'engagement de l'administration militaire.
Sa poésie c'est aussi la France, cette belle jeune fille qui piaffe de douloureuse volupté à l'Est et se sent mourir une fleur à la main. Elle appelle ; les fleuves portent sa voix jusqu'à Paris. Et le poète qui a tout entendu va lui donner l'immédiate réponse de sa vie.
Apollinaire a bien compris qu'il ne s'agissait pas là d'une aventure ordinaire mais d'un drame de haute tenue où chaque acteur prend au sérieux son rôle de meurtrier et le parfait chaque jour. Le rideau doit tomber sur un petit village de tuiles rouges et d'auberges avec ses oliviers où chante l'oiseau de paix ; le soleil sera enfin retrouvé et derrière un horizon de poitrines sanglantes un ange casqué annoncera le temps des hommes forts et des fruits lourds.
Le thème est joli, l'idéal en vaut la peine et la guerre devient bientôt pour Apollinaire une raison de plus de s'émerveiller, de s'affirmer. Il vit pleinement, de tous les rouages de son corps. Quant à l'esprit, il croit toujours en la Victoire, en sa Victoire.
Ainsi Apollinaire aura été sa vie durant cet éternel engagé volontaire qui trouve sans cesse de nobles causes à défendre. Souvent il partira en guerre :
« Sans pitié chaste et l'œil sévère
Comme ces guerriers qu'Epinal
Vendait Images populaires
Que Georgin gravait dans le bois... »
et non comme le héros de Cervantès contre des moulins à vent mais contre de terribles réalités que seule une âme aussi bien trempée que la sienne pouvait se permettre d'affronter.
Pour en finir avec cet esprit qu'il faut bien qualifier ici de chevaleresque même si l'expression a été maintes fois galvaudée, il convient de rappeler qu'Apollinaire a poussé le sentiment de sa dignité morale si loin qu'il n'hésite pas, lorsqu'il considère son honneur en jeu, à avoir recours au seul et expéditif jugement de Dieu. Un jour par exemple que dans le Censeur politique et littéraire le journaliste Max Daireaux avait représenté le poète au cours d'un dîner réclamant avec obstination de l'eau d'Apollinaris, ayant soin de préciser chaque fois au garçon : « C'est mon eau », il se sentit réellement offensé par cette innocente plaisanterie et ses amis Max Jacob et Jean de Mitty furent chargés sur-le-champ de demander à Daireaux rétraction publique ou réparation par les armes ; en fin de compte, grâce à Billy, qui était secrétaire de rédaction du journal, le duel n'eut pas lieu.
Maintenant je ne veux plus rien dire de cet homme sinon qu'il était bon et que l'amour reconnaissant les siens finira bien par faire pour son œuvre ce que son œuvre fit pour l'amour. Il disait du poète que son métier ressemblait en somme à celui des putains puisque comme celles-ci il prostituait ses sentiments en public, et sans doute n'avait-il pas tort. Mais il y avait en lui ce sublime désintéressement, cette franchise, cette gaieté de cœur qui n'entrent pas dans l'habituel commerce des prostituées.
Depuis qu'Apollinaire n'est plus il ne cesse d'être là.
C'est le compagnon de table à l'auberge, l'aveugle des coins de rues, l'ami des grands chemins, ce mystérieux crieur de journaux dont l'aboi matinal révolutionne les vitres.
Et on est d'accord avec Cocteau quand il écrit .
« Je ne sais pourquoi, je l'imagine toujours en train de dérouler le fil de quelque cerf-volant. Je pense à ses hardiesses aériennes lorsque Notre-Dame porte le gui charmant d'un échafaudage.
« Il savait que l'ange de la poésie boite et louche et qu'il en tire son charme. Son souffle givrait les vitres. Il n'avait qu'à tacher une feuille, la plier et la déplier, pour épanouir les terribles dentelles du rêve.
« ... Fils d'Apollon, il tenait du dieu le privilège de pouvoir changer un arbre en jeune fille et n'importe quoi en merveille. »
Chapitre 5 - La part du lion ou Testament d’Apollinaire

« Si tu nous revenais Guillaume Apollinaire
Aurais-tu dans les mains la cendre du tonnerre
Et ce sont-ils rompus les maillons de ta chaîne
Chez les morts oubliés de la mer et des plaines ?
Le soir des lampes se souviennent
Une odeur de poèmes flotte sur les ruelles
Une odeur de fards gris de salpêtre et de caves
Celle qui fleurit ta cervelle
Sous la pierre que le vent lave
Nous sommes toujours là à peine massacrés
Le noir a réfléchi ses flaques sur notre âme
Nous sommes là malgré les coups malgré
Le vaisseau désarmé malgré les larmes
Et nous parlons de toi Guillaume Apollinaire
Au feu qui nous dévore au déluge qui monte
A tout ce qui se heurte aux écluses de l'air
Et notre souffle nous fait honte. »
Ainsi s'exprimait Michel Manoll dans un poème paru en janvier 1939 dans la revue Le Pont Mirabeau. Ce poète avait voulu commémorer le vingtième anniversaire de la mort d'Apollinaire en apportant par l'entremise de sa propre beauté le témoignage de ferveur de toute une génération. Il avait voulu retrouver dans le ciel brûlant d'un poème les hautes constellations de cette face azurée, le beau regard de ce vogueur qui reculait sans cesse son Amérique. Et comment ne pas donner un sens à ce geste d'amour d'une jeunesse pourtant difficile à s'émouvoir. Si tous ces yeux se sont levés il fallait que la figure soit bien rayonnante et pleine de cette douloureuse nouveauté qui conféra au Christ sa grandeur.
Jamais nous ne pourrons oublier le tragique de ce front entouré gravement de linges, ni cette « Minerve triomphale » miraculeusement jaillie, ni rien de cet homme qui pouvait dire comme Josué : « Le geste de ma main vers le soleil est le plus beau monument de l'ignorance et de la puissance humaine, surhumaine. »
A certaines époques de l'année il nous semble qu'Apollinaire va revenir, pareil aux équinoxes, aux tornades, aux météores, à tous ces phénomènes physiques qui donnent une flamme aux saisons. Il suffit de penser à lui pour que l'esprit se sente enfin à la taille de sa fortune, car il y a sa façon de donner bien avant de promettre, cette perpétuelle naissance de lui-même qui dépasse les joies de l'annonce.
Apollinaire c'est le cri du coq avant le jour. Une fois qu'on l'a entendu on est fixé sur la lumière, on ne peut plus douter de l'inclinaison du soleil, et le cœur accomplit lentement sa révolution.
Je ne connais personne qui ait fait autant que lui pour l'amour. Il y a dans son héritage les trésors fabuleux des premiers âges, la richesse végétale des temps non souillés où l'homme n'avait pas encore pris possession de son état d'homme. Alors les fleuves coulaient pour le plaisir de couler, les pierres éclataient sous le gel comme des roses et les bêtes confiantes venaient boire dans la main.
Mais les enfants sont descendus au jardin et ont tout bouleversé. Il ne reste plus rien de l'ancien ordre, de l'ancienne joie. Dans ce pays de saccages et de ruines Apollinaire apparaît. II lui suffit d'un geste en l'apparence banal pour que tout reprenne forme, pour que ce désordre même soit l'élément d'une nouvelle beauté.
C'est ainsi que l'homme ne pouvant qu'ajouter à l'œuvre divine a jeté des viaducs, érigé des pylônes, élevé d'immenses pyramides de béton, portant la panique bleue des tunnels au cœur même des collines. Apollinaire n'a pas voulu que cette architecture démoniaque demeurât en vain mais que tout ce qui venait du Malin retournât à Dieu.
Il est le poète de son temps, celui de la démesure, et non comme l'entendait Hugo qui ne voyait dans l'art qu'une plus grande dimension, sans dimensions véritables.
Rien de plus difficile à centrer en effet qu'un poème d'Apollinaire : il part en toutes directions pour se regrouper mystérieusement et jaillir finalement sur l'âme qu'il éblouit. On est d'abord saisi d'étonnement comme devant les premières machines volantes, on doute que cet oiseau humainement disproportionné parvienne un jour à s'envoler. Et puis il a depuis longtemps disparu dans le ciel qu'on regarde encore avec admiration la place qu'il occupait dans l'herbe.
Maintenant, il y a quelque chose de changé sous le soleil. De nouvelles vérités sont apparues dont l'homme cette fois est responsable, comme il est responsable de sa joie. « Les airs se peuplent d'oiseaux étrangement humains, écrivait Apollinaire dans un article intitulé L'Esprit nouveau et les Poètes. Les savants scrutent sans cesse de nouveaux univers qui se découvrent à chaque carrefour de la matière et il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. Pour le soleil peut-être. Mais pour l'homme ! »
La matière vit. Voilà une vérité dont on ne peut plus se passer. Une table par exemple qui était condamnée à demeurer une chose inerte devient par la grâce du poète une identité remuante. On dit la table et c'est toute la forêt qui se lève soudain, on voit l'épaule ronde du bûcheron, la blessure fraîche de la cognée ; bientôt l'odeur de la scierie emplit la chambre et le chant des compagnons menuisiers monte jusqu'à nous. Désormais il n'y a plus de nature morte. L'objet le plus misérable est doué d'une merveilleuse vibration parce que le poète ne se contente plus d'interpréter la nature mais la porte en lui et la recrée. Ce qui était extérieur à l'esprit lui devient intérieur, ce n'est plus lui qui parle mais qui donne la parole. On assiste alors à d'étranges réconciliations. Tout devient possible dans ce monde où rien n'est oublié ; des dialogues inouïs, des drames se préparent où le poète intervient directement.
Apollinaire s'est servi pour nouer ses intrigues lumineuses d'images semblables à celles qu'emploient les enfants gauches pour peupler leurs rêves, d'images faites de couleurs violemment mêlées, acides comme les fruits verts de la jeunesse.
C'est qu'il s'agit bien plus de faire aimer que de faire comprendre, d'entourer l'objet d'un tel amour que celui-ci le soulève et lui donne un grand pouvoir séducteur
« Ce petit tableau où il y a une voiture m'a rappelé le jour
Un jour fait de morceaux mauves jaunes bleus verts et rouges
Où je m'en allais à la campagne avec une charmante cheminée tenant sa chienne en laisse. »
Avec Apollinaire on y regarde à deux fois avant de dire « c'est ça ». Rien n'est plus trompeur que la réalité. On croit voir un navire et c'est une fleur qui se referme sur la mer. Ce qui est vrai c'est ce qui se trame derrière l'œil et non ce mince rayon qui n'impressionne guère que les couches froides de l'esprit. La beauté se dégage d'elle-même de cet amas de perspectives capricieuses et jaillit avec cette vigueur artésienne qui lui donne son élan.
Enfin voici « le temps de la Raison ardente ». Le poète célèbre, mais non plus pour lui seul, les messes noires de la lumière, confrontant une à une les images de ses nuits. Il est à l'origine d'une vie nouvelle ; il est celui qui imitant la bête se rapproche lentement de l'ange.
Toutefois il convient de se méfier de cette débauche de l'intelligence. Dans les poèmes-conversations ou les poèmes-promenades l'intention de désordre apparaît clairement. L'image même ne répond plus à une nécessité interne, à un mal physique mais devient tout simplement l'étroite raison du poème. Apollinaire s'est laissé dépasser par ce double mystérieux qui veillait au fond de lui, il ne s'est pas aperçu que l'esprit contrôlait de plus en plus ses émotions premières, que la mémoire retenait pour des fins secrètes ce que son cœur voulait laisser deviner :
« Tu chantes avec les autres tandis que les phonographes galopent
Où sont les aveugles où s'en sont-ils allés
La seule feuille que j'aie cueillie s'est changée en plusieurs mirages
Ne m'abandonnez pas parmi cette foule de femmes au marché. »
Il est certain qu'Apollinaire a voulu retrouver la naïveté des grands primitifs, la douleur murale et qu'il a mis tout en œuvre pour cela. Malheureusement il avait contre lui les témoins encombrants du passé et que faire contre ce qui a déjà pris place dans l'éternel. Quand il s'évade tout le ramène au noir cachot de sa mémoire. Peut-être aurait-il fallu qu'il se perde comme le douanier Rousseau dans une imagination d'exil pour se retrouver avec la terreur sacrée des premiers hommes.
Malgré tout, la tentative n'aura pas été vaine et il faut voir dans ses poèmes autre chose que l'œuvre d'un vaincu. Apollinaire nous a redonné foi dans la beauté, il a partagé avec nous les plus élémentaires croyances, séparant l'ivraie du blé, ce qui n'était qu'un art des douloureuses raisons de la terre. Lui-même s'est donné la vie quand tant d'autres se donnent la mort.
Aussi sa poésie est-elle avant tout une poésie de bonne nouvelle, une montée verticale vers la joie.
« J'ai eu le courage de regarder en arrière
Les cadavres de mes jours
Marquent ma route et je les pleure... »
a-t-il écrit dans Alcools. Dressé sur ce monstrueux piédestal il est bien près du ciel.
Il a suffi d'aimer pour que l'angoisse ait un sens, pour qu'elle ne soit plus un état morbide comme chez Baudelaire mais un encouragement et mieux encore une récompense. Parce qu'Apollinaire est passé là, la terre se couvre de fleurs belles comme des panthères, des réverbères éclosent de branche en branche, un enfant qui porte sa tête dans ses mains sourit tristement, l'amour ressuscite l'amour.
Et que nous importe après cela que le poète se soit parfois lourdement trompé. Colomb n'avait-il pas pris l'Amérique pour les Indes ? Il n'en est pas moins resté l'Amérique. Et j'appelle ainsi la nouveauté.
Malgré son intelligence et peut-être grâce à elle, Apollinaire a ouvert toutes grandes les fenêtres de l'esprit. Ce n'est plus une grange pleine à, craquer mais un grenier charmant où avec une absolue gravité les enfants viennent chercher, parmi les cadres brisés et les ressorts, les personnages inquiétants de leurs rêves.
Je me souviens d'avoir retrouvé aux environs de ma huitième année une vieille boîte de lotos dont le couvercle s'ornait d'une magnifique pagode chinoise. Or j'apprenais à cette époque la rivalité de la France et de l'Autriche et je ne sais trop pourquoi cette pagode représenta tout de suite pour moi la Maison d'Autriche. Je n'ai jamais cherché à m'expliquer comment ce rapprochement s'était fait dans mon esprit mais je sais bien maintenant qu'il y a eu beaucoup de pagodes chinoises pour Apollinaire.
Une beauté nouvelle vient de naître en effet des rapprochements les plus inattendus :
« ... Le petit saltimbanque fit la roue
Avec tant d'harmonie
Que l'orgue cessa de jouer
Et que l'organiste se cacha le visage dans les mains
Aux doigts semblables aux descendants de son destin
Fœtus minuscules qui lui sortaient de la barbe
Nouveaux cris de Peau-rouge... »
Mais nous devons surtout à Apollinaire cette liberté de langage, ce ton volontairement dégagé qui donnent au poème une apparence facile. Déjà Villon affectait de considérer avec une semblable désinvolture ses tourments, il se contraignait à rire, de ce rire tragique des masques grecs, quand la douleur le serrait plus fort à la gorge et, ce faisant, il ajoutait encore à sa douleur.
Apollinaire a déguisé sous un paysage fait de toiles, sous de « faux fleuves de sang » les contrées désolées de son âme. Il a eu la pudeur de ne rien laisser voir de ses épouvantes. D'ailleurs ses larmes auraient été bien inutiles, les romantiques s'étant livrés à des démonstrations assez ridicules pour que l'on soit à tout jamais dégoûté de la pitié.
Unique passant « sous l'arbre fleuri d'étoiles » il a préféré nous apparaître comme ce clown de Vitam Impendere Amori tragiquement pâle dont toute la vie peut se résumer de la sorte
« Un froid rayon poudroie et joue
Sur les décors et sur sa joue
Un coup de revolver un cri
Dans l'ombre un portrait a souri... »
C'est en recréant comme toutes choses le vocabulaire que le poète d'Alcools est parvenu à donner à ses poèmes cette dimension humaine qui a tant fait pour la beauté. Désormais les mots participent intensément à la souffrance de l'homme ; animés d'un souffle végétal ils germent sous l'effort d'un merveilleux printemps. Si devant un arbre Apollinaire s'écrie parfois « Oh ! la belle lampe » c'est que nous nous étions trompés sur le sens du mot lampe et que celui-ci désignait réellement cette lumière qui s'envole du tronc vers les branches.
Poussé par un sentiment de révolte et d'amour, donnant à tout un nom nouveau, Apollinaire a fait de la poésie non pas un art, non plus une patience composition de l'intelligence mais une œuvre de plein vent, de pleine poitrine, houleuse comme le grand large ; ne pouvant abaisser davantage le niveau du ciel bleu, il a du moins tenté de rehausser la terre, il en a fait la première marche du soleil.
C'est ainsi qu'il se trouve à l'origine de tous les mouvements qui, libérant le langage et l'esprit, espèrent libérer l'homme. Il a proclamé dans les Méditations esthétiques qu'il n'y avait plus de matière noble et qu'on pouvait peindre avec n'importe quoi. De même en nous révélant le sujet de sa pièce leximal Jélimite Croniamental nous persuade qu'il n'est plus d'entrave à la pensée
« Un homme achète un journal au bord de la mer. D'une maison située côté jardin sort un soldat dont les mains sont des ampoules électriques. D'un arbre descend un géant ayant trois mètres de haut. Il secoue la marchande de journaux qui est de plâtre et qui en tombant se brise. A ce moment survient un juge. A coups de rasoir il tue tout le monde, tandis qu'une jambe qui passe en sautillant assomme le juge d'un coup de pied sous le nez et chante une jolie chansonnette. »
C'est en peu de mots le drame d'un nouveau réalisme, une création merveilleuse de l'esprit où le rêve l'emporte sur la veille. Dans la lignée de Nerval, de Rimbaud, des romantiques allemands, Apollinaire retrouve les forces noires qui dirigent le monde mais au lieu de les contenir il les lâche brusquement au grand jour, et sans doute est-il à cause de cela le premier surréaliste.
Discuté jusqu'à sa mort, souvent même calomnié, son influence depuis lors n'a cessé de grandir. Il est celui qui a permis, outre les grandes découvertes surréalistes, Dada et l'écriture automatique. Et a pu grâce à son génie se passer de sentiment et d'idée et cependant créer une surprenante émotion qui n'est pas celle à laquelle nous étions habitués
« J'écris seulement pour vous exalter
O sens ô sens chéris. »
Apollinaire nous a convaincu de la nécessité d'une vie de débordement et d'amour, de la nécessité de se saisir des libertés immédiates pour que nous soit gardée la chaude substance du cœur. Mystique des hautes herbes, des flores tahitiennes d'un esprit supérieur, il retrouva pour nous les vertus nègres, celles du feu et de la danse, celle aussi de la joie. S'il adora des dieux d'ébène et d'ivoire, des poteaux de couleurs et ces fétiches semblables aux oiseaux des îles, c'est qu'il avait les croyances des hommes simples dont la contemplation ne dépasse guère les limites du regard.
Pour moi je n'oublierai jamais ces vers de Calligrammes où il est dit :
« La parole est soudaine et c'est un Dieu qui tremble
Avance et soutiens-moi je regrette les mains
De ceux qui les tendaient et m'adoraient ensemble
Quelle oasis de bras m'accueillera demain
Connais-tu cette joie de voir des choses neuves. »
Toute la poésie d'aujourd'hui s'est souvenue du message et surtout de l'exemple apollinariens, elle a construit à partir de cette Floride d'étranges cités, de hautes rues pleines de trolleys chanteurs qui répondent aux étoiles, elle est allée au-devant du soleil comme si la main de Guillaume faisait signe là-haut et renversait sur nous des cubes de lumière.
Dans toutes les sèves qui portent le printemps, il y a maintenant ces terribles Alcools qui donnent à l'arbre sa folie. Cela vient de dessous la terre et monte lentement dans les doigts : Apollinaire passe en nous, il mesure nos lèvres. Influence considérable de l'amour.
Est-il besoin de rechercher dans Eluard l'origine de cette transparence, dans Reverdy celle de ce perpétuel qui-vive, et quel Tabarin enseigna à Cocteau la science des jongleries et des disparitions prestigieuses. Chacun de nous a entendu Apollinaire s'écrier :
« Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir
Que c'est vraiment par habitude et manque d'audace
Qu'on les fait encore servir à la poésie. »
L'expérience de cet enfant de Dieu n'aura pas été inutile. Les plus clairvoyants ont retenu le meilleur de son enseignement, les autres le pire mais tous ont été d'accord pour reconnaître qu'il y a dans cette œuvre bien des raisons de s'étonner et d'admirer.
Venu avec cette « violente pluie qui peigne les fumées » avec ces ondes dont on ne saisit que la vibration merveilleuse, Apollinaire est demeuré en nous une présence essentielle.
Je le salue comme le poète d'un nouvel apocalypse, comme la dernière incarnation de l'ange :
« Toi qu'on disait un Dieu revenu de Cayenne
Forçat nègre innocent dernier aventurier
Homme de cuir et pâle des terreurs anciennes
Voleur du poivre d'or qui coule au sablier
Je t'attends ce matin sur les comptoirs du monde
Pour déjouer les complots terrestres des douaniers
Comprends-tu qu'il fait froid très tard sous nos épaules
Que le gel est en nous bien après la saison
Et qu'il ne suffit pas de reculer les pôles
Pour que nous soit donné un nouvel horizon
Je sais Tu as connu les beautés difficiles
Du petit jour l'ennui des attentats manqués
A vingt ans comme nous les pudeurs imbéciles
Les remords et le rire idiot de la pitié
Mais tu as vu s'ouvrir les fleurs et les oranges
Les fouets charmants siffler dans l'air comme des anges
Le phosphore éblouir un instant les charniers
Les statues se couvrir de moisissure étrange
Et tu as fait souvent l'amour Apollinaire
Pour tous ceux qui voulaient de toi tu as souffert
Pour ceux qui apprendront de toi qu'il est une aube
Tu as jeté ta vie sur le grand tapis vert. »
LA CHESNAIE
Octobre 1943 - Février 1944.
Fragments d'une lettre d’Italie
(Fragments de lettre de Marie Laurencin adressée le 30 novembre 1943 à René Guy Cadou.)
Le matin, dans le train, je ne pouvais que dire grâce, grâce italienne en regardant les maisons, le ciel, les ponts, et plus on avançait, plus on ne voyait que des pierres et un peu de misère...
Je suis abasourdie par Rome. Grandes choses, on a l'impression que tout ce qui s'est passé à Saint-Pierre de Rome, Vatican, etc. a été fait par des êtres avec une vue extrêmement puissante...
On sent partout, encore maintenant, un amour-propre fou : Je ferai mieux que lui, plus grand.
Guillaume Apollinaire était né à Rome. Il est resté en Italie jusqu'à l'âge de sept ans et, enfant, sa mère, qui était moitié italienne et fille d'un camérier du pape, le comte de Kostrowitzsky, le faisait venir lorsqu'elle recevait, pour lui faire parler le pur toscan.
Il n'a pas appris le français avant six ou sept ans, et c'est à Nice ou à Monaco qu'on le fit entrer au collège.
Il aimait les fruits, surtout les melons, les oranges. Les raisins, et le soleil, bien avant tout le monde.
Il s'intéressait aussi passionnément à tout ce qui était fait à la maison, l'écriture, la peinture, la dentelle, il avait horreur de travailler à une table et sa joie était de se promener, de regarder les boutiques et d'avoir un compagnon avec lequel il pouvait discuter, presque se battre. A trente ans, il avait une belle tête ; de grands yeux noirs, d'une mobilité inouïe, des sourcils comme les masques de tragédie grecque, une toute petite bouche, sa voix était le « Bestiaire » de Poulenc. Pourquoi je vous parle de Guillaume Apollinaire ? C'est Rome, il aimait l'Italie et surtout cette ville.
Cet homme sans véritable patrie disait : « Je suis Romain. » Maintenant j'en comprends tout le sens.
Marie Laurencin, Rome, avril 1929.