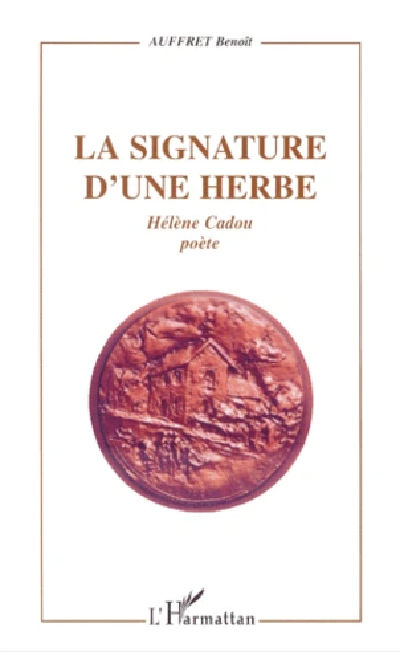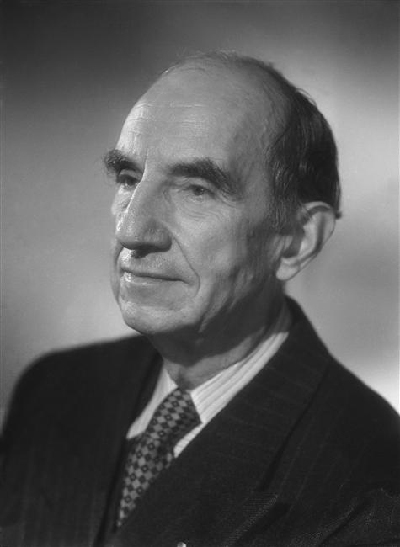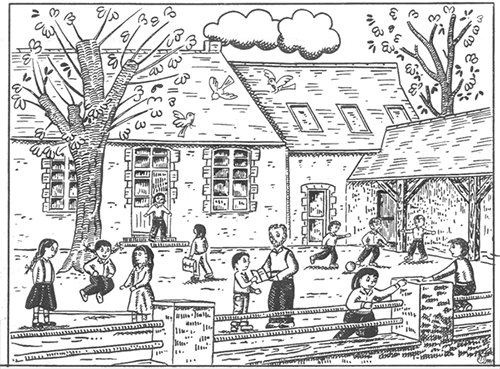|
Cadou, les peintres et le Pays de Châteaubriant,
par Yves Cosson
Professeur honoraire à l'Université de Nantes, poète. |

(Retour au sommaire archives)
Aux Marches de Bretagne, au cœur du Bocage, Châteaubriant, pompeusement nommée « Capitale du Pays de la Mée ? » (contraction de « moitié » aux limites de passage entre Bretagne, Maine et Anjou) vit au rythme des saisons, s'anime le mercredi, jour de marché, (un peu plus de dix mille habitants) offre aux touristes deux attraits : un château médiéval et Renaissance, et l'église romane de Béré. À cinq kilomètres, près de la route de Saint-Nazaire, un tout petit bourg serré autour de son église sans clocher : Louisfert, quelque six cents âmes. Voilà pour le décor.
Dans les années 1938 s'installe à Châteaubriant une grande famille, de souche aristocratique, les Trévédy. Le père a été nommé juge au Tribunal. C'est lui que désigne l'intitulé d'un poème de Cadou « Le Jardin du Juge » 1
Un fils, Yves, « fait les Beaux-Arts » à Paris. Quand il déambule dans les rues, il fait sensation. C'est un artiste. Il est beau. Il a un superbe collier de barbe. Né à Rennes en 1916, il sera élève de l'École Nationale des Arts Décoratifs, puis de l'École Nationale des Beaux-Arts à Paris : la consécration vient, rapide. Il est Premier Grand Prix de Rome de Peinture en 1943. Sa première exposition parisienne est triomphale. Sacha Guitry le parraine. Il possédera trente toiles du jeune peintre. En 1949, Trévédy obtient le Prix de la Casa Velasquez à Madrid ; en 1950, le Prix de la Fondation Rothschild de Londres. Parallèlement à sa carrière de peintre, il sera professeur de dessin à Polytechnique.
Il m'écrivit un jour : « J'ai toujours dessiné. Mon enfance et mon adolescence s'épanouirent dans un climat familial où l'art pictural était prisé et vénéré. Ma famille comptait des artistes et des écrivains de valeur. »
Pour le situer, ajoutons sa passion pour la musique : son dieu était Mozart. En peinture, ses maîtres furent initialement Bonnard et Vuillard, et, pour l'art religieux, il faut citer Maurice Denis.
À sa mort, en 1986, André Lenormand écrivait dans l'Éclaireur, hebdomadaire de Châteaubriant : « Oui, c'était bien un seigneur, il avait le panache, la parole, d'énormes qualités de cœur. Tous les grands personnages de l'époque le recevaient. »
Apparition d'un second personnage : Guy Bigot, alors Lorientais. Chassé de sa ville par les bombardements, il débarque réfugié à Châteaubriant, sans doute en 1942. Il ouvre, 1 rue Pasteur, une boutique de photographe. Il exposera régulièrement au Salon d'Automne et à la Nationale. En 1947, il obtient une Bourse de voyage, second Prix National (le premier étant attribué à Francis Gruber). À Nantes, il exposera à la Galerie Bourlaouën en 1947, 1951, 1958, 1961, 1964. En 1949, accrochage chez Denise René et Prix Hallmark. Fin août 1949, il regagne Lorient. Cadou l'aide à déménager. Le transporteur le ramène à Louisfert. Événement qui sera à la source du poème : « La route de Lorient passe par Louisfert » (in Les Biens de ce monde, PVE, p. 335).
Bigot est né à Vitré en 1918. Il monte à Paris, suit des cours à l'Académie de Montmartre et à la Grande Chaumière (son professeur et maître est 0. Friesz). Il quittera définitivement Lorient en 1959 et se fixera à Mennecy. Il vient d'y mourir. La ville de Nantes lui avait rendu un grand hommage au Musée des Beaux-Arts en 1975, (voir Catalogue : textes de René Guy Cadou, Paul Chaulot, André Salmon, Jean Bou-hier, Luc Bérimont, Sylvain Chiffoleau, Yves Cosson, Edmond Humeau, Michel Manoll, Jean Rousselot, Yves Trévédy et plusieurs autres poètes).
Hélène Cadou écrit alors:
À Guy Bigot, notre frère
Un instant la neige souvenir
Homme démantelé
Devant la porte
Avec la joie
Qui piège
L'Aubier
Couteau sous l'écorce
À vif
L'hiver en travail
Détruire
Pour cet espace bleu
À perdre cœur. 2
Yves Trévédy et Guy Bigot se sont sûrement rencontrés dans les rues de Châteaubriant, sans doute, par l'entremise d'Arsène Brémont, le Conservateur du Musée.
Paraît un troisième personnage. Il n'est pas peintre, mais sculpteur : Jean Fréour. Né à Nantes en 1919, il voyagera beaucoup. Son père était « dans les chemins de fer ». Tanger, Fès, Meknès. Et le Lycée Clemenceau « où il côtoie Cadou, sans bien le connaître », puis le Lycée de Bordeaux. Ses parents s'opposent d'abord à sa vocation puis se résignent. Il entre à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1936. En 1939, il obtient, par concours, une bourse pour l'École des Beaux-Arts de Paris. Il se retrouve dans l'atelier de Henri Bouchard. Quelques mois plus tard, il quitte Paris et s'installe à Issé chez ses grands-parents. Il travaille surtout à des œuvres religieuses. Sa première exposition date de 1942 chez Mignon-Massart (Nantes). Il m'a dit avoir connu Trévédy, vers 1938, à l'une de ses premières expositions à Bordeaux.
Il m'écrivit : « J'ai trouvé à Châteaubriant une ambiance que je n'ai connue nulle part ailleurs. Il est vrai que c'était « l'occupation » et que nous n'avions pas grand-chose d'autre que l'amitié... » Il allait souvent d'Issé à Châteaubriant à pied, et à Louisfert quand Cadou y arriva en octobre 1945.
Il m'écrivit encore ceci : « Un jour de certificat d'études à Issé, sans doute en 1947, Cadou était venu me voir alors que je cassais des modèles en plâtre ; il devait sauver in extremis une tête de Christ que j'ai toujours vue ensuite accrochée au-dessus de sa cheminée, au premier étage, à côté du Coq de Max Jacob. »
Fréour réalisera le buste d'Hélène en 1948.
À la mort de Cadou, on l'appela pour qu'il fît le masque mortuaire. Il en fut incapable, tant sa peine était grande. Il moula la main droite. De René, il fit deux stèles, l'une sur la maison d'école de Louisfert, l'autre dans un square de Bourgneuf-en-Retz.
Le quatrième personnage se nomme André Lenormand. Né en 1901 à Paimboeuf, il est, au moment de la guerre, comptable à Lorient. Lui aussi est chassé par les bombardements et se retrouve à Nantes et Paimboeuf en 1942, avec sa famille. Sans doute, connaissait-il Bigot à Lorient. Toujours est-il qu'il le retrouve à Châteaubriant. Autodidacte, il expose ses premières toiles à la Nationale en 1943. L'une d'entre elles sera accrochée dans la chambre de Cadou. Elle a nom La cabane.
Dessinateur né, il devient, dans les années 1945, dessinateur de presse à Ouest France, sous le nom de Len, s'affirmant grand caricaturiste. Dans le même quotidien, il tient une rubrique de critique d'art. Il meurt à Nantes en 1993.
Son œuvre plastique est présentée, pendant des décennies, à la Galerie Katia Granoff à Paris. La ville de Nantes lui a consacré une exposition au Musée des Beaux-Arts en 1974. Au catalogue figurent une prose liminaire et le poème de Cadou intitulé « Peinture ». (PVE, p. 375) 3.
En octobre 1945, Cadou est nommé à Louisfert, instituteur adjoint, titularisé, alors qu'il vient de faire huit postes, comme suppléant dans le département. Louisfert, c'est un village avec sa place, son église, sa bascule, ses cafés, son épicerie où l'on vend de tout, et au bout, vers la Forêt Pavée, sa Maison d'École (le directeur en est Jean Autret). C'est la vie simple avec ses gens, de Jules Gadessaude, « l'amoulageur », à Francis Caridel, le cafetier, épicier, secrétaire de Mairie. Louisfert sera la vie du maître d'école en sabots et en pèlerine, avec la kyrielle de copains de tout poil, « Les Amis de haut bord », qui viennent saluer le poète. Il était l'Amitié même : « Cet homme qui avait le culte de la Poésie et de l'Amitié était aussi le plus généreux et le plus délicat des amis. Il ne se perdait pas en formules. Il avait horreur de toute cérémonie, » écrivait Camille Bizot en 1952, dans Signes du Temps, (P. 29-30).
Ou encore Yves Trévédy, vingt ans après : « Je revois René, vers les années 45, à la porte de sa maison d'école, la main tendue, l'accueil toujours affectueux, le visage épais, grave et souriant du bourlingueur de rêve ; j'entends sa voix un peu gouailleuse détachant toutes les syllabes de son poème du jour, là.-haut dans sa chambre de travail ouverte sur cet horizon de la Forêt Pavée ». 4
Et, surtout, il y eut Hélène, (le mariage civil eut lieu à Nantes le 23 avril 1946, avec pour témoin Michel Manoll). Le couple emménage dans deux pièces à l'école de filles. En octobre 1947, Autret étant nommé à La Baule, Hélène et René habitent la maison d'école. Ce fut le temps de La vie rêvée, de ce Règne végétal, le temps de la métamorphose opérée par l'Amour d'Hélène, médiatrice d'un univers qui enlace à l'infini les regards et les gestes de la vie à tout le décor.
Une amitié exigeante qui liera les partenaires bien au-delà des rires et des blagues de copains à la Jules Romains, jusqu'au plus extrême mystère des destinées.
Cadou ne pouvait supporter la solitude. Ainsi « cette vie ensoleillée, cette vie émerveillée aura traversé la douleur même sans rien perdre de son éclat. De la nuit assumée, de la souffrance apprivoisée, tu as fait une journée qui garde éternellement sa fraîcheur, et, s'il faut parler de toi, c'est toujours au présent, parce que ton amour aura porté chacun au meilleur de lui-même, aura éveillé chaque objet, chaque être à sa destination la plus justement accordée », écrira Hélène Cadou en mai 1971. 5
Il y eut des rencontres et des soirées mémorables chez Caridel et dans la maison d'école, surtout les jeudis et samedis, souvent jusqu'à des aubes lumineuses. Les piliers étant Bigot, Lenormand et parfois Trévédy (il était souvent à Paris).
Cadou aimait la peinture. Il aimait dessiner. On connaît son autoportrait. Ses premiers contacts avec la peinture remontent, sans doute, à ses visites, adolescent, au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Il y avait remarqué cette toile montrant Charlotte Corday poignardant Marat dans sa baignoire, œuvre d'un Paul Baudry (1828, La Roche-sur-Yon,1886, Paris) évoqué dans le poème « Mémoires » :
« Le vieux peintre Baudry qui barbouilla Marat dans sa baignoire avec un assortiment de couleurs sévères [...] est mort sûrement. » (PVE, p. 324)
La rencontre de Cadou avec le fils de Pierre Roy pendant ses vacances à La Bernerie en juillet 1937 lui fait découvrir, dans la demeure paternelle, des œuvres surréalistes 6. La même année, il rencontre à Sainte-Marie-sur-Mer, dans le jardin de Michel Manoll, le Paulhan nantais : Julien Lanoë, alors président des amis du Musée, créateur de la revue La Ligne de cœur (1925-1928), qui lui fera connaître Max Jacob, Pierre Reverdy, le Père Agaesse de Solesmes. Celui-là sera, en poésie, son gourou, avec Manoll et Bouhier.
Il va de soi que, dans ses sources, il faut placer Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars, tous deux profondément mêlés aux batailles des avant-gardes du début du siècle.
L'éclatement des écoles en isme fut orchestré par ces deux aventuriers de l'art moderne (fauvisme, cubisme, orphisme, futurisme, abstraction lyrique, géométrique, art naïf, etc.), les Montparnos répondant aux Montmartois du Bateau-Lavoir. Ne pas oublier que Max Jacob vivait (chichement) de ses travaux plastiques (dessins et aquarelles, surtout). Ne pas oublier non plus que le poème devient un objet plastique (dimensions visuelles) de Mallarmé (Un coup de dés) à Apollinaire (Calligrammes), en passant par Cendrars avec sa Prose du Transsibérien, premier poème simultané colorié par Sonia Delaunay.
Cette collaboration intime des poètes et des peintres aboutit à des illustrations de Derain pour L'Enchanteur pourrissant (d'Apollinaire) ou de Dufy pour Le Bestiaire du même.
Ainsi, en 1949, Les Sept péchés capitaux de Cadou (PVE, p. 306-316) sont édités par Chiffoleau avec une couverture de Guy Bigot. En 1951, Nocturne (PVE, p. 345-346) comporte un portrait d'André Lenormand. Le poème est tiré à vingt exemplaires dans la nuit du 20 au 21 mars. Chiffoleau l'apporte à Cadou le matin du 21. L'ami est mort dans la nuit.
L'entreprise la plus importante fut évidemment la réalisation de Le Diable et son train, en 1948. Dans le format 24 x 32, papier Canson, l'ouvrage comporte 20 poèmes manuscrits de René Guy Cadou et, en regard de chaque texte, un dessin signé des initiales G.B., Y.T., c'est-à-dire Guy Bigot, Yves Trévédy.
Il était prévu d'en fabriquer 23 exemplaires, dont 3 hors commerce (H.C.). La tâche était épuisante. Il me semble qu'ils arrêtèrent ce travail vers le quinzième exemplaire. Le temps nous manque pour dresser ici la liste des textes (qui ne correspond pas d'ailleurs exactement à celle qui paraît sous ce titre dans Les Œuvres poétiques complètes).
Etrangement prémonitoire est le poème final : il s'agit d'Aller simple (PVE, p. 285). L'illustration représente un train qui s'en va et au premier plan, au pochoir, un couple qui semble s'effacer dans la lumière.
Il faut lire le texte de Guy Bigot, 1948 et Le Diable et son train, dans le catalogue de l'Exposition de Châteaubriant (PVE, p. 33) : « Cadou écrivait alors des poèmes sur des peintures et dessins de ses amis peintres, Toulouse, Trévédy et moi-même... »
*
Cadou aimait les peintres. Sa prédilection allait à Van Gogh et Gauguin 7, à Chagall et Rouault. Mais la référence aux peintres parsème ses poèmes : Le Gréco, et Toulouse-Lautrec dans « Hommage à Pablo Picasso » (PVE, p. 323), Lurçat dans « L'homme de Jean Lurçat » (PVE, p. 234), dans ses proses : Braque, à propos de ses « natures mortes » et d'une confrontation avec l'œuvre de Picasso (Les Liens du sang, PVE, p. 404), Daumier et Delacroix, Goya et Van Gogh dans ses propos sur La Peinture. (De la Peinture, PVE, p. 435)
Dans le même esprit qu’ Usage interne, il a, en effet, rédigé quelques notes sous cette rubrique. Elles appelleraient un commentaire de fond.
Schématiquement, il manifeste son refus de l'esthétisme (l'art pour l'art). La création se passe de tout système. Elle est une aventure. Tout est sujet. Tout doit se situer en dehors de toute anecdote. La peinture est une passion violente. Van Gogh est une réponse, qu'importe la question. « La main sanglante est sur le mur. Soyez la main sanglante ». « Van Gogh est un lyrique - comme Apollinaire ou Milosz - le feu de punch. Il y a aussi le lyrisme d'Aragon, Van Gogh brûle, ne brille pas ; il ne développe pas, il hurle, comme le soleil. Son "lyrisme" est "concentrationnaire" comme celui de Goya ou de Daumier. Il n'a que faire de la mélodie ». (PVE, p. 435)
Enfin, et surtout « Se méfier de l'intelligence, autrement dit brûler tous les papiers de famille avant l'inventaire. » (Ibid.)
Nous voici, en fait, au cœur du grand débat qui agitait nos amis. Et les discussions étaient assurément âpres. La peinture est-elle ou non la représentation du réel, entre le monochrome et le néo-expressionnisme, entre le figuratif et le non-figuratif, entre le réalisme, le trompe-l'oeil et l'abstraction lyrique ou géométrique ?
Tous, ils refusent le surgissement spontané de l'inconscient ou la déréalisation de l'objet (le merveilleux est dans les choses). Ils refusent le « stupéfiant-image », si essentiel au surréalisme. Pour eux, l'œuvre est construite, selon un certain ordre, et exige un métier et une matière de qualité.
Il serait passionnant d'analyser l'itinéraire des trois amis qui ont oscillé entre la figuration et l'abstraction.
Bigot écrit : « Qu'est-ce être figuratif ou non ? Et la peinture "abstraite" ? Comme je préfère la peinture secrète. Le peintre est sa propre figuration. La moitié de ma vie de peintre a été consacrée à une certaine description figurative du monde, l'autre moitié à un recryptage du même monde... et naturellement, j'ai opté pour le rêve comme figuration spirituelle de la Totalité de tous les mondes... l'acteur créateur devient son propre théâtre... Speculum Mundi. » (in Catalogue Bigot)
On croirait entendre Reverdy ! Je cite, de mémoire : « Le poète est à l'intersection du rêve et du réel. »
Quelle est la vraie nature de cette réalité ? « Le poète est un four à brûler le réel » (Reverdy), car, au-delà de ce monde sensible, est cette Grande Nature qui est une voie vers l'absolu. L'image naît de la rencontre de deux réalités, les plus éloignées possible. Plus la distance est grande, plus la surprise est forte. Mais c'est l'esprit qui prend conscience (acte d'hyper-conscience) de cette distance, construisant ainsi un monde second... la surprise, l'éloignement, la justesse. Du Gant de Crin on reviendrait aisément à la préface du Cornet à dés, texte fondateur. De Reverdy à Max Jacob : oui « L’œuvre est située. » Le dépaysement est ravissement.
L'Art - la poésie, la peinture - est une métamorphose du réel le plus banal, le plus quotidien. Il introduit le rêveur dans un univers où les contradictions seraient effacées : l'euphorie de l'extase Au-dessus de la porte de sa chambre, Cadou avait accroché le masque de l' Inconnue de la Seine. (Poème, PVE, p. 240). Il écrit :
« Je ne conçois d'autre poète (d'autre artiste) que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe, et de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, ce cri magique béant au fond de nous » (PVE, p. 389)
Et encore :
« L'amour qui sublimise toute chose nous aura portés. Dans cette solitude aérienne que nous nous sommes créée, non comme une tour d'ivoire, mais comme un royaume sans frontières, il aura été cette multitude vagabonde, cette parole du matin. » (PVE, p. 390)
Cadou est mort à Louisfert, dans la nuit du printemps, celle du 20-21 mars 1951. Il avait trente-et-un ans. (« Moineaux de l'an 1920 », PVE, p. 318). On l'enterra au Cimetière de la Bouteillerie, ici, à Nantes, un Vendredi-Saint Tous les amis étaient là.
On lit dans Usage interne:
« Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. » (PVE, p. 390)
J'ose dire ici qu'il me comptait au nombre de ses amis.
Notes :
1. Poème placé dans le recueil : L'Aventure n'attend pas le destin, alors qu'il figurait dans l'édition manuscrite de Le Diable et son train. Cf. René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Seghers, Paris, 1978, p. 223. (Abréviation PVE dans les pages qui vont suivre).
2. Bigot. Quarante ans de peinture, Ville de Nantes, Musée des Beaux-Arts, 4 avril-10 juin 1975, Nantes, Nantaise de presse.
3. Catalogue André Lenormand, Musée des Beaux-Arts, Nantes, du 25 octobre au 26 novembre 1974, Nantaise de Presse.
4. in Catalogue, Exposition René Guy Cadou, Ville de Châteaubriant, Bibliothèque municipale 20 mars-2 mai 1971, presses de Sylvain Chiffoleau, Nantes, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de son ami.
5. Texte extrait du Catalogue désigné ci-dessus, p. 12.
6. cf. Yves Cosson, « Cadou et la cité d'Orphée, Centrale du hasard surréaliste ? », in Le rêve d'une ville Nantes et le surréalisme, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Bibliothèque municipale de Nantes, 17 décembre 1994, 2 avril 1995, p. 443 et suiv.
7. Van Gogh in « L'idiot » (PVE, p. 290), « Lettre à Pierre Yvernault », (PT/E, p. 338), « De la peinture » (PVE, p. 434). Gauguin in « Comme un Christ » (PVE, p. 225), « Confession générale » (PVE, p. 245), « D'où venons-nous ? » (PVE, p. 320).
Informations complémentaires
Cadou avait à Nantes de nombreux amis peintres :
- Lean Iégoudez (cf. poème « Amitié à Lean Jégoudez », PV?, p. 248).
- Yves Boré. Dans sa chambre était accrochée une Descente de croix qui aurait inspiré le poème « Possibilité de corps en trop » (PVE, p. 349) et peut-être « Le Christ étendu » (PVE, p. 235), dixit Hélène Cadou.
- Jean Bruneau (Cadou écrivit une préface pour son exposition à la galerie Bourlaouën à Nantes en 1949). Son témoignage pour le 25e anniversaire de la mort du poète est bouleversant, in Soleils de René Guy Cadou.
- Guy-David, Le Ricolais, Bourlaouën qui tenait une galerie rue du Roi Albert.
Et à Orléans, Roger Toulouse.
a) Les blagues abondaient dans le groupe des copains. Un jour, Trévédy les retrouve, attablés chez Caridel. En traversant la Forêt Pavée, il dit avoir vu une bête qu'il décrit avec force détails. C'est le darin, disent en chœur les amis. Le lendemain, parut dans Ouest France, cette image. Len en était l'auteur. Il avait fait figurer auprès de la bête, un brave homme de Louisfert qui était attablé non loin d'eux. Cette publication entraîna une explication orageuse avec ce dompteur involontaire, vexé d'être ainsi « dans le journal »...
b) À l'occasion de manifestations organisées à Châteaubriant en mars 1991 (Exposition Cadou. Éditions du Petit Véhicule. Conférences), a été distribué un dépliant qui comportait l'autoportrait de Cadou et le texte d'Hélène Cadou que voici :
 |
René Guy Cadou ou la poésie du réel,
par Colette Guedj
Université de Nice-Sophia Antipolis |

(Retour au sommaire archives)
L'œuvre de René Guy Cadou est d'un immense intérêt tant pour le chercheur que pour le pédagogue, car elle est, comme celle des vrais poètes, l'œuvre tout à la fois d'un théoricien et d'un praticien de la poésie, l'activité poétique ne se concevant pas chez lui sans une activité réflexive sur la poésie 1. Une poésie qui, pour parler comme les tenants de la pragmatique, relève donc d'une double fonction de transparence et d'opacité, par laquelle elle nous donne à voir quelque chose du monde, tout en renvoyant elle-même à ses propres trajets. C'est ce qui m'a conduite à tenter de mettre en évidence, dans une sorte de parcours croisé entre les recueils et les textes plus théoriques, quelques fragments signifiants d'une poétique qui célèbre, au travers du réel le plus humble et le plus quotidien, les liens mystérieux qui unissent l'homme à la vie et au monde.
Le travail du poème
Les images sont nombreuses, tant dans l'art poétique (Usage interne notamment) que dans le corps même des recueils, qui renvoient à la fabrication du poème, manuelle, physique, concrète, et assimilent le poète à un artisan aux prises avec la matière des mots : il semble n'avoir de cesse, en effet, de les raboter (« Lorsque je fais voler sur mon propre établi/Les copeaux de ce cœur », p. 236), de les étayer, d'y planter des clous (« Poète ! René Guy Cadou : mais montrez-moi trace des clous !/Montrez l'eau vive où il s'abreuve/Montrez rabots et planches neuves », p. 303), d'en serrer et tresser les cordages («cordages du poème »), d'en huiler les rouages : («Le train qui passe à l'horizon est très ancien/Sa mécanique très moderne n'y fait rien/Il est graissé et sans défaut comme un poème », p. 281).
Ce tâcheron des mots, au sens noble du terme, sait que, comme le bois, les mots travaillent. Il ne répugne cependant pas à faire appel à d'autres savoir-faire que celui du charpentier ou du menuisier, tels que ceux du laboureur (« La poésie ne sera jamais pour moi ce que vous voulez en faire : une perfection à l'usage des gens de lettres, des snobs, et des professeurs. J'écris comme on laboure et peu m'importe que le sillon fasse une courbe si celle-ci prolonge le rêve intérieur des semences », p. 409), du forgeron (« Le style n'est pas l'outil du forgeron mais l'âme de la forge », p. 387), du potier (« Les mots sont comme ces poteries bon marché et poreuses d'où l'eau s'échappe mystérieusement », p. 386).
Autant de formules proverbiales ou aphoristiques qui, dans leur concision lapidaire, affirment la force performative d'une parole dont on ne saurait mettre la vérité en doute 2 et ressortissent à une conception toute pragmatique de la poésie, dans la mesure où celle-ci se constitue en acte. C'est probablement ce qui explique, du moins en partie, la répugnance de Cadou pour l'intellectualisme qui, faisant écran à la sensation et à l'émotion, tue la poésie, - et, partant, ses réticences vis à vis des mots abstraits : le poète fait son miel, en effet, des leçons que Max Jacob, par exemple, pouvait donner à ses contemporains :
« Écrire en mots concrets, un point c'est tout (Lettre à Lean Grenier dans « Lettres à un ami ») ou encore : « Évite le style abstrait ». Une bonne langue est l'assurance du succès. J'appelle « bonne langue » la « langue concrète » écrite avec des objets (regarde Jean Follain, il doit tout à sa concrétion) »3.
Diverses figures de rhétorique jouent ce rôle, qui tendent à concrétiser l'abstrait, telles les métaphores, bien entendu (qui se fondent si souvent sur des analogies avec la vie concrète du monde rural), mais aussi d'autres figures prisées par Cadou, comme par exemple celle du zeugma : « L'air est plein de pailles fraîches/de houblons et de sommeils » 4, (p. 261), ou de l'hendiadyin, lequel valorise souvent le concret en tempérant l'abstrait : « Un logis qui sent l'étable et la grandeur », (p. 287) ; « La douleur et la chaux ont blanchi mon épaule », (p. 272).
Une poésie de l'objet
La poésie de Cadou - s'en étonnera-t-on? - est au plus près de l'objet familier, utile, voire usuel : le vaisselier, la lampe-pigeon, l'horloge (qui bat comme un cœur), la pomme, le couteau («La poésie n'est rien que ce grand élan qui nous transporte vers les choses usuelles comme le ciel qui nous déborde », p. 386), mais, à la différence de la poésie matérialiste de Ponge, par exemple, qui met l'objet à distance pour dire le monde, Cadou ne nomme les objets du monde que pour autant qu'ils suscitent en lui, arrimés volontiers à sa propre histoire, cette effusion qui pourrait être de l'ordre ce que j'appellerais une jubilation infuse. Ni romantique, ni surréaliste :
« J'appellerai surromantisme toute poésie qui, ne faisant point fi de certaines qualités émotionnelles, se situe dans un climat singulièrement allégé par le feu, je veux dire ramenée à de décentes proportions, audible en sens qu'elle est une voix, aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle surréalistes » (p. 406).
Certains poèmes sont ainsi de véritables équivalents scripturaux de scènes de genre où est planté un décor intimiste (« Mais le mur nu la chaise en bois le pot d'émail », p. 283), qui n'est pas sans faire penser aux natures mortes, plus proches peut-être, dans leur rusticité lumineuse et leur réalisme, de celles de Chardin que de Braque. Et de fait la poésie de Cadou se veut au plus près du réel (« La poésie est un four à brûler le réel », disait Reverdy), un réel à la taille de l'homme et circonscrit (sans y être réduit cependant) à la terre immédiate, comme Éluard parlerait de « poésie immédiate ». La poésie de Cadou n'est pas une poésie de l'ailleurs (le poète n'a aucun goût pour le nomadisme ou l'exotisme), elle est une poésie de la proximité, de l'ici, d'un ici sédentaire, celui de la « ruralité » du terroir (pour reprendre le terme utilisé par Bertrand Degott). Et il faut dire ici la saveur de cette langue (dans le triple sens étymologique du terme qui conjugue, on le sait, le goût, la sagesse et la connaissance), toute pénétrée de régionalismes et d'archaïsmes (huis, ce jour d'hui, hocher la hure, etc.) évoquant la vie rurale de jadis, mais surtout le parler paysan, à propos duquel Cadou s'explique sans ambiguïté:
« Il y a dans le parler du paysan une poésie indéniable - je ne dis pas une source de poésie. Sa parole est un aboutissement. Ainsi le verbe abolir, odieux dans ce vers de Mallarmé « Aboli bibelot d'inanité sonore » prend une force et un charme proprement poétique dans ces expressions tant de fois entendues dans ce hameau de Basse Loire: « On a aboli le moulin des Grées ». « Il s'est aboli doucement dans la nuit du 27 » (p. 398).
C'est sans doute ce qui explique que cette langue, courante, comme on parle d'une eau courante, soit au plus près de la simplicité (« Mais le style direz-vous. Justement le style : cette écriture sans écriture, déliée comme la langue des muets », p. 387) de la spontanéité de la langue quotidienne («ne rien écrire qui soit prémédité », p. 392) et comme elle pénétrée de fragments d'oralité et de langue parlée 5. Il faudrait évoquer ici le recours constant du poète à ces expressions stéréotypées qui renvoient à la mémoire collective de la langue et peuvent apparaître soit en l'état dans un jeu de syllepse, plus ou moins subtil («Retour de flamme », p. 23, « Années-lumière », p. 33, « Morte saison », p. 40, « Cœur de pierre », p. 29, « Cœur à l'ouvrage », p. 31, « Mort d'homme », p. 33, « Peine de mort », p. 39, « Prise de terre », « De quel bois je me chauffe », p. 273), soit transformés (« Pensez, il en restera toujours quelque chose », p. 314; « la lampe aux œufs d'or », p. 306, « le cœur au bond », p. 34, « condamnation à vie », p. 39, « Rien dans les mains/Rien dans les voiles » p. 97) ou encore régénérés par un effet d'hypallage : « Les bras tombés le cœur ballant, » (p. 276) : la liste est loin d'être close. En tout état de cause, on peut dire, suivant en cela les pénétrantes analyses de W. Babilas qui s'est intéressé à ce qu'il appelait les collages de lieux communs dans la langue, que l'écriture poétique de Cadou relève, linguistiquement, de l'intrusion du réel, ou plutôt de l'effet de réel, dans le texte.
Une autobiographie poétique (« Je parle ce qui m'arrive », p. 252)
Le réel, Cadou l'explore en effet de façon quasi autobiographique.
Je citerai vite, et dans le désordre, car je n'ai pas le dessein de retracer sa biographie, ces événements qui sont enchâssés dans le texte : la mort d'êtres chers, dont celle du père (« La Série noire »), la mort de Max Jacob («Les Ides de Mars »), la découverte de la librairie de la place Bretagne («La Cité d'Orphée »), la naissance de l'École de Rochefort («Les Amis de Rochefort »), l'amitié avec Chiffoleau, Bérimont, Manoll, Вéаlu («La Haie longue : 1 km »), avec Roger Toulouse ou Jean Rousselot («La Soirée de décembre »), avec Lean Jégoudez (« Amitié à Jean Jégoudez »), l'émotion amoureuse («17 juin 1943 »), le peu de goût pour la capitale («Paris du souvenir: Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? »), le mariage avec Hélène («23 avril 46 », p.344) le testament spirituel («Tout amour », p. 350), la libération de Nantes. 7
Il est en effet frappant de constater à quel point cette poésie datée (mais qui ne date pas) est, singulièrement, de circonstance, sans s 8 («Je ne conçois de poésie qu'engagée envers soi-même », écrit-il dans Usage interne 9) : tout se passe en effet comme si la poésie de Cadou avait pour fonction, testimoniale, de consigner les sursauts et soubresauts de sa vie, dont il fait de nous les témoins bienveillants et complices (il faudrait parler de la bonté de Cadou, diffuse et rayonnante - et contagieuse comme peut l'être la poésie, au dire d'Éluard). C'est ainsi que défilent, recueil après recueil, des visages (la figure de la grand-mère pourvoyeuse des mots vrais ou faux de son enfance) ; des dates, consignées de façon tantôt référentielle («17 juin 1943 »), tantôt subjective (« Ce soir du 2 janvier », « le 8 mai de cette année ») ; des lieux (« Rochefort sur Loire ») qui, dans leur sécheresse topographique, annihilent tout effet poétique au profit d'une sorte d'authentification du réel. Il faut souligner à ce propos l'importance des titres qui rythment ces événements, et en balisent le trajet, s'apparentant davantage au texte qu'au paratexte, à quoi ils sont généralement réduits. Loin, pour la plupart, en effet, de remplir la fonction que l'on attendrait d'eux, à savoir celle de résumer et d'anticiper sur ce qui suit, ils participent pleinement à l'histoire en en amorçant la narrativité. Mis bout à bout, ils pourraient idéalement constituer la biographie du poète, réduite à sa plus simple expression, c'est à dire à l'essentiel.
Ce serait cependant considérablement réduire la poésie de Cadou que de la limiter à l'évocation du seul monde du poète : celui-ci, en effet, entretient d'étroites correspondances avec l'univers tout entier, et ce, au travers d'une posture scripturale qui n'est pas sans lien, comme nous allons le voir, avec celle des surréalistes.
Le poète-médiateur
Il est un texte fondamental de Cadou qui éclaire lumineusement sa poétique, c'est la préface à Hélène ou le règne végétal, dans laquelle le poète nous livre nombre d'observations concernant l'acte d'écriture :
« Je n'ai pas écrit ce livre, dit-il. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer -, comme un muet (le terme revient très souvent sous la plume de Cadou) l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du monde. La parole m'a été accordée par surcroît, afin de retransmettre quelques-unes de ces étonnantes vibrations, quelques unes de ces mystérieuses palabres qu'il nous est donné d'intercepter, parfois, dans les couloirs de la détresse » (p. 251).
On ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec la « petite phrase qui cogne à la vitre » de Breton, ou encore avec la démarche scripturale du René Char du Marteau sans maître, qui congédie l'auteur («Toute poésie tend à devenir anonyme ») et postule, on le sait, que l'écriture d'un texte s'engendre autotéliquement en dehors de celui-ci : Char, le loup : « Il faut que le poète meure pour que naisse la poésie »; Cadou, l'agneau : « Comment le poète toujours placé en amont de la poésie ne troublerait-il pas son breuvage ? » Interrogations toutes rhétoriques qui renvoient, mais je n'ai que le temps d'en amorcer la problématique, à la question du sujet dans la poésie de Cadou, lequel s'efface souvent devant l'événement qu'il est chargé de retranscrire.
Quoi qu'il en soit, le rôle du poète, tel que Cadou nous le donne à voir, est bien d'enregistrer les vibrations du monde qui se répercutent en lui ; les exemples parlent d'eux-mêmes, tels ce poème intitulé « Art poétique »:
« O mon poète aie garde d'allumer tes phares
[…]
Et sans souci du flot battant ton pare-brise
[…]
Enfonce toi comme un noyé dans la nuit rageuse qui grise
[…]
Tu es couché prés de toi dans la verdure
Tu es comme mille petits trous de serrure
Qui regardent dans ta tête éclatée
Les éléments épars de la beauté » (p. 290),
ou encore celui-ci qui, conjuguant lyrisme et scientificité, évoque le principe des vases communicants (plaçons-le sous l'égide de Breton) pour évoquer cette osmose entre le poète et le monde : « La sensibilité du poète est cette aiguille aimantée dont l'une des pointes est fichée dans son cœur alors que l'autre s'agite désespérément dans l'espace » (p. 394).
Les métaphores sont ontologiquement signifiantes, par lesquelles le poète s'identifie à l'univers comme s'il voulait se l'approprier physiquement, et l'intégrer en lui, dans son corps, dans sa propre respiration :
« Entrez n'hésitez pas c'est ici ma poitrine
Beaux oiseaux vous êtes la verroterie fine
De mon sang je vous veux sur mes mains
Logés dans mes poumons parmi l'odeur du thym
Dressés sur le perchoir délicat de mes lèvres (p.272)
Ou encore, celles-ci, d’une capillarité heureuse :
Il a neigé sur mes pensées et je crois même
Que le gel a muré les failles de mon cœur »(p. 337)
Ainsi mon sang se noue
Au sang lourd de l'horloge (p. 162)
C'est ce même mouvement d'interpénétration des règnes (animal, humain, végétal) ajouterai-je, qui me semble fonder des oxymores tels que celui-ci « Le soleil neige », (p. 244), dignes du langage cuit de Desnos, mais dont l'incompatibilité sémantique relève, selon moi, bien moins de l'arbitraire bretonien que d'une alliance sensible et harmonieuse entre les contraires.
Conclusion : Poésie la vie entière
Il faut souligner la diversité et la richesse de la langue cadoucéenne qui, non seulement, résonne d'infinis échos intertextuels (Cendrars, Baudelaire, Jammes, Guillevic, Breton, etc.) mais relève également de procédures scripturales aussi diverses que celles de la narrativité, du dialogue, de l'épistolarité, de l'apostrophe lyrique, du récit, du journal intime, de la citation, de la parole rapportée.
Ajoutons enfin l'extraordinaire diversité rythmique et prosodique qui voit se côtoyer strophes et distiques, prosodie classique et vers libre, isométrie et hétérométrie, vers et versets, vers et prose, la prose submergeant souvent le vers qu'elle transforme, revivifie en une parole en crue, comme portée par un élan vital.
Et le rôle du poète est bien de rendre lisibles et mémorables les paroles qu'il a prononcées, les paroles qu'on croit avoir déjà écoutées, et qui semblent nous habiter depuis toujours de leur familière connivence.
Poésie la vie entière, la bien-nommée.
Notes
1.Cadou développe cette idée dans Usage interne, en l'appliquant aux grands poètes que sont Max Jacob, Reverdy, Valéry, Michel Manoll, Aragon, Breton, qu'il oppose aux représentants de la « critique assermentée » de la poésie, tels que Thibaudet, Caillois, Paulhan, etc. (Usage interne, in Œuvres complètes, Seghers, 1977, p. 406-407 ; c'est à cette édition de référence que renvoient toutes nos citations qui dans le texte seront suivies de la seule mention de la page).
2.Et à ce titre Cadou est bien le frère de René Char, mais aussi de Joё Bousquet qui, dans Note Book, énonce des vérités décisives quant à l'acte d'écrire en relation avec sa blessure, dont il dit à maintes reprises qu'elle l'a précédé et qu'il était né pour l'incarner. On trouve de semblables « aveux » chez Cadou à propos de sa maladie.
3.Dans la « Lettre à Jean Rousselot » du 6/11/1942 (propos cités par Christian Moncelet dans son ouvrage René Guу Cadou. Les Liens de ce monde, Champ Vallon, 1983). Pensons également à Éluard, avec lequel Cadou aussi a plus d'un point commun : « Que le langage se concrétise ! »
4.Et le pluriel accentue la concrétisation.
5.Il faudrait citer à cet effet de l'emploi de l'anacoluthe chargée d'une grande force expressive : « Les chiens qui rêvent dans la nuit/il y a toujours un poète qui leur répond », p. 284 ; « Les gens qui vivent dans les terrains d'équarrissage/Leurs enfants rêvent, » p. 246. Dans le même ordre d'idées Cadou n'évoque-t-il pas « ces fautes de français douces comme du pain », p. 313.
6.W. Babilas, « Le collage dans l'œuvre critique et littéraire d'Aragon », Revue des Sciences humaines, 1973, p. 329-354
Voyelles renversées sur le ciel
O cigales
Bulles du souvenir éclatées sur les dalles
Églantines du coq au feutre des clochers.
D'autres images par ailleurs appartiennent au registre éluardien, comme « Le soleil fait la roue », ou encore l'expression « Comme une image », qui est le titre de l'un des recueils de L'Amour la poésie.
9.Cf. également : « Le poète se fera témoin de l'événement dans la mesure où celui-ci sera en dehors des événements », p. 407.
 |
René Guy Cadou et « Le parti pris des choses »,
par Georges Jean
Professeur honoraire à l'Université du Maine |

(Retour au sommaire archives)
J'emprunte à Francis Ponge les mots qui constituent le titre d'un de ses premiers recueils, sans doute le plus connu : Le Parti pris des choses.
Cela peut sembler paradoxal pour évoquer René Guy Cadou, que tout, dans son œuvre paraît opposer à Ponge et à sa poétique. Ponge écrit en effet:
« Le poète ne doit jamais proposer une pensée mais un objet, c'est-à-dire que même à la pensée, il doit faire prendre une pose d'objet. » 1
Or, la poésie de Cadou ne constitue pas, me semble-t-il, une quelconque tentative de faire prendre aux poèmes « une pose d'objets ». Chaque poème, chez Cadou, contient, en dehors d'une diégèse constante, ce qu'il appelait « une âme »:
« Les mots, écrivait-t-il, sont comme des poteries à bon marché et poreuses dont l'eau s'échappe mystérieusement. Prenez un mot et revêtez-le de la matière brûlante de votre âme. » 2
Chez Ponge, les mots n'ont pas « d'âme » ; ils détruisent les choses pour mieux les incarner. Ils deviennent, comme dirait Sartre « Chosification » Cependant, ainsi que Ponge, Cadou aime les choses ; elles l'obsèdent. Il appelle sans cesse dans sa poésie à la découverte de leur présence. Je pense que c'est cette obsession qui m'a fait répondre spontanément et sans réfléchir aux organisateurs de ce colloque, lorsqu'ils me demandèrent le sujet de ma communication : « Cadou et le parti-pris des choses ». Et le titre de Ponge ainsi que sa démarche qui me sont très précieux s'associaient alors à un poème de Cadou qui m'a toujours semblé emblématique dans son œuvre, et que je cite ici « in extenso »:
« Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète
Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui
Que chaque noeud du bois renferme davantage
De cris d'oiseaux que tout le coeur de la forêt
Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme
À la tombée du soir sur un meuble verni
Pour délivrer soudain mille peuples d'abeilles
Et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris
Car tel est le bonheur de cette solitude
Qu'une caresse toute plate de la main
Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes
La légèreté d'un arbre dans le matin. »
(Poésie la vie entière, p. 347)
Ce poème qui offre par ailleurs un exemple parfait des « correspondances » baudelairiennes, constitue, dans la perspective qui est la mienne ici, la dynamique très particulière caractérisant les rapports que la poésie de Cadou établit avec les « choses » et, plus particulièrement, avec certaines catégories de choses, ou plutôt avec les mots et les structures langagières les désignant et les exprimant.
La transparence des choses
Cadou s'est d'ailleurs expliqué sur cette dynamique et cette dialectique qui lui appartiennent en propre. On lit en effet dans Usage interne:
« Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, cet œil magique béant au fond de nous » 4
À partir de ce poème et de ce texte, je me suis mis à relire attentivement toutes les œuvres poétiques de Cadou en scrutant au sens propre de ce mot les choses qui, dans leur « transparence », ont précisément « pouvoir sur nous ».
Le mot « chose »
Auparavant, il m'a semblé intéressant de faire un petit détour lexicologique à propos du mot « chose ». Dès le XIIIe siècle le mot désignait « une réalité plus ou moins déterminée par un contexte ». Il s'oppose à « apparence » et à « mot », et il renvoie à une réalité matérielle non vivante ; en cela, le mot « chose » s'oppose au mot « personne ». Il s'oppose également dans une certaine mesure à « objet », utilisé pour évoquer une réalité « spécifiée »
Ce détour m'a permis de comprendre que le poète Cadou saisit les choses dans leur apparence, leur transparence et leur vie. Car elle vivent, les choses, par l'usage qu'on en fait, ou métaphoriquement. Sans s'opposer au contexte, il arrive souvent qu'elles le créent; loin d'être déterminées par lui, elles le déterminent.
Inventaires
J'ai donc absorbé toute l'œuvre poétique de Cadou en partant des points de vue exprimés ci-dessus, et en essayant de saisir les signifiés attestés ou latents de ce recours aux mots désignant des choses, de Brancardiers de l'aube aux poèmes inédits de Les Visages de solitude.
Je dois dire que, faute de temps, je n'ai pas cherché à me livrer à un comptage minutieux d'attestations lexicales, ni cherché à constituer ce qui serait à faire les « champs sémantiques » propres à faire appréhender au plus près la « poétique des choses de Cadou »
J'ai relevé plus simplement des constantes et même des « permanences » lexicales que j'énumère dans le désordre, en citant d'abord les mots les plus « fréquents ». En voici une première liste :
lampe
table
chambre
porte
fenêtre
mur
plafond
toit
lit
meubles
À cette liste peuvent être ajoutés : horloge, escalier, cloches, lanternes, cuvette, échelle, truelle, pommes... On peut remarquer des expansions. Exemples : fenêtre, persiennes, volets. Porte, serrure, clef Horloge, pendule. Lampe, lanterne. Meubles, vaisselier etc. etc.
Ces choses, ou ces ensembles considérées comme des choses (la chambre, la demeure) sont le plus souvent « d'usage interne ». À l'extérieur vivent les arbres, les oiseaux, le ciel le soleil et les nuages, et il me semble qu'à quelques exceptions près, ( l échelle, la truelle, etc.) les « choses » du monde extérieur, elles, sont opaques et définitivement immobiles et mortes. Comme l'indique la répétition dans toute l'œuvre poétique du mot pierre, employé avec des nuances au singulier et au pluriel.
En fait, je constate que nous avons dans la poésie de Cadou une permanente attention portée (et je reviens au poème « emblématique » cité plus haut) à la demeure. Et aux choses simples qui accompagnent la vie quotidienne.
Vie quotidienne « interne » qui s'oppose au monde extérieur et lui répond. Le monde extérieur, c'est le monde du travail « l'école », « la classe » et naturellement le « règne végétal » : arbres, paysages, faune et flore. Et je me suis aperçu que les « natures mortes » chez Cadou, natures mortes de « l'intimité », comme dirait Bachelard, avalent la mobilité des éléments extérieurs : « abeilles », oiseaux, trains, personnages, les amis poètes de Rochefort et les autres, Max Jacob, les enfants et, au centre, le vivant amour : celui qu'inspirait Hélène et, proche, lointain, incertain et familier, « Dieu qui passe... »
Transcendances
À la différence de Ponge, qui « fige » les « mots-choses » et les construit, les « fabrique » comme « le pré » (a), a) Allusion au livre de Ponge, La Fabrique du pré, SlгΡira, 1990. Cadou me semble hanté par la transcendance des choses, par le fait que les choses naissent autour de nous et que ce sont dans une certaine mesure les mots du poète qui les créent. D'où la présence permanente, dans toute l'œuvre poétique des lampes et de la table, de la lumière et de cette chose plate et dure sur laquelle on écrit. Je me souviendrai toujours que lors d'une visite à Hélène, alors à Orléans, elle me montra la table luisante et cirée sur laquelle le poète écrivait. Et cette vision me renvoie à un poème essentiel dans lequel la table et la lampe transcendent effectivement ce que Sartre nommerait leur « ustensilité ». Je cite :
Retour à l'aube
« Le bouquet du soleil danse dans la serrure
Les tables sont fleuries
On glisse les parures
Une main cache encore les écluses dorées
Tout ce qui dort a son secret
Le village enfoui sous la lampe
Les oiseaux perchés sur la rampe
La feuille blanche du plafond
J'ai reconnu ton pas
La voix fée de la porte
Le cri désespéré d'un homme qu'on abat
La chambre sous le toit
Et la petite morte. » 5
Dans ce poème de 1940, on ne note aucun souci de description, ni de dépliement (selon l'expression de Deleuze) mais déjà, en dehors des métaphores, une fonction métaphysique de la table et des lampes. Ainsi se produit comme une ontologie des choses simples, en une dialectique dont j'esquisse quelques mouvements :
L'intimité des choses de la chambre renvoie au monde extérieur, soit que celui-ci soit perçu de l'intérieur : « Un bouquet de soleil danse dans la serrure », soit que la nature- investisse le dedans : « Les oiseaux perchés sur la rampe ». Et dans ce cas, comme souvent chez Cadou, on se connaît pas très précisément la situation des espaces : rampe extérieure vue par la fenêtre ? rampe intérieur d'un escalier ? L'ambiguïté « épaissit » et densifie la vision.
L'Immobilité des choses est vivifiée, « vitalisée » par ce que l'imaginaire du poète y cache ou y déploie : « Les tables sont fleuries »; « Le village enfoui sous la lampe ».
Les choses deviennent métaphores exprimant le travail d'écriture à faire ou se faisant : « La feuille blanche du plafond », « La voix-fée de la porte ».
En fait, ce qu'on pourrait appeler la métamorphose transcendantale des choses, chez Cadou, provient du fait que les métaphores, les images ne sont pas que des figures de style. Elles deviennent d'ordre ontologique, créant des êtres de paroles renvoyant à des essences.
Ces dialectiques verbales de l'enfermement du monde extérieur ou de l'extériorisation du monde de l'intimité des choses que le travail du poète construit, « donnent à voir » dans leur nudité expressive un « décor » - mot très fréquent chez Cadou - qui s'anime, devient « la vie entière » ; à tel point que dans le poème de jeunesse que nous citons plus haut, la mort vit : « Et la petite morte » devient elle-même légère.
Usages détournés
Très souvent, chez Cadou, les choses sont ainsi nommées dans la perspective d'un usage qui les détourne de ce qu'elles sont. Ces choses immobiles « bougent ». Ainsi, dans ce poème :
Odeur du jour
« Je serai là
J'attendrai
La poitrine écartée de tes mains et des ronces
Maintenant la maison s'en va à la dérive
La table a des remous et des reflets d'eau vive
La lampe descendue aiguise le matin
Tout est clair
On entend ton nom sur le chemin
Les yeux changent de face »
Plus près de moi se lève
Une ombre douce et nue
Le soleil fait la roue
La houle diminue
Six heures
Au pied du lit
Une tête inconnue. 6
En quatre mouvements - au sens musical du mot « mouvement » - nous passons de l'immobilité de l'attente (1ère strophe) au mouvement des choses : « la maison s'en va à la dérive », « La table a des remous et des reflets d'eau vive », « La lampe descendue aiguise le matin ». Puis nous avons un adagio : « la houle diminue », puis un étonnant point d'orgue pour marquer un retour à l'immobilité : « Au pied du lit/Une tête inconnue. » Ainsi les choses deviennent, pour parler comme Greimas, « actants » d'une houle qui les vivifie, vivifiées parce qu'elles font échos au monde extérieur qui les investit dans ce merveilleux poème de l'attente. Et la table de travail, ici, est une des plus belles illustrations de l'imaginaire bachelardien évoqué dans « L'eau et les rêves ». On le retrouve naturellement dans « la houle ».
Le nouveau « tremplin » des choses
Au demeurant, Cadou s'est expliqué sur cette mouvance des choses. Il écrit en effet :
« On ne peint pas de natures mortes. On tente de limiter sur la toile ou sur la feuille, un mouvement parfois à peine perceptible. Il serait vain de vouloir lui attribuer une attitude définitive, c'est-à-dire de la décrire. Simplement la situer dans un univers nouveau auquel elle s'adaptera, qui sera pour elle un nouveau tremplin, une nouvelle base de lumière. » 7
Ce que propose le poète, c'est bien un autre parti pris « sur » les choses. Et je comprends de moins en moins les concepteurs ou « poéticiens » de la modernité poétique qui contestent à Cadou toute démarche novatrice, le rangent parmi les poètes « ruraux », ou les « lyriques obsolètes » (sic) I Alors que le poète de Louisfert, « pointe », comme diraient les psychanalystes, l'opacité et le non visible des choses simples ; de ces choses, comme dit si bien Jacques Prévert, « qui sont derrière les choses »
Fonctions de la lampe
Il parait maintenant intéressant de revenir sur deux « choses », en fait deux objets qui jouent dans cette thématique particulière de Cadou un rôle central. J'emploie le mot « rôle » au sens de « personnage qui joue à être celui ou celle qu'il n'est pas communément ».
La lampe est bien source de clarté ; elle éclaire la maison ; elle éclaire surtout la table et, sur la table, la feuille sur laquelle le poète écrit. Mais la fonction de la lampe est de n'être pas qu'une source de clarté. Dans le poème que j'ai cité au début de cette communication, on lisait :
« Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme
A la tombée du soir contre un meuble verni... »
Il ne s’agit pas ici d’une simple métaphore. La lampe devient cou de femme, image de tendresse, de sensualité. Elle préfigure ou annonce :
« une caresse toute plate de la main… »
La lampe est « chose » vivante. Elle est certes la lumière, mais également, l'âme, porteuse du poème que réfléchissent la feuille et la table...
Fonction de la table
La table répond à la main, la table renvoie le poème à la lampe.
Mais dans la poésie de Cadou la « table » est également la table autour de laquelle se réunissent et se retrouvent les amis, pour boire un verre et palabrer.
Elle est la table « des mains mortes » et surtout la table des mains qui renaissent, c'est-à-dire des mains qui écrivent. On pourrait à ce propos entreprendre à partir de la poésie de Cadou toute une « poétique de la main ». Et c'est la table qui réveille la main, la main que traverse matériellement le poème ; la main « morte » comme une chose, que l'amitié comme l'amour rend à cette prodigieuse fonction chez l'homme qu'est l'écriture, la trace qui exprime l'être et donne au poème, oraculaire dans sa nature profonde, sa durée et son apparence de « chose » faite pour perpétuellement renaître.
La maison
Cadou écrit le monde proche, le monde naturel, sur la table, sous la lampe. Toutes deux remplissent une fonction ontologique et magique. Elles sont nominations vives au centre de ce lieu « d'usage interne » qu'est la demeure, la maison. Avec ses murs, son plafond, son toit, ses fenêtres, ses portes et leurs serrures, ses persiennes, ses volets. Elle contient « les grands meubles noirs et taciturnes » et surtout le lit, le lit du sommeil, de l'amour et de la mort. On y rencontre la « cheminée », le « vaisselier » et, comme dans les natures mortes de Cézanne, les « pommes », devenues choses à renaître. Et tout ceci, en dehors d'images de l'intimité tranquille, dirait Bachelard, constitue bien souvent pour le poète ce « décor », si cher à Cadou, comme si le poète était au centre d'un théâtre dans lequel les humains, les ombres et les choses, deviendraient autant de personnages d'une saga aux incessantes variations.
Les mots du silence
Revenons au poème du début:
« Car tel est le bonheur de cette solitude
Qu'une caresse toute plate de la main
Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes
La légèreté d'un arbre dans le matin. »
J'у reviens parce que les gens qui font aujourd'hui de Cadou un « petit poète » ne l'ont pas lu et n'ont pas remarqué, que ce maître d'école avait, comme les plus grands, une perception très juste du sens propre de chacun des mots qu'il emploie.
Dans le passage ci-dessus, le mot « taciturne » est pris dans son sens étymologique : « qui exprime la qualité du silence nocturne ». C'est à dire que dans la relation du mot « taciturne » au mot « matin » (3e et 4e vers), ce dernier lui est sémantiquement et proprement antinomique, la nuit s'opposant à la couleur du matin et de l'aube.
Par ailleurs, la « caresse toute plate de la main » est la subtile allégorie de la main qui écrit et, par des mots tracés, réveille les choses, les rendant à l'extériorité et à la clarté, non plus celle de la lampe, mais celle du matin...
Et je me demande si l'univers de choses « d'usage interne » dont se nourrit la poésie de Cadou ne se détruit pas à la fin, devenant silence, immobilité, nuit, mort pour renaître à la lecture (ou à l'audition) dans le temps du poète, avec cette horloge « qui répond par un pas de travers ».
Les choses et les abeilles
Au terme de mon parcours, j'ai été très frappé par le fait que les choses, chez Cadou, étaient sources de mobilités vivantes, comme il est dit dans le poème emblématique cité en ouverture :
« Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme
Pour délivrer soudain mille peuples d'abeilles... »
On pourrait dire, dans le langage un peu pédant de Greimas, que ces « peuples d'abeilles » rencontrent dans toute l'œuvre poétique de Cadou des « isotopies », c'est-à-dire des structures sémantiques et signifiantes figurant la multiplicité, la mobilité, la vitesse, l'envol : les abeilles, les oiseaux, la poussière, le train (il y aurait à mettre en lumière toute une poétique du « train » chez Cadou.) C'est-à-dire que la traditionnelle antithèse vivant/mort, inerte/mobile, choses/êtres se réduit dans cette œuvre à une thématique généralisée du mouvement. L'émotion d'un poème, écrit en effet Cadou, ne vient pas tant de ce qu'il représente que de son mouvement.
La poésie de Cadou, contrairement à ce que disent certains poètes d'une soi-disant avant-garde, ou qui croient en être, loin de constituer une poésie plus encombrée de métaphores que conçue par nécessité, est une poésie de perpétuel mouvement, de flux et de reflux, entre transparence et opacité. Sa « structure profonde », comme c'est le cas dans toute poésie digne de ce nom, demeure perpétuellement signifiante.
C'est au cœur de ces dialectiques dont je me suis contenté d'évoquer quelques aspects concernant les choses que Cadou, dans sa poésie, « bâtit sa demeure », comme dit Edmond Jabès. Et l'être aimé lui même est chose, naissance et création :
« Avec toi qui me dissimules
Dans les tentures de ta chair
Je recommence le monde. » 9
Pour conclure provisoirement
Je dirais volontiers pour conclure très provisoirement cette « recherche/lecture » un peu rêveuse que les « choses », dans l'univers de Cadou, ne sont pas matière brute, objets inertes. Pour emprunter une expression à Bergson, elle sont « matière et mémoire ».
Elles sont recréation d'elles-mêmes et d'un monde, c'est à dire poésie au sens premier de ce terme.
Ici, la rose mallarméenne « absente de tout bouquet » est par des mots rendue présente. Mon viеux maître, le philosophe Henri Gouhier, disait du théâtre qu'il était l'art « de rendre présent par des présences » La poésie de Cadou dans la perspective où je me suis placé, est bien un théâtre de choses. Un théâtre de la création poétique où les choses comme les êtres nous sont offerts et rendus dans leur « obscure clarté ». Par un poète d'aujourd'hui et que rien ne saurait réduire !
Notes
1.Francis Ponge, Proêmes, Gallimard, 1948, « Natare piscem Lices », 1924). Repris clans le Parti pris des choses suivi de Proêmes, Paris, Poésie-Gallimard, 1967, p. 130.
2.René Guy Cadou, Usage interne, Poésie la vie entière, Œuvres complètes, Seghers, P. 386.
3.Les Biens de ce monde, Œuvres complètes, P. 347.
4.Usage interne, Œuvres complètes, p. 389.
5.Morte saison, Œuvres complètes, p. 47 (a). Voir FRANCIS PONCE, La Fabrique du pré, Skira.
6.La Vie rêvée,1944, ouvres complètes, p. 104.
7.Les Liens du sang, Œuvres complètes, p. 403.
8.Usage interne, Œuvres complètes, p. 389.
9.La Solitude, in Les sept péchés capitaux, Œuvres complètes, p. 306.
 |
Ruralité de Cadou,
par Bertrand Degott
IUFM de Besançon |

(Retour au sommaire archives)
« Instituteur rural »1, « poète provinciale », René Guy Cadou ? Les raccourcis biographiques imposent et martèlent de telles certitudes, installent des paradigmes, et en même temps génèrent d'autres syntagmes : instituteur provincial, poète rural. Or c'est le poète qui nous intéresse. Et l'homme. Voici donc un homme, un de plus « au milieu du monde ». Ce qui ne veut pas dire qu'il en occupe le centre — comme tant de poètes encore qui nous invitent à remonter toutes les impasses du solipsisme —, mais bien que son regard et sa position déterminent ce qu'il voit, que son expérience du monde oriente ce qu'il en dit. Dans le cas précis de Cadou, nul doute que son enfance dans la Grande-Brière, sa charge d'instituteur rural et sa volonté de rester à Louisfert, son implication personnelle à tout âge dans les travaux quotidiens, nul doute que de pareils facteurs impressionnent sa poésie, la déterminent à des degrés divers. Mais sous quelles espèces apparaît cette détermination, voilà ce qu'il faudra se demander : la ruralité tient-elle du souvenir, d'une rêverie sur l'enfance, ou bien de l'expérience quotidienne ? Et d'ailleurs doit-on la confondre avec ce « règne végétal » indissociable d'Hélène ? La poésie de Cadou s'alimente aux réalités, plante ses racines dans l'humus millénaire. Dans les années 1940, la Brière n'est pas un jardin botanique. Nul besoin donc d'en halluciner les campagnes.
La nature et le corps
Le poème, par l'analogie, relie l'homme et le monde. Chez Cadou particulièrement, le corps « sublimisé » 3 devient le lieu des travaux et des jours :
« Voici que les charrues glissent dans mes cheveux
Voici que mes poumons comme des moissonneuses
Éparpillent des mots légers dans le ciel bleu. »
(PVÉ, 170)4
Le travail du poète est pour l'essentiel dans cette transfiguration, qui en l'occurrence l'identifie aux travaux agraires. La dialectique du corps et du paysage dans la poésie de Cadou, expansion du moi, compression du monde, identité, altérité, tout cela a été finement analysé par Jean Yves Debreuille, dont voici les conclusions :
« Les poèmes n'ouvrent pas sur un ailleurs, mais sont autant de visages de solitude qui renvoient à celui dont ils émanent son visage d'homme au milieu du monde. Poésie partagée entre une quête de l'immanence et un désir de sélection des Biens de ce monde, entre l'affirmation du « je » et la conviction qu'hors de lui sont les conditions de sa survie, entre les sensations qui la construisent, le désir de les maîtriser, et le pressentiment qu'en elles est cependant la vérité. »
Ce partage et cette hésitation se conçoivent d'autant mieux en effet que la vérité poétique n'est pas la vérité pratique. On admettra encore que l'« incapacité à parler de soi sans parler du monde »6 fonde la poésie de Cadou. Il n'y a toutefois pas lieu d'y voir quelque infirmité que ce soit, plutôt la preuve administrée en poésie d'une enfance préservée (l'enfant, non plus, ne distingue pas les deux...). Le petit monde et le grand monde se correspondent : c'est une des lois d'analogie que le poète met en œuvre.
On pourrait cependant former l'hypothèse qu'une évidence préside à ces correspondances. C'est le destin des corps de retourner à la poussière, d'être happés dans le devenir et le temps : du cadavre enseveli du « Soldat », par exemple, le poète dit qu'il « entre dans les maïs [...]Car son corps désormais fait partie des saisons » (РVE. 71). Aussi le poète qui veut exprimer la vie doit-il, sur ce modèle, ici et maintenant, faire entrer le corps dans la ronde des saisons. Le corps immense des titans qu'apostrophe « L'origine des saisons » dans La Vie rêvée (РVE, 145). Le corps-paysage d'Hélène, depuis l'été jusqu'au printemps, et finalement aspiré au-delà:
« Je partage avec toi la cinquième saison
La fleur la branche et l'aile au bord de la maison
Les grands espaces bleus qui cernent ma jeunesse
Sur le mur le dernier reflet d'une caresse ».
(« La cinquième saison », PVE, 149)
Sans doute en va-t-il de la cinquième saison comme de la cinquième essence ou du cinquième élément : elle est à la fois présente en chacune et commune aux quatre, semblable et cependant différente. Par la vertu de l'alchimie rurale, tout corps dans cette poésie non seulement est panique, mais il peut être « sublimisé », transmuté en un paysage à la fois dans et par-delà les saisons.
L'expression de la vie
On cite fréquemment Valéry qui cite Degas, lequel cite Mallarmé à propos de la poésie. La limite de cette anecdote, c'est qu'il n'y soit question que de pensée et de mots. Les vers qu'on fait avec des mots ne valent que pour ceux qui ne savent plus ce qu'est la vie, ou bien qui prétendent l'ignorer. Qui nous dira que la poésie se fait à partir de la vie? Cadou, par exemple, dans ces lignes de 1943 : « Je cherche surtout à mettre de la vie dans mes poèmes, à leur donner une odeur de pain blanc, un parfum de lilas, la fraîcheur d'une tige de sauge ou d'une oreille de lièvre? ». On retrouve là le rêve, d'un Grosjean par exemple, d'une langue concrète où il n'y ait plus de frontière entre le mot et la chose. Ou le vertige provisoire d'un Follain : « Impossibilité pour un moment d'admettre que pour désigner le pain il puisse exister un autre mot que celui même de pain »8. Dire pain, pour qu'aussitôt monte aux narines une odeur de fournil... Autant de poétiques d'où la notion de présence n'est pas exclue, et l'on mesure l'écart entre ces entreprises et la mаllarméenne « absente de tous bouquets ». La vie d'abord et avant tout, voilà ce qu'exprime dans La Vie rêvée le poème éponyme :
« Si la vie n'était pas
La seule la première
À quoi bon la rosée
Sur le front du matin
[…]
Mais les oiseaux sont là
Sous les palmes obliques
Un arbre cache au ciel
Ses épaules gothiques
La rampe du rosier
Dérobe la maison
L'agneau cherche plus haut
Son miel et sa toison
Tout le jour écarté
Quand s'allument les fleuves
C'est l'homme au fond des cours
Qui déplie sa peau neuve. »
(« La vie rêvée », РVE, 107 et 108)
La vie prête à surgir, comme un vol d'oiseaux du feuillage. Et le vivant unanime sur la voie de l'évolution « cherche plus haut », « déplie sa peau neuve ». La vie enfin selon l'hexasyllabe primordial, mesure fondamentale, dédoublable au besoin.
L'enfance et le souvenir
De manière plus générale, c'est à la nature — au pays natal — que la poésie de Cadou doit sa vie et sa substance. Michel Manoll nous le redit sur tous les tons : « René Guy Cadou n'est explicable que par son lieu d'origine et le contact permanent qu'il a établi avec une Nature qui lui était consubstantielle...» 9 Le village d'origine surgit, dans le recueil posthume des Amis d'enfance (1965), parmi d'autres souvenirs fondateurs :
« Sainte-Reine-d e-Bretagne
En Brière où je suis né
A se souvenir on gagne
Du bonheur pour des années ?
Est-ce toi qui me consoles
Lente odeur des soirs de juin
Le foin mûr des tournesols
Le chant d'un oiseau lointain ?
C'est la pluie ancienne et molle
Qui descend sur le jardin
Et ma mère en robe blanche
Un bouquet dans chaque main.»
(РVE, 359)
Recomposant les sensations d'enfance, à la limite de la synesthésie, c'est sur cet arrière-plan d'expériences vécues, que le poète peut évoquer le fantôme de sa mère. Les campagnes du passé sont hantées par nos chers défunts. Nos villes, en revanche, n'ont que des cimetières.
Ruralité contre la veille
On ne fait pas la même poésie à la capitale et dans les provinces 10. C'est une assez vieille histoire, sans doute : vers 1895, à une époque où le symbolisme parisien s'épuise en quintessences, c'est de la province que vient dans une large mesure ce qu'on appelle l'élan naturiste 11. On pense à Francis Jammes. On sait combien sa poésie, attentive aux travaux des humbles, à leurs gestes quotidiens, exalte les valeurs de la vie. Depuis que la ville est ville, depuis qu'elle refoule aux lisières les champs et les basses-cours, son domaine d'expérience vitale en ressort amputé d'autant. Pour le citadin de souche, chaque instant de la vie rurale prend figure d'événement : il s'étonne d'un œuf à l'instant pondu parmi la paille, l'odeur du fumier peut-être le révulse. Sans parler de ses enfants qu'il plaint de n'avoir jamais vu de vache.
Dans une telle indigence rien d'étonnant, suggère Cadou dans ses Notes inédites, qu'on se méprenne sur la nature et sur les conditions du poétique : « Quoi que vous puissiez en penser il existe encore une vraie poésie, comme il existe de vraies vaches dans les villages. » (PVE, 425) La comparaison est trompeuse pourtant car, si les vaches — à défaut d'être vraies — sont bien réelles et que l'homme n'y est pour rien, la poésie, elle, reste à faire. La vérité, en matière de poésie, serait à proportion de la vie qu'on éprouve. Or, à la ville, l'homme ne peut faire l'expérience que d'autrui, et jusqu'à l'expérience solitaire de soi ne vaut pleinement qu'en rapport avec la diversité du vivant. C'est le contrepoint que développe en dialogue le très connu poème d'Hélène ou le règne végétal :
« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?
— Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys !
Mais moi seul dans la grande nuit mouillée
L'odeur des lys et la campagne agenouillée
Cette amère montée du sol qui m'environne
Le désespoir et le bonheur de ne plaire à personne »
(PVE, 300)
Ce n'est pas que la ville ne soit présente à Cadou, bien au contraire. Il n'est aucune de ses séductions qui n'affecte le poète. La plus terrible de toutes peut-être, c'est qu'il n'échappe pas à la ville puisqu'elle s'exprime en lui, puisque « le poète vit dans une prison de rues, de gens, d'immeubles, de klaxons, de bris de vaisselle »12. Forcé d'assumer cet état, s'il dit la campagne c'est en même temps pour refuser la ville. Et, ce faisant, « il nous délivre »:
« L'agitation des villes, la dispersion, les contraintes inhérentes à la condition de citadin le rebutaient. Il n'avait besoin que d'un seul décor, d'un seul lieu, du silence des campagnes afin de se livrer à ce lent travail de défrichement intérieur qui le tenait sans cesse en haleine » 13.
Or, on le voit, le défrichement dont il s'agit est un défrichement à l'envers. Il faut retrouver l'arbre sous le pavé des cours, l'étang sous les immeubles. Remplacer petit à petit Paris par « sa métamorphose », sous peine d'y perdre son âme de poète :
« Et l'enquête aboutit à des portes cochères
À de petites rues sans nom à des logis
Où dans la société d'une fille de chambre
Ariel devenu vieux trompe la poésie. »
(« Paris du souvenir », PVE, 274)
À l'écart de la ville, dans ces campagnes traversées par des rails, sillonnées de rares petites routes, rien ne ressort comme une gare ou le passage d'un train. Dans le silence du village, l'arrivée d'une automobile peut devenir matière à poésie, fournir une image de la parole poétique:
« Lucien Becker Jean Rousselot Michel Manoll
Amis venus à la parole
Comme un bruit de moteur à l'orée du matin »
(« Les compagnons de la première heure », PVE, 152)
C'est uniquement lorsqu'il échappe à la ville — et parce qu'il parvient à y échapper — que le citadin que nous sommes découvre la campagne dans toute son intensité:
« La nuit lorsque les femmes très pieuses dorment
Et qu'un cheval se met à rire doucement
Dans l'escalier tourmenté de la lune
Comme un automobiliste en panne
Le voudrais
Tout seul
Attendant l'aube
Pénétrer dans une église de campagne. »
(PVE, 242)
De façon générale, le poème dit à quel type d'expérience imaginaire le poète invite son lecteur. Pour bien lire René Guy Cadou, il suffirait de se faire à soi-même le coup de la panne !
C'est à l'évidence toutes ces tensions que La Maison d'été transpose sur le plan narratif. Pour en résumer l'argument, on peut se reporter à la quatrième de couverture :
« Gilles, le héros, est déchiré entre la solitude misérable de la grande ville et le mirage de la vie simple et rustique. Ce récit aux accents autobiographiques n'a d'autre contenu que celui d'un mythe : peut-on échapper à la faute que symbolise la ville, peut-on retrouver le lieu de la pureté? Le destin de l'homme est tel qu'il ne peut retrouver la Maison d'été. »
Où l'on retrouve la problématique judéo-chrétienne de la chute et du paradis perdu. On ne revient pas dans la maison d'été, pas plus que Meaulnes ne peut retrouver le chemin du domaine perdu. « Le langage est la maison de l'être », aurait dit Heidegger : le logos entrave notre perception de l'être en le situant hors de portée, le figeant en dehors du temps. On peut relire le titre de Cadou à la lumière de cette formule. La maison d'été serait alors le langage poétique, seul séjour possible pour l'exilé, qu'il réconcilie avec le passage du temps, ici et maintenant. Rien d'étonnant que le poème soit traversé de labours et de meules, de troupeaux, de récoltes, de vendanges. Mais en même temps c'est la maison où l'on a été, la maison de l'enfance, dont on ne parle qu'au passé. En marge de l'existentialisme athée, il appartient à la poésie surromantique d'aménager la maison d'été, de la rendre vivable pour le jour qu'on y reviendra, ressuscité des morts.
Ruralité et foi
À cette condition, la campagne peut devenir un article de foi. Qu'il s'agisse d'hommes en ribote, d'une femme exemplaire, du ciel ou de la tête du bœuf — dans tout 14 ce qu'on y trouve...
« Il est une raison éternelle de croire
Par-delà les moissons et les calendriers
A la grandeur des jours bornés et sans histoire
Qu'on dispose le soir comme un peu de fumier »
(РVE, 207)
À travers les motifs ruraux qu'il décline, le poème nous fait entrer dans la cinquième saison, qui n'est pas abstraction mais « sublimisation » du temps, rachat d'un monde que l'on croyait perdu.
Attardons-nous par exemple à l'une de ces gares oubliées dont on n'a pas fini de mettre en poésie les charmes désuets. Elle n'est là cependant que pour s'ajouter à la nuit, pour désigner l'attente, la déréliction du poète :
« Ô nuit! salle d'attente où brûle un feu de lèpre
Vieille gare des pluies seule et désaffectée
Quel voyageur maudit saccage tes fenêtres
Qui baigne des prairies de panonceaux crevés
Serait-ce moi ? »
(« Que la lumière soit », PVE, 246)
L'image surréalisante comme à l'ordinaire complique la vision, qui sert ici de comparant : « feu de lèpre », prairies « baign[ées] de panonceaux crevés ». Toute cette imagerie accentue le sentiment d'un monde abandonné, comme condamné. Or, la rédemption vient du christ, ou de ceux qui comme le poète ont accepté le sacrifice. L'évangile de Cadou proclame que le monde est sauvé. Et le poète en donne pour preuves cette somme d'expériences personnelles que la contemplation rend possibles, la fréquentation quotidienne des champs, du verger, du jardin. On songe à des notations récurrentes dans les récits de Grosjean, au tremblement d'une feuille, au brusque effeuillement d'un pavot. À cette différence près que, pour Cadou, l'expérience sensible n'est jamais traitée comme une fin en soi. Et c'est juste s'il ne nous dit pas que la terre est bleue comme une pomme qu'on ramasse :
« Mais voici qu'aujourd'hui un homme entre les hommes
A choisi par-delà ses astres préférés
La planète déchue tombée comme une pomme
Sur la dernière marche de l'éternité. »
(Ibid.)
À côté de la référence biblique, ce n'est pas seulement la pomme qui est en cause, mais bien l'expérience qu'on en a, son histoire et son avenir immédiats. Dans ce planétarium compliqué d'escaliers, la notation juste (on hésite encore à dire « vraie ») est cette pomme tombée ; tout le reste est littérature. Or, il s'agit de littérature, justement. Le travail de Cadou c'est d'accomplir la transfiguration. Sur la base de notations d'expérience, les plus profondément ancrées dans la vie et dans le temps, s'élabore à travers l'amour une espèce de campagne inverse. Ce qui est en haut est en bas, disent les mystiques : c'est encore la loi des correspondances 15. Dans le ciel cadoucéen où sa poésie nous invite, nous voici donc mêlés aux règnes du vivant, pour constater qu'à l'évidence nous y sommes plus vrais que jamais :
« Penche-toi à l'oreille un peu basse du trèfle
Avertis les chevaux que la terre est sauvée
Dis-leur que tout est bon des ciguës et des ronces
Qu'il a suffi de ton amour pour tout changer
Je te vois mon Hélène au milieu des campagnes
Innocentant les crimes roses des vergers
Ouvrant les hauts battants du monde afin que l'homme
Atteigne les comptoirs lumineux du soleil »
(« Hélène ou le règne végétal », PVE, 259)
À la fin cette question de la ruralité doit être replacée dans le cadre d'une réaction plus générale aux valeurs et aux contre-valeurs du surréalisme. Mais ce serait en même temps perdre de vue la cohérence et l'originalité de Cadou. Rousselot, à propos des poètes de Rochefort, écrivait en 1966 :
« Il s'agissait, pour ces poètes résolument provinciaux, de rendre au langage poétique une humanité, un poids terrestre, voire paysan, sans le priver de sa liberté d'invention, de son pouvoir de choc, sinon de révélation »16.
Qu'il soit ensuite revenu sur cette parenté pourrait montrer l'influence de Cadou sur son entourage poétique, plus évidente encore avec la distance des années. Assurément, c'est de Cadou qu'il parle. De lui d'abord, de sa fidélité aux mots de la terre. Sa quête ontologique et son humanité naissent de l'humus, s'enracinent parmi le vivant, exaltent l'étant, l'été et le passage du temps. Il ne saurait donc être question de reléguer Cadou, de le figer dans une ruralité ou dans un provincialisme réducteur : loin d'être une infirmité, le choix qu'il en fait fonde sa poétique. Au risque d'y mourir trop vite, trop jeune et bien trop tôt, sa poésie ne saura ni ne voudra démordre des campagnes. Il se peut que l'homme, de son vivant, fit oublier le poète. Il reste que l'effet le plus sûr de sa poésie est qu'elle nous met au monde :
« Je prétends à la vie
Et ne supporte pas
Qu'on me tienne enfermé
Dans les pages d'un livre
Hors des mots seulement
Je palpite et je suis
Pareil à cette image
Inconnue de moi-même
Si quelqu'un veut toucher
Mon cœur qu'il s'agenouille
Et creuse lentement
Le cœur chaud de la terre
Qu'il soulève en ses mains
La glaise et le terreau
L'humus qui garde encore
Une odeur de châtaigne »
(PVE, 196)
Notes
1.Le petit Robert des noms propres, édition de 1994.
2.J.Y. Debreuille, L'École de Rochefort, 1987, p. 468.
3.« Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le font voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, béant au fond de nous » (Usage interne, PVE, 389)
4.L'abréviation [PVEJ renvoie aux Œuvres poétiques complètes, Poésie la vie entière, Seghers, 1976.
5.Debreuille, op. cit., p. 196 et 197.
6.Ibid., p. 195.
7.Cité in Manoll, René Guy Cadou, 1954, p. 88.
8.« Formes de la poésie », cité in Lire Follain, PUL, 1981, p. 27.
9.Préface à La Maison d'été, p. 7.
10.Voir B. Degott, « Parisianisme et provincialisme fin de siècle entre Mercure et Gaudes », Aspects de la critique, Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, 1998.
11.Voir M. Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes, 1960, p. 33-37.
12.Hélène ou le règne végétal, préface, PVE, 251.
13.M. Manoll, Avant-propos, PVE, 8 et 9.
14.Pourtant, ainsi que l'a justement fait remarquer Jean Yves Debreuille, on n'y trouve pour ainsi dire jamais de paysans au travail. Mais il paraît que l'homme Cadou ne les fréquentait guère. Et de surcroît, ces hommes, qu'ont-ils à m'enseigner que je ne puisse trouver en moi-même ? les blés, la forge et tous les animaux me rapprochent davantage de l'être.
15.Les motifs chrétiens en pourraient être le Saint-Suaire et le linge de Véronique, l'un et l'autre présents chez Cadou.
16.Dictionnaire de la littérature française contemporaine, cité in Debreuille, op. cit.
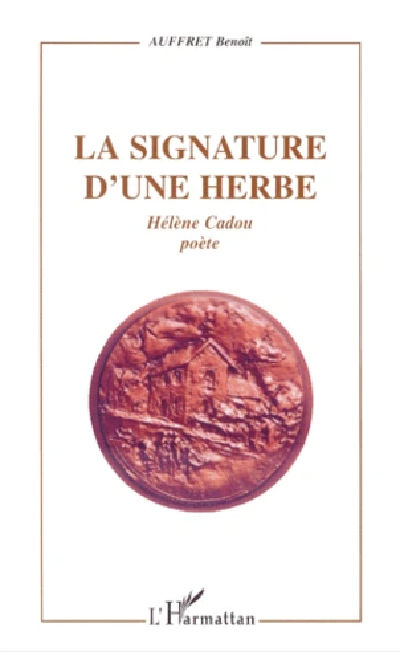 |
Le double et le miroir dans l'œuvre de René Guy Cadou, par Benoît Auffret
Université de Nantes |

(Retour au sommaire archives)
Toute l'oeuvге poétique de René Guy Cadou peut, à notre avis, être lue comme la poursuite par le poète « d'un visage » qu'il considérerait, à terme, comme étant « uniquement le sien » (198) 1. Car le « visage », dont part et où se pose le regard, manifeste, pour Cadou, la réalité de l'âme. Quêter son vrai visage à travers l'écriture du poème revient à discerner peu à peu sa « face de lumière » (264) qui se livre et se refuse tour à tour.
Le miroir poétique provoque le face-à-face. Le poème, de ce point de vue, est d'abord un acte de courage : René Guy Cadou, depuis sa Brière natale jusqu'à Louisfert, choisit de « faire face » et par conséquent de ne pas subir un destin qu'il pressent terrible comme une main posée sur son épaule. L'acte créateur induit aussi un devoir de loyauté envers soi-même : le poète vient se placer face à la réalité du monde, face à sa propre réalité. Sans fuite possible, l'écriture du poème s'apparente donc pour lui à un regard de vérité.
Assumé ce choix, le poète, pressé, ne veut plus « hésiter » - il n'en a pas le temps. Il se lance en quête de sens en se défaisant de tout ce qui pourrait embarrasser sa progression :
Fais vite
Ton ombre te précède et tu hésites
Derrière toi on marche sur tes jeux brisés
On referme la porte
Et les heures sont comptées
Mais la vie la plus courte
Est souvent la meilleure (36)
Le choix qu'il fait de la poésie n'en est pas vraiment un, car le poète n'a pas d'autre issue que de choisir « La part de Dieu », titre du poème dont nous venons de citer quelques vers. Il ne fait que suivre son « ombre » qui « le précède ». À la recherche de son image, il trouve dans le poème un miroir dont il accepte les modes particuliers de réflexion, qui deviennent pour lui des modes d'appropriation du réel. « La part de Dieu » se révèle être cette possibilité d'un autre regard sur l'être et sur les choses.
L'« ombre » est une sorte de double du poète, et non pas un clone. Elle est liée à lui personnellement, grammaticalement définie dans le texte ; s'il est dit, dans le poème, qu'elle le précède, le même poème souligne, à l'inverse, l'impersonnalité de celui ou de ceux qui, dans un même mouvement, le suivent. Reste que le mot « ombre » exprime une part de mystère : tout n'est pas très clair. Il faut se souvenir que la problématique du double s'ancre, particulièrement chez René Guy Cadou, dans celle du nom. Le poète porte le prénom d'un frère mort-né quelques années auparavant : Guy. L'étymologie de son premier prénom (Re-né, « né deux fois ») ne fait alors que renforcer la conscience d'une dualité interne. L'« ombre » est d'abord ce frère qui « précède » René. Elle constitue pour lui une charge ténébreuse, une responsabilité pesante puisqu'il doit vivre aussi pour cet être privé de vie dès la naissance qui se prolonge ainsi en lui et, finalement, pourrait bien lui succéder. Gilles, l'enfant non-né imaginé par Cadou (316), et Guy ont en commun peut-être plus que la lettre initiale de leur prénom:
[…]
On a changé ton nom le jour de ta naissance
Ta mémoire a perdu la forme de ton corps
Peut-être ton regard suffit au passeport
Ne crains pas de briser la glace des frontières
De jeter des flocons de sel dans la lumière
Cheval dément que flatte un désir de galop
Risque le monde entier au péril de tes sauts
Force les étendues sans havre sans mirage
Inscris ton pas vogueur sur tous les équipages
Ensemence de feu les poitrines sans tain
Que ton appel du soir soit proche du matin
Laisse tomber sur nous tes poings comme des perles. (134)
Le poète est convié ici à une « Ruée vers l'or » (c'est le titre du poème). À l'image des chercheurs de métal précieux plongeant sans cesse leur tamis dans la rivière, celui-ci se penche sur le miroir vivant du poète. L'allusion au miroir est d'ailleurs bien présente dans ces vers, bien que voilée par le lyrisme du texte qui sied aux grands espaces : il est pourtant question de « poitrines sans tain », de « mirage » ainsi que de « la glace des frontières » qu'il s'agit de « briser ». À l'hésitation qui marquait le poème extrait du recueil intitulé Années-lumière (publié dans les Cahiers de Rochefort en 1941) répond, dans celui-ci (publié dans le recueil La vie rêvée trois ans plus tard) une série d'injonctions très nettes : « Ne crains pas », « Risque », « Force », « Inscris », « Ensemence ». La poésie s'apparente pour Cadou à un miroir, à un « miroir ombreux », comme l'écrit, après lui et comme en écho, Hélène Cadou 2 Ce texte « musclé » à l'impératif s'appuie donc sur l'évocation de phénomènes spéculaires. Le poème, par nécessité pour le poète de se rendre reconnaissable en se « faisant une image », est le lieu d'un dédoublement de la personne (le « je » interpelle ici un « tu » qui est un autre lui-même). Il constitue surtout le lieu d'un passage (on parle de « passeport ») d'un sujet à un autre, d'un endroit à un autre ; autrement dit, il est une démarcation entre deux mondes. D'où l'invitation faite au poète : « Ne crains pas de briser la glace des frontières » : la polysémie du mot « glace » remplissant parfaitement son office, la « glace » est une autre façon de dire le miroir. Mais le premier sens de ce terme dénonce surtout la rigidité du miroir artificiel auquel s'apparente l'eau figée par le froid. Le poème-miroir, s'il saisit, de manière vivifiante, par sa froideur, ne peut, quant à lui, être envisagé que comme mobile et donc vivant : « le miroir tremblant d'Orphée » évoqué dans la première chronique de Cadou dans la revue Les Essais 3, en février 1947, est un « miroir comme une eau froide » (365). Le tremblé de la perception rejoint la part ombreuse décrite auparavant : ce qui est perçu reste vague, approximatif ou tout au moins parcellaire, dans un mouvement d'images présenté comme le gage d'une relation spéculaire féconde. Dans le poème « L'enfant de la balle », le suicide du clown se trouve ainsi relié à l'arrêt de sa roulotte (comme dans d'autres poèmes la mort est induite par l'arrêt d'un train), arrêt qui annule tout mouvement de l'eau dans la cuvette où, chaque soir, l'artiste se démaquillait et supprime, de facto, toute possibilité de vie au-delà du miroir et des masques :
Mais dans la roulotte arrêtée
Un soir
[…]
Pas de visage dans la cuvette (222)
La nécessité d'entretenir ce tremblement s'impose d'ailleurs au poète, puisqu'il s'avère être le moteur de sa démarche sans lequel tout se fige et se meurt : Il doit « jeter des flocons de sel dans la lumière » et se présenter comme un « Cheval dément que flatte un désir de galop ». Le désir, cette tension vers autre chose, vers un autre monde (on retrouve l'idée de conquête de terres encore vierges liée à l'intitulé du poème : « La Ruée vers l'or ») est au cœur de l'expérience poétique de Cadou. Dans le poème « Moineaux de l'an 1920 », il insiste sur cette corrélation entre la poésie et le mouvement de la vie, quoi qu'il puisse en coûter :
Moineaux de l'an 1920
La route en hiver était belle !
Et vivre je le désirais
Comme un enfant qui veut danser
Sur l'étang au miroir trop mince (318)
La force de la volonté presque capricieuse de l'enfant se joue du danger que représente un « miroir trop mince », infime pellicule entre deux mondes, entre un ici et un au-delà dont le poète, dès l'enfance, a perçu la proximité et la beauté. Celui-ci est poussé par un désir si fort qu'il choisit de « danser » à la limite des possibles, quitte à sombrer, ne pouvant renoncer à cette vie que dorénavant il désire de tout son être et dont l'harmonie est comparée à celle d'une « route en hiver ».
Le poème forme donc un miroir vivant, élaboré au fur et à mesure de son écriture, au-delà duquel René Guy Cadou tente de rejoindre son « ombre ». Interrogeons-nous sur l'identité de ce double qui le « précède » et le prolonge à la fois.
Le dernier homme
Quand le lilas aura grandi sous la fenêtre
[...ј
Un homme qu'on avait cru mort se lèvera
Et repoussant les feuilles rouges
Comme un drap
Se mettra à marcher tout nu dans la forêt
[…]
Il fera des centaines de kilomètres
Sans s'éveiller et sans s'y reconnaître
Puis un beau jour [...]
Sans comprendre il suivra une petite voie
Qui le mènera un peu plus loin dans la profondeur des bois
[...] il est mort depuis vingt siècles [...]
Il est nu et il a les poches bourrées de livres
Il a soif de visages mais l'eau bleue des étangs
Est couverte de masques et de flocons d'argent
Si bien qu'il ne se voit pas lui-même et s'imagine
Aveugle [...]1 (232-233)
Ce ressuscité de « vingt siècles » incarne peut-être le Christ ; il renvoie surtout directement au poète qui « se lève » et « repousse » « Comme un drap » les forces de mort. Contrairement à son divin prédécesseur, il agit « sans s'y reconnaître », « Sans comprendre ». Il suit, à l'instar de Sainte Thérèse de Lisieux, « une petite voie/ Qui le [mène] un peu plus loin » ; l'objectif se montre modeste. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est sa soif, expression d'un désir : « Il a soif de visages » (le terme est au pluriel). Le lecteur comprend que de l'étanchement de cette soif dépend, pour le poète, la reconnaissance de « lui-même ». L'homme semble traverser la mort dans un demi-sommeil (il marche « Sans s'éveiller »), pénétrant ainsi « dans la profondeur des bois ». Tout lui apparaît différent de ce qu'il a cru connaître et pourtant tout est là. Il a soif mais se heurte finalement à « l'eau bleue des étangs », dont la transparence est insuffisante pour permettre d'accéder véritablement aux « visages » qu'il espère. L’ « eau bleue » qui aurait pu l'apaiser forme l'ultime obstacle à sa démarche. L'homme attendait des « visages », l'eau trouble lui renvoie des « masques », des faux-semblants, des identités manquées qui sont peut-être des reflets narcissiques auxquels le poète a prêté trop d'attention, « Si bien qu'il ne se voit pas lui-même et s'imagine/ Aveugle ». Pourtant la démarche de cet homme est une démarche de vérité : sa nudité est soulignée à deux reprises (« tout nu dans la forêt », [...] « Il est nu »). Mais le miroir d'eau dans lequel il voudrait se mirer est, quant à lui, « [couvert] de masques ». Ainsi donc Cadou insiste sur la nécessité pour le poète d'ассерter une double nudité : il doit se défaire de tout bagage (même s'il triche quelque peu puisque l'homme, malgré sa nudité totale apparente, « a les poches bourrées de livres ») et, en même temps, doit travailler le support miroitant de ses mots, autrement dit le poème, pour qu'il s'épure des « masques » d'un certain nombre de travers d'écriture et des « flocons d'argent », métaphore que l'on peut entendre comme une allusion directe au désir d'une reconnaissance (« Le n'écris point pour me donner ou conserver une position avantageuse mais, entends-moi bien, pour me situer toujours au-delà de moi-même, pour avoir une raison plus tard de m'accueillir à quelque carrefour perdu dans les bois » (424), précise Cadou dans ses Conseils et notes).
Contrairement à Narcisse, le poète est renvoyé par le miroir poétique à des visages inattendus, différents du sien. À vrai dire, il se reconnaît toujours « différent de lui-même » (210). Ce n'est pas, bien évidemment, le cas de Narcisse, pour qui la perfection du reflet renvoyé a rendu l'expérience mortelle :
Entre vos bras ouverts un cadavre descend
Qui vous sourit déjà et déjà vous ressemble
Et vous ne pensez plus qu'à forniquer ensemble (171)
René Guy Cadou, quant à lui, trouve dans l'imperfection du miroir vivant constitué par la poésie son image fragmentée mais véritable. Il situe dans la qualité du tremblement, dans l'approximation maladroite, dans l'infidélité de la perception la performance et l'exactitude de ce qui lui est donné. La connaissance de soi s'avère être parcellaire et conditionnée par une mise à distance de l'ego : « Et loin de moi je savais bien me retrouver/ Ensoleillé dans les cordages d'un poème » (275). Le mouvement décrit dans ces deux vers est centrifuge, le « je » se trouvant propulsé « loin » du « moi » et achevant sa course dans les salutaires « cordages » du « poème ». Cette progression de l'être est la conséquence directe de la démarche spéculaire découverte ou redécouverte par René Guy Cadou à travers son écriture poétique. À la fois proche et distant de lui-même, il s'appréhende comme étant le même et l'autre. L'ouverture à l'altérité dessille son regard aveuglé par la tentation du reflet narcissique. Le poème intitulé « Le Mime » tient, dans une étude des phénomènes spéculaires dans l'œuvre de Cadou, une place particulière :
Il n'у avait qu'un haut plafond dans cette chambre
Оù personne avant lui n'était jamais entré
Et c'était tout à fait dans les derniers étages
D'une vie menacée par les trains de banlieue
Une autre vie déserte encor mais que lui-même
S'efforçait d'éveiller doucement sur sa joue
Seules ses mains parlaient qui suivaient le visage
Jusqu'au fond du miroir inquiet de la beauté
Et composant pour lui une danse légère
L'éclairaient lui donnaient son profil enchanté
Il n'y avait qu'un haut plafond dans cette chambre
Mais penché sous la lampe oblique de ses mains
Cet homme remuait un visage d'eau douce
Qui n'était déjà plus uniquement le sien
Un visage éloquent comme une porte ouverte
Et l'ombre pouvait bien dérober ses épaules
Le distraire à jamais d'entre ses deux genoux
Faire tant qu'il perdit la science végétale
Qui portait dans son cœur un bruit lourd de cailloux
Heureux de se savoir vivant dans un visage
Où la douleur a mis sa forme préférée
Cet homme se prenait maintenant à sourire
À son propre visage et à sa vérité. (197-198)
On retrouve ici les éléments que nous avons tenté de mettre en lumière plus haut (le dédoublement, la relation douloureuse et fertile avec « l'ombre », les jeux spéculaires de la ressemblance et de la répétition, la perturbation des référentiels, le caractère mobile et vivant du miroir offert à l'homme qui se mire). Nous insisterons, à ce stade de notre trop courte étude, sur la mise au monde du poète par lui-même à laquelle nous assistons. « Ma poésie travaille pour moi » (396), autrement dit, « Ma poésie me met au monde ». Dans ce poème-ci, deux vies se répondent : la première est « menacée par les trains de banlieue » : il s'agit d'une vie remplie, et même encombrée, marquée de surcroît par la symbolique du train qui, chez Cadou, renvoie à la mort ; la seconde s'éveille lorsque semble finir la première. Sa caractéristique est la virginité, « déserte encor ». La dernière strophe du poème est, métaphoriquement parlant, tout entière construite autour d'un accouchement : dans la douleur, un « homme » donne naissance à son double, « entre ses deux genoux ». L'« ombre », part mystérieuse et obscure de soi-même, tente bien de se « dérober » à cette mise au monde dont elle est l'objet, de « distraire » l'homme, probablement en renvoyant dans le miroir des images trompeuses. Rien n'y fait. La mise au jour a lieu. L'« ombre » prend alors les traits d'« un visage ». L'homme, vainqueur de cette épreuve, sourit pour finir « À son propre visage et à sa vérité ». Mais quel est ce « visage » véritable ? La strophe précédente évoque « un visage d'eau douce/ Qui n'était plus uniquement le sien/ Un visage éloquent comme une porte ouverte ». Le visage découvert à travers la mise au monde de soi dans le miroir du poème s'avère être à la fois celui du poète et celui d'un autre. La relation normale d'identité d'un être avec son image se trouve transformée.
La première identité de visage renvoyée par le miroir est celle de l'enfant. L'enfance forme, aux yeux du poète, une surface vierge, innocente, fragile comme un « miroir trop mince », si mince qu'il révèle au mieux ce qui se cache derrière : ainsi, lorsque Cadou parle de l'ami Guy Bigot, il écrit : Il « N'avait pour se mirer que l'ongle d'un enfant » (247). Car l'innocence de l'enfant renvoie, sans fuite, l'homme à sa vérité : « Jésus vient de naître les rois/ Vont se mirer dans ses prunelles » (188).
De ce visage d'enfant à celui du poète adulte qui se regarde dans le miroir défilent les « Visages de solitude » :
Mais moi multiple moi blessé moi partagé
Entre toutes ces nuits venues à ma rencontre
Vivrai-je assez longtemps pour vous aimer enfin
Vous qui me tourmentez visages de moi-même
(...)
Visages de ma solitude je vous vois
Et c'est toujours ainsi que je vous ai voulus
Penchés toujours penchés sur l'ombre et regardant
Tout au fond de la vie qui remue
Accueillez-moi du moins comme on accueille un pauvre (268)
Autant de visages de lui-même qui établissent le poète en tant que vivant. Les tourments issus de ces visions sont un gage de vitalité : Cadou parle de « la vie qui remue ». Le plus étrange ici est le retournement des référentiels qui débouche sur l'incertitude de savoir qui regarde qui. Une inversion de points de vue décrit en effet les « Visages » « Penchés sur l'ombre et regardant »; or, pour finir, c'est le poète qui demande à être « accueilli », de l'autre côté du miroir, parmi ces fragments d'identité. Le poème s'apparente à une « frontière déployée entre un réel et sa contrepartie » 4 sans que l'on ne sache plus vraiment qui, de l'image ou du modèle, fait face à qui. Il forme une pellicule tendue entre un visage qui se cherche et des visages multipliés par le jeu de l'écriture. L'unité qui rendrait ce visage identifiable n'est livrée au poète que de manière spectrale, sous la forme d'une multitude d'autres visages. Le miroir se présente comme un lieu d'échanges ; « le mime » incarne, par son jeu, un autre personnage que lui-même, acceptant ainsi de s'ouvrir vers l'extérieur. Il découvre ce « visage éloquent comme une porte ouverte » (198), l'ouverture de la porte symbolisant tous les possibles contenus dans la parole du poème. Par l'écriture, le poète s'ouvre, se dépossède de lui-même pour mieux se retrouver. L'acte de vérité est donc essentiellement un acte d'amour. Les visages découverts par René Guy Cadou sont ceux d'amis, proches ou lointains, « connus et inconnus » (213) révélés comme autant de « visages de lui-même » (268). « Aux amis perdus » il adresse par exemple ces mots : « Vous étiez là je vous tenais/ Comme un miroir entre mes mains » (175). A Michel Manoll qui s'inquiète de sa santé, il écrit ces vers où le jeu spéculaire est tout à fait étonnant : « J'entends ton cœur dans ma poitrine/ Au fond du miroir je me vois/ Et tu as toujours bonne mine » (187). Cadou n'hésite pas à se pencher au-dessus d'un miroir vivant comme la Loire à Nantes pour débusquer, par amour de la poésie et par amitié des poètes, ses propres « visages de solitude »:
Alors j'interrogeai le fleuve et les pontons
Comme si j'espérais trouver André Breton
Ailleurs qu'en sa mémoire et ailleurs qu'en l'Histoire
Penché sur le flot noir comme en un miroir (298)
Cadou rassemble tous ces visages et, par les ressemblances mises au jour par son amour, reconstitue, à travers eux, son propre visage : « Le vous rends semblables à moi par mon amour » (193). Cette parité ne sera que plus forte lorsqu'il s'agira d'assimiler Hélène à sa propre identité, le « corps » même de l'aimée devenant, grâce à l'acte amoureux, un miroir, un poème de chair :
Inquiets nous attendons les oiseaux de passage
Comme s'ils devaient nous rapporter nos visages
Transfigurés par les soleils du pays froid
Et je cherche à travers ton corps la transparence
La fleur de neige au bord des vallées de silence
[…]
Pour qu'on ne sache rien de ta joie de ta peine
Tu rêves d'une fine écorce sur ta peau
Je m'avance vers toi bruissant comme un feuillage
Je suis en toi mon sang continue son voyage
Il ferme ton épaule il soupèse ta joue
Et quand j'ai bien sculpté ta chair à mon image
Une tige de blé sépare nos genoux. (166)
On peut lire encore, dans Hélène ou le règne végétal : « Depuis le temps que je t'invente/ Fatalement tu me ressembles/ Et chaque jour me prend un peu/ De ma lumière et de ma nuit » (264). Cadou configure ainsi l'être aimé au miroir et au poème.
Peu à peu, à travers ces identités multiples mises en jeu par le miroir, René Guy Cadou dégage une « certitude obscure » (212), celle de la préexistence d'un Visage unique auquel lui-même se rapporte comme chaque visage découvert dans les miroirs de l'amitié et de l'amour, le visage de celui qui « (le) hante » et qu'il nomme « (sa) face de lumière » (264). Ce « Visage du Voyageur » (305), « Sainte Face » (106) qui s'éclaire avec le monde, de par son universelle ressemblance avec tout homme, est donc aussi celui du poète. Cadou découvre que l'amour, par la multiplicité de ses liens et de ses renvois, crée l'unité de soi. Il saisit alors mieux la relation de l'être créé à « celui-là si grand qui nous rassemble/ L'homme pareil à l'Homme/ La troublante effigie » (213), autrement dit, Dieu. Dieu, à qui l'on peut attribuer cet aphorisme extrait d' Usage interne: « Celui qui ressemble à tout le monde, ne ressemble à aucun autre » (390). Qu'il s'agisse du Christ ou du poète, l'identité personnelle déсоulе de la fusion avec l'universel.
C'est pourquoi l'expérience poétique est une expérience de vérité qui s'apparente à un examen rigoureux de soi-même. Dans un poème intitulé justement « Confession générale », René Guy Cadou écrit : « Plus besoin (...)/ De ressembler à travers soi à quelqu'un d'autre » (245). Chaque « autre » est en effet à la fois le fragment et l'image de l'unité transcendante en dehors de laquelle le poète ne pourrait prétendre découvrir sa propre unité. Parce qu'il est un acte d'amour, le miracle poétique a lieu [et nous rappellerons en passant que les mots miracle et miroir ont même racine étymologique]. En effet, seul l'amour, qui induit l'existence d'autrui, peut engendrer l'unité de soi. On comprend alors mieux la formule suivante : « Je ne suis seul que dans mon amour » (408), où l'adjectif « seul » ne renvoie pas à solitude, mais à unicité et harmonie. Le poète n'est finalement lui-même qu'à travers l'ouverture amoureuse vers l'autre. Dans son amour du monde et d'autrui qu'il exprime par le texte poétique, il se sent « fort comme un seul homme » (204) face au destin.
Le miroir du poème, tout en lui dévoilant sa vrаiе nature, lui confirme son aptitude à ne pas être seulement ce que le reflet lui renvoie : un être mortel, marqué par la mort et par la souffrance. Il l'ouvre, au-delà de lui-même, à mille visages dont sans doute, par projection, chaque lecteur fait partie, mille « éclats », mille témoins de la beauté disséminée dans le monde que le poète rassemble en lui :
Et tu sens soudain un grand choc
Tu es couché tout près de toi dans la verdure
Tu es comme mille petits trous de serrure
Qui regardent dans ta tête éclatée
Les éléments épars de la beauté (209)
Ce « choc » final et mortel ramène brutalement notre étude à un constat, non pas d'échec mais de manque : le poème n'ouvre la porte vers une autre réalité que pour attiser en nous le désir, sans livrer le passage. Il s'apparente plutôt à ces « mille petits trous de serrure » par lesquels nous sommes invités à regarder. La poésie, pour sa part, peut s'apparenter à ce que Cadou décrit comme « Ce minutieux mouvement d'herbe de mes mains/ Cherchant vos mains parmi l'opaque sous l'eau plate/ D'une journée, le long des rives du destin » (347). Mais elle « n'est rien », dit-il encore, « que ce grand élan qui nous transporte vers les choses usuelles - usuelles comme le ciel qui nous déborde » (387). Le miroir poétique ne propose à terme que l'image d'un désir, sans qu'aucun passage n'ait lieu. Par distanciation, il met à jour une autre réalité tout en en préservant celui qui se mire. Il ne donne accès à aucune autre réalité que celle du poème. L'âme, celle du poète ou celle de son lecteur, est invitée, dans le jeu spéculaire ainsi décrit, à participer de la beauté à laquelle, dans le poème, elle s'ouvre. Nous nous rapprochons ainsi « de ces pays qui n'ont un sens qu'à travers (le poète) » (213).
Notes
1.Toutes les citations de René Guy Cadou sont extraites de Poésie la vie entière, Œuvres complètes, Paris, Seghers, 1977. Les numéros entre parenthèses renvoient aux numéros de pages dans cette édition.
2. In L'Innominée, Remoulins-sur-Gardon (30), éd. Jacques Brémond, 1980.
3.Le Miroir d'Orphée, Mortemart, Rougerie, 1976, p.31. Cette chronique est initialement parue dans la revue trimestrielle Les Essais en février 1947.
4.Jean-François Comte, « Derrière le miroir... », in Vagabondages n° 14 (décembre 1979), p.8.
Références Bibliographiques
Hélène Cadou, Méditation sur le thème de la mort dans « Poésie la vie entière » de René Guy Cadou, Mémoire de Maîtrise en Philosophie dactylographié, Université de Nantes, Dir. Philippe d'Harcourt, 1980, chapitre II : « L'ombre portée. L'ombre, le double, le dévoilement », p.18-43.
Jean Yves Debreuille, Les Miroirs d'Orphée : reflets, ressemblances, inversions dans l'écriture poétique de René Guy Cadou, Actes du colloque René Guy Cadou, Nantes, 23 - 24 - 25 octobre 1981, Textes et Langages 6, Université de Nantes, 1982, p.107-123.
Christian Moncelet, Les Liens de ce monde, Champ Vallon, Seyssel (01), coll. Champ poétique, 1983, chapitre IV : « Orphée aux reflets. Cadou l'anti-Narcisse - Les miroirs - De l'un à l'autre - De l'un au multiple », p.201-226.
 |
Cadou et l'imaginaire du sang,
par Francine Caron
Universités de Rennes II et d'Angers. |

(Retour au sommaire archives)
Lorsque l'on découvre l'œuvre de René Guy Cadou, on ne peut qu'être frappé par une sorte d'obsession du « sang » : sur les 341 poèmes de la première partie des Œuvres poétiques complètes, on en décompte 110 qui présentent au moins un vers où ce mot est cité. Plus d'un tiers, n'est-ce pas une proportion énorme, hors-norme ? Je vais donc étudier les caractéristiques de cette « obsession du sang », m'en tenant aux pages 15 à 248 de Poésie la vie entière, Seghers, Paris, 1996. Qualitativement, quelle apparence cet imaginaire va-t-il revêtir ? Que nous révèle-t-il du monde ? De l'auteur lui-même ? Présentera-t-il quelques poncifs ? Sera-t-il « originel », ou simplement original ? Enfin, pourra-t-on vraiment parler d'une « rêverie du sang » telle que la concevrait Bachelard ?
La première métaphore du sang « cadoucéen » apparaît dès le 1er recueil de 1937, Brancardiers de l'aube ; elle est active et même agressive : « les caillots crèvent le chemin » (page 18).
Déjà, n'est-ce pas là une expression étonnante dans sa richesse évocatrice, presque excessive, voire « dangereuse », corporellement parlant ? Tout comme si l'inconscient connaissait son « haut mal » (titre de la page 129) que j'entends ici, sans aucun doute comme Cadou, au sens de carcinogénèse, et non d'épilepsie - Elle évoque pour le moins une analogie sensible, telle que « le chemin(ement) du sang à travers le corps », pour la transformer à l'inverse et complémentairement en sang d'un chemin humain et d'une vocation), mais qui exploserait comme une sorte de « bombe sanglante » « Les caillots crèvent »), préfigurant ainsi un destin condamné (« crèvent le chemin »).
D'autre part, lorsque l'on emploie ce mot, ailleurs tabou, on sait que le sang « passif » est associé à « la femme passive », du moins dans une vision arсhétypale. En est-il-bien ainsi ? Pour ma part, en 240 pages, j'ai trouvé cinq équivalences où la femme égale le sang. Ouvrons Années-lumière sur le poème « La nuit, la mort » (pages 36/37). Nous lisons : « Écoute/ Il y a celui qu'on attend/ Et qui est mort en route/ Celle qui prie/ La porte se referme/ Ah les premiers soucis/ Les mains qui saignent/ Les orphelins dans l'ombre ».
Ces « mains qui saignent », présentées nues comme portant stigmates, sont donc celles d'une jeune veuve, tandis que la mort s'éloigne en riant « tout bas ». Mais les « stigmates » sont peut-être ceux qu'imposent les circonstances, une société inhumaines,-ceux d'un travail trop rude qui crevasse des mains fines... Enfin cette femme est christique », comme nous le verrons plus loin.
Le sang, c'est encore, in « Traduit de l'amour » (220), « Dans une ville triste et lourde avec des femmes/ ensanglantées sous la lumière des trottoirs »
Un dessinateur actuel de bande dessinée, tel Enki Bilai, donnerait selon moi parfaitement à voir ces vers, montrant d'étranges femmes « suburbaines », en train d'évoluer sur des trottoirs (« sous des trottoirs... », dit Cadou) brillants de pluie, éclairés par des réverbères. (Dans un texte précédent, le poète évoquait « les fleurs de réverbères qui s’ouvгеnt sous la pluie »). Mais là où j'ai voulu expliquer, « déplier » en 24 mots, la poésie en convoque seulement huit, essentiels, où la tristesse première transforme les trottoirs en lieux tragiques (de vraisemblable prostitution). On relève enfin :
p. 147 « Déjà / et dans le sang / ta femme va paraître »
p. 234 « et la femme occupée à vivrе se souvient / d'un enfant de son sang paré »
p. 192 « Et : la femme "écoute son sang" » etc (« Image de la femme nue »)
Dans les deux derniers cas, sans doute sous l'influence de la femme aimée, Hélène, mais aussi en raison de son hypersensibilité, l'on voit comment Cadou a convoqué la part féminine de lui-même. Et l'on y découvre autant la particulière cénesthésie du cycle (parfois douce en ses secrets), révélée beaucoup plus tard par une Annie Leclerc, que la grande fierté de mettre au monde. Une Marceline Desbordes-Valmore, nullement « dépassée » quant aux mots du corps, en témoigne dans le choix de Jeanine Moulin, par exemple. Mais, pour en revenir à notre poète, comment oublier cette « parure » qu'il invente, ce riche vêtement des cellules maternelles ? Nostalgie d'un enfant impossible ?... Revenons au style. Donc, si Cadou recourt à certains clichés, c'est pour les questionner, les recréer et par cela-même les détruire. Jamais banal, il est dans ces exemples tour à tour expressionniste, allusif, féal de la merveille, hypersensible. Presque toujours unique.
« Un sang original »
C'est donc sous les allures de l'Originalité, l'un des visages de la Liberté, que se présente cette vision du sang.
Et ladite originalité va être exprimée dans un premier temps par des adjectifs :
- le sang peut être amer (67), frais moulu (50),
-le sang n'est plus le sang bleu des nobles, mais celui de l'acier ennobli par le travail : « le sang bleu de l'acier dans le cœur de l'usine » (50)
-le sang noir est nocturne et alors singulièrement salvateur : « le sang noir de la nuit finit par nous sauver » (49)
ou le sang n'est pas rouge, comme le dit la langue vernaculaire, mais flamboyant (52) : « et la flamme du sang qui me lèche la main »
En fait, il est une palette de peintre : « C'est votre sang qui donne une teinte aux saisons », lance le poète en 1944 à ses « Amis de Rochefort » (148). Nous lisons dans le même esprit : « Et mon sang passe en moi par toutes les couleurs » (141) in « Ville ouverte ».
Ce sang multicolore peut donc être positif comme un arc-en-ciel. Il est même associé parfois à la tendresse et au désir (cf Fleur), à la gaieté, à la beauté, à la clarté :
- 45 : « On vit sans rien de plus dans la douceur du sang »
- 57: «A la clarté du sang / je dors »
-114 : « Le gai refrain du sang qui remonte son cours »
Ou encore, page 107: « C'est un homme seul qui s'avance/ et qui saigne/ Il est beau/ car le sang lumineux qui le baigne/ touche son front ».
Sang-lumière, sang fier, même : « mais le sang/ orgueilleux comme un rameau d'avril » (122).
Il va sans dire que ces connotations positives sont rares. Le mot sang évoque en premier lieu ses dérivés sinistres (« sanie », « saigner », « ensanglanter » etc). Bachelard pouvait parler à cette occasion dans L'Eau et les rêves d'une « poétique du sang », « d'une poétique du drame et de la douleur car le sang n'est jamais heureux ». Et il en ira ainsi, souvent, dans l'oеuvre de Cadou : « Chair béante et qui saigne » (120 :« Couleur des esclaves »). Et plus encore, on le devine, sous la botte nazie : « Rien ne fait plus chanter le sang des terres douces » (172).
Mais nous commencions d'évoquer l'originalité de Cadou, et il importe de prendre connaissance des voies nouvelles qu'images et métaphores suivent souvent fabuleusement avec lui. Toute une logique de l'imaginaire va rassembler et révéler des vers séparés grâce à de très belles métaphores filées qui font communier dans le sang l'humain et le végétal :
Ainsi dans « Jour de Dieu » (108), transposition poétique de l'expression « jour du Seigneur », la mort transforme la chair humaine en chair florale : « On parle à ceux qui boivent / [...] / Tu te souviens, Seigneur/ Celui qu'on a trouvé/ Avec un gros bouquet de sang sur le côté ».
Il en va presque ainsi d'ailleurs de la chair d'un Christ, assez hétérodoxe par ailleurs, qui semble à la fois en disparition et en agonie éternelles : « Tu ne reviendras plus dans le chaud de l'étable / Tandis que tes deux mains saignent sur les rosiers » (ces vers figurent également page 108).
Et Cadou - un Christ moderne ? - dit de lui-même : « Et je vais gaspillant mon sang dans les rosiers » (118, « Mehr Licht »)
Puis on arrive à d'autres paliers de cette métamorphose du sang en fleur quand le poète peut parler, dans un monde de belle ou douloureuse merveille, de « cueillir le sang » : « le sang que j'ai cueilli n'a pas laissé de trace » (61). De son côté, aussi avide, la bouche de la Terre boira cette liqueur : « Fleur de sang sur la lèvre épaisse du sillon » (« Le coquelicot », 131). De sorte que, dans « Bourgneuf-en-Retz », les collines ont un nectar mêlé de sang (56).
Autre exemple complémentaire et en apparence plus simple dans le poème « Ève », page 67, « le sang coule dans l'herbe », dans une association de séquences qui rend ces réalités naturelles presque inquiétantes, de cette primitive inquiétude que peut cependant apaiser la tendresse : « Le soleil met sa gerbe / Tout est clair entre nous / Le sang coule dans l'herbe / Et l'ombre me ramène au bord de tes genoux ».
Dès lors, il n'est guère de différence entre les humains et la grande Nature : « C'est en nous que nous marchons, dans les hautes herbes de notre sang » (85), s'exclament les Moissonneurs. Et dans le même « Lilas du soir », in « Liens de la terre », l'arbre parle et dit à l'homme : « C'est l'odeur de ton sang qui flotte dans mes feuilles » (87)
Ainsi le grand cycle de la Vie est-il recréé. La différence imposée par des noms différents s'efface : Cadou n'utilise guère davantage le mot « sève » que le mot « lymphe » : c'est bien le sang végétal qui gouverne.
Mais, dans cette œuvre, plus originales encore sont les métaphores animales du sang. Nous l'avions vu « minéral » avec l'acier (50). Animal, il peut être cheval, chien, serpent : (67) « la voix qui tire encore sur les rênes du sang »
(130) « le sang qui compte ses anneaux »
(158) « le sang qui jappe dans mes doigts » («A la Chesnaie en novembre 43 »)
- Inouï, le sang peut encore sonner comme une clochette : cf « mon sang léger tinte dans ma poitrine » (59), métaphore de 1942 reprise deux ans plus tard dans « la Charmeuse de serpent » sous cette forme: « pourquoi fais-tu tinter les grelots de mon sang » (161)
- Extraordinaire, il peut même s'associer à l'un de ses analogons presque contraires, la neige, dans la traduction dramatique de l'absence (page 21 : « des caillots de neige » ou encore (133) : « le fracas sanglant des avalanches »). Cadou en vient alors à évoquer sous le titre « la neige rouge » une bien étrange nativité dès le vers 1 : « Noël précoce encor le sang » (140).
Or ce sang, évocateur de l'absence, est en réalité omniprésent...
Répandu dans la terre-mère, puis en surface, il est chemin, vecteur :
(69) « Sur les pistes du sang c'est mon cœur qui se lance »
(161) « sur mes mains sur mon sang / je vous ai promené »,
Il est parcelle du sol dans l'expression « les cadastres du sang » (163)
Il est infiltré dans la pierre, tel un cœur de feu : « l'étincelle de sang qui fait battre les pierres » (137).
Enfin, Cadou évoque incroyablement plusieurs Éléments intrinsèquement mêlés : Feu + Terre + Eau. Ainsi, dans « Découverte de l'Amérique » (111) : « Salut à toi soleil, céréale du sang », il « court-circuite » entre autres le complément attendu : du sang... [de la terre]. Alors, nous prenons conscience que la terre elle-même est faite de sang. D'autre part, la simple logique nous engagerait à dire par exemple, selon le schéma de René Guy: « Salut à toi, ô blé, céréale du soleil... », association assez commune, il est vrai. Donc, il faut voir autrement le monde. Donc c'est le soleil (soit l'élément Feu) qui devient céréale d'une terre (= idem élément Terre) de Sang (soit l'élément Eau) en gésine. Relevant d'autres dimensions anthropomorphiques et sidérales, le soleil est la nouvelle moisson terrestre. Et ce sang devenant igné, c'est alors qu'il peut s'incorporer notre étoile, ou, comme l'on disait autrefois, accéder à « l'astre du jour ».
Sang de la terre, premier Élément féminin, il va, liquide, plus naturellement encore, envahir le second Élément féminin qui est l'Eau, se changeant alternativement en étang, fleuve et mer :
- l'étang : « Ton sang n'en finit plus d'agiter ses roseaux » (130)
- le ru ou le fleuve : « mon sang (...) coule à la mer goutte à goutte » (146) ou (156) « le sang change de rive / Il n'est plus de ruisseau / le long de ma maison ».
Il est encore mer sauvage : « Une lame de sang me fracasse les doigts » (152) et le poète, retrouvant les grandes origines, boira au sang de l'océan : « Océan maladif aux pâles intestins / C'est ton sang que je bois pour clore le festin » (111)
En oubliant ce qui, pour une fois, semble un emprunt à un Dictionnaire de rimes, on voit quel « grand rêve », au sens bachelardien du terme, s'incarne ici. La mer (rouge) changée en sang qui arrêtait les Égyptiens de la Bible n'arrête plus le Poète. C'est en fait une véritable Cosmogonie du sang que Cadou va créer pour notre enchantement. Après sa mutation en Eau, en Terre, c'est en Air et en Feu, les deux Éléments masculins qu'il va se transformer, créant ainsi la Tétralogie majeure :
- Il est d'abord le soir ou le matin, ceci presque normalement par les rougeoiements de certains couchers ou levers de soleil : « le soir met à son front des guipures de sang » (162) ou (58) « O sang frais du matin inonde mon visage ». Ailleurs, in « Panique à l'hôtel », c'est encore : « minuit, mais c'est aussi mon sang qui n'attend pas » (66).
Le voici soudain poseur d'étoiles : « le sang met une étoile à l'endroit de ton cœur » (61) ou double du ciel : « mon sang est traversé d'étoiles et d'éclairs » (102). Aérien donc, en dernière magie, le sang va devenir Feu, ce que nous anticipions :
(150) « et la fumée du sang sous les lampes du soir »
(67) « un sang amer m'aura consumé cette nuit »
(52) « et la flamme du sang qui me lèche la main » (un feu de caresses... ?)
Ainsi métamorphosé en 4 éléments, le Sang est panique, total, essence de Tout. Il est presque « divin », puisqu'il construit un langage et une architecture.
Cadou emploie alors des termes d'artisan (la benne... née sans doute de sa consonance avec « la veine » ; la poulie), plus conformes à sa poésie fraternelle que des termes démiurgiques : « la première fois je regarde l'homme / ( ... ) / j'entends monter sa voix dans les bennes du sang » (31).
Ou bien, iп « Haut mal », « Et la poulie du sang qui tire le visage » (129).
Ce liquide (qui dans notre réalité humaine est contenu dans le cœur et dépendant de lui) devient contenant du cœur, maître du cœur, le dessinant (« mon sang dessine un coeur au bord de ma chemise », 123) ou le recréant autrement. C'est alors que Cadou peut parler pour les autres, en une pitié désolée : « Que dire des genoux retombés sur les dalles/ du sang qui donne au cœur l'inclinaison fatale » (165). Idem dans les « Maisons du destin », page 205 : « la pluie d'avril ne chante pas dans les gouttières/ bouchées par un caillot de sang gros comme un poing ».
Matière première, le sang est enfin pour le poète la corde sur laquelle ce dernier essaie de trouver l'équilibre : « Je danse sur mon sang/ comme un danseur de corde » (98).
En réalité, cette grande allégorie quasiment indienne, pouvant nous rappeler la danse impassiblement souriante de Çiva, cache à grand-peine l'angoisse qui émaillait les avant-derniers poèmes. Et si je n'ai pu - faute de temps - procéder à un historique du sang douloureux, conjoint à un bonheur d'écriture croissant, je remarque que c'est surtout à partir de 1941 que les métaphores du sang sont les plus profondes et les plus belles : autrement dit, à partir du moment où Cadou ose s'incarner, dire « mon sang ». C'est chose rare chez un homme quand il ne parle pas de sa lignée, et chez un poète français de surcroît. (Il en va tout à fait différemment en poésie espagnole. J'en veux pour preuves parmi tant d'autres, Lorca, Hernandez surtout, et ma dernière lecture en 1998 de l'écrivain José Maria Lopera.)
« Un sang originel »
J'ai noté précédemment quantité d'expressions originales, puisque nous les observions à la lumière du style. Mais comment faire abstraction de l'autre versant profond, déjà bien présent ? Signalons (ou plutôt soulignons) en quelques nouveaux exemples la marque de l'Originel dans l'œuvre de Cadou. Elle est bouleversante car nous envisageons maintenant la profondeur du vécu, une « remontée » de l'inconscient et parfois la souffrance du non-dit, voire la souffrance physique tout court, quoique transposée. Ou distanciée.
Ensanglanté, comme perdant son sang, Cadou va utiliser à plusieurs reprises la troublante métaphore d'un « visage caillé » (64), que l'on retrouve dans l'« étoffe de sang qui moules [s]on visage » (147), et il demande aux « grands soleils » de sécher « le fard de sang qui maquille [s]a joue » (70).
Près d'un Sang éternel et tout-puissant parce que partout épandu, le sang humain limité bat le tempo de la prochaine mort : « le sang renverse en moi son pâle sablier » (in « le Grand voyage » - 138, qui s'achève par ces vers ambigus : « J'avais tant de plaisir / À penser que j'allais être seul à mourir ».)
Ailleurs (108), « mon sang se noue/ Au sang lourd de l'horloge ». L'horloge égrène pour les hommes un temps qui est perçu comme son propre sang (à elle). Ainsi en va-t-il pour la langue française : le sang est le temps, à un phonème près.
Ce sang, dépourvu de pouvoir, ne peut plus « achever le profil de la nuit » (155). À défaut de recréer une vie, en l'occurrence celle d'un jeune combattant de la Liberté, il ne peut qu'en suggérer le simulacre, une masse défaillante - « Et son beau sang qui faisait peur/ avait coulé jusqu'à sa poche/ la gonflant comme un autre cœur » (182) - avant que ce flux ne se mette à « reculer » (109), à « tomber sur le cœur » (203), en des raccourcis saisissants qui le disputent au réalisme atroce d'une vie « liquidée » dans la vision suivante, qui date de 1947-48 : « le remugle du sang dans le trou d'un évier » (207).
Ailleurs reprendra, sinon le cycle de la vie, du moins sa tendresse. Aussi, semblable à Christ, selon le Nouveau Testament, le poète peut-il avouer : « Et ceci est mon sang et le froment des larmes » (117). Ou, comme le Nazaréen a offert sa vie pour les hommes, Cadou, pour l'amour de l'amitié, se donne en transfusion de tendresse à Michel Manoll : « et ma main sur ta main tout mon sang passe en toi » (187). Ces deux dernières métaphores sont éminemment vivifiantes, puissantes : Tant que le Sang est assimilé à l'Essence du monde, tant qu'il parcourt en comète les ciels et qu'il passe « de l'horizon d'un seul à l'horizon de tous » (si j'ose citer Éluard dans un contexte assez différent), il y a quelque réconfort à se savoir immergé dans ce bain primordial, il y a quelque vision jungienne d'inconscient (collectif) salvateur. Du moins, pour qui écoute ou lit Cadou avec sympathie.
*
J'ai donné à dessein, pour l'intensité de l'exposé, outre une énumération de ces métamorphoses souvent incroyables, une présentation plutôt dramatique du cycle du « sang général » (pour plagier Neruda et son Canto general), et j'espère avoir convaincu de l'importance capitale de ce thème et de cette expérience dans l'œuvre de Cadou, aboutissant donc à une véritable rêverie bachelardienne, puisque cosmogonique, aux féeries d'une imagination piétinant amplement de nombreuses barrières. Nous avons découvert le sang féminin heureux parfois, le sang chromatique, le sang fleur, le sang animal, le sang neige, pour tout dire « le Beau Sang ». Tout comme le sang inscrit dans les quatre Éléments, interactifs de surcroît.
Deux dernières preuves qualitatives de plus : Dans la pièce de 1942, Lilas du soir, le second acte présente à l'égal de Christ, du Poète, de la Femme du Poète, un personnage singulier, certes inventé par Jean Cocteau en 1931 (à un article près), mais jamais VU, en définitive : « le SANG du POÈTE », qui peut parler de lui-même à la première personne (78). De plus, il est porteur de ruisseaux et « arpenteur de temps » (82, 83). D'autre part, des titres sont encore informés, comme page 255, une curieuse « Rue du Sang » qui dessine une ville imaginaire personnelle, véritable révélateur de la psyché du poète.
Un ultime exemple :
Comment Cadou, poète alors débutant, traduit-il dans son langage une « nuit calme, une nuit sans drame (d'amour) »? Dès 1938 - il n'en est alors qu'à son dix septième poème - il évoque « une nuit vierge de sang » (21). Ou encore, en 1942, alors que, poète majeur dans les deux sens du terme, il a déjà donné la première partie de « la vie rêvée » (« Grand Élan »), il clôt cette série avec « Partage des eaux » (page 126), poème consacré à la célébration DES sangs, en un fort pluriel panique. C'est la synthèse rêvée de mon axe de recherches et de mon bonheur de lire, de prendre en bouche cette musique :
O sangs qui remontez les fleuves les siècles
Avares royautés perdues
Sangs de toutes les plaies retrouvés en un homme
Sangs félins
Sangs plus hauts que les cris
Plus hauts
Que les cachots dorés de la lumière
Aux quatre coins des vents
Sur la fresque des vignes
Et les étangs de blés
Sangs noirs sangs rouges sangs mêlés
On entend vos anneaux tinter
Soulignons : in fine : les « sangs mêlés, sangs de toutes les plaies retrouvés en un homme ». N'est-ce pas la manière la plus humaine qui soit d'exorciser tant une souffrance personnelle qu'une souffrance collective ? A ce point que l'écrivain s'efface devant l'être de réconfort et de partage que devait être ou que voulait être Cadou dans sa vie. Une preuve : il est une faiblesse, me semble-t-il, au vers Э cité - une nasalisation « retrouvés en un homme » que le poète n'aurait pas dû conserver.
Mais la fraternité l'emporte même sur le style, et voilà bien une réponse de la Poésie-Catharsis, nécessaire à l'actualité d'alors et aussi... à notre actualité en proie à divers dangers. Que ce soit l'entrée dans le « virtuel » superficiel, une « clonisation » pouvant aller de pair avec une deshumanisation accentuée, la perte du sens élémentaire du Sacré, le sacré des Éléments j'entends (ou du bel « amour fol » comme dirait André Velter)... Sans jouer les Cassandre, je pense que si un jour, on ne comprenait plus un poème « vierge de sang » tel que « Celui qui entre par hasard dans la maison d'un poète », c'est que le corps du monde serait profondément atteint. (Vous excuserez cette dernière métaphore sur ce qui se prête par excellence à la métaphorisation. Je vous remercie.)
Notes
L'exposé se fonde sur la première partie des Œuvres poétiques complètes de René-Guy Cadou, Seghers, Paris, 1996. D'autre part, qui voudra lire ce texte en sa genèse, passablement différente, consultera le volume L'École de Rochefort, Actes du Colloque, Université d'Angers, Presses Universitaires d'Angers, 1984. Et ce, avec d'autant plus de fruit qu'y figurent de beaux articles sur Cadou, dus entre autres à Yves Cosson, Yvan Leclerc et Denise Martin, etc. Quant au mien, il utilisait une grille de lecture « astrologique » pour une lecture qui dut dénommée « astrocritique » par le Professeur Yves-Alain Favre. Cette étude illustre quelques aspects de la troublante fraternité psychique entre Bérimont, Cadou et Guillevic ; travail apprécié alors par Christian Moncelet et Jean Rousselot. En fait, ma recherche générale, qui s'établit de plus en plus sur les saisons et les quatre éléments en relation avec le corps, est quelque peu reléguée actuellement au profit de ma propre création (au premier trimestre 1999, signature de la « Convention de dépôt » du Fonds consacré à l'œuvre littéraire de F.C., en la B.U. d'Angers). Je tiens cependant à rappeler un point important, au vu de certaines confusions : notre regretté Serge Brindeau ne déclarait-il pas que « dans ma recherche à titre de poète sur la fondation du Zoodiaque, je lui semblais bien retrouver les mêmes structures de l'imaginaire que dans la création poétique et lyrique » ? (cf. mon article-témoignage « Un Serge familier », paru dans la revue Jointure n° 57, pp. 64 471, Paris, printemps 1998). Telle est également l'approche du Professeur Georges Cesbron.
Auteurs
Gaston Bachelard, L'Eau et les rêves, Corti, Paris, 1942. Annie Leclerc, Parole de femme, Grasset, Paris, 1974. Jeanine Moulin, Huit siècles de poésie féminine, Anthologie, Seghers, Paris, 1975 & 1981 ; cf M. Desbordes-Valmore : « Un nouveau-né », pp. 122-123. Jean Chevalier et Alain Germain Dictionnaire des symboles, Seghers, Paris, 1974, 4 volumes.
Remerciements
À Marie-Hélène Descamps des Cahiers Froissart de Valenciennes.
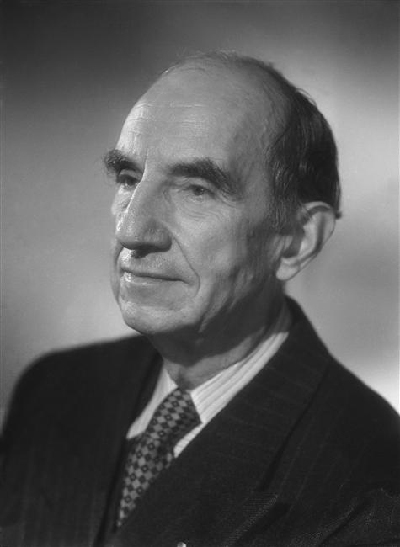 |
L'Ami inconnu : René Guy Cadou et Jules Supervielle, par Régis Мiaппаy
Université de Nantes |

(Retour au sommaire archives)
On connaît l'influence déterminante exercée par Max Jacob et Pierre Reverdy sur les débuts poétiques de René Guy Cadou. Un matin du printemps de 1936, lorsqu'il pousse la porte d'une petite librairie de la place Bretagne à Nantes, le lycéen de seize ans qu'était Cadou accomplit un geste où ses amis et lui-même verront plus tard la marque du destin. Il fait alors connaissance avec le jeune libraire Michel Laumonier qui est aussi, sous le nom de Michel Manoll, un poète ardent et inquiet, bien informé sur la poésie contemporaine.
Devenu l'ami et le confident de Cadou, en qui il a reconnu les dons d'un poète incontestable, Manoll lui fait rencontrer l'industriel Julien Lanoë, ami de Jean Paulhan, collaborateur de la Nouvelle Revue Française, qui fonda à vingt et un ans sa propre revue littéraire, La Ligne de cœur. Dans les douze numéros de ce périodique, publié à Nantes de novembre 1925 à mars 1928, Julien Lanoë donna une place de choix à la poésie contemporaine. On y lit en particulier de nombreux poèmes de Max Jacob, d'autres de Reverdy, poètes avec qui il entretenait des relations d'amitié.
Admis dans ce réseau, Cadou s'attache à développer ces relations par des rencontres, par sa correspondance et ses publications. Cette période préfigure la constitution du groupe des poètes de Rochefort en 1941. L'effet immédiat est une véritable métamorphose poétique, comme le montrent ses compositions de cette époque. Michel Manoll, dans la préface aux Œuvres complètes de son ami, attribue une importance primordiale à ces rencontres :
« L'aventure de la Poésie fut aussi, pour René, l'aventure de l'amitié. C'est grâce à un contact permanent avec ceux qu'il aimait et qu'il eut la chance de découvrir très tôt - et parmi eux il faut citer les grands aînés ; Pierre Reverdy et Max Jacob - que s'affirma en lui sa foi inébranlable en l'efficacité de la poésie, entendue comme une chaleur directement transmissible, un moyen d'expression de portée universelle, où l'effusion, l'apport affectif, la fluidité s'expriment en intime fusion du sujet et de l'objet » 1
Dans les vers de Cadou, l'hôte de Saint-Benoît-sur-Loire et celui de Solesmes sont maintes fois célébrés, à la fois comme amis et comme détenteurs des secrets qui permettent d'enregistrer les ondes mystérieuses venues des profondeurs de la conscience. À propos de Max Jacob, on citera « Encore une lettre à Max » 2, « En liaison avec Max » 3, « L'Amitié » 4, « Ce que disait l'épicière de Saint-Benoît-sur-Loire » 5 et « Anthologie » 6. A propos de Reverdy « A Pierre Reverdy » 7 et aussi « Anthologie » 8. Sur l'un et l'autre, Cadou écrit aussi des articles.
Cependant, on se tromperait si l'on pensait que le poète s'est enfermé dans un cercle d'admirations exclusives et restreintes. En fait, s'il a besoin de points d'ancrage très solides, il considère surtout la poésie comme une aventure qui l'entraîne clans un mouvement expansif. Il ne s'adresse pas à des maîtres, mais plutôt à des compagnons qui l'aident à dégager sa personnalité et à inventer son écriture. La pièce « Anthologie » témoigne de son esprit d'indépendance et de la variété de ses lectures. Max Jacob et Reverdy sont cités avec beaucoup d'autres : Éluard, Jouve, Fargue, Cendrars, Apollinaire, Saint-Роl Roux, Supervielle, Milosz, Jammes, Aragon, Cocteau. Claudel, Essenine et Lorca. En quelques mots, Cadou définit leur poésie; sur certains, il écrit des articles, des textes d'émissions radiophoniques et même des livres. Ces poètes, morts ou vivants, sont des interlocuteurs familiers avec qui il entretient au cours des années un constant dialogue intérieur.
Moins cité que Max Jacob ou Reverdy, Jules Supervielle nous paraît être une des présences très importantes, mais souvent méconnues. Cette situation n'est pas propre à Cadou, si l'on en croit Michel Manoll :
« Supervielle, on ne l'a pas assez dit, est de nos plus grands poètes et sa grandeur n'est faite que du souci qu'il a de s'exhausser en lui-même, de percevoir, dans les battements minéraux du monde, le rythme profond de l'esprit - associé éternel du voyageur terrestre » 9.
La solitude et la discrétion de l'homme, la simplicité de son chant expliquent sans doute en partie ces omissions trop fréquentes. Cadou lui consacre deux vers dans « Anthologie » :
« Boulevard Supervielle
Noé la fable et les gazelles » 10.
Cette phrase nominale est constituée, en grande partie de titres: celui du poème « 47 boulevard Lannes » de Gravitations (1925), puis celui du volume de poésies La Fable du Monde (1938) et du recueil de contes L'Arche de Noé (1938). Cadou rend ainsi hommage à l'enchanteur qui transfigure la vie quotidienne et qui introduit les animaux dans un monde de légende. Mais il aime aussi en Supervielle le poète de Débarcadères (1922) et le romancier de L'Homme de la Pampa (1923) qui fait rêver à la vie rude des gauchos dans les grands espaces de l'Uruguay. Un passage de son livre de souvenirs Mon enfance est à tout le monde, qu'il acheva d'écrire à Louisfert en décembre 1947, nous montre que ce plaisir a un rapport avec l'enfance du poète à Saint-Nazaire, avec des images de films ou de journaux illustrés:
« Longtemps j'ai rêvé d'habiter un ranch entouré d'une double palissade, peuplé de grandes jeunes filles brunes et de chevaux. La grosse lampe de cuivre brille au-dessus d'une table gauchement équarrie ; le chef de famille a posé son étui à revolver à portée de sa main, un air tiède fait trembler la moustiquaire et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui j'aime tant les poèmes de Jammes, de Cendrars et de l'inquiet Supervielle. » 11
Le mot pampa est riche de significations pour Cadou, qui l'emploie assez souvent dans son œuvre. Il traduit fondamentalement un besoin d'évasion et d'aventure, mais aussi un sentiment d'effroi devant l'inconnu et la brusque sensation de la présence de la mort. Sur ce point, il y a une ressemblance entre les deux poètes. Supervielle, qui a fait souvent l'expérience de la nuit menaçante et de la mort qui rôde, y voit la cause d'une tension bénéfique : « S'il est quelque humanité dans ma poésie, c'est peut-être que je cultive mes terres pauvres avec un engrais éprouvé : la souffrance » 12.
L'hommage le plus éclatant et le plus riche figure dans la « Lettre à Jules Supervielle » qui paraît d'abord dans la collection Le Miroir d'Orphée, éditée à Nantes par Sylvain Chiffoleau, ami du poète, en une élégante plaquette de format 13,5 x 16,5 cm, tirée à 200 exemplaires sur vélin blanc de Rives numérotés. A la suite du poème, on lit une précieuse indication : « Louisfert, novembre 1947 », qui correspond bien, on le verra ultérieurement, à sa date de composition. Après la mort de Cadou, il paraîtra, sans mention de lieu ni de date, dans Le Cœur définitif (Seghers, 1961) avec une préface de Pierre Mac Orlan.
On peut être surpris de cette manifestation tardive d'une révérence affectueuse pour un poète lié depuis longtemps à Max Jacob, Julien Lanoë, Michel Manoll, Maurice Fombeure, Jean Rousselot et d'autres amis de Cadou. Ces admirateurs de Supervielle avaient déjà témoigné dans diverses publications de l'importance qu'ils attachaient à son œuvre. Or Cadou ne participe pas à ces hommages. Edmond Humeau s'étonne de ce décalagе dans un article sur Cadou et Fombeure 13. Il se demande aussi pourquoi, dans deux déclarations postérieures à son poème, Cadou n'a pas mentionné sa dette envers Supervielle. On les trouve dans l'entretien avec Pierre Béarn du 20 septembre 1950 à Louisfert et dans une confession de 1950 reproduite dans Le Miroir d'Orphée.
L'histoire de ces relations commence en fait avant 1936, année où Cadou rencontre Michel Manoll. Max Jacob, enthousiasmé en 1922 par le recueil de Supervielle, Débarcadères, fit sa connaissance l'année suivante chez Jouhandeau à Guéret. Les deux poètes devinrent alors des amis. Par la suite, Julien Lanoë publia des poèmes de Supervielle dans plusieurs numéros de La Ligne de cœur (sixième cahier de juin 1926, neuvième cahier d'avril 1927 et douzième cahier de mars 1928) et des « Notes sur la poésie de Supervielle », par Pierre Menanteau, dans le huitième cahier (juin 1927) de cette revue. Supervielle et Julien Lanoë ont un ami commun : Jean Paulhan. En 1929, Supervielle assiste au mariage de Julien Lanoë à l'église des Invalides à Paris (il y rencontre Maurice Fombeure). Enfin, presque dix ans plus tard, Pierre Boujut publie un hommage à Supervielle dans Regains, revue qui précède La Tour de feu. Ce numéro 21 (Été - automne 1938), édité à Jarnac, s'intitule : « Numéro spécial de reconnaissance à Supervielle par les jeunes d'aujourd'hui ». On y relève les signatures de Julien Lanoë, Edmond Humeau, Jean Rousselot, Maurice Fombeure, Lucien Becker et Marcel Béalu. Mais, comme le remarque Edmond Humeau, Cadou ne figure pas dans cette liste des auteurs. Pourtant, dans le numéro précédent de la revue (N° 20, printemps 1938), il a publié un poème en prose, « Le Crime de Morphée » tandis qu'une note d'un article de Rousselot, « Sur deux vers de Supervielle », lançait un appel, en vue de trouver des collaborateurs pour le numéro spécial sur le poète de Gravitations. Indifférence pour ce premier hommage collectif rendu à Superviеllе ? Ou occasion manquée ? Cadou lui-même, dans une lettre citée plus loin, nous fournit un élément de réponse. Il ne connaît Supervielle que depuis 1937.
Pour les années suivantes, nous pouvons nous reporter à quelques lettres échangées par les deux poètes. Dans la première 14, Supervielle, de Montevideo, le 6 avril 1940, informe Cadou qu'il est parti pour l'Uruguay en août 1939 pour assister au mariage de son fils et qu'il pense rentrer à Paris le mois prochain. En fait, il ne revint en France qu'en 1946. Dans sa missive, il annonce aussi à Cadou qu'il ne collaborera pas à la revue Le Grand Erg. Les circonstances, on le voit, n'ont pas favorisé les relations des deux hommes.
Peu après son retour, le 5 mars 1947, Supervielle décline l'offre de faire partie du comité des Cahiers du Nord 15. La même année, le 26 avril, il remercie Cadou de lui avoir adressé Visages de solitude :
« Je ne connaissais que peu de choses de vous et je suis vraiment très heureux d'avoir ces Visages de solitude si généreusement dédicacés.
Vos images surgissent avec grand naturel de l'obscur de vous-même pour nous donner leur lumière et leurs ombres, non moins précieuses. A travers les clartés de vos vers votre mystère serpente. Il vient de vous, des profondeurs au rythme de votre respiration et de votre grave indolence de poète [...] » 16
Supervielle prit alors connaissance du compte rendu assez critique de son recueil 1939-1945, publié par Cadou dans la revue Horizon (n° 5, sans date, [1946]) :
« [...] Il fut un homme des pampas, Jules Supervielle, dont chaque moment gravitait autour d'une présence humaine sans cesse renouvelée, un grand homme bleu aux bras démesurés et souples comme la langue des muets, un ami inconnu qui venait rôder dans les soirs d'haciendas avec toute sa meute de bêtes familières. Il parlait de tendresse et de mots très purs. Je le retrouve parfois comme un écho lointain de lui-même dans 1939-1945, un gros livre de poèmes qu'il nous envoie de son Uruguay natal [...] » 17
Cadou apprit par Michel Manoll que Supervielle avait été affecté par la lecture de ces lignes. Il lui écrivit une lettre d'excuses le 1er juillet 1947, où il lui rappelait sa « fidélité de dix ans ». Il craignait, disait-il, de voir Supervielle succomber à la mode de la poésie patriotique et il lui demandait comment il pouvait se procurer trois de ses recueils qui avaient brûlé en 1944 dans l'incendie de sa maison :
« Louisfert
Loire inférieure
Cher Jules Supervielle,
Mon vieil ami Michel Manoll m'écrit qu'il a eu le bonheur de vous rencontrer au cours d'une de ses maraudes nombreuses dans Paris, que vous avez conversé ensemble et que vous vous êtes montré peiné d'un mien article paru dans « Horizon ».
Vous avez eu tort, cher Jules Supervielle, d'attacher la moindre importance à mon propos, et moi bien davantage encore de l'écrire. C'est parce que je vous aimais avec une fidélité de 10 (sic) ans que j'ai craint soudain de vous perdre, de vous voir renier votre grande tragédie végétale pour célébrer, comme nous l'avons tous fait, la victoire - ou l'absolue défaite de l'homme. Je vous demande pardon comme un enfant. Je veux que vous sachiez ce que vous êtes pour moi, pour nous tous et que la poésie n'a pas d'épaule plus chère que la vôtre.
Je vous prie de croire en mes sentiments de respectueuse affection.
1er juillet 1947
René Guy Cadou.
P.S. Peut-être pourriez-vous me dire où j'aurais la possibilité de trouver Gravitations, La Fable du monde et Le Forçat innocent, que je possédais, et qui ont brûlé avec mes autres livres dans l'incendie de ma maison à Nantes en juin 1944 » 18.
En réponse, Supervielle lui fit parvenir son Choix de poèmes. Le 7 juillet, Cadou le remercia en termes très chaleureux. Il lui décrivit avec humour sa vie d'instituteur et lui exprima la joie exceptionnelle que lui procurait son amitié:
« Louisfert
7 juillet 1947
Cher Jules Supervielle
Vous ne savez peut-être pas que je suis instituteur et que Louisfert est un petit village de 500 (sic) âmes (une cathédrale entourée de cinq ou six bistrots). En ce moment mes élèves ont déserté l'école pour ramasser les foins et « piquer les lisettes » 19. Je fonctionne - c'est le mot - de 8h à 16h avec le fils du forgeron et le garçon du bourrelier. C'est vous dire que j'ai l'esprit fort libre tandis que mes deux citoyens barbouillent ardoise ou papier. J'en profite pour lire. Ce midi - et c'est le but de ma lettre - je lisais le « Radeau de la Méduse » de Moussinac, juste le passage où il est question d'Oloron-Sainte-Marie et des poèmes des Cahiers du sud et forcément j'étais plus jeune de sept ans, militaire en traitement à la maison Pommé d'Oloron (vous savez, le grand parc où Jammes aimait à s'asseoir), je pensais à vous, le long du Gave, à Derème aussi, à Toulet quand le facteur est entré - il passe tard dans la campagne. Et tout de suite j'ai compris qu'il se passait quelque chose ; votre écriture reconnue, je n'osais pas faire sauter la ficelle.
Je ne sais pas vous dire les mots, Jules Supervielle. C'est avec le blé, les longues routes et la croupe des chevaux qu'il faudrait vous remercier, que vous sachiez la vertu de votre don et combien j'ai été « touché », comme on reçoit une pierre en plein cœur. J'ai abandonné ma classe pour porter votre livre à ma femme et nous sommes bien restés une demi-heure à le feuilleter avant que je songe à repartir. Tout cela a l'air idiot mais il faut bien que je vous dise que vous nous avez donné une vraie joie, une de ces joies qui n'ont plus cours maintenant et que seul un poète sait parfois faire jaillir de sa main d'enchanteur.
Je pars lundi prochain pour Murols dans le Puy de Dôme et votre « Choix de poèmes » est le seul livre que j'emporte avec, peut-être, la secrète inquiétude de trop aimer vos vers pour que les miens puissent, un jour, leur ressembler.
Votre humble et affectionné
René Guy Cadou » 20.
L'envoi de cette lettre si amicale précéda de quelques mois la publication du poème intitulé « Lettre à Jules Supervielle ». Ce poème est une sorte de confirmation publique des sentiments exprimés dans la correspondance privée. Il offre le bilan d'une amitié vécue dans l'attente et dans l'absence, source inépuisable d'émerveillement.
Dans la première strophe de son poème, Cadou donne une valeur positive au silence, car il convient à une affection très profonde. Mais il va rompre, dit-il, ce silence. Non pour écrire un article, ce qu'il ne fera jamais mais en adoptant la forme spontanée d'un poème :
« Pardonnez-moi Jules Supervielle, je devais écrire un article
Où j'aurais dit la grande la douce solitude de vos écrits
Et je me laisse soudain aller à quelque chose d'informe comme un poème
Simplement parce que j'ai vos livres sous les yeux et que je vous aime… » 21
Ces vers expriment la confiance et l'allégresse, mais aussi une certaine gravité :
« …Ah voyez-vous c'est difficile de s'interdire
Dans cette vie quelques minutes de loisir
Et de parler à cœur ouvert à un ami qui vous ignore
Comme on peut avec les ridicules moyens du bord » 22.
Quand il parle de « ridicules moyens du bord », il se réfère à une conception de la poésie qu'il partage avec son ami. Il refuse de se soumettre à des dogmes esthétiques ou aux mots d'ordre de la littérature engagée. Il adopte une forme qui combine librement des éléments divers de la poésie du passé et du présent. Il se dégage donc de ce poème une impression de nonchalance et de décousu. Les strophes variées et les vers de longueur inégale épousent les méandres d'une confidence incontrôlée. Mais l'entrelacement subtil de nombreux thèmes vient renforcer l'unité de l'ensemble. Le surgissement imprévu du vers final, qui conclut le poème sur une note d'incertitude et de tristesse, fait penser à la structure de beaucoup de poésies de Supervielle. Le plus bel hommage que rend Cadou à son ami est peut-être ici d'utiliser avec brio la même forme poétique que lui. Comment ne pas songer ici à ce jugement de Michel Décaudin : « Écartant la soumission comme la subversion, réglant son pas sur son souffle, René Guy Cadou est de cette famille de poètes qui, avec Apollinaire et Supervielle, ont élaboré une écriture poétique de notre modernité » 23.
L'incantation à caractère magique produite par la répétition de certains mots (« Jules Supervielle », « penser », « parler », « écrire », « voici ») suscite l'apparition de l'ami inconnu dans la vie du poète de Louisfert. Comme au début du Grand Meaulnes, cette présence mystérieuse est révélée par le bruit d'un pas : « J'entendais un grand pas partout dans la maison » 24. Supervielle, « l'Ulysse montevidéen », le « hors venu » arrive par les chemins de Louisfert, associant le monde des campagnes de l'Ouest de la France et celui de la pampa de l'Uruguay :
« Enfin voici un grand bonhomme sur le chemin
Une silhouette jeune comme le vent et la luzerne
Voici la haute lanterne là-bas dans le domaine du cheval »25.
En fait, c'est en lisant ses œuvres dans sa chambre bureau, le soir après la classe, que Cadou éprouve le bonheur d'une rencontre avec Supervielle :
« Voici l'auberge le rendez-vous de tous les jours et le festin le plus original » 26
En 1947, Cadou reconstituait sa bibliothèque détruite en grande partie à Nantes par le bombardement du 18 juin 1944. Celle du bureau de Louisfert comporte douze volumes de Supervielle (mais on n'у trouve pas Gravitations). S'il n'est donc pas possible de connaître avec précision les ouvrages dont il disposait, on a une idée de l'étendue de ses lectures par les allusions précises de son poème à des passages ou à des titres bien connus. Le motif du cheval et celui de la lanterne apparaissent dans beaucoup de poésies de Supervielle. Ils sont associés dans un vers de « L'Autre Amérique » dans Le Forçat innocent :
« Sous les yеux des vivants les livres qui se ferment
Deviennent des chevaux au milieu des lanternes
Et l'on monte dessus pour bien mieux s'égarer » 27.
Cadou fait ainsi pénétrer dans sa poésie les éléments imaginaires que Supervielle tire de son expérience de l'Uruguay. En évoquant Oloron-Sainte-Marie, Cadou renvoie au très beau poème du Forçat innocent qui porte ce titre: « C'est la ville de mon père, j'ai affaire un peu partout » 28. Cette ville rapproche les deux poètes. Les parents de Supervielle y ont été enterrés et Cadou séjourna trois semaines, en octobre 1940, dans un hôpital situé près du Parc Pommé. Le miroir est aussi un motif important : une autre pièce du Forçat innocent porte ce titre. On reconnaît plus loin un rappel du poème « Saisir », qui figure dans le même recueil :
« Saisir, saisir le soir, la pomme et la statue,
Saisir l'ombre et le mur et le bout de la rue » 29,
Enfin Cadou se fait l'écho, en deux vers, des poèmes de l'espace céleste illuminé de Gravitations:
Dans l'étendue lunaire et sans spectacle
A vous seul comme vous en faites des spectacles 30,
Cadou tisse ainsi des liens qui le rapprochent de l'ami lointain sans qu'il y ait de rencontre effective. La seule communication possible passe par la lecture.
Supervielle accueillit de tels vers avec une grande satisfaction. Le 18 novembre 1947, il écrivait à Cadou :
« Votre poème est sur ma table. Il l'illumine et l'humanise. Son accent me touche beaucoup et je l'entends en moi qui chante et j'entends aussi un grand pas partout dans la maison. Il monte l'escalier avec les moyens du bord. Bref, je suis sous le charme et vous adresse mon affectueux merci ainsi que la photo que vous me demandez si gentiment [...] » 31
Cette photo parvint à Cadou dans un autre envoi (б décembre) 32. Il la plaça dans son bureau en face de sa table de travail. Cependant, après l'édition du poème par Sylvain Chiffoleau, à Nantes, les relations proprement littéraires des deux poètes ne connurent aucune amélioration. Supervielle, le 2 février 1948, s'excuse de ne pouvoir envoyer à Cadou de poèmes inédits 33. Il salue encore en termes chaleureux, le 9 juillet, la publication en volume du poème que Cadou lui a consacré:
« Vous savez déjà combien ce poème m'avait touché. Il m'a paru encore plus charmant dans sa nouvelle tenue, définitive. C'est bien de recevoir une telle confirmation par une lecture poétique.
Je ne désespère pas d'aller un jour à Nantes et de vous y voir [...] » 34.
Une dernière lettre de Supervielle date du б août 1949 34. S'il envisage encore la possibilité de venir à Nantes, on sait que ce projet ne se réalisa pas. Le destin mit fin à cette relation un peu étrange où la sympathie et l'estime sont tempérés par la discrétion et le silence.
Au moment le plus sombre, les marques de cette estime réciproque ne manquent pas. Ainsi Michel Manoll apprit à Supervielle que Jean Rousselot avait lu à Cadou, peu avant sa mort, des pages de son dernier volume, Naissances, suivi de En songeant à un art poétique:
« [...] Savez-vous, mon cher ami, qu'il a occupé le dernier jour de sa vie à la lecture de votre récent livre de poèmes - et c'est l'âme toute bourdonnante de vos vers qu'il s'est engagé dans l'éternité [...] ? » 35
Inversement, Supervielle, en octobre 1951, témoigna un vif intérêt pour le volume d'Usage interne qui lui avait été adressé par Madame Hélène Cadou. Il lui écrivait alors :
[...] Comme il est heureux que nous n'ayons pas été privés d'Usage interne. Nous connaissons même ainsi les pensées et les chers secrets d'un poète. Il a raison de dire que sa poésie travaille pour lui. Nous n'en sommes que d'autant plus heureux de voir comment il concevait le travail des poètes 36
Cadou et Supervielle étaient proches par leurs idées sur la poésie. Le poète de Louisfert trouva dans l'œuvre de son aîné des échos de son monde imaginaire. De ces rapprochements naquit un des ses plus beaux poèmes.
Notes
1.Michel Manoll, préface à René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, Paris, Seghers, 1977, p. 7.
2.Ibidem, p. 226.
3.Ibidem, p. 294.
4.Ibidem, p. 306.
5.Ibidem, p. 311.
6.Ibidem, p. 338.
7.Ibidem, p. 159.
8.Ibidem, p. 338.
9.Michel Manoll, Introduction à la poésie d'aujourd'hui, Pierre Fanlac, 1945, p. 41.
10.René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, p. 338.
11.René Guy Cadou, Mon enfance est à tout le monde, Le Castor astral, 1995, p.129 (La première édition de cette œuvre a paru aux éditions Jean Munier à Paris, la seconde aux éditions du Rocher en 1985).
12.J. Supervielle, « En songeant à un art poétique », dans Œuvres poétiques complètes, La Pléiade, Paris, Gallimard, 1961, p. 564. L'édition originale de ce texte figure dans Naissances, Paris, Gallimard, 1951.
13.Edmond Humeau, « La Terre promise de Fombeure à Cadou », Cahiers bleus, n°22, Hiver 1981-1982 (numéro consacré à R. G. Cadou), pp. 59-66.
14.Centre René Guy Cadou de Nantes. Nous exprimons notre vive gratitude à Madame Hélène Cadou pour les précieux renseignements et la riche documentation qu'elle a mis à notre disposition en vue de cette étude.
15.Centre René Guy Cadou de Nantes.
16.Centre René Guy Cadou de Nantes.
17.« La poésie », dans Horizon, Revue des Lettres, Nantes, [1946], n° 5, p. 90.
18.Inédit. Archives J. Supervielle. Nous remercions chaleureusement Madame Denise Bertaux, fille aînée de Jules Supervielle, de nous avoir permis de connaître de précieuses lettres inédites conservées dans les archives familiales du poète.
19.« Piquer les lisettes » signifie « piquer les betteraves » dans la région de Châteaubriant où se situe Louisfert.
20.Inédit. Archives Supervielle.
21.Poésie La Vie entière, Œuvres poétiques complètes, p. 212.
22.Ibidem.
23.Michel Décaudin, « Le Vers de guingois de René Guy Cadou », Cahiers bleus, n° 22, Hiver 1981-1982, p. 58.
24.Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, p. 212.
25.Ibidem, p. 212.
26.Ibidem.
27.Jules Supervielle, Œuvres poétiques complètes, La Pléiade, Paris, Gallimard, 1996, p. 284.
28.Ibidem, p. 257.
29.Ibidem, p. 244.
30.Poésie La vie entière. Œuvres poétiques complètes, p. 212.
31.Centre René Guy Cadou de Nantes.
32.Centre René Guy Cadou de Nantes.
33.Centre René Guy Cadou de Nantes.
34.Centre René Guy Cadou de Nantes.
35.Inédit. Archives Supervielle.
36.Centre René Guy Cadou de Nantes.
 |
René Guy Cadou/Roger Toulouse, Affinités du regard,
par François Garros 1
Poète, écrivain |

(Retour au sommaire archives)
Approcher les caractéristiques du regard d'un poète, comme Cadou, à partir de celles d'un peintre, comme Roger Toulouse, relève d'un double défi. Nous devons poser comme principe que le langage d'un poète, dans ce qui le constitue, est antinomique de celui d'un peintre. Plus encore, et je fais ici référence à des écrits de Pierre Boulez I sur la peinture de Paul Klee, il serait illusoire de penser que le langage musical, le langage plastique, la poésie sont des langages identiques, au point que, par exemple, la notion de structure, ou celle de rythme qu'on rencontre dès qu'on approche un de ces trois domaines, obéisse à des principes, voire des lois, transposables directement d'un domaine à l'autre. « Il est assez artificiel de mettre en parallèle différents moyens d'expression. », écrit Boulez. Bien évidemment Boulez vise la peinture et la musique, mais il faut dire la même chose pour la poésie. 2
Tel est le premier défi : mettre à jour dans une comparaison entre le travail poétique de René Guy Cadou et l'œuvre plastique de Roger Toulouse des éléments communs - alors que leurs langages sont antinomiques. Paradoxalement, leur comparaison, qui visera les moyens employés par le peintre et par le poète, pourrait être à la source d'une recherche sur les « équivalents », des marques objectives, par lesquelles le travail du poète pourrait rencontrer le travail du peintre. Toutefois, en quoi le regard du peintre Roger Toulouse et celui du poète - R. Toulouse a publié plusieurs recueils de poèmes Э - seraient-ils en affinité avec celui du poète René Guy Cadou ? Affinités de pensée, amitié dans la vie, certes, pour deux « amis de Rochefort-sur-Loire » - mais des affinités artistiques dans la manière même de regarder ?
C'est là mon deuxième défi : avoir recours à l'œuvre de Roger Toulouse, la solliciter comme un élément essentiel à verser au dossier Cadou. Car mon objectif essentiel est bien l'œuvre poétique de Cadou. Comment lire Cadou aujourd'hui, maintenant que d'autres œuvres importantes 4 nous font entendre d'autres silences, d'autres zones d'ombre et de lumière, à l'intérieur de l'espace du poème ? Quelle autre lecture pouvons-nous proposer, aujourd'hui, de celui que Michel Manoll, dans une remarquable étude parue chez Seghers, en 1963, douze ans après la mort de celui qui avait
« pressenti » sa propre mort, présentait ainsi :
« (...) Il possédait avec l'ordre et la méthode qui l'avive cette vertu de persévérance et cette aisance à s'exprimer par la « langue des muets », qui font d'un poète non un diseur de mots ou un fabricant d'élégies, mais cet homme qui ramène au jour tous les fantômes et tous les cortèges de sa vie profonde - créant autour des objets et des êtres une zone lumineuse qui les cerne d'un trait de feu. »
(Michel Manoll, René Guy Cadou, Poètes d'Aujourd'hui, Éditions Seghers, 1963)
Ce double « éclairage » permet-il en même temps de jeter un autre regard sur l'œuvre picturale de celui qui, très vite « repéré » par Max Jacob, puis Picasso, comme un des grands peintres de la première moitié du siècle, a continué - en retrait volontaire de « l'agitation » artistique - à édifier une œuvre essentielle, dont « l'énigme » qui l'organise, depuis son départ, et la sous-tend dans ses différentes périodes, brusquement nous « parlerait » mieux ? Je ne cache pas qu'il s'agit là de mon deuxième objectif. C'est à la lumière de cette énigme - l'œuvre de Roger Toulouse est encore à « situer », tout comme celle de Cadou - que l'œuvre du poète de Louisfert pourrait nous apparaître... comme autre.
La rencontre Roger Toulouse/René Guy Cadou
Je m'intéresse tout d'abord à un échange artistique entre les deux hommes. On sait qu'ils se sont rencontrés - physiquement - en septembre 1948, à Orléans, dans l'atelier de Roger Toulouse. Cadou voit de nouvelles toiles 5 de R. Toulouse : «L'Homme au képi de garde-chasse » (1947), « Le Jeune homme à la médaille » (1946-1947), « Le Jeune homme de l'hospice » (1947), « L'homme au tablier de boucher » (1948) - je les présente rapidement dans le cadre de cette communication - il est enthousiasmé et propose peu après quatre poèmes correspondant 6, qui seront publiés en 1953 chez Millas-Martin, Quatre poèmes de René Guy Cadou sur quatre portraits de Roger Toulouse, en hommage au poète disparu.
Un tel exemple de collaboration artistique, au-delà de l'aspect strictement biographique, me semble propice à mettre à jour des traces créatives objectives d'une qualité de regard, par la saisie « d'équivalents » dans le travail du poète, puis dans celui du peintre, pour définir avec plus de clarté les lignes directrices essentielles du « métier » de Cadou et, partant de là, les spécificités de l'art de Roger Toulouse que Cadou a manifestement voulu saisir, pour les « traduire » à l'intérieur de sa propre vision artistique.
Le double éclairage R.G. Cadou/Roger Toulouse
Quelles peuvent être les bases d'une autre lecture de Cadou ? L'époque qui l'a nourrie est un paramètre que nous devons prendre en considération 7, avec deux événements majeurs pour tous « les amis » de Rochefort : la mort de Max Jacob, le 5 mars 1944 à Drancy, puis la mort de Cadou en 1951. Mais elle ne peut à elle seule constituer aujourd'hui la base d'une analyse. Nous devons aussi voir comment un ensemble de formes poétiques est en jeu, façonne l'œuvre. Cadou n'est pas seulement un « grand poète sensible ». Il est aussi à la fois le continuateur d'un certain travail poétique, d'une certaine conscience du « savoir » écrire, et un novateur. On retiendra ici trois nouveaux paramètres susceptibles de nous ouvrir à une lecture renouvelée de ce poète. Lire une peinture de Toulouse passe aussi, aujourd'hui, par la saisie de formes et figures anciennes/nouvelles qui traversent l'œuvre et déterminent un espace pictural original. Et c'est dans ce cadre que les valeurs d'humanisme, de grandeur tragique - que je ne nie pas, bien au contraire - prennent ou prendront sens.
La hauteur d'une solitude tragique. Je n'ignore pas que la vie de Cadou est traversée, nourrie, interrogée par le tragique. Mais je ne parlerai pas de cela. La solitude est pour Cadou, mais aussi pour Pierre Reverdy, la condition nécessaire du poète. Non pas une solitude dans la vie - il y a chez Cadou une aspiration à la rencontre, il rêve Hélène avant de la rencontrer :
Ta place est retenue sous la lampe déserte (Morte Saison, 1940),
car l'œuvre crée le manque d'Hélène et celle-ci surgit - mais une solitude, pourrait-on dire, de langage. Pour Cadou, le poète est rigoureusement seul. Le langage, toutes les constellations de formes agissant dans l'œuvre, a reçu l'empreinte de la solitude la plus tragique. Écrire, pour Cadou, c'est se confronter à ce tragique-là, alors qu'il n'a de cesse dans sa vie d'appeler la vie, de la vivre dans le vin, dans l'amitié, dans la rudesse et la rigueur paysannes, comme l'a très bien vu Michel Manoll dans son étude parue chez Seghers.
Le regard chez Cadou. Analyser la qualité d'un regard chez Cadou, c'est rechercher quelles caractéristiques présente l'œuvre du point de vue précisément du regard. Les quatre poèmes que Cadou écrit après avoir vu les quatre peintures de Roger Toulouse dans son atelier sont un exemple assez intéressant. On remarque l'attention portée à la précision d'une peinture - le « sujet » est même « écrit » assez « fidèlement » par Cadou : Cadou observe le tableau.
Quel est-il ? Quel revers terrible de médaille
Le figure debout dans l'angle d'un portail
Il rêve et clans l'absence on dirait qu'il sourit
(Le Jeune Homme de L'hospice, (Œuvres poétiques complètes, 1948, p. 251)
Son attention se porte aussi sur « l'expressivité des couleurs » 8, leur « extravagance ».
Qu'est-ce qu'il porte là dans ses deux mains brisées ?
Un cor de cuivre noir comme un poulet vidé.
(L'Homme au Képi de Garde-chasse, 1948, repris dans Hélène ou le règne végétal)
Derrière son œil il y a de grandes places
Rouges avec des flaques sous les arbres verts
Pareilles à de lourdes campagnes qui tanguent
De tous leurs chevaux saouls et peignés de travers
(L'Homme au tablier de boucher, 1948)
Mais lа question n'est pas pour Cadou « d'imiter » mais de trouver dans sa poésie un « équivalent » de force et de langage. Il ne mélange pas langage pictural et langage poétique : il innove.
La matière du réel, chez Cadou. Très proche en cela de Reverdy 9, qui est l'initiateur, celui qui a reconnu et reconnaît toujours (en 1947-48) l'exemplarité du génie de Cadou, Cadou « sait » que « le poète est un four à brûler le réel », que c'est seulement dans ces conditions - la réalité est de l'ordre de l'inacceptable - que le poète peut faire apparaître - présenter et non représenter - des transmutations de valeur, faire montre de ce que Reverdy appelle « le réel absent ». Bien sûr, la réalité sociale est présente dans l'œuvre, mais plus encore la matière du monde, une poésie ancrée dans la nature - non pas un décor, un charmant intérêt pour nos bois et nos villages, mais une poésie viscéralement forgée dans cet humus : la nature est la langue.
Avec toi qui me dissimules
Sous les tentures de ta chair
Le recommence le monde.
La Solitude, 1949, Hélèпе ou le règne végétal)
Sont alors convoqués, goûtés dans le palais de la langue, tous les biens de ce tout ce qui fait plaisir, réjouit, il y a une réjouissance dans la solitude de l'écrit mais c'est d'abord la vie - la plus simple possible - qui a été célébrée, par et dans le vin, l'amitié, l'amour. La poésie de Cadou est aussi une « phusis ».
Partons maintenant de l'œuvre du peintre. Cadou, en 1948, est déjà un poète accompli, et non pas un jeune poète qui aurait été fasciné par l'œuvre de Roger Toulouse. Les circonstances de leur rencontre à Orléans sont tout à fait précises. L'un et l'autre connaissent leurs œuvres, ils se connaissent 10. Par ailleurs les correspondances 11 entre ceux qui ne sont pas encore rassemblés à Rochefort-sur-Loire sont aussi nombreuses que possible, tandis que l'occupant exerce sa loi. C'est un des événements essentiels de cette période, pour le futur « groupe » de Rochefort comme pour les nombreux amis et relations 12 qu'il a dans les milieux littéraires et artistiques parisiens, qui va rapprocher les deux hommes : la mort de Max Jacob.
Dès les premières toiles, les caractéristiques très construites de la peinture de Roger Toulouse sont évidentes, proches de Kandinsky, ce qui apparente son œuvre à un expressionnisme construit. Elles se font plus éclatantes dans la période constructive, qui se développera jusqu'à sa mort. Mais en même temps éclatent dans cet ordre, cette architecture qui apprend à voir dans l'espace, une tension libératrice de la couleur, une révolte du peintre initié très tôt aux figurations cubistes, sans que « l'âme » du cubisme soit un enjeu de sa peinture. Celle-ci se traduit par un expressionnisme de révolte qui trouve dans la couleur le chemin d'une expressivité personnelle, sorte de chant rigoureux d'une figuration tragique. Une nouvelle force « poétique » surgit dans la peinture de Roger Toulouse. Par « poétique », qu'entend-on ? Le terme pose problème, en effet. J'entends ici un rapport entre l'organique irrationnel et le construit. C'est Paul Klee qui définit cette relation, dans la période de ses cours au Bauhaus de Weimar, avec le plus de netteté, ce que reprend Boulez avec une grande pertinence :
« (...) Il ne faut jamais être prisonnier d'une quelconque logique, qu'elle soit académique ou qu'on l'ait soi-même forgée. Klee l'a bien montré: (...) C'est de ce combat que résulte la poésie, une poésie fondée sur le dynamisme et la transformation ; une poésie qui apporte l'irrationalité dans un monde requérant une structure solide ; une poésie qui transcende le confit entre ordre et chaos. »
(Pierre Boulez, Le Pays fertile, Paul Klee, Gallimard, 1989)
Dans la période qui nous intéresse - la rencontre de Cadou et de Roger Toulouse à Orléans, devant les nouvelles toiles du peintre - n'est-ce pas cette « force poétique » que Cadou va juger déterminante pour sa propre écriture ? Regarder la peinture de Roger Toulouse correspondant à cette période, effectivement marquée du poids tragique de la guerre, permet de prendre la mesure de ce que le poète de Louisfert va apporter d'unique à la poésie française. Ainsi peuvent être repérés les nouveaux moyens mis en œuvre par Cadou. La force de sa poésie, souvent soulignée dans les commentaires du temps, tient à la justesse de composition, au choix des « sujets », à l'expressivité métaphorique, en accord avec la vibration soutenue de la couleur. Autant d'atouts dont dispose la « palette » du poète.
Aussi devons-nous considérer que le tableau, si l'on veut en proposer une « lecture », de même que le poème, s'il l'on veut en apprécier la « picturalité » à la lumière de la critique contemporaine et des œuvres poétiques et picturales de la deuxième moitié de notre siècle, avant d'être le « cri » solitaire d'un homme blessé, est un espace où s'élaborent des figures et des signes. Il est enjeu et mise à l'épreuve de « forces » poétiques ou plastiques qui détruisent et reconstruisent de nombreuses formes anciennes, que le peintre connaît bien, dont le poète est imprégné 13, afin de proposer au lecteur 14 une écriture novatrice, c'est-à-dire qui invente constamment, fidèle en cela à « l'enseignement » de Max Jacob 15. Elle est la « marque » du tempérament d'un homme dont le langage est ascèse, rigueur et solitude.
Quelle est alors la place spécifique de la peinture de Roger Toulouse dans le XXe siècle ? De même, qu'en est-il de la poésie de Cadou, œuvre solitaire au même titre - devenue marginale - maintenant que nous avons plus de recul pour la lire, et que les diverses aventures littéraires et artistiques 16 ont perdu de leur prégnance devant la découverte d'autres œuvres 17, devant aussi la redécouverte de l'univers poétique de Reverdy, auquel Cadou doit beaucoup, ainsi qu'à celui de Max Jacob, avec une meilleure connaissance aujourd'hui des œuvres mises à l'index par le pouvoir nazi 18 ?
Sans doute une perspective plus complète s'ouvre-t-elle aujourd'hui, pour mieux cerner le clivage figuration/abstraction, qui a été un des modes de préhension de la peinture dans l'immédiat après guerre - un véritable « credo » que Roger Toulouse dénonce comme tel - alors qu'aujourd'hui il paraît moins souverain. Nous sommes alors en droit de nous demander si cette opposition figuration/abstraction, au cœur des aventures picturales de la première moitié du XXe siècle, dit également quelque chose de l'évolution des formes poétiques dans tout le XXe siècle.
La poésie de Cadou : un « expressionnisme » unique dans la poésie française de la première moitié du XXe siècle
Lire la force communicative de Cadou, c'est s'interroger de fait sur le travail des formes et l'expressivité qui s'en dégage. Toutefois, la façon dont Cadou est aussi un « quêteur de sens », pour reprendre une formule chère à Salah Stétié 19, signifiant par là que, au-delà d'une expression ouvragée de formes et de figures, le poète oppose à la réalité quotidienne dans ses divers aspects une tension vers un réеl « absent », est également essentielle. Il est vital pour Cadou de saisir la part « débordée » de la langue (André Du Bouchet), ce « monde muet » (Michaux), qu'il est désireux de « partager » avec son lecteur, afin de le « hausser » vers cette part inconnue de lui-même qui est tragiquement la sienne, et peut-être celle de tout homme en qui respire le souffle de ce que Pierre Reverdy appelle « l'invisible » 20. C'est définir par là ce qu'est pour Cadou, après Reverdy, la conscience du poète.
Mais revenons à l'œuvre picturale de Roger Toulouse, une œuvre « en marge » elle aussi. Retraçons son évolution pour saisir quelle est exactement sa « situation » au moment où Cadou écrit les quatre poèmes que son admiration lui a « dictés ». Revenons également à Klee et à la « lecture » qu'en propose Boulez. Je voudrais ici faire apparaître un autre paramètre.
Les vertèbres du sens. Au-delà de la « nouvelle figuration » et d'un glissement progressif de Roger Toulouse vers l'abstraction, en dépit même de ses déclarations sur une peinture « réaliste, etc. », force est de noter un « déplacement » de l'œuvre vers un expressionisme architectural à portée cosmique. La peinture est alors, pour lui, la matière de l’univers... un « kosmos », une ré-organisation à partir d'un « chaos » primitif qui est « sujet » de chaque toile, de même que chez Klee. J'ai recours à cet exemple comme détour pour mieux comprendre ce qu'est, plus en profondeur, le poétique chez Klee, afin de saisir ce qui est encore énigme dans un équilibre que Toulouse promeut entre le « chaos », lа matière inorganisée du monde où les forces - réelles - de la « guerre » deviennent presque aveugles et s'élèvent vers un véritable mythe de la déstructuration de l'univers humain - ceci étant sensible notamment dans la période « constructive » - et la volonté d’une restructuration de notre imaginaire - faut-il reconstruire la peinture ? - ce qui -était aussi la « tension » de l'oeuvге de Klee.
L'organisation de la toile n'obéit pas seulement à une construction de type « scientifique », aussi bien chez Klee que chez Toulouse : elle « laisse » ouvert le « conflit » entre le « primordial » et le très-construit. C'est aussi à cette époque que Roger Toulouse érige d'étranges « métaphores », des statues de métal, renouant avec son apprentissage de « ferronnier » et aussi avec sa formation première en architecture, comme s'il voulait doter le monde de ces « créatures » émergeant du « conflit » symbolique, comme pour en manifester la force.
La rencontre de Cadou avec Roger Toulouse, dans son atelier, et non par personnes interposées, l'a amené à fortifier son regard. La poésie de Cadou se reconnaît dans la grandeur tragique - la majesté dérisoire du « Jeune homme de l'hospice », au vêtement plongé dans la « teinture » de la guerre. Il fallait trouver une couleur pour dire cela, mais c'est d'abord la couleur dans le tableau qui nous alerte - par sa vibration inconnue, énigmatique, comme au-delà d'elle-même. La couleur nous « conduit » dans son « extravagance », son « délire » interne (le jeune homme est comme prisonnier de lui-même et d'un monde qu'il ne comprend pas ou plus), à rechercher - oui maintenant - ce qui dans l'homme fait encore sens, est encore « sujet », un « vrai » sujet.
Cadou, malgré ses déclarations sur un « surromantisme » qui rassemblerait ceux de Rochefort et lui-même, nous a donné à entendre ce que nous n'entendons plus dans l'homme, ce vers quoi il reste « ouvert », tout en étant irrémédiablement enclos dans une « histoire » qui le dépasse, mais dont il sait - de façon instinctive - que c'est la sienne, que le sens est encore à ouvrager, qu'il n'y a pas de répit, que formes et figures sont des médiatrices de « l'être » - et non des moyens, des procédés, des scénario, des processus - par lesquels l'homme atteint peut-être la zone infranchissable de tout homme.
L'œuvre de Cadou relève ainsi d'un courant poétique expressionniste - terme qu'on réserve plus communément à la peinture - un expressionnisme de l'homme à reconstruire, à réinventer, comme disait Max Jacob. Cadou saisit le cosmique d'une relation de l'homme à l'univers dans une poésie de facture intime, voire intimiste. Cadou est le « peintre » de « l'homme naturel » reconstruit. Le végétal n'est pas chez lui un attribut de la nature, mais l'essentiel, dans la noria de l'univers, d'un ancrage sur cette terre. L'homme est terre. Il est cette terre.
Ainsi nous ne pouvons plus lire Cadou comme un des derniers grands « lyriques », mais comme celui qui, d'une manière forte, avec rigueur à l'intérieur du « chaos », nous ouvre les portes de « l'être ». Le lyrisme de reconstruction qui l'anime 21 est non pas le signe d'un « recul » poétique - par rapport aux « avancées » surréalistes et aux aventures du verbe qu'elles ont engendrées - mais d'une conscience autre du rôle et de la fonction du poète dans un univers de l'homme déchiré 22. Cadou a le mérite d'oser poser avec force ce que Michaux, Bonnefoy, Du Bouchet, Char - avec plus de réserve - laissent à réentendre : « La poésie est dans ce qui nous manque » (Pierre Reverdy).
Nous avons encore à nous interroger sur la peinture de Roger Toulouse 23. Son œuvre 24 est un lieu de départ, non une œuvre close. C'est peut-être cela l'énigme qu'elle nourrit depuis sa naissance, Cadou l'a parfaitement vu.
Quelle est la place de l'œuvre poétique de Roger Toulouse? Cette question reste pour moi ouverte. On sait que l'écriture 25 a accompagné toute sa vie, aussi bien que sa peinture. Elle s'est développée « en cachette » de la notoriété picturale. Elle se rattache au « mouvement » de Rochefort, dans une « agrégation libre ». Elle est vraisemblablement « l'ombre portée de sa peinture ». « Un lieu d'essayage » du tragique de la condition humaine, confronté au néant de l'Histoire ? La part « ombreuse » que la peinture tenterait de donner en lumière ? N'est-elle pas le heu du « chaos primordial » dans lequel sont nouées les « vertèbres du sens » ? Les commentateurs de l'œuvre du peintre auraient grand tort de la minorer. La vie de Roger Toulouse - et sa peinture -ont partie liée avec l'écriture poétique. C'est le sens de la collaboration constante que Roger Toulouse a menée avec « ses amis poètes », ceux de Rochefort, Cadou, mais aussi Rousselot, Manoll, Béalu, Bouhier, Вérimont 26. Les « illustrations » de Roger Toulouse ne sont pas un « à-côté » de son œuvre, mais elles se situent toujours en un point nouveau du « chaos restructuré » - par lui et par d'autres poètes 27 qu'il entrainait ainsi dans le mouvement de son œuvre, ouverte à l'inconnu, au mystère 28, sachant dynamiser le parcellaire, lui donner une force communicative.
Roger Toulouse n'est-il pas, en fin de compte, l'un des « initiateurs », par l'intermédiaire de Max Jacob, du mouvement de Rochefort sur Loire ? Une figure centrale de ce mouvement poétique - non un simple accompagnateur, un illustrateur des poètes... mais un continuateur de l'esprit de Max Jacob. « Invente », disait Max à ses jeunes amis, à Cadou, à Rousselot, à Béаlu, à Bérimont, à Bouhier, ce que disait aussi la peinture de Roger Toulouse dès cette époque, et ce qu'elle leur dira ensuite, comme si, le « maître » disparu, le message était encore de haute amitié et de rigueur : l'homme a encore un avenir... Invente-le !
Au moment de conclure, j'ai encore une hésitation... Peut-on conclure sur ce qui doit rester ouvert ? Ce double éclairage, quelle est exactement sa pertinence ? Ce double éclairage permet-il la saisie d'affinités réciproques ? Des affinités du regard ? Un fonds commun sur lequel le peintre et le poète travaillent permet-il de mieux définir l'œuvre de l'un, l'œuvre de l'autre ? J'ai voulu montrer que la relation poésie/peinture - manifestée à mes yeux par la rencontre Cadou/Toulouse - est « un lieu méthodique » pour cerner ce que le poète « voit » dans le tableau et ce que le peintre « voit » dans le poème. Je voudrais en revenir à Pierre Boulez, conclure comme cela.
Boulez ouvre une perspective critique fort judicieuse. L'analyse d'un domaine permet parfois de mieux comprendre ce qui fait énigme dans l'autre, et particulièrement dans le sien. Selon Boulez, « lire » Klee - particulièrement la manière dont Klee utilise dans sa peinture et dans ses cours du Bauhaus le « concept » de « variation » lui a permis de mieux sentir dans la musique - et dans sa propre musique - la manière dont il pouvait « résoudre » tel « problème » de « déplacement de perspective 29 musicale ». Or ce « concept » n'a rigoureusement pas le même sens, écrit Boulez, en peinture ou en musique - et j'ajouterais en poésie, où il apparaît aussi - mais il permet - par comparaison - de découvrir des « ressorts créatifs » pour chacun dans son propre domaine.
Klee, Boulez, et j'ajouterais Toulouse, sont parfaitement « conscients » que le travail de l'artiste repose sur un « aléatoire », un « chaos » dont il cherche, à l'aide des Techniques parfois les plus « scientifiques », la manifestation ardente, la « traduction » plastique, musicale, poétique. Le poète a l'intuition de cela - une intuition fulgurante chez Cadou. Cadou saisit - plus intuitivement - ce que d'autres vont « repérer » - par confrontations, recherches intellectuelles, le « poétique » surgi du chaos. La force poétique » de Cadou est en effet la marque majeure, décelable aussi dans la peinture de Roger Toulouse, d'une autre poésie que Cadou inaugure : un courant expressionniste, peut-être unique dans la poésie française, par son refus de l'académisme, sa révolte, sa viscérale « revendication » d'un homme à reconstruire, à réinventer, en donnant parole au « chaos ». Tel serait aussi le « message » d'un peintre comme Toulouse : l'art structure le chaos en le laissant parler. Tenir les deux aspects, _la nécessité de la structure - ce que montrent de façon éclatante toute l'œuvre de Paul Klее et celle d'un compositeur comme Pierre Boulez (pas de composition musicale sans structure !) - mais la « primordialité » de l'errance, du « mystère », du « chaos » symbolique dont nous venons, permet d'atteindre le poétique. Le poétique n'est donc pas dans les formes, les figures, ce que ne cesse de dire Cadou. Il est dans ce que nous ne savons pas de l'homme et de sa relation à l'univers que l'opération de structure, de composition - de mise en rythme - tente d'éclairer.
La peinture, de même que la poésie, « enquêtent » sur le sens. Cadou a de cela une intuition majeure. « Le sens du sens », disent les spécialistes ! Non, plus simplement, pour Cadou, la vérité, la quête de l'homme, au plus misérable de ce qu'il est 30, au plus désireux de se hausser 31, au plus vain d'espérer 32. La peinture ou la poésie, aussi « inutiles » l'une que l'autre, mais enchâssées dans l'humain, auquel nous aspirons tous. Je vous remercie.
Je voudrais dédier cette communication à Marguerite Toulouse et à Thérèse Manoll.
Notes
1.Pierre Boulez, Le Pays fertile, Paul Klee, Gallimard, 1989.
2.Surtout à partir du moment où elle s'est affranchie de la partition musicale et du chant.
3.Il serait utile de préciser l'importance de cette œuvre singulière qui accompagne l'œuvre picturale.
4.Je pense plus particulièrement à Michaux, Char, Jaccottet, Du Bouchet, Bonnefoy, Rousselot.
5.Certaines de ces toiles posaient des problèmes de datation. Je renvoie ici le lecteur à : Roger Toulouse 1918-1994 - Catalogue raisonné de L'œuvre, Jean Perreau, 1998, pp. 477-478.
6.Cadou envoie le 17 septembre à Roger Toulouse trois poèmes, dont « Le Jeune homme de l'hospice » qu'il qualifie de « directement inspiré » par le tableau. « Je songe toujours aux quatre poèmes illustrant les quatre tableaux », lui écrit-il. Puis le 11 octobre il lui adresse « l'Homme au tablier de boucher », qui clôt la série de « Sur quatre tableaux de Roger Toulouse ». In Le Catalogue raisonné.
7.Le « pressentiment » de la guerre, la vie en temps de guerre, une « libération » qui n'est pas sans déception, sont des « moteurs » directs du travail de Roger Toulouse et de celui de René Guy Cadou.
8.Il faut toutefois signaler que Cadou, avant de voir, physiquement, les quatre tableaux, a travaillé, pour certains, à partir de photographies en noir et blanc (in Le Catalogue Raisonné). Il anticipe donc parfois sur l'expressivité des couleurs.
9.Reverdy reconnaît très tôt le génie de Cadou, alors que « l'intelligentsia parisienne », les post-surréalistes et les néo-classiques, se font plus rares dans leurs éloges.
10.Cadou est parfaitement conscient de l'évolution de R. Toulouse : l'un et l'autre ont eu comme initiateur Max Jacob. De même Roger Toulouse n'ignore pas l'importance de l'œuvre de Cadou.
11.La lettre est alors le moyen de regroupement des amitiés dispersées.
12.Cocteau, André Salmon, les peintres émules de Picasso, etc.
13.Ceci est à mon avis essentiel pour Cadou qui, se méfiant déjà des excès de sens surréalistes, un jeu gratuit pour lui, ne renonce pas à lire Apollinaire, Jammes, Hugo etc.
14.Cadou n'oublie pas son lecteur, ce qui est aussi une caractéristique de l'œuvre.
15.« Invente », écrit-il à Cadou, en lettres capitales, dans les marges d'une de ses lettres.
16.Le surréalisme, le dadaïsme etc. notamment, qui ont façonné notre façon d'écrire et de peindre.
17.Michaux, Char, Jaccottet, Bonnefoy, pour la poésie, le mouvement de l'abstraction et ses diverses variantes, pour le domaine plastique.
18.Notamment l'expressionnisme allemand ou tchèque et ce que le régime nazi a appelé « l'art dégénéré ».
19.Je renvoie ici le lecteur à Salah Stétié et La Maison du Souffle, revue Sud, 1994, et à notamment l'Interdit, José Corti, 1993. Salah Stétié - ai-je tenté de montrer, dans ma participation à ce numéro de Sud - nous rappelle, par son œuvre, que la poésie est « acheminement » de l'être, une tension vers, et non pas un état du langage qui serait à lui-même sa propre finalité, ce dont Cadou a aussi l'intuition.
20.Ce que d'autres appelleront après lui, « l'indécidable », ou « l'illimité », ou encore « l'improbable ».
21.Partant de là, toute « l'histoire » de Rochefort est à reconsidérer.
22.C'est ainsi que je tente de lire l'œuvre de Luc Bérimont (grand ami de Roger Toulouse), qu'on a voulu trop « tirer » vers une « poésie claire » alors qu'il est aussi « l'homme retrait » que l'ombre des choses travaille. Voir Luc Bérimont, le poète retrait, in Actes du Colloque Luc Bérimont, Presses Universitaires d'Angers, 1994.
23.C'est ma rencontre avec lui et son amitié - il a illustré un de mes livres peu après dans lequel je proposai à mon tour quelques regards sur sa peinture - qui ont été décisives pour ma relecture de Cadou.
24.Plus importante encore qu'il n'y parait, malgré des mises au point successives ces dernières années.
25.On le lui a reproché à plusieurs reprises. Certains de ses marchands, ou galeristes, n'aimaient pas qu'il écrivît aussi.
26.Pour qui il réalise un très bel ensemble, pour la parution de Grenier des Caravanes, juste avant la mort de son ami.
27.Je voudrais citer ici Pierre Garnier, dont le mouvement qu'il a fondé, le spatialisme, est en résonance avec l'oеuvге de Roger Toulouse.
28.C'est dans cette direction que je lis l'œuvre poétique récente de Jean Rousselot (Le Mystère profane dans la poésie de J. Rousselot, Actes du Colloque, Presses Universitaires d'Angers, 1998).
29.En effet, en musique, comme en peinture, apparaissent de nouveaux foyers de perspective : la perspective héritée de la Renaissance est caduque, estime Klee.
30.L'œuvre de Cadou annonce ainsi celle d'André Du Bouchet.
31 L'œuvre d'Yves Bonnefoy ne trouve-telle pas ici un écho ? En ce sens, Cadou est un poète « éveilleur » de la poésie contemporaine de la deuxième moitié du siècle.
32. L'œuvre de Jean Rousselot, avec ses caractéristiques propres, est aussi « aimantée » par celle de Cadou. Et Jean Rousselot - parmi les poètes - est sans doute un de ceux, avec Pierre Garnier, qui a le plus interrogé le « mystère » poétique de l'œuvre picturale de Roger Toulouse. Ce sont leurs travaux qui ont « guidé » ma propre recherche.
 |
« En liaison avec Max » : correspondances réelles et fantasmatiques entre René Guy Cadou et Max Jacob,
par Patrick Denieul
Université de Nantes |

(Retour au sommaire archives)
Les liens entre l'oeuvге de René Guy Cadou et celle de Max Jacob sont multiples et, le plus souvent, souterrains. Cadou s'est plu à parsemer ses textes de nombreuses références à son grand aîné en littérature, mais aussi à rédiger des hommages, à publier des extraits de leur correspondance. Notre communication portera justement sur ces documents, dont certains, parus en revue, sont souvent peu connus, documents où apparaît clairement le crédit attribué par notre poète à l'auteur du Cornet à dés.
La première et unique rencontre entre René Guy Cadou et Max Jacob, relatée par Cadou lui-même dans un article daté du б juin 1947 et intitulé : « Présence de Max Jacob » 1, remonte au mois de février 1940, à Saint-Benoît s/Loire. À cette époque, la correspondance entre les deux hommes a déjà presque trois ans d'âge : dès juillet 1937, Cadou a fait parvenir quelques vers à Max, en évoquant également la figure du peintre Pierre Roy, qu'il connaît par son fils. C'est sous cette égide que commence leur échange de lettres, que seule interrompra la mort de Max à Drancy, le 5 mars 1944.
Pourtant, cette relation épistolaire ne semble pas devoir se poursuivre sous les meilleurs auspices. Lors de la rencontre de février 40, Max Jacob apparaît au poète, sans que cela soit péjoratif, comme un « homme ancré dans la profondeur de Dieu » 2. Très clairement, du côté de Max Jacob, cette religiosité va vite se vouloir contagieuse. Ce même mois de février 40, l'ermite de Saint-Benoît s/Loire adresse ainsi à un René Guy Cadou issu pourtant d'un milieu laïque et anticlérical un texte d'inspiration chrétienne à méditer et il précise :
Le t'enverrai de temps en temps des méditations du genre de ceci.
N'y vois aucune littérature mais le désir que j'ai de t'agrandir philosophiquement, de
t'approfondir car la profondeur de l'homme fait celle de l'œuvre. 3
Cette volonté autant pédagogique que missionnaire de former le jeune poète qu'est alors Cadou ne laisse pas dupe ce dernier. À l'écoute des conseils de son aîné, il passe cependant outre. Néanmoins, d'un naturel mystique, Cadou, des années plus tard, reviendra sur cet engagement religieux souhaité par Max :
Entre la grande table à dessin et le lit monastique, il y a place pour un idéal chemin de croix. Et moi qui ne crois en rien, je suis tout près d'aimer, et je suis sûr que tu dis vrai, cher Max. 4
Entre les deux hommes va naître une confiance mutuelle. Après la lecture de la plaquette de poèmes de Cadou, Années-Lumière, Max Jacob réitère sa
prédilection pour cette poésie douce et bonne, imprévue où tout d'un coup, le sublime s'installe à côté du sourire. 5
Cet avis n'est pas hypocrite de la part de Max. Même si, comme Cadou le stipulera lui-même plus tard dans une note, on attribue à l'ermite de Saint-Benoît un besoin de flatter ses émules, ici, au contraire, il témoigne d'une véritable volonté de transmission que ne dément pas l'ensemble de ses lettres au futur poète de Louisfert :
On a dit de Max Jacob qu'il ne dut son entourage de jeunes poètes qu'à son habileté à manier l'encens et la pommade. C'est possible. Je vous signale toutefois qu'il m'écrivait, ou du moins quelque chose d’approchant : « Quand il s'agit de toi devant moi je dis tout le bien que je pense de ton œuvre, mais entre nous, permets-moi de t'engueuler. » 6
À travers cette note, nous prenons conscience de la place essentielle que tenait Max Jacob pour les jeunes auteurs de son temps, dont certains lui demandaient conseil. À ce titre, Cadou n'a été qu'un parmi d'autres. Cependant, pour Max, chacun de ces correspondants se révèle important. C'est en cela qu'il ne gère pas une cour d'admirateurs, mais tente d'éclairer chacun par ses avis, libre à ces jeunes gens de les suivre ou non. Les jugements de Max sont sévères et peuvent dérouter. Cependant, comme il l'écrit à Cadou, ce qui compte pour lui, c'est de s'éloigner de l'hypocrisie littéraire ambiante, d'être juste dans ses critiques afin d'assurer une éventuelle filiation :
Les compliments sont inutiles. La franchise est la seule marque de l'amitié sincère. J'aime dire du bien de toi quand tu n'es pas là et t'étaler des plans pédagogiques quand tu y es. L'inverse est plus à la mode, mais je ne suis plus à la mode. 7
Peu à peu, les deux hommes vont renforcer leurs liens d'amitié au fil d'une correspondance régulière. Ainsi, de l'aveu même de Max, Cadou acquiert un certain statut, car lui seul a su déchiffrer entre les lignes le vrai visage de l'ermite de Saint-Benoît :
Tu es la seule personne qui ait compris que le Cinématoma et le Cabinet Noir sont uniquement des études de caractères qui se tracent eux-mêmes par les mots qu'ils emploient. Uniquement. 8
Il est aussi enthousiasmé par la verve épistolaire de notre poète, qu'il souligne dans une lettre concernant les relations littéraires que l'on peut se créer, justement par le biais de la correspondance : :
Prépare tes avènements ? Puisque tu écris si facilement de belles lettres, ne te prive pas d'en écrire... au nom d'une misanthropie inconcevable. 9
René Guy Cadou est ainsi jaugé comme une sorte d'élève attentif et prometteur, mieux même : comme un confident, un camarade. Évoquant les poèmes obscurs et insipides qu'un poète du dimanche lui adresse, Max questionne René indirectement, concluant par ces mots : « Ce ne sont pas des conseils : je me parle à moi-même devant mon ami » 10. Telle semble être la finalité même de cette correspondance.
Pour Cadou, Max Jacob s'impose comme la figure tutélaire du passeur, de celui qui a connu Apollinaire et les artistes du Bateau-Lavoir et qui ose parler aux jeunes gens de cette époque mythique de la poésie: « La vérité de Max Jacob m'apparaît bien mieux maintenant que j'ai vu son cercueil porté à bras par quatre générations littéraires [...] » 11. La stature de ce grand aîné stimule l'imagination de Cadou. Celui-ci, se remémorant leur unique rencontre, nuance le portrait idéalisé de Morven le Gaëlique :
Ce n'est pas ainsi que je t'imaginais. Pas de lorgnons. Et plus grand, beaucoup plus grand, comme Gide, et plus épais aussi, peut-être comme mon père, mon père que j'aime tant, qui vient de mourir et qui m'amène ici en sarrau noir 12.
Cette phrase explicite bien les rapports qui vont s'instaurer entre Max et René, non pas des rapports de poète à poète mais, davantage, une relation filiale. Leur correspondance devient le terreau de liens plus complexes. Les parents de Cadou sont morts subitement, le laissant jeune encore. De par ses conseils, ses avis, son amitié paternelle, Max Jacob va prendre insidieusement une place douloureusement vacante dans le cœur du poète. L'ermite de Saint-Benoît est alors chargé de tous les espoirs, c'est à lui maintenant de veiller sur Cadou, de lui permettre de devenir homme en Poésie. La disparition brusque de Max accentuera encore plus ce rôle crucial. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le cycle de quatre poèmes intitulé « La série noire » 13, où Cadou exprime toute sa peine devant la perte des siens : sa mère, son père, et Max Jacob. Max Jacob mis en scène dans ses derniers instants comme le Christ emmené sur la croix. Ces malheurs en chaîne, cette série noire, laissent orphelin notre poète, et seule la Nature pourra quelque jour le consoler : l'annonce, déjà, du lieu idyllique de Louisfert comme remède à l'absence.
Un des aphorismes d'Usage interne résume toute l'importance de Max aux yeux de Cadou en tant que maître à penser et correspondant idéal :
Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. 14
Quand on sait quelle importance revêt pour Cadou l'exercice quotidien de la correspondance 15, véritable passerelle entre lui et ses amis lointains 16, l'annonce de la disparition définitive du plus fidèle des épistoliers est ressentie comme un abandon. Max défunt, c'est comme si son père mourait de nouveau :
J'étais descendu par désœuvrement dans un petit bistrot des bords de Loire. [...] Machinalement mes yeux se portent sur un journal du jour déployé devant moi: [...] « Max Jacob est mort [...] » [...] Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. J'ai répondu hier à sa dernière lettre. 17
Le correspondant suprême est mort. À l'évidence atterrante de cette nouvelle, confirmée plus tard par les amis, Cadou oppose la poésie et sa faculté de ressusciter les défunts par le verbe : « Tu n'es pas mort. Tu es descendu du car à la Roche-Hamon. Tu m'arrives. Nous allons boire le pastis chez Carridel. » 18 Dès cet instant, s'enracinant dans la campagne de Louisfert, et par-delà l'apparente clôture de la mort, Cadou va redonner vie à travers ses poèmes à Max Jacob, à la fois correspondant de l'Autre Monde et témoin du poète auprès de Dieu.
Le passage s'effectue dans le poème « Cornet d'adieu », extrait du recueil Pleine poitrine, écrit en 1944-45, recueil par ailleurs dédié à Max 19:
Souvent tu m'écrivais et c'était chaque fois
des bavardages de bergères et de rois
Tu m'écriras encore
J'attends tes reportages sur la mort 20
Par cette affirmation du rôle de « passeur » entre l'existence et l'absence grâce à la parole poétique, René Guy Cadou renoue le dialogue avec Max Jacob. Celui-ci devient alors un témoin de l'au-delà, un confident « ignoré des hommes, mais vivant comme lys dans le cœur des poètes » 21.
Les textes évoquant Max qu'écrira par la suite Cadou, et plus particulièrement en prose, ne seront pas des témoignages, mais des entretiens, le plus souvent sous la forme de missives, comme si notre poète envoyait directement à Morven le Gaëlique ses constatations sur l'existence et comme si le lecteur surprenait ce courrier intime de pensées.
Des douze poèmes faisant explicitement référence à Max Jacob, trois s'adressent directement à lui: « Cornet d'adieu », « Encore une lettre à Max » 22 et « En liaison avec Max » 23 Cadou y emploie la deuxième personne du singulier et interpelle le poète. Les deux derniers textes, plus particulièrement, évoquent la correspondance, notamment par leurs titres : dans « Encore une lettre à Max » 24, Cadou relate la venue à Louisfert d'un de leurs amis communs, Julien Lanoë. Et c'est l'occasion pour notre poète, à travers cette lettre ultime, de proclamer la présence toujours vivace de Max en lui et en ce monde :
Lanoë est là ma main bafouille et j'entretiens
Notre ami de ses fantômes quotidiens
Qui font que tu reviens toujours et nous rassembles
O Max dans l'infortune de ma chambre
Je t'aime et je fais bien et c'est un réconfort
O Max de te savoir au-delà de la mort
En moi présent intact et toujours secourable
Tu ne sortiras point à jeun de cette table
Où ton portrait figure et sans cesse grandi
N'est-ce pas cher Lanoë que notre ange maudit
Pèse comme un oiseau sur ma feuille et me donne
Le courage de ne ressembler à personne. 25
Tout comme l'image soudaine du Christ dans la chambre de Max Jacob, rue Ravignan, épisode qui suscita sa conversion religieuse 26, Morven, par la force de l'amitié, apparaît à Lanoë et Cadou et guide ce dernier dans une voie nouvelle où il peut « ne ressembler à personne » 27_
Plus encore, Max fait corps avec notre poète, en lui « présent intact et toujours secourable » 28. Ce n'est pas simplement un souvenir, mais bien la présence d'un « ange maudit » 29 qui « pèse comme un oiseau sur (la) feuille » 30 de papier où Cadou dépose ses vers. Max Jacob est tout entier dans l'écriture, à la fois le destinataire, l'inspirateur et la main invisible qui seconde le poète.
En effet, Cadou « considère la Poésie comme un chant, ou plutôt comme une opération magique ». Et il précise : « Les Chants bretons de Morven le Gaëlique comme les derniers poèmes de Filibuth sont des opérations magiques. Ils rejoignent Dieu à travers l'homme et l'homme à travers eux rejoint Dieu. » 31
Ce rôle de passeur de l'écriture, nous le retrouvons dans le second poème adressé à l'auteur de Filibuth. « En liaison avec Max » nous introduit dans un monde de fantômes où l'ombre de Jacob se profile. Tout commence par un mystère que ne peut résoudre la raison humaine, surtout celle des « curé commissaire et gendarmes » 32 : l'apparition d'une lumière éternelle, symbole de la présence du poète pourtant disparu :
Un car illuminé et personne dedans
Où est Monsieur Jacob criait le débitant
Et cependant là-haut dans la chambre de bonne
La lampe nuit et jour continuait de brûler 33
C'est le retour, semble-t-il normal, du fantôme de Max dans son ancien logis, retour que seul comprend et décrit le poète qui devine, à travers cette figure, le lien entre ce monde et l'autre, celui de Dieu :
Tu ne songes qu'à Dieu en toi-même invisible
Tellement merveilleux et tellement présent
Que sans cesse tu nais de ce rapprochement
Et la lampe qui fait bouger ta maison rose
Nous accueille et nous ouvre à ta métempsychose 34
« Ta métempsychose » : Max devient irréel, se réincarne constamment (« tu nais de ce rapprochement », vers 20) et rejoint Dieu dans sa petite « maison rose » (vers 21), lampe dont la flamme vacille comme sur un autel d'église.
Les êtres chers sont auprès de Dieu, en Dieu, même, et préparent la place à celui qui va venir. Que ce soit le père, la mère ou Max, ils ont tous un rôle dans l'Au-delà, un rôle, essentiel, de médiateur. Cadou chérit cette idée., lui qui rappelle à Morven la rencontre fixée de longue date et attendue après la mort: « Tu sais bien que nous devons un jour nous retrouver. » 35. Cette échéance, loin d'être terrifiante, lui permet au contraire par le biais de l'amour et de l'amitié, de réconcilier son existence et le sentiment tragique qui l'habite. Max Jacob a vécu le même cheminement. Ne conseillait-il pas, dans sa correspondance avec notre poète, « (d')apprendre à souffrir davantage et à se taire. (...) Ne te plains pas d'être désespéré : c'est l'état de désespoir qui est désirable. » 36
En effet, pour Max, « la souffrance est la seule clé du progrès et du bonheur. » 37 C'est pourquoi Cadou va s'efforcer de transmuer sa poésie à partir des malheurs qui l'accablent, afin de façonner un monde lumineux. Il se rend maître de sa tristesse en la magnifiant. Car, « la poésie sublimise (sic) ces douleurs dont elle se nourrit. » 38
Les parents de René Guy et Max sont partis avant lui et l'attendent. Fort de cette conviction, notre poète peut ainsi créer son univers en toute sérénité, le modelant à son gré selon les circonstances graves ou heureuses. Toute la poésie de Cadou est bâtie sur cet enjeu, comme le rappelle Yves Cosson. Car, « c'est le lien affectif qui fait le rapport, la métaphore ». 39 Pour preuve, ces premiers vers tirés de « Cornet d'adieu »:
Il n'y aura pas de printemps cette année
Parce que Max s'en est allé. 40
Notes
1.René Guy Cadou, « Présence de Max Jacob », cité dans Créer, Centre artistique et littéraire de Rochechouart, n° 23, Février 1976, p. 27.
2.Ibid., p. 27.
3.René Guy Cadou, lettre de Max Jacob à Cadou en date du 23 février 1940 in Esthétique de Max Jacob, Paris, Seghers, 1956, p. 79. Cet ouvrage reprend, la plupart du temps sans indications de dates, un bon nombre de lettres de Max Jacob à René Guy Cadou.
4.« Présence de Max Jacob », op. cit., p. 27.
5.René Guy Cadou, Esthétique de Max Jacob, op. cit., p. 43.
6.René Guy Cadou, Notes inédites, in Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, Paris, Seghers, 1978, p. 418.
7.René Guy Cadou, Esthétique de Max Jacob, op. cit., p. 60.
8.Ibid., p. 37.
9.Ibid., p. 71.
10.Ibid., p. 53.
11.Ibid.,9 p.11.
12.« Présence de Max Jacob », in Créer, op. cit., p. 27.
13.In Hélène ou le règne végétal, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 265.
14.Usage interne, œuvres poétiques complètes, op. cit., p.390.
15.Dans les Œuvres poétiques complètes, on relève dix occurrences de titres portant la mention « lettre ». Après Apollinaire, Cadou a littéralement inventé le poème-correspondance.
16.Cadou « avait besoin de cette correspondance qui lui donnait l'impression d'exister, de vivre comme les autres. Si parfois nous restions plusieurs jours sans répondre à ses lettres, c'était en lui le tourment, l'insécurité, presque le naufrage. » Roger Toulouse, « Lui et le Surromantisme » in Cahiers de l'Herne n°1, avril 1961, p. 21.
17.René Guy Cadou, « évocation de Max Jacob », in « Tombeau de Max Jacob », Simoun n° 17-18, (années 50), Oran, p. 14-15. Il s'agit de la transcription d'une émission de radio réalisée en mars 1949 sur les ondes de Radio-Rennes.
18.Ibid., p. 17. Hélène Cadou fera de même par la suite pour son mari : « Je m'applique à te redonner (...) Une part de jour assez douce/Pour t'obliger à vivre encore » («Je sais que tu m'as inventée », in Hélène Cadou, Le bonheur du jour, vers 6-9). Le verbe poétique permet de transmuer l'absence en présence.
19.« Cornet d'adieu », Cornet à dés : rien que par la similitude des titres, on peut déceler un clin d'œil complice de Cadou à Max. Non seulement le recueil est dédié à Max Jacob, mais l'expression « pleine poitrine » est communément employée par l'auteur de Filibuth, ainsi que le signale un extrait de lettre cité dans l'Esthétique de Max Jacob, (op. cit., pp. 38-39), la « pleine poitrine » révélant une écriture puissante, où tout l'être se donne dans le style. Le titre du recueil joue ainsi sur l'ambivalence du sens, à la fois celui qui s'offre sous les balles et le poète qui écrit avec toute sa fibre humaine.
20.« Cornet d'adieu », vers 23-26, in Pleine poitrine, Ouvres poétiques complètes, op. cit., p.171.
21.René Guy Cadou, « Pour en revenir à Max Jacob », in Pour en revenir à Max Jacob, collectif, José Millas-Martin éditeur, Paris, 1969, p. 13.
22.In L'aventure n'attend pas le destin, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 226.
23.In Le diable et son train, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 294.
24.À noter, dans ce même poème, que la mention des « Noël » de Cadou au vers 15 (« un Noël de Cadou, ça sent le Gaëlique ! ») n'est pas anodine puisqu'elle se réfère aux textes de Morven le Gaëlique traitant de la Nativité, thème également cher à notre poète. Six poèmes de Cadou traitent de ce sujet (in Grand élan, p. 125 ; La vie rêvée, p. 136 ; Ma vie en jeu, p. 188 ; L'aventure n'attend pas le destin, p. 238 ; Le diable et son train, p. 288 ; Les biens de ce monde, p. 341 ; Œuvres poétiques complètes, op. cit.). Quatre ont pour seul titre « Noël », et font le pendant à ceux de Max, au nombre de sept (dont cinq portent comme nom « Noël ») parus sous ce pseudonyme de Morven justement dans La ligne de cœur, revue qu'animait Julien Lanoë. Le fait d'évoquer Morven et Lanoë lie l'œuvre de Jacob à celle de Cadou et accentue cette correspondance déjà décrite.
25.Vers 11-15 et 17-24, in L'aventure n'attend pas le destin, Œuvres poétiques, op. cit., p. 226.
26.L'écriture du court poème, « Possibilité du corps en trop » (in Tout Amour, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 349), dont le titre fait irrésistiblement penser à ceux du Cornet à dés ou du Laboratoire central, rappelle justement l'épisode de la rue Ravignan. Est-ce la marque d'une conversion chez René-Guy à la fin de sa vie, comme ce le fut pour Max ? Ou, au contraire, un rappel de son ami par l'anecdote ?
27.« Encore une lettre à Max », op. cit., vers 24. Ce vers fait sans doute référence à ce conseil de Max (Esthétique de Max Jacob, op. cit., p. 24) : « Aie tes goûts à toi et aie la force de choisir tes voisins, ton domaine, ton théâtre, ton vocabulaire, ta nourriture, ta cravate, ton opinion politique, ton rythme, ta couleur, ta forme. »
28.Ibid., vers 19.
29.Ibid., vers 22. Cette mention des anges se retrouve aussi dans la correspondance. Page 26 de l'Esthétique de Max Jacob, on peut lire ce conseil : « Entre en rapports diplomatiques avec ton ange gardien, tes voix intérieures et extérieures. Apprends à discerner ce qui vient de toi ou de l'extérieur, les voix des anges et celles des démons. » Conseil assimilé par Cadou dans Usage interne, p. 400: « Ne méprisons pas notre ange gardien, ne l'accablons pas non plus de nos signes. Sa réponse n'engage que lui. » À la fois bonté et maléfice, Max est bien cet ange maudit dont parle le poème.
30.Iыd., vers 23.
31.René Guy Cadou, in Le miroir d'Orphée, Rougerie, 1976, p. 167.
32.« En liaison avec Max », vers 7, in Le diable et son train, Œuvres poétiques, op. cit., p. 294.
33.Ibid., vers 1-4. À noter le thème de la lampe, commun à Max et à René Guy.
34.Ibid., vers 17 et vers 20-22
35.« Présence de Max Jacob », in Créer, op. cit., p. 27.
36.René Guy Cadou, Esthétique de Max Jacob, op. cit., p. 45.
37.Ibid., p. 28.
38.Ibid., p. 27.
39.Extrait d'une série d'entretiens avec Yves Cosson, en 1996 (inédit).
40.« Cornet d'adieu », vers 2-3, in Pleine poitrine, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 171.
N.B. :
Il semble que Cadou, à la fin de sa vie, ait beaucoup investi sur la personne de Max Jacob, alors que tout porte à croire que, pour Max, comme nous l'avons écrit précédemment, René Guy était un jeune littérateur parmi d'autres. En 1949, Cadou consacre une émission radiophonique à Max Jacob, ainsi que deux articles parus, l'un dans les Cévennes du 5 mars, l'autre dans Р.А.В. Pour la seule année 1950, Cadou donne aux journaux et revues, La Gazette des lettres, la République du Centre (le poème « en liaison avec Max » y avait paru en mars 49) et les Cahiers du Nord, trois livraisons concernant toutes le poète et son œuvre. Si l'on comptabilise tous les comptes rendus écrits sur Max Jacob, nous arrivons au chiffre de six, dont cinq publiés entre 1949 et 1950. Pouvons-nous voir ici une urgence à évoquer ce passeur entre les mots et la mort, cet ange fugace et sarcastique, mais toujours bienveillant que serait pour Cadou Max Jacob ? Selon nous, Cadou se reconnaît en lui ou espère s'y reconnaître. Il souhaite aussi témoigner d'un grand vivant avec qui il a conversé et, à travers cette figure tutélaire, assurer la filiation poétique pour les générations suivantes. Par ailleurs, cette question de la survivance à travers la mort relie Max à René, René pour qui cette réflexion est cruciale. N'est-il pas celui par qui son frère Guy renaît ? Sa conception de l'Au-delà est proche de celle des Celtes, qui la devinaient tout près d'eux, dès le seuil de leurs portes. Cadou investit ainsi sa représentation mentale et fantasmatique de Max Jacob de tous ces espoirs de survivance. Pour lui, l'ermite de Saint-Benoît est un voisin de l'Autre Monde, toujours présent en celui-ci.
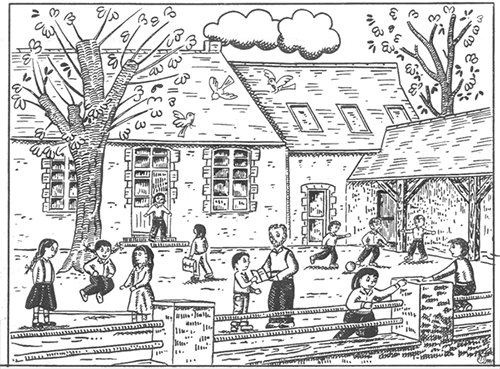 |
« Cette indicible tristesse qui était en moi » (Mon enfance est à tout le monde),
par Christian Rоbin
Université de Nantes |

(Retour au sommaire archives)
En juin 1947, le 14 exactement, René Guy Cadou écrit à Marcel Béalu « qu'il s'est promis d'écrire un gros livre sur son enfance (atmosphère de la saison de Sainte-Reine) ». Il est à Louisfert, où s'achève sa deuxième année comme instituteur à l'école publique ; il est marié avec Hélène depuis un an, il trouve auprès d'elle une tendresse infinie. Les heures sombres de la guerre lui ont appris que la vie à la campagne apporte malgré tout son lot de joies et d'impressions ; d'une certaine façon, il revit le passé bienheureux qu'il avait connu à Sainte-Reine de Bretagne, entouré de l'affection de son père et de sa mère, instituteurs avant lui.
Son œuvre poétique est appréciée, il s'est entouré d'amis sûrs, les échanges épistolaires sont nombreux. René Guy peut solliciter les grands éditeurs, Gallimard, Grasset, Robert Laffont. Certes, les réponses ou les délais ne sont pas à la hauteur des espérances. Robert Laffont vient, précisément et malheureusement, de refuser son roman La Maison d'été. Cadou ne veut pas rester sur un échec et opte pour l'autobiographie, déjà sollicitée dans La Maison d'été. Il consigne régulièrement depuis un an, dans ce qui deviendra Usage interne et Les Liens du sang, les réflexions et les aphorismes que lui inspire son intense activité créatrice. Aussi, quand il achève Mon Enfance est à tout le monde, il n'est pas surprenant de le voir tenter d'expliquer une nouvelle fois pourquoi il est devenu poète. La page est admirable. Le 30 mai 1932, était décédée sa mère, dans l'appartement de fonction de l'École publique du Quai Hoche, où son père avait été nommé directeur en octobre 1930. Cette disparition jette les deux êtres dans la désolation, René Guy ne trouve aucune consolation au Lycée Clemenceau dont il déteste les longs couloirs, les salles sinistres, les cours qu'il juge fastidieux. Georges Cadou, un jour que son fils lui a rapporté un livret scolaire exceptionnellement bon, après un déjeuner offert sur les bords de la Loire, lui confie qu'il a autrefois taquiné la Muse et lui montre ses cahiers de poésie:
« Le crois bien que c'est ce soir-là que tout a commencé. Le lendemain je me trouvais assis devant la fenêtre de ma chambre avec une feuille blanche sur mes genoux.
Dans les tilleuls, les moineaux pépiaient, les rats se promenaient dans la cour. L'air sentait la bougie et les fonds de jardin. Qu'est-ce que j'écris ? Que signifiaient ces mots maladroits que je dresse comme un rempart contre la nuit ?
Les soirs suivants me retrouvèrent à la même place, et je pris l'habitude de traduire, au lieu de versions latines, cette indicible tristesse qui était en moi. »
Qu'importe si ces tout premiers essais ont été détruits, Cadou insiste, dans ces quelques lignes écrites, après quinze ans de création, sur les raisons qui l'ont conduit à devenir poète. Il a trouvé en elles une consolation inattendue, et à cette conception somme toute classique il est resté manifestement fidèle. Mais, cette réaction salutaire ne conduit pas à l'oubli, bien au contraire : l'inspiration s'enrichit aussi des souvenirs, elle est le moment privilégié pour interroger les profondeurs de l'être qui a fait l'expérience de la douleur, puis elle se donne pour tâche, devant la complexité des sentiments de les « traduire », de les faire passer de « l'indicible » au « dicible ». Le poète retrouve là le rôle que lui a confié une longue tradition.
*
Il va sans dire que ces propos s'étendent à toute l'œuvre du poète, mais qu'ils éclairent aussi le livre où ils se trouvent consignés. La disparition d'Anna Cadou, vers laquelle culmine l'ouvrage, révèle une propension à la tristesse, que le poète découvre, grâce au jeu de la mémoire, jusque dans les moments où il pensait l'avoir méconnue. Cette précocité est régulièrement suggérée dans Mon enfance est à tout le monde, et la réitération de cette constatation confère à l'ensemble un lyrisme bien propre à installer ce climat poétique dont l'écrivain, biographe de lui-même, ne peut plus se séparer. Un rapide examen des occurrences du mot « tristesse » autoriserait une première constatation. Le substantif ne fait pas son apparition avant la page 114 dans l'édition du Castor Astral, comme si René Guy n'avait pas voulu hypothéquer l'évocation de la joie de vivre éprouvée à Sainte-Reine, évocation qui occupe plus de place à elle-seule que les parties réunies consacrées à l'Ecole de la rue de Cardurand, puis à celle du Quai Hoche. Cadou use, seulement et timidement, de l'adjectif « triste » 2, pour noter l'impression que lui laissent les cantiques de la procession de la Fête-Dieu 3, ou pour qualifier le parfum des fuchsias et de géraniums qui ornaient la fenêtre de la maison des Couvrant:
« …fleurs rouges au parfum un peu triste dont je mesure aujourd'hui l'amère douceur » 4.
Le mot de « tristesse » n'est pas loin de faire son apparition, la seconde partie du livre en propose symboliquement, faut-il préciser religieusement, sept occurrences. Les deux premières méritent d'être relevées, car elles se cumulent avec la forme adjectivale. L'une apparaît au moment où s'achève le chapitre consacré au cinéma muet découvert à Saint-Nazaire :
« Je ne pense pas à ces années sans tristesse, aujourd'hui que vous n'êtes plus, silencieux personnages, enchanteurs aux mains rudes qui parliez si bien à mon cœur. Vous aviez les défauts des rêves, vous étiez un mythe ouvert comme une tombe, vous brûliez la mèche des deux bouts, mais comme vous illuminiez le ciel aride de l'enfance !
Je quittais L'Athénée vers cinq heures, ballotté par des rues adverses, sans regard pour les devantures ni les passants, triste, inquiet, le visage pâli. » 6
L'autre, la deuxième, qui suit la page qui vient d'être lue, traduit la réaction paradoxale de l'écolier mêlé aux festivités d'une amicale laïque:
« Je suis vite fatigué, mortellement triste, d'une tristesse qui me vient toujours de la fréquentation des compagnies joyeuses. » 7
La portée générale conférée par cette dernière correction, comme le partage établi par la citation précédente, entre le narrateur qui écrit et l'enfant qu'il fut, ne relèvent donc pas du pléonasme, mais du désir d'établir une chronologie. René Guy fut à l'occasion « triste » jusqu'à l'époque du Quai Hoche. Cadou, devenu poète, est habité par la « tristesse ». L'état, de sporadique, est devenu permanent, plus dense également. L'usage du mot ne varie guère ensuite. Hormis sa présence naturelle, pourrait-on dire, pour caractériser l'atmosphère de la chapelle de Monval, visitée en solitaire, pendant les grandes vacances 8, ses dernières irruptions sont toujours liées à la nostalgie, et à la permanence du sentiment. Ainsi la silhouette de sa mère qui a abandonné sa longue coiffure provoque-t-elle un regret, toujours à vif:
« Epoque des cheveux-courts ! des vêtements de pluie ! des chapeaux-cloches ! Images que je ne puis feuilleter sans une tristesse qui n'est pas seulement un mal d'enfance. » 9
Et l'évocation des enfants qui habitent la Cour des Miracles du Quartier de la Madeleine déclenche des sentiments mêlés. Malgré leur indigence, « ils sont heureux », semble-t-il, mais ce « bonheur farouche », s'empresse de corriger l'écrivain, cache un abîme qu'il n'a pas encore pu mesurer 10, et dont il soupçonnait alors la présence, car il poursuit à propos de cette sauvagerie à deux visages :
« [Elle] me fait longuement songer, tandis que, retiré dès huit heures dans ma chambre, j'entends distinctement la lune s'écraser sur le toit comme un litre brisé ». 11
Nul doute que René Guy se reconnaisse dans ces garnements au bonheur douteux, et que ces rencontres l'aient conduit à la croisée où naissait sa vocation. Il peut désormais nommer clairement cette sensation étrange qu'il avait déjà éprouvée, mais dont il taisait le nom. L'occasion lui en est proposée le jour même du décès de sa mère. Attendant anxieusement dans sa chambre, il se souvient :
« C'était tout à fait comme dans les temps de Sainte-Reine, alors qu'une rougeole m'obligeait à garder le lit, et que, dans un demi-sommeil, je percevais tous les bruits de l'école ; c'était d'une douceur et d'une tristesse insupportables. » 12
Le livre se clôt, il s'en faut de peu, par les lignes à la faveur desquelles René Guy annonce qu'il se consacre désormais à traduire son « indicible tristesse. » 15
C'est peu de dire que le thème a été orchestré, et qu'il a subi un traitement quasi musical. D'apparitions pianissimo, il s'enfle pour gagner la tension du fortissimo. Cet effet ne serait pas si puissant si, dans les pages lumineuses qui évoquent Sainte-Reine, le poète n'avait pas laissé prévoir son éclosion. Certes, René Guy s'attarde pour notre plus grand contentement sur les lieux qui abritèrent sa petite enfance, salles baignées d'ombre douce à une époque où l'électricité était encore distribuée parcimonieusement, vergers généreux, haies bigarrées où se joue le soleil. Le bonheur s'affiche en conclusion du chapitre auquel est donnée pour titre la célèbre phrase de George Sand, reprise par Gaston Leroux dans Le Mystère de la chambre jaune : « Le Presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat », comme si l'idylle cachait un mystère à déchiffrer. Ces pages, éclatantes de la joie de vivre retrouvée, sont bien dans la manière du poète qui entame plusieurs de ses poèmes sur le mode de la morosité pour s'achever dans une lumière heureuse. Mais cet univers plein de quiétude n'ignore pas les alarmes. Les contes de fées qui entourent l'enfance, cités à la cantonade, avertissent déjà de l'existence de la cruauté dans cet univers protégé. Ainsi, en va-t-il de la chaleureuse école de son père qui recèle un cabinet inquiétant :
« Monde de terreur que je ne puis apprivoiser.
O Chambre Noire! chambre vide et toute pleine d'un remugle confus, chambre aux sept femmes, à la petite clé sablée - on frotte et toujours le sang mort reparaît - chambre dont la fenêtre était de gros drap noir, comment saurais-je te chanter ? » 14
Le jeune garçon s'évade-t-il clans le proche voisinage, le paysage offre incidemment le spectacle de ses cicatrices ou de ses désastres : ici,
« Les "pains de vipères" dressaient leurs grappes vertes et rouges dont la vue l'oppressait délicieusement » 15 ;
là,
« La reine des prés s'accroche aux barbelés de la clôture, les moineaux piaillent dans les saules, et parfois la panse gonflée, un chat mort descend à petits coups le maigre courant ». 16
Car les animaux sont les premières victimes dans une Brière qui est considérée comme un Paradis, seulement par les chasseurs. Ils souffrent parfois des mêmes infirmités que les êtres qui les nourrissent : ainsi de Tempête, le chien aveugle, mis sur le même pied que Pierre-à-Filleul et le borgne Lean Delahaye, dont le souvenir arrache à l'écrivain cette constatation :
« Toute mon enfance sera douloureusement impressionnée par des personnages de cécité ». 17
Ainsi que l'a relevé Christian Moncelet 18, les proches de l'enfant lui offrent fréquemment le spectacle d'une chair marquée, que ce soit la Mère Fleury qui crache le sang, le père Joulain amputé d'un bras, Marie Delahaye et Tante Célestine affligées d'une claudication, le jeune voisin de la rue du Cardurand, immobilisé à vie, ou surtout Georges Cadou à la poitrine glorieuse. Tous ont provoqué l'étonnement apitoyé de René Guy, qui a préféré la vérité simple à l'embellissement de sa période d'enfance. Que le rappel de ces figures douloureuses mette à mal son extrême sensibilité, il en accepte néanmoins le religieux devoir : horresco referens. Il a trop conscience que les sanglots, les épouvantes mêmes, provoquées alors par cette fréquentation de la faiblesse humaine et le spectacle d'une nature parfois cruelle, ont peu à peu formé une richesse intérieure qui le conduit à devenir poète. La tristesse, à peine désignée par son nom, est apparue discrètement, dès les premières années, et de cela René Guy voulait témoigner en composant Mon enfance est à tout le monde.
*
Lorsqu'il écrit son livre de souvenirs, Cadou ne sait pas qu'il est mortellement atteint ; il passe une partie de ses vacances en Auvergne, à Murols, où il était venu l'année précédente chez un camarade d'armée de son père, instituteur également. Il avait dû s'aliter quelques jours, victime d'une apparente insolation. Est-il habité par cette prémonition inconsciente que partagent les créateurs et les grands malades ? Il ne semble pas pourtant qu'il ait été conscient du mal qui le gagnait. Mais l'empressement mis à écrire ce livre lui donne une curieuse tonalité de testament, que confirmerait par ailleurs l'omniprésence de la mort.
Commencé pendant les vacances, l'ouvrage est achevé à Louisfert. René Guy Cadou, laïc, adhérent du bout des lèvres au parti communiste, collaborateur de la revue Clarté, n'est pas athée. Au contraire, il manifeste une profonde religiosité, multiplie les appels à Dieu dans son œuvre, admet parfois l'existence d'un au-delà où il retrouvera ses chers disparus. Il aime surtout à se comparer au Christ en croix, compagnon de souffrance, comparaison qui est appelée dans les mois qui viennent à une poignante ressemblance. Il n'est pas étonnant que le calvaire de Sainte-Reine de Bretagne occupe une place particulière dans sa mémoire de poète. Il se confond pour lui avec les premiers émois de sa riche perception et l'initiation involontaire à la prière, enseignée affectueusement par une grand-mère maternelle que ne rebute pas l'indocilité de son petit-fils 19. Aussi loin qu'il puisse plonger dans le souvenir de ces jours passés en Brière, c'est pour se remémorer Sœur Chantal, la directrice de l'hospice, qui lui enseigna à faire son signe de croix. Et si personnel que soit le christianisme de René Guy Cadou, fort bien évoqué tant par Jean-Charles Payer 20 que par Christian Moncelet 21, il semble bien qu'il ait été marqué par le pessimisme qui caractérisait encore le christianisme rural. En tout cas il prit ses racines au cours de ces années de Sainte-Reine de Bretagne qui s'achevèrent à l'automne 1927. C'est d'ailleurs vers le Calvaire que se tournent lеs regards du poète René Guy lorsqu'il abandonne à regret l'évocation de son village natal, où il compte retourner un jour :
« Et l'enfant que je fus refera en pleurant ses premiers pas dans l'allée du calvaire ». 22
Le dernier mot qui achève la première partie du livre n'est pas seulement un toponyme. Si l'on accorde quelque symbolisme à cette ultime mention, il devient le pendant inéluctable d'une première page, tout aussi chargée de sens. A dessein, le poète a daté l'achèvement de son manuscrit du 25 décembre 1947, et l'on sait l'attachement qu'il éprouvait pour Noël. Il n'est donc pas surprenant qu'il commence par évoquer l'espèce de crèche où il pense être né, cette caisse de savon de Marseille « aux planches disjointes, mal rabotée » et surtout « toute hérissée de clous comme une bogue de châtaigne » 23. Certes l'humour domine ces lignes initiales, mais comment ne pas penser déjà à une annonce discrète des atteintes de la douleur intérieure, susurrée puis déclarée par le narrateur ? Ce sont en somme les futurs clous de la Croix qui joignent les planches raboteuses de cette crèche.
*
Si, en 1932, René Guy Cadou pensait que la tristesse qui l'habitait était « indicible », quinze ans plus tard, à l'époque de sa plus grande maturation, il a trouvé l'art de la suggérer, d'en noter les premières atteintes, et d'en orchestrer la progression. Grâce à Mon enfance est à tout le monde, le poète fait heureusement mentir la critique qui interdit désormais de louer une œuvre au nom de la sincérité. La réussite de ce livre tient en effet pour une large part à cette lucidité dans le souvenir et dans l'inspiration. Ces souvenirs ne constituent nullement une parenthèse dans une œuvre qui s'avançait alors sur plusieurs fronts. Cette autobiographie poétique est une tentative d'approfondissement tout autant que les notes critiques jetées alors sur le papier. Elle est surtout une station dans la montée vers le sommet que représente le recueil Les Sept péchés capitaux, dominé par le chef-d’œuvre qui le clôt, la Tristesse :
« Embarqués dans je train de nuit qui ne s'arrête jamais
Sans avarie possible de machine sans espoir
D'entendre battre au loin une petite gare
Ses volets verts et la pluie grise de son timbre
Mais la grande fuite éperdue dans une éternité malingre
Anna ma mère dans la couchette du wagon
Et mon père au-dessus qui la protège de son affection
Je vous vois l'un et l'autre dans ce même lit où je suis né
Le suis couché entre vous deux
Et vous n'avez plus de place pour vous retourner
Je prends dans mes deux mains vos deux mains qui s'éteignent
Pour qu'elles soient chaudes et farineuses comme des châtaignes
Quand la braise d'hiver les a longtemps mûries
Ah! Croyez-moi ! je ne sais rien de plus atroce
Que de vous laisser partir seuls pour ce voyage de noces
Que d'attendre durant des mois et des années
Derrière la fenêtre étroite et grillagée
Le passage de l'ange essoufflé qui m'appelle
A l'aubette perdue dans les genêts du ciel
Où le train qui vous mène est enfin arrêté. » 24
Notes :
1.René Guy Cadou, Mon enfance est à tout le monde, 1995, Bordeaux, le Castor astral, p.174.
2.Ibid., p.31.
3.Ibid., p.45.
4.Ibid., p.31.
5.Ibid., рр.114, 124, 127, 147, 156, 171 et 174.
6.Ibid., p.114.
7.Ibid., p.124.
8.Ibid., p.127.
9.Ibid., p.147.
10.Ibid., p.156.
11.Ibid.
12.Ibid., p. 171.
13.Ibid., p.174.
14.Ibid., pp.24-25.
15.Ibid., p.50.
16.Ibid., pp.22-23.
17.Ibid., p.39.
18.Christian Moncelet, Vie et Passion de René Guy Cadou, 1975, La Roche Blanche, Éditions BOF, p. 61.
19.Mon enfance est à tout le monde, op. cit., pp.26-28.
20.« La Présence de Dieu dans la poésie de René Guy Cadou », in René Guy Cadou, Actes du colloque, 23¬25 octobre 1981, Nantes, Université de Nantes, Textes et Langages n° 6, 1982, рр.213-227.
21.Op. cit., pp.273-278.
22.Mon enfance est à tout le monde, op. ch., p.99.
23.Ibid., p.17.
24.René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, Paris, Seghers, 1996, рр.309-310.
 |
Inquiétude de Cadou,
par Aude Préta de Beaufort
Université de Paris-Sorbonne. |

(Retour au sommaire archives)
Dans son Panorama critique des nouveaux poètes français, en 1952, Jean Rousselot a salué dans sa dimension historique le « réconfortant message » donné par la poésie de René Guy Cadou en pleine époque « de l'anti-nature et de l'anti-humain » 1 La présence d'un « réalyrisme » éclatant a également guidé l’étude de Christian Moncelet 2. Nous retrouvons là, de fait, le « programme » de l'École de Rochefort formulé par Jean Bouhier dans « Position poétique de l'École de Rochefort » ainsi que par René Guy Cadou dans « Précisions sur l'École de Rochefort » (un « appel à l'enthousiasme, à la plénitude de la vie » 3) et dans « Présence d'un surromantisme » (une résistance au « désespoir » et à ce qui pourrait apparaître comme « un nouveau mal du siècle » 4). Le travail de Jean Yves Debreuille, en 1987, en a éclairé orientations et pratiques 5. Ce qui nous occupera ici sera toutefois l'inquiétude qui parcourt l'œuvre du poète et sous-tend l'effort vers la vie. Ce frémissement constant d'une parole dont le poète nous dit qu'il a pu l'« intercepter, parfois, dans les couloirs de la détresse » pour nous entretenir « d'un monde fugace, inaccessible comme un feu d'herbes et tout environné de maléfices » б est ce qui nous aura retenue à la lecture des recueils, même si nous gardons à l'esprit que cette inquiétude ne veut tourner ni à la révolte ni au désespoir de l'absurde, comme le suggérait en partie Marcel Вéalu en y goûtant une simple « mélancolie devant la fatalité du destin » 7.
L'inquiétude apparaît d'abord comme un mode premier de la sensibilité de Cadou, avant de se doubler d'un mouvement de résistance à la complaisance dans le mal-être. Mais l'élan vers les choses, la communion amoureuse, le dialogue avec Dieu, et la quête d'une identité ne sont pas pour autant dénués d'inquiétude. La recherche d'une fusion est souvent définie et formulée comme une mise en question du moi. Au point que cette poésie qui se propose de poursuivre à sa manière l'effort de « connaissance de l'homme et du monde », apparaît essentiellement comme un élan de sympathie avec le monde, ne s'en retranchant pas, mais participant de son mouvement perpétuel, de son inquiétude fondamentale. Il ne s'agit point de connaître ou d'explorer le monde en cédant au « virus de l'imagination » 8, mais de l'aimer : Croire à la vie, titre d'un recueil de Jean Bouhier 9 fait figure d'injonction. Ici, l'inquiétude n'est pas le contraire de l'amour de la vie, mais l'incessante palpitation de la vie et de l'habitation du monde.
*
Le « contact poignant du poète avec sa destinée », où René Guy Cadou situe l'authenticité de la poésie, nous pourrions l'entendre, en un sens littéral, comme l'expression, durable dans l'oeuvге, d'une appréhension inquiète de l'existence.
L'œuvre laisse entendre un deuil interminable. Le poète conserve une mémoire vive - ou plutôt à vif - des êtres aimés qui sont morts et de l'enfance disparue. Les parents morts ressurgis parmi les « feuillages têtus de [l'] enfance » dans l'« Avant sommeil » de Bruits du cœur 10 veillent sur « remords » et « lendemains », ne cessant ainsi de marquer l'existence qui continue après eux. Celle-ci se voue alors pour une part à la commémoration du révolu : « 30 Mai 1932 », mort de la mère, « Janvier1940 », agonie du père 11, mort de Guillaume Apollinaire, de Max Jacob, quatre ans de l'amour pour Hélène 12, mentions de son propre anniversaire par le poète ou évocation d'anciens moments d'amitié. L'avenir est lui aussi sous le signe du deuil. Le poète évoque dans presque tous ses livres l'imminence de sa propre mort 13 et, comme le remarquaient déjà Georges Bouquet et Pierre Menanteau dans leur présentation du Florilège poétique de René Guy Cadou 14, cette perspective suffit bien souvent à donner une tonalité pathétique à l'expression de l'élan vers la vie. Les choses et les êtres apparaissent précaires. « Cœur sur table » ou « Épisode », dans Retour de flamme, confessent un sentiment d'urgence (« Il n'y a plus une minute à perdre » ; « Je suis pressé de tout me dire/ Comme si j'allais perdre la mémoire » 15). Dans Ma vie en jeu,« le Fond de la pensée » donne l'image de la vie tout entière descendant « Au fil du sang » vers un horizon difficile à percevoir (« Les yeux et l'horizon qui manquent d'éclairage/ Le feuillet où j'inscris l'avenir de travers ») et le poète y énumère ce « qu'on veut [lui] prendre » : fleurs, oiseaux, amour, auxquels le poème, tâtonnant défi, offre un refuge précaire et de haute lutte conquis.
Une certaine tonalité élégiaque s'impose aussi bien dans la déploration rétrospective que dans l'anticipation angoissée 16. La variété des tons où elle s'abrite la préserve de la complaisance et crée une tension, soit que le poète envisage sa mort avec le réalisme cru et peu sentimental du poème « Dans le soleil » de Que la lumière soit 17, soit qu'il ait recours à l'humour ou l'ironie qui surgissent en particulier du décalage entre expressions toutes faites et intention ou entre titre et contenu. C'est le cas par exemple dans L'Héritage fabuleux quand, sous le titre « Déménager », le poète imagine le jour où les corbillards l'emporteront et où le « dernier feuillet » s'envolera de sa table de travail déserte pour aller se perdre et pourrir 18. Mais ce qui caractérise en propre la poésie de Cadou, c'est sans aucun doute une simplicité où l'économie de moyens devient la meilleure figure du dénuement de celui qui voit tout lui manquer et choisit alors d'attendre, dans une vibration inquiète, de découvrir à quoi il faudra faire face, comme dans « La Neige rouge » de La Vie rêvée ou dans « À la lumière des mains » des Visages de solitude 19.
En dehors même du deuil proprement dit, l'existence apparaît pour une part comme « Coups et blessures », pour reprendre un titre de La Viе rêvée. Larmes, tristesse, ennui composent un lexique récurrent qui a d'ailleurs des échos dans la correspondance avec Marcel Вéalu ou dans Mon enfance est à tout le monde. La vie est une sorte d'exode (« J'écoute/ C'est bien moi/ Je suis seul sur la route/ Mon passé sur le dos/ Dans ma gorge enflammée un bouquet de sanglots » 20) et dès Retour de flamme la présence à soi-même a le caractère ambivalent d'une singularité que le jeu de mots désigne comme exemplaire et déchirante tout à la fois («Je n'ai plus rien à moi/ Que ma vie sur les bras/ Un cœur qui n'a pas son pareil » 21). Un certain sentiment de l'inanité de l'existence affleure ici et là. On se rappelle le convoi sinistre d'« Aller simple » dans Le Diable et son train 22 ou la vie en forme de « Série noire » où se succèdent les morts, dans Hélène ou le Règne végétal 23. Avec l'enfance, c'est toute la vie qui semble d'une certaine façon définitivement en-deçà. Dès Bruits du cœur,« Rideau » 24 détermine cette posture : de la plénitude « le temps n'est plus », « Maintenant tout est clos » et la seule « douceur » qui se dessine est celle du « remords », remâchage au passé des jours écoulés. Nous ne saurions énumérer tous les titres qui, comme « La Vie promise », « Partie perdue », « Homme mort », « Peine de mort »,« Condamnation à vivre », « Les voyages forment la jeunesse » désignent directement ou ironiquement la déception existentielle du poète. Il n'est jusqu'à la voix des bêtes où le poète entend « La diane doucement poignante du destin » 25 qui ne change les matins en heure des bilans. « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? », dans L'Héritage fabuleux 26, interroge et presse le sens de l'existence. Laconfiance qui s'y amorce reste inquiète, se fait presque implorante, et c'est finalement sans véritable réponse qu'il faut s'engager dans un simple pari.
Mais malgré l'absence d'angoisse de type dualiste, l'inquiétude accompagne encore l'élan vers le monde, la communion amoureuse, le dialogue avec un Dieu hors dogme, ce qui constitue en somme pour Cadou la quête d'une identité.
Il y a une inquiétude des choses : l'« inquiétude étroite » des ailes des hirondelles dont le poète guette le départ avec un serrement de cœur 27, les « yeux inquiets » « Des bêtes qui remuent/ Tristement le passé » en guettant un espoir 28. Les présences concrètes et les paysages sont soumis à la même loi de durée et d'éloignement qui frappe l'enfance. Cela est visible dans le fil dramatique de « Comme un enfant perdu » et dès le début de « Quand tout s'en est allé », dans La Vie rêvée 29. Ajoutons que le titre « Les Biens de ce monde » joue autant sur l'allusion possible aux vanités que sur la proclamation de la dignité de ce monde. Il faudrait dire aussi que le corps n'est pas toujours le lieu d'une communion avec le monde : l'homme « Comme les autres/ Dans ses épaules de craie/ Dans sa poignante vérité de sable » 30 avoue qu'il ne saurait offrir assise à l'oiseau ni à la fleur. L'existence est souffrance, pour l'« Homme mort », et vivre est toujours tenter de « Reprendre pied » 31. Même quand le monde se fait promesse heureuse, une instabilité diffuse continue à le cerner et il se présente dans bien des pièces comme une victoire sur la menace. Au point que le poète souhaite, « Comme un enfant qui cherche à préserver le nid/ Surveillé deux saisons », abriter son amour dans un décor d'objets familiers et usés, témoins d'une durée de l'existence 32 Ailleurs, il arrive que la présence positive du concret se creuse d'absence. C'est ainsi que « L'odeur brûlée des pinèdes » humée « À perte de sens » renvoie à l'enfance disparue, ou que le cri d'un oiseau des marais « rappelle » douloureusement le passé évanoui 33. On en pourrait dire autant de divers lieux, « La Haie longue » par exemple, dans la mesure où ils se rattachent au souvenir. Fragiles sont ces présences que le poète ne convoque parfois qu'au conditionnel (« Je ne vis que pour quelques feuilles/ Quelques oiseaux qui seraient là » 34). Et puis l'évocation des choses se fait le plus souvent par une série de touches concrètes : pas de jeux symboliques ni de spéculations cosmiques. Si bien que, l'apparente simplicité prosodique aidant, le réel reste une présence vivante et précaire:
« La route
Les grands airs
Ceux qui vivent à cœur ouvert
Le temps qui passe
Un peu de ciel au fond des tasses
Après-midi l'odeur des foins
Et l'ombre lasse dans un coin ». 35
Si l'évidence du monde demeure chez Cadou subtilement énigmatique, c'est en grande partie grâce à cet art de présenter les choses, de les laisser dans leur présence, leur simplicité que le poème ne prétend pas analyser. Cela est sensible dans « Dur à vivre » : la simplicité de l'objet familier dit celle de la mort (« Et mon cœur doucement aura cessé de battre/ À cause d'un compotier de pommes sur la table » 36) mais, au foпd, ce compotier possède une évidence aussi secrètement close sur elle-même que la mort du poète, et le lien de causalité qui est posé nous demeure mystérieux.
D’une façon analogue, la communion amoureuse est souvent présentée comme un défi lancé à l'inquiétude, même si aucune condamnation ne pèse ici sur l'Éros qui n’a rien en soi de transgressif et ne possède pas non plus la sensualité souvent trouble et teintée de violence qu'on peut lui voir chez Marcel Béalu. Hélène est celle qui apparait après que le poète dut errer « dans le corridor mauve du chagrin » 37 et sa maison est un refuge offert « [...] aux bêtes qui ont froid/ À ceux qui n'ont connu que la douceur des pierres » 38. C'est encore à la nécessité de choisir « entre avenir et souvenir » qu'est rapportée la rencontre avec Hélène 39. Plus profondément toutefois, l'amour s'inscrit dans le mouvement même du monde. Le schéma d'une rupture initiale de l'unité et d'une faute de l'Éros ne se trouvant pas chez Cadou, ne s'y trouve pas non plus l'image d'une communion amoureuse ayant à restaurer une androgynie primordiale et un avant-temps édénique. L'amour se vit sur fond de quotidienneté : la maison, ses objets, ses bêtes, la vie partagée ensemble, la carriole d'Esprit dans la côte. Point ici de fausse quiétude désincarnée, et nous ne saurions même parler d'une quelconque prise de possession du concret par les amants. Ceux-ci, « inquiets » ne communient, dans le poème « Feuillages » de La Vie rêvée, que dans la « transparence » d'un grand courant de fontaines, d'arbres, de troupeaux, de feuillages et de sang. Cette image essentielle de circulation et de traversée revient dans le poème « Toi » d'Hélène ou le Règne végétal. La communion amoureuse participe donc du monde, de l'existence et de leur incessant mouvement.
L'inquiétude marque aussi le dialogue avec Dieu, non seulement parce que le poète semble hésitant dans ses conceptions, mais surtout parce qu'il incline vers une spiritualité ancrée dans l'existence.
La figure traditionnelle de Dieu est présente: amour et rigueur («La mansuétude immense de Dieu lourde comme une feuille blanche » dans Usage interne 41), figure du Juge 42 lors de bilans de plus en plus fréquents dans l'œuvre et à qui l'on se confesse (voir la « Confession générale » de Que la lumière soit 43), Dieu Puissant qui donne naissance au « Nocturne » des Biens de ce monde 44, confiteor, prière et supplique pleins d'ampleur quoique d'un ton moins solennel que les Trois psaumes de Jean Bouhier parus dans Les Cahiers de l'École de Rochefort en 1942. Mais ce Dieu est aussi un Dieu familier, « pas si loin » et « [...] tout à fait comme « l'oncle Isidore/ Qui était roux de poil et qui peut-être est mort » 45, Christ à secourir, dans « Comme un Christ de Gauguin » 46 ou dans Lilas du soir, clochard 47 ou nouveau-né mal accueilli de la Noël. C'est le Dieu d'une foi simple et populaire dans Saint Antoine et Cie et dont les images pieuses sont, avec « Paille et velours » dans L'Héritage fabuleux 48, intimement mêlées aux souvenirs personnels. Ce Dieu est parfois vertement et de plain-pied apostrophé. « Après Dieu le déluge » 49 parodie le Notre Père pour faire de Dieu celui qui inflige à l'homme le « goût de vivre » puis s'en lave les mains.
Ce Dieu-là est celui qui place l'homme dans l'insécurité de vivre et c'est à lui que s'adresse le plus souvent René Guy Cadou. Le poète affirme qu'il n'est « pas métaphysique » et estime, tout engagé dans l'existence, qu'« [...] on a bien mérité/ de croire dans la vie plus qu'en l'éternité » 50. Son bref « Credo », dans Les Biens de ce monde 51, est explicite:
Je ne crois pas en les miracles de Lourdes
Le crois dans une belle journée
Avec des ramasseuses de colchiques
Et des jeunes gens égayés
Pas de surnaturel, mais la vie présente. Dieu est celui qui « Assaisonne la soupe noire de la terre », s'engageant lui aussi dans l'existence. La religion de Cadou, si elle n'exclut pas l'idée d'une nature transcendante de Dieu, s'applique donc à saisir Dieu « dans les manifestations de l'Univers » 52. L'amour des « Biens de ce monde » n'est dès lors pas tant présenté comme un nouvel épicurisme que comme une forme d'abandon de soi et de renoncement salvateur. Le poète demande que derrière les « propos gentiment salaces » de l'homme on voie plutôt « [...] sa profonde tendresse/ Pour ce monde où les doigts du Seigneur sont marqués » 53. L'amour du monde est présenté comme une vocation absolue 54 difficile à assumer et source d'un pâtir, d'une sympathie aussi, avec le monde dans ce qu'il a de plus fragile. Le poète s'identifie alors au Christ en Passion, supplicié par le « goût de vivre » que Dieu lui a fiché dans la poitrine comme un « clou rouillé » 55, ou à Job, éprouvé mais sans révolte et ne possédant que cet « immense amour » qui le noue à l'inquiète existence 56 Devient exercice spirituel cette participation vibrante à la vie :
« Peut-être bien
Que tout au bout de cette vie il n'y a rien
[…]
Il reste malgré tout l'espoir d'une aventure
Le goût sûr et salé d'un matin de printemps
[…]
On est porté plus loin que son épaule même
[…]
[...] et l'on s'élève
Miraculeusement à son propre niveau ». 57
La quête de soi, quête d'identité et d'unité, est également marquée du sceau de l'inquiétude. Le poète exprime souvent le désir de se débarrasser de son ancien moi douloureux et inquiet. L'identité est problématique pour celui qui, dans un poème intitulé « La Fuite éperdue » se sent partagé entre « l'homme inquiet » et « celui qui [le] fait sourire » et joue « A les dresser l'un contre l'autre/ Qu'ils [le] délivrent de [lui]- même » 58 ou qui, « Pour [se] sauver » « retranche [son] enfance de [sa] vie » 59. Ailleurs s'exprime un désir régressif du repos : ne pas voir, ne pas savoir 60, dormir pour « l'échappe[r] belle » 61, mourir et être retiré de la circulation comme « fausse monnaie » 62, revenir « Sous l'écorce du premier jour » 63 ou se blottir « comme un enfant frileux » contre la femme aimée 64. Mais surtout, le désir d'identité est, chez Cadou, désir de se fondre dans le monde. Après avoir évoqué les maisons de son enfance habitées par des voyageurs toujours en transit, le poète confie en ce sens dans Les Visages de solitude :
« Hésitant à chercher dans leurs maigres bagages
Peut-être le secret de mon identité
Je préférais laisser planer sur moi comme une eau froide
Le doute d'être un homme
Je m'aimais
Dans la splendeur imaginée d'un végétal
D'essence blonde avec des boucles de soleil
Ma vie ne commençait qu'au-delà de moi-même
Ébruitée doucement par un vol de vanneaux. » 65
Ce qui est ici recherché n'est pas la permanence d'une essence, d'une Nature équivalante à l'Etre, mais bien une fusion avec l'existence, ses efflorescences, ses bruissements, son mouvement. Cela va jusqu'à une véritable dissolution du moi dans les choses : « chair épanouie] en haillons » du vent du large, ou bien s'endormir « dans le crin/ Sur la pierre lavée/ Pesant comme les bois/ Comme les pâturages », investi par l'« Arbre des temps futurs/ Dangereuse saison/ Pour que [son] corps jaillisse aux quatre coins de l'horizon » 66. Avec La Vie rêvée 67, le poète cherche à partager la nudité des choses, dans « Retour au pas », et leur impermanence, dans « Bientôt l'arbre » où le poète se voit devenir arbre offert aux oiseaux migrateurs, parcouru de sèves et métamorphosé encore, « Tronc si blanc qu'il n'est plus/ Qu'une neige attentive ». Grâce à « La Visiteuse » aimée, le poète révèle :
« [...] Les mains vont s'habituer à devenir abeilles
Et le corps atteindra la courbe de la treille
[...]Les fourrés descendaient le long de mon visage
Mes yeux bleus devenaient des prunelles sauvages.» 68
et dans « Première traversée », il se rêve à nouveau arbre, pris dans un vaste élan du monde et « parlant couramment le langage des pierres » 69. La contrepartie en est parfois, jusqu'à La Vie rêvée, la crainte de ne pouvoir fonder son identité sur les « Biens de ce monde » si, comme dans « le Temps perdu » de La Vie rêvée 70, il faut constater l'évanouissement des soleils, vent, arbres, cerviers du soir dont le poète pensait qu'ils constituaient le moi ou s'il faut craindre, changé, de n'être pas « reconnu » 71. Mais cette crainte le cède à une acceptation d'autant plus attentive de l'impermanence qui régit ce monde. Si le père mort de « Chambre de la douleur » survit, ce n'est donc pas ailleurs qu'en ce monde : dans la « pâque » des printemps, « au fond de chaque/ Sillon, dans chaque grain de blé/ Et dans la fleur ouverte aux flaques/ Impitoyables de l'été » 72. Et de même Hélène, source de toute plénitude, demeure « L'inquiète la dormante » en ce qu'elle est « de tous les jours », accordée à l'alternance du jour et de la nuit, au cycle des saisons. L'inquiétude n'est pas ici le contraire de l'amour de la vie et ne donne pas l'espèce de sentiment d'une disproportion entre l'homme et ce qui l'entoure que peut laisser la lecture de l'Astrolabe de Michel Manoll malgré la présence du concret 73. Identité et unité sont à l'image de l'inquiétude du monde que le poète ne veut cesser de partager : évidence insondable d'une vie qui renaît sans cesse de la mort, vision héraclitéenne d'une permanence faite du mouvement perpétuel des choses, non loin de ce que formule Luc Decaunes, dans L'Air natal, en 1944: « Ce qui change étant ce qui demeure/ Et qu'on ne voit pas » 74.
*
Cette poésie se présente donc, non sans parentés avec la « souffrance » préconisée par Max Jacob 75, comme une sympathie inquiète avec le monde. Nous retrouvons là l'insistance des « Précisions sur l'École de Rochefort » et de « Présence d'un surromantisme » à définir la poésie en termes de connaissance-fusion plutôt que de connaissance-exploration : élan vers la « plénitude de la vie », amitié, « amour obstiné », mise au diapason de l’« universel concert », « contact poignant du poète avec sa destinée ». Par le choix d'une poésie de « pleine Poitrine » « [...] cri d'un homme/ En face de sa nuit » 76, d'une beauté qui ne soit pas refuge mais Passion, dite « fille en Jésus-Christ » dans Les Sept péchés capitaux, le poète situe son éthos : « J'écris pour me sauver/ Pour sauver ce qui reste/ Un bourgeon de soleil oublié sur ma veste » 77. Mais c'est vaincre le temps sans l'abolir : « J'écris pour divulguer ce qui vient des saisons » « J'écris pour dépasser la crue noire du temps/ Tandis que les oiseaux et les fleurs me précèdent » 78. Connaissance et salut, mais sans que la poésie transcende le mouvement de l'existence. Elle est avant tout expérience, et l'on comprend le rejet de ce qui paraissait éloigner romantisme et surréalisme de la vie. Il s'agit désormais d'« Écrire mais vivre » 79.
Notes
1.Pierre Seghers, éditeur, 390 p., p. 251.
2.René Guy Cadou, Les Biens de ce monde, Seyssel, « Champ poétique », Champ Vallon, 1983, 324 p.
3.Les Cahiers de l'École de Rochefort, Paris, René Debresse éditeur, Hors série, 30 mai 1941.
4.« Présence d'un surromantisme », Les Essais, n° 6, sept. 1947, repris dans Le Miroir d'Orphée, Mortemart, Rougerie, 1976, 176 p., pp. 50-54.
5.Jean Yves Debreuille, L'École de Rochefort, Théories et pratiques de la poésie, 1941-1961, Presses Universitaires de Lyon, 1987, 506 p.
6.« Préface », Hélène ou le Règne végétal, Œuvres poétiques complètes, Seghers, 1973, 2 vol., 465 et 365 p., II, p. 7-8.
7.Marcel Béalu, René Guy Cadou, Correspondance 1941-1951, Limoges, Rougerie, CNL, 1979, 188 p., p. 36
8.« Présence d'un surromantisme », op. cit., p. 52.
9.Jean Bouhier, Croire de la vie, 1941- 1954, Les Amis de Rochefort, impr. A. Nicolas, Niort, 30 nov. 1954, 101 p.
10.« Avant-sommeil », Bruits du cœur, 1941, OC., I, p. 123. Voir aussi « Tristesse » Les Sept Péchés capitaux, OC. II, p. 11 (une vie dans l'attente de rejoindre les parents terriblement abandonnés dans la mort).
11.La Vie rêvée, 1. Grand Élan, OC., I, p. 209 et 229.
12.« 23 Avril 46 », Les Biens de ce monde, OC., II, p. 170.
13.Voir notamment « Mort d'homme », Retour de flamme, OC., I, p. 64 ; « Le Grand voyage » et « Homme mort », La Vie rêvée, 2. La Vie rêvée, OC., I, p. 266 et 303; « Dur à vivre », Les Biens de ce monde, OC., II, p. 171.
14.Florilège poétique de René Guy Cadou, établi et présenté par Georges Bouquet et Pierre Menanteau, L'Amitié par le Livre, impr. J.- P. Vibert, Grosrouvre, 10 juin 1957, 93 p.
15.Retour de flamme, OC. I, p. 45 et 53.
16.Bruits du cœur, entre autres, en offre plusieurs exemples, avec jusqu'à la reprise de l'ancien ubi sunt.
17.« Et déjà cinq cent mouches/ Un rat/ Dans l'eau de l'herbe/ Autour du ventre/ Comme un sac plein de chats » (« Dans le soleil », Que la lumière soit, OC. I, p. 455).
18.« Déménager » L'Héritage fabuleux, OC., II, p. 122.
19.OC., I, p. 272 et II, p. 42.
20.« Trop loin », Morte saison, OC., I, p. 90.
21.« Les Oiseaux... », Retour de flamme, OC., I, p. 42.
22.« Rien ne subsistera du voyageur/ [...] / Le vent de la déroute aura tout emporté » OC., II, p. 68.
23.OC., II, p. 33.
24.OC., I, p. 133.
25.« Les Chiens qui rêvent dans la nuit », Le Diable et son train, OC., II, p. 65.
26.OC., II, p. 129.
27.« Comme un cri long... », L'Aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 438.
28.« Les Chevaux et les chiens... », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 26.
29.OC., I, p. 236- 241 et 317.
30.« A la lumière des mains », Les Visages de solitude, OC., II, p. 42.
31.La Vie rêvée, 1. Grand Élan, OC., I, p. 195.
32.« Quelque part », L'Héritage fabuleux, OC., II, p. 117.
33.« A perte de sens... », Forges du vent et « Paille et velours », L'Héritage fabuleux, OC., I, p. 37, II, p. 114.
34« Dans la campagne dévorée... », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 384.
35.« Fond de ciel », Bruits du cœur, OC. I, p. 138.
36.Les Biens de ce monde, OC., II, p. 171.
37.« Traduit de l'amour », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 414.
38.« La Maison d'Hélène », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 13.
39.« Toi », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 25 et : « Lettre à Hélène », Ma vie en jeu, OC., I, 380.
40.OC., I, p. 321- 322.
41. OC., II, p. 253.
42.Voir « Devant cet arbre... », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 27.
43.OC., I, p. 459.
44.OC., II, p. 172- 174.
45.« Mon Dieu cela m'arrive... », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, 430.
46. Ibid., OC., I, p. 424.
47.« Rue du sang », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 12.
48.OC.. II, p. 114.
49.L'Héritage fabuleux, OC., II, p. 138.
50 « Ah je ne suis pas métaphysique... », Le Diable et son train, OC., II, p. 96.
51.OC., II, p. 160.
52.« Mémoires », L'Héritage fabuleux, OC., II, p. 137.
53.« La Foi du charbonnier », Tout amour, OC., II, p. 181.
54.« Personne au monde », Les Visages de solitude, OC., II, p. 39.
55.« Après Dieu le déluge », L'Héritage fabuleux, OC., II, p. 138. Voir aussi « Raisons de santé », La Vie rêvée, 1. Grand Flan, OC., I, p. 226,: « Et ceci est mon sang et le froment des larmes ».
56.« Job », La Vie rêvée, 1. Grand Elan, OC., I, p. 190- 191.
57.« L'aventure n'attend pas le destin », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 394.
58.« La Fuite éperdue », Les Visages de solitude, OC., II, p. 41.
59.« Dérive », Retour de flamme, OC., I, p. 61. ,
60.« L'Esprit du feu », La Vie rêvée, 1. Grand Elan, OC., I, p. 204.
61.« La Nuit la mort », Années-lumière, OC., I, p. 72 ; v. « Plain chant », Bruits du cœur, OC., I, p. 116-117.
62.« Le Cœur à flot », La Vie rêvée, 2. La Vie rêvée, OC., I, p. 261 et « La Fausse monnaie », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 415.
63.« A perte de sens... », Forges du vent, OC., I, p. 37.
64.« Les Paroles de l'amour », L'aventure n'attend pas le destin, OC., I, p. 408.
65.« J'ai toujours habité », Les Visages de solitude, OC., II, p. 51.
66.« La Flamme verte », La Vie rêvée, 2. La Vie rêvée, OC., I, p. 309.
67.OC. I, p. 310 et 255-256.
68.« La Visiteuse », La Vie rêvée, OC., I, p. 263-264.
69.« Première traversée » Ibid., OC. I, p. 298-299.
70.OС., I, p. 274.
71.Voir : « Hors de moi » « Le Forçat mutilé » « Mehr licht » « Le Grand Voyage » OC., I, p. 126, 194, 228, 266- 267.
72.« Chambre de la douleur », Hélène ou le Règne végétal, OC., II, p. 11.
73.Michel Manoll, Astrolabe, poèmes, Les Amis de Rochefort, impr. Nicolas à Niort, 8 fév. 1945, 60 p.
74.Luc Decaunes, L'Air natal, Neuchâtel, Ed. de La Baconnière, « Les Cahiers du Rhône », Série rouge, XV (53), Juillet 1944, 126 p.
75.Voir René Guy Cadou, Esthétique de Max Jacob, Pierre Seghers éditeur, 1956, 92 p.
76.« Si mes yeux si mes mains... », Ma vie en jeu, OC., p. 377.
77.« Au pied du mur », La Vie rêvée, OC., I, p. 275.
78.« Les Secrets de l'écriture », Poèmes inédits 1944-1949, OC., II, p. 220.
79.« Écrire mais vivre », Le Diable et son train, OC., II, p. 89 : « Est-ce que je sais seulement que j'écris ? mais je vais/ Au bout de ma vie comme d'une route mal percée Toujours au bout crevant l'opaque pour mieux voir ».
 |
Poésie mémorable, la versification de René Guy Cadou,
par Jacques Charpentreau
Maison de Poésie de Paris. |

(Retour au sommaire archives)
« La poésie sera mémorable ou ne sera pas, attendu que cette formule vaut pour le peuple tout entier et non pour une mince catégorie d'amateurs que satisfait davantage l'alambiqué, l'amphigouri et l'écriture artiste que la résonance profonde du plain-chant. »
René Guy Cadou, Les Liens du sang, Louisfert, 1946-1949.
Dans: Usage interne, Poésie La vie entière, Œuvres poétiques complètes, p. 398
La poésie de René Guy Cadou existe, puisqu'elle est « mémorable » comme il le demandait dans ses notes à Usage interne. Une poésie fille de la mémoire, si riche de vertus qu'elle est confiée dans les écoles au cœur des enfants, qu'elle est étudiée à l'Université, et qu'elle fait l'objet de colloques.
Si l'on s'interroge sur les raisons de cette popularité, il suffit d'ouvrir le premier recueil de René Guy Cadou, Brancardiers de l'aube, publié en 1937, et de lire les deux premiers vers du premier poème :
Ils sont venus au jour prédit par le prophète,
Dans leur gangue de l'enfance (p. 15)
Tout est enclos dans ces deux premiers vers : la présence de l'enfance (que Cadou voulait « préserver », comme il le dit dans ses Notes, p. 426) ; la coexistence de deux vers dont l'un, le premier, est un alexandrin, et même un superbe trimètre romantique, dont l'autre a le charme d'une mesure un peu floue, imprécise, comptant 6 ou 7 syllabes suivant qu'on y fasse ou non l'apocope de gangue ; l'harmonie de l'allitération entre prédit et prophète et de l'assonance entre gangue et enfance ; et enfin la puissance de l'image, qui étincelle comme un diamant dans cette gangue.
Autant de pistes d'analyses pour le lecteur qui cherche « la raison de ce chant qui monte jusqu'à lui » (« L'Aventure de nuit », Les Visages de solitude, 1944-1946, p. 272).
Dans un temps, le nôtre, où tant de poètes sont manifestement sourds, mais, hélas, pas muets, j'ai choisi de privilégier l'une des raisons de la popularité croissante des poèmes de René Guy Cadou, l'une de celles qui rendent sa poésie mémorable : mon hypothèse est que sa versification explique aussi, à côté de ses autres vertus, que sa poésie soit devenue, comme il le disait de celle de Max Jacob, « la poésie tombée en domaine public » (« Encore une lettre à Max », L'Aventure n'attend pas le destin, 1947¬1948, p. 226), puisqu'elle s'inscrit d'elle-même dans les mémoires.
Le filet d’un audacieux
Ce n'est là qu'un aspect de sa poésie, mais René Guy Cadou y attacha assez d'importance pour y revenir à plusieurs reprises dans ses notes. Ainsi écrit-i1 à propos de Jean Cocteau :
« A vrai dire, Cocteau ne craint plus grand-chose aujourd'hui, travaillant ses exercices (car ce ne sont que des exercices) au-dessus d'un filet protecteur, cette prosodie classique qui rassure et qui tente malgré tout les plus audacieux » (Les Liens du sang, p. 401).
Les textes de René Guy Cadou sont de vrais poèmes et jamais « des exercices », mais ils sont bien l'œuvre d'un audacieux que « tente » aussi la « prosodie classique ».
L'éternelle jeunesse d'Alexandre
Si le filet de la prosodie classique laisse passer bien d'autres choses, comment ne pas être frappé, dès l'abord, par la présence considérable du vers français le plus classique, l'alexandrin ? En ne comptant que les poèmes écrits entièrement en alexandrins, on trouve un poème sur cinq composé des seuls vers de 12 syllabes, rimés ou non. Et beaucoup parmi les plus célèbres.
Voici le début de l'un d'entre eux, deux strophes sur six, afin de bien retrouver la respiration du vieil Alexandre :
Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires
Dans les années de sécheresse quand le blé
Ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe
Qui écoute apeurée la grande voix du temps
Je t'attendais et tous les quais toutes les routes
Ont retenti du pas brillant qui s'en allait
Vers toi que je portais déjà sur mes épaules
Comme une douce pluie qui ne sèche jamais
(Quatre poèmes d'amour à Hélène, 1945, p. 279).
Cette présence importante et permanente de l'alexandrin dans l'œuvre de Cadou n'est pas une découverte, vous la connaissiez, mais, tout de même, elle mérite d'être soulignée. C'est évidemment un alexandrin auquel il redonne une nouvelle jeunesse, qui mériterait des observations un peu plus précises. Peut-être a-t-on remarqué que les deux premiers vers de la deuxième strophe sont des trimètres, comme un peu plus loin dans le même poème, ce vers splendide: « Tous mes oiseaux tous mes vaisseaux tous mes pays ».
Ce type de coupe ternaire est fréquent dans les alexandrins de Cadou qui se fait ainsi le successeur des romantiques, mais aussi de Corneille (« Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir ! ») et de Racine (« Et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre »).
Quand Alexandre frappe à la porte
Si un poème de Cadou sur cinq est entièrement tissé d'alexandrins, le dodécasyllabe est en réalité présent un peu partout.
Et d'abord pour commencer un poème qui continuera en vers libres, comme s'il venait tout « naturellement » frapper à la porte (ou « à la vitre », pour reprendre une expression fameuse), comme si sa mesure apparaissait spontanément avec l'inspiration - quitte, ensuite, à la casser, peut-être volontairement pour ne pas s'y soumettre avec la facilité que donne au poète la fréquentation des grandes œuvres du passé:
« Ameute les miroirs, décolore les vitres
Et relève la tête, face au Seigneur.
Un poème est prisonnier dans sa cage d'épines,
Petite larme chaude
Qui chante les ailes
Sans connaître leur nom duveté »
(Forges du vent, 1938, p. 20)
Un alexandrin classique d'abord, la césure soulignée par une virgule, une ponctuation assez rare chez Cadou, puis un vers de 10 syllabes (soit 6 avec apocope + 4), des vers de 13, 6, 5, 9 syllabes. Le vol d'un audacieux, sans doute, voulant, avec le poème en formation, s'échapper du filet de la prosodie classique.
Mais le veut-il vraiment ?
L'inverse permet d'en douter. Car très nombreux sont les poèmes commençant dans la plus audacieuse liberté métrique et s'achevant par un ou plusieurs alexandrins. Voici quelques titres un peu au hasard : « L'âme en peine » (p. 68), « Déclaration d'amour » (p. 193), « Cantique d'automne » (p. 245), « Art poétique » (p. 290), etc. Les uns commencent par des vers très longs, rares dans l’œuvre de Cadou, comme cette « Confession générale » (p. 245), presque des versets d'une vingtaine de syllabes, pour finir par trois alexandrins parfaits ; d'autres commencent par des vers courts qu'un alexandrin vient conclure, un vers dont la forme plus ample n'est pas étrangère au sens même, comme dans le poème « Mauvais départ » (Années-lumière, 1939, p. 38) :
« Je pars
Mais mon cœur a déjà des années de retard »
Dans beaucoup de poèmes, la mesure semble d'abord hésitante, tâtonnante, comme si elle se cherchait, puis l'alexandrin s'impose, souvent avec la complicité d'hémistiches séparés dans la graphie, de rimes intérieures et de quelques apocopes. Ainsi, dans « Le cœur au bond » (id. p. 34) :
« Rien n'a changé
Les fleurs du paravent montent jusqu'au plafond
La serrure secrète retrouve sa chanson
La fenêtre est ouverte
Le regarde courir la Loire jument verte
L'écume des corbeaux qui flotte au bord du toit ».
Ce poème date de 1939. Mais cette montée de l'alexandrin aux lèvres est une constante. Ainsi le poème intitulé « La poésie », publié en 1949, dix ans plus tard, offre-t-il un cheminement semblable : à un alexandrin irrégulier succèdent quatre vers de longues mesures un peu vagues malgré les rimes, comme s'il fallait échapper à l'obsédante présence d'Alexandre, mais viennent alors quinze vers qui lui appartiennent jusqu'à la fin, avec une discrète apocope :
La poésie
« Je te cherche sous les racines de mon cœur
Comme un enfant à l'intelligence retardée qui a peur
D'entrer dans l'eau qui parle seul et fait bouger ses mains
« 0 mon Dieu permettez que cette eau ne me broie pas comme Votre Moulin »
Le m'attarde résolument près des colchiques et des saules
Laissez-moi regarder par-dessus votre épaule
La route qui poudroie et l'herbe qui verdoie
Sans désirer jamais autre chose que cela
Mais Dieu qui n'entend pas l'amour de cette oreille
« Tu descendras au fond de toi et je surveille
Tes allées et venues Tu me dois de trouver
Dans l'eau de mes regards la noisette tombée. »
(Les sept péchés capitaux, 1949, p. 308)
La паissапсе du роèmе
L'alexandrin impose sa mesure et son rythme dans de nombreux poèmes de toutes époques, qui semblaient d'abord vouloir tourner autrement, comme « Saisons du cœur » (p. 41), « Cornet d'adieu » (p. 171), « Hommage à Picasso » (p. 323) notamment. Oui, « impose », comme le sentait fort bien René Guy Cadou.
« Le choix n'est pas une opération qui précède la mise en page du poète. Mais l'esprit pratiquant à son insu une sélection, tout se passe comme si une volonté supérieure avait préalablement choisi ».
(Usage interne, p. 387).
Cette « volonté supérieure », c'est peut-être tout simplement la culture qui a déposé tant de poèmes dans l'esprit, acclimaté les mesures, les rythmes, les accents de notre versification. On en a un exemple avec le célèbre poème consacré à « La Parole ». Il est apparemment composé de vers de sept mesures différentes : 2 syllabes, 3, 6, 8, 9, 10, 12 syllabes. Pourtant, à une exception près, celle du quinzième vers (« Dans l'ascenseur doré de la lampe »), on pourrait dire que ce sont, en réalité, tous des alexandrins, soit parce que la ligne typographique du vers a bien 12 syllabes, soit parce qu'on peut combiner deux vers entre eux (ainsi les deux premiers ont 2 et 10 syllabes ; ainsi les deux vers du début de la deuxième strophe 3 et 9). On pourrait le dire - mais je ne le dis pas. Je dis simplement que l'alexandrin est toujours présent, par en-dessous, qu'il est là comme le fameux filet qui permet toutes les fantaisies à l' audacieux.
Alors il peut, par la disposition typographique du poème, imposer au lecteur une certaine diction mettant en valeur des mots et des silences. C'est à quoi sert le découpage sur la page. Pour emprunter une métaphore à la musique, la main gauche joue une basse exacte et la main droite peut chanter. De là cette impression d'harmonie, de fluidité et de solidité tout à la fois. On peut penser à certaines œuvres de Chopin, avec la souplesse subtile du « rubato », à Haydn, avec le décalage des « trois pour deux » entre la main gauche et la main droite. Rien n'est plus libre que cette poésie exacte ; rien n'est plus strict que ces vers libres :
La parole
« Voleuse
Ô perle noire enrichie d'étincelles
Écuyère des mots
Trapéziste du sang
Lancée sur le circuit vertigineux du temps
Convoi de mon amour
Écharpe lumineuse
Je te perds
Je te prends
Je te mets en veilleuse »
(La Vie rêvée, 1944, p. 153)
On sait qu'il existe au moins trois grilles de lectures possibles d'un poème : celle de la logique du sens, marquée par la ponctuation, une logique abandonnée depuis le début du XXe siècle ; celle de la disposition typographique, qui conduit à privilégier certains mots, certaines tournures, dans la diction ; celle du chant pur, indépendant du sens, débordant la typographie, déterminée par les accents, les rythmes, les rimes. La poésie de Cadou n'est généralement pas ponctuée ; elle entrelace subtilement le sens et le chant.
Que cela plaise ou déplaise, après mille ans de poésie française, l'alexandrin est toujours présent, visible ou non, dans nos poèmes. La langue française ne permettant ni le vers accentué ni le vers mesuré, c'est le décompte des syllabes, marqué ou non par la rime, qui s'est imposé. L'alexandrin, phénomène culturel, semble devenu si « naturel » que Flaubert était obligé de le pourchasser dans sa prose. On a pu affirmer que cette prédominance des 12 syllabes rituelles correspondait au souffle du français. C'est peut-être confondre cause et conséquence.
On peut dire, me semble-t-il, que René Guy Cadou, sans le cacher, a su soumettre l'alexandrin, le dompter, et utiliser sa force poétique comme l'assise d'un chant qui s'échappe de la cage de la stricte prosodie.
Les fils d'Alexandre
Cette présence manifeste ou cachée de l'alexandrin est l'un des éléments qui rendent « mémorable » la poésie de René Guy Cadou, en référence à notre culture poétique qui, d'une façon générale, privilégie le rythme binaire, celui de la marche, celui du cœur - malgré de prestigieuses exceptions.
Si le décasyllabe est assez rare dans l'œuvre de Cadou, on trouve une quarantaine de poèmes écrits uniquement en octosyllabes, quelques-uns parmi les plus célèbres, comme « La beauté » (p. 308), « L'amour » (p. 309), « La blanche école où je vivrai » (p. 355), « L'enfant du garde » (p. 355), « Les amis d'enfance » (p. 357), « Anthologie » (p. 378), « Automne », et plusieurs autres encore.
Automne
Odeur des pluies de mon enfance
Derniers soleils de la saison !
A sept ans comme il faisait bon
Après d'ennuyeuses vacances
Se retrouver dans sa maison !
(Les Amis d'enfance. Édité en 1965, p. 358)
Mais c'est le vers de б syllabes, l'hexasyllabe, qui retient le plus fortement l'attention, surtout quand il est le seul employé dans un poème. Nous y retrouvons, brisé, notre vieux dodécasyllabe. La disposition typographique exige une certaine diction de ce demi-alexandrin, respectant l'imperceptible pause obligatoire à la fin de chaque vers, surtout quand ces vers ne sont pas rimés.
Ce vers de б syllabes est employé pour quelques-uns des poèmes devenus célèbres et « mémorables », comme « Terre natale » (p. 95), « La Vie rêvée » (p. 107), « La Chute des corps » (p. 125), « Oiseaux balles perdues » (p. 244), « Les Chevaux et les chiens » (p. 262), « Qui marche sur la mer » (p. 264), « Le Jardin de Grignon » (p. 353), etc.
Certains de ces poèmes sont rimés, d'autres non. Certains, disposés en quatrains, font rimer deux vers sur quatre, ce qui réintroduirait l'alexandrin si l'on ne respectait pas dans la diction la disposition typographique :
« Sous le rêve encore chaud
La conscience chemine
Et déjà le soleil
Gonfle ses étamines »
(« La fleur de l'âge ». La Vie rêvée, 1944. p. 113)
Si l'on examine l'un des poèmes les plus justement célèbres, « La Fleur rouge », entièrement composé d'hexasyllabes, on constate qu'il n'est apparemment pas rimé et que la scansion suffit à déterminer la coupe des vers :
« À la place du ciel
Je mettrai son visage
Les oiseaux ne seront
Même pas étonnés
Et le jour se levant
Très haut dans ses prunelles
On dira le printemps
Est plus tôt cette année »
(Hélène ou le règne végétal, 1944-1948, p. 253)
En réalité, l'oreille a déjà entendu des rapports de similitude de finales des vers, même un peu éloignés dans la graphie (ciel/prunelle ; étonnés/années ; l’avant-printemps) - soit б rimes ou assonances sur 8 vers. Par la suite, tout se passe comme si les rimes arrivaient d'elles-mêmes, sans être forcément proches dans la typographie, constituant un subtil réseau, ou, reprenons la métaphore, un filet structurant le poème de façon invisible, mais non pas inaudible, un poème qui donne ainsi l'impression qu'on l'entend, qu'on le voit, qu'on le fait librement éclore en le disant. Sur les 48 vers du poème, 5 seulement n'ont pas d'écho à la rime ; les 43 autres sonorités finales se retrouvent au moins 2 fois (pour б d'entre elles), 3 fois (5 d'entre elles), 5 fois pour une, et jusqu'à 11 fois pour l'assonance en é.
Quand l'imprécis au précis se joint
Bien entendu, tout n'est pas si simple, même si l'on peut affirmer que les fils d'Alexandre finissent toujours par préférer les rythmes pairs et les font triompher. Si l'on prend par exemple ce pur chef-d’œuvre « Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? » (p. 301), après un vers de 9 syllabes viennent des décasyllabes, des alexandrins (et deux vers de 14 syllabes, soit б + 8 et 8 + 6), moyennant quelques apocopes évidentes.
Un grand nombre de poèmes utilisent des vers de mesures différentes, introduisant ainsi cette imprécision qui est aussi une caractéristique de cette libre poésie. Toujours l'audace par-dessus le filet.
D'ailleurs, René Guy Cadou lui-même a revendiqué ce déséquilibre en une note des Liens du sang (p. 408) qui devrait me couvrir de confusion dans mes décomptes :
« Croyez-moi, la vraie poésie s'inquiète fort peu du nombre de ses pieds, attendu qu'elle ne se chausse point en confection. Apollinaire et quelques autres, dont Saint-Pol-Roux et Jammes, auraient dû vous l'apprendre. La beauté boite et Louis XIV choisit Mlle de La Vallière parmi une foule de courtisanes pour cette façon qu'elle avait de tirer la jambe comme si l'amour royal eût été boulet à son pied. »
Il a noté également qu'un « Monsieur, poète parisien » qui lui demandait 20 000 francs pour publier son manuscrit, le lui renvoyait en s'étant « cru autorisé à [lui] signaler en marge quelques vers de treize, quatorze, voire quinze pieds parmi les alexandrins » (p. 424).
Nous, nous n'y voyons pas des erreurs, mais nous y entendons le charme de la beauté, qui boite un peu, car elle n'est pas faite de marbre mais de chair. Ses émotions se traduisent par ces frémissements.
D'autres cadences
Il faut bien voir qu'à côté de la postérité triomphante d'Alexandre, il en existe une autre, celle de l'impair, préconisé par Verlaine (qui, à vrai dire, l'a peu utilisé).
On trouve dans la poésie de René Guy Cadou plusieurs poèmes, et non des moindres, composés en heptasyllabes, ce vieux mètre que tous les poètes français ont utilisé un jour ou l'autre - et susceptible d'être populaire, comme l'a prouvé Georges Brassens transformant en chanson « Pensée des morts » de Lamartine.
Chez Cadou, ce sont de grands poèmes, très connus, comme ses deux « Noël » (p. 138 et 288), comme « L'étrange douceur » (p. 261), « Sainte-Reine de Bretagne » (p. 359), ou l'admirable « Liberté couleur des feuilles » :
« Liberté couleur des feuilles
Liberté la belle joue
Jeune fille qui dénoues
Tes cheveux blonds sur le seuil »
(Pleine poitrine, 1946, p. 181)
C'est aussi le vers de 5 syllabes qui donne la mesure d'un autre chef-d’œuvre où Cadou montre la maîtrise la plus difficile de son art : la simplicité.
« Des œufs dans la haie
Fleurit l'aubépin
Voici le retour
Des marchands forains »
(Tout amour. Publié en 1951, p. 348)
Mais le secret de la versification de Cadou n'est pas là. On ne commence à l'entrevoir que dans le subtil enlacement des mesures, des rythmes et des rimes.
Un mètre поп étalonné
À côté de ces certitudes dont j'ai tracé un peu trop régulièrement le quadrillage, absolument nécessaire, celui des mailles du filet, il existe une imprécision, mieux, une indécision du mètre qui bouge, qui apporte une espèce de flou, celui de la vie, qui est tuée par les photos quand elles prétendent la figer.
Un poème ramassé comme « 23 avril 46 » (p. 344), en vers courts, ne peut être ramené à un schéma métrique simple (vers de 3 à 14 syllabes), non plus qu'un poème abondant comme « Nocturne » (p. 345) aux vers longs (jusqu'à 20 syllabes).
La majuscule, toujours sauvegardée dans la graphie au début du vers, indique bien la volonté qu'il en soit ainsi : le vers est l'unité de mesure du poème.
La cohérence du poème est ailleurs que dans la régularité métrique. Elle est dans le thème, dans l'image, et, en ce qui concerne la versification, dans le balancement des mesures.
Elle peut être aussi dans la rime qui impose sa similitude aux distiques de la « Prière du convict » (p. 211) dont les vers vont de 8 à 17 syllabes, ou à ceux d'« Encore l'enfance » (p. 217) qui passe de deux vers de 19 et 17 syllabes à la régularité de l'alexandrin. La rime constitue un autre système que celui de la mesure. Ces deux systèmes peuvent coexister, s'enlacer, se compléter.
À cette indécision du mètre, parfois, dans le poème, peut se joindre une relative imprécision due aux apocopes à faire ou non.
Certaines sont simples et traditionnelles comme celle d'encore, indiquée ou non dans la graphie (et je soupçonne d'ailleurs quelques coquilles dans le recueil à ce sujet). D'autres reprennent de vieilles formules, comme l'apocope du e muet à la césure, celle qu'on appelait jadis « la césure épique », car on la trouve dans les Chansons de geste. Elle semble « naturelle », et on ne s'en aperçoit même pas. Ainsi dans le célèbre poème « Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète » (p. 347), l'apocope du cinquième vers passe inaperçue au milieu des alexandrins : « Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme ». La légère césure et le parallélisme des deux p rendent l'apocope « naturelle ». Ainsi encore, assez fréquente, l'apocope du pluriel : « Des mille chambres où j'ai vécu » (p. 334).
Cette imprécision du mètre vient souvent d'apocopes qui sont usuelles dans le langage parlé. On en trouve de nombreux exemples indiscutables ; d'autres qui font hésiter. Dans « Mourir pour mourir », une suite de dix-huit alexandrins groupés en distiques, on trouve ce vers rebelle à l'alignement :
« Qu'en dites-vous Isidore Ducasse et toi Rimbaud
Dont le nom est un lis de sang sur un couteau »
(Le Diable et son train, 1947-1948, p. 294)
qu'il faut dire :
« Qu'en dit (es)-vous Isidor (e) Ducasse et toi Rimbaud »
Manifestement, l'auteur s'est fié ici à son sens de la langue parlée - et il a eu bien raison.
Par-dessus la balustrade
À cette élasticité (relative) du mètre s'ajoute la grande diversité des rythmes (ou, si l'on préfère, la place des accents).
Si certains poèmes, souvent en distiques, alignent deux vers parallèles dont chacun est une phrase complète, sage et finissant au bout de la ligne, on trouve jusque (surtout) dans les vers les plus réguliers des enjambements, des sauts, des ruptures qui cassent le côté mécanique du vers français syllabique et font passer le métronome par-dessus la balustrade.
Les exemples sont nombreux. Il suffit de citer quelques vers de « La longue haie : 1 km », constitué principalement de six quatrains d'alexandrins :
« Toi dont la jambe traîne un peu comme une brume
D'été et comme si la douleur te tirait
Lentement vers la terre ô compagnon que j'ai
Choisi pour les yeux, enfin voici que s'allume
Toute ma vie et que je vois l'éternité
Mais près d'ici la bonne auberge, la tonnelle
Où volètent les mains fluviales les prénoms
Aimés ; et sur la table ronde qui chancelle
Un verre vide avec des larmes dans le fond. »
(Hélène ou le règne végétal. Publié en 1952. p. 264)
Le quadrillage et l'envol
La versification joue un grand rôle dans la séduction des poèmes de René Guy Cadou, par cette souplesse qui suscite l'envol de la libre imagination, et par cette rigueur, apparente ou cachée, qui en facilite la mémorisation. Le destin du poème est d'inscrire son dessein dans son dessin.
Le dessin du poème
Le dessin du poème sur la page n'est pas indifférent, même si le poème est fait pour être entendu plus que pour être lu, car il exige le respect de la diction voulue par le poète, telle que l'indique la partition, que cette diction soit intérieure ou proférée. Par la disposition du texte sur la page, grâce aux traditions culturelles, on sait à première vue qu'il s'agit d'un poème ; on distingue s'il s'agit d'une prosodie un tant soit peu régulière ou de vers libres. L'œil balise déjà le quadrillage visible qui entraînera un mode de lecture-diction.
Les vers réguliers de René Guy Cadou sont souvent regroupés en strophes allant de deux à six vers. Les plus fréquents sont des distiques, des quatrains, des quintils.
On trouve une trentaine de poèmes disposés en distiques à rimes plates, la plupart d'un seul mètre, quelques-uns devenus très célèbres, comme « La cinquième saison » (p. 149), « Ravensbrück » (p. 181), « Louisfert » (p. 228), « Qui marche sur la mer » (p. 264), « Je voudrais je ne pourrai pas » (p. 281), « Trains de vie » (p. 292), etc. Ainsi « Anthologie » :
« Max Jacob ta rue et ta place
Pour lorgner le voisin d'en face!
Éluard le square ensoleillé
Un bouquet de givre à ses pieds »
(Les Biens de ce monde, 1949-1950, p. 338)
Cette forme semble particulièrement favorable à la mémorisation.
Les quatrains (les plus nombreux sont en alexandrins) présentent les diverses dispositions de rimes (croisées, embrassées, plates) - ou ne sont pas rimés. De même les quintils. On peut signaler, pour la curiosité, de rares monostiches comme :
« Déchire sur mes dents le bâillon du silence ».
La disposition des poèmes écrits en vers libres est plus révélatrice, car deux exigences s'y superposent, celle du sens et celle du rythme.
Le sens de la phrase peut entraîner le découpage des vers et le passage à la ligne, en une espèce d'analyse grammaticale. On le constate dès les premiers poèmes en vers libres : chaque vers a un sens complet, constituant soit une phrase, soit un membre de phrase, déterminé par sa fonction, un complément par exemple, sans émietter le poème outre mesure :
« Nous mettons tout en commun
Sous la lampe
Tout ce que contiennent nos mains notre regard
Un ciel cent fois partagé
Un amour limité à sa forme la plus simple
Il ne faut plus parler de ce que tu dois
Tu es là
Et tu payes de ta présence
Tu peux compter sur moi
Puisque tu es la plus belle. »
(Retour de flamme, novembre 1938-mars 1939, p. 24)
Certains poèmes ont bien sur la page le dessin de vers libres, mais l'analyse des mesures fait réapparaître des structures binaires précises. Un poème comme « Ami les Anges » (p. 98) n'est composé que d'alexandrins (avec quelques apocopes) disposés d'après le sens, alors qu'on peut décompter des vers de 2 à 12 syllabes d'après le découpage linéaire. Mieux que la machine à coudre et le parapluie, on trouve dans cette poésie l'alliance du quadrillage et de l'envol, de la page bien réglée du cahier d'écolier et de l'oiseau-lyre qui passe librement dans le ciel.
La structure d'un poème comme « Les Fusillés de Châteaubriant » (Pleine poitrine, 1946, p. 169) montre la complexité du cheminement du poème par le sens, par les sonorités, par les rythmes, par les mesures. Chaque vers constitue une progression par divers moyens. On passe, par exemple, du premier au deuxième vers grâce à une précision supplémentaire, un ajout du sens :
« Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel »
Il y a une espèce de « logique » de cette progression, qui peut aller d'image en image (« appuyés contre le ciel »/ «un monument d'amour »), qui peut être relancée par des assonances ou des rimes marquant la fin de certains vers (village/table ; mourir/martyre ; les autres/apôtres), une progression qui repose ainsi sur tout un réseau non-systématique d'une grande souplesse (et c'est pourquoi nous avons vraiment à faire à des « vers libres »).
Mais bientôt le sens est relayé par le rythme, comme si peu à peu le poème prenait une forme régulière, à partir de « Et leur seul regret est que ceux/Qui vont les tuer n'entendent pas », comme si, une fois encore, le poème venait d'éclore grâce à notre voix de lecteur, pour s'envoler librement en faisant triompher la forme sur l'informe, la structure sur le chaos, comme si triomphait enfin le chant qui se cherchait.
On constate que le découpage des vers n'est donc jamais « arbitraire » mais répond à des exigences très diverses, ou, pour le dire de façon banale, que le poète utilise des moyens variés au service de l'émotion.
Nous sommes loin des découpages arbitraires de certains recueils à la mode, plus proches de la charcuterie par leur saucissonnage des vers - que de la poésie.
Les détails du dessin
Une étude plus précise de la versification de René Guy Cadou pourrait montrer comment les détails de ce dessin concourent au dessein global de chaque poème. Faute de temps, je me contenterai de quelques esquisses, en me gardant bien de trop charcuter à mon tour cette poésie, ce que n'aurait pas aimé Cadou qui préférait la plaisanterie à la pédanterie :
« La sémantique ? ne connais pas !
Je me ris de l'anacoluthe
Dites-moi quels sont ces gravats
Qui dégringolent sur mon luth ! »
(« Le portrait fidèle », Les Biens de ce monde, 1949-1950, p. 340)
Commençons par l'esclave, tout juste bonne à obéir, la rime. Et abandonnons-la tout de suite, en disant qu'elle ne pose pas de problèmes à Cadou, qui l'utilise ou non suivant son bon plaisir, sa fantaisie, son inspiration - ou son apparition impérative. Riches ou banales, ses rimes ne se discutent pas. Tout de même, j'aime bien l'audace qui fait rimer « les steamers » et « une main qui meurt » (p. 57), ou encore, dans « L'envers du décor », l'un de mes poèmes favoris, ces deux premiers vers:
« Derrière le paravent du ciel n'est-ce
Pas qu'il y a des anges en caisse »
(Le Diable et son train, 1947-1948, p. 299)
Et je ne résiste pas, dans « Les paroles de l'amour », à cette rime :
« Je m'entoure de toi comme un enfant frileux
Je pars je suis en route depuis des siècles je
T’arrive un matin beau comme un matin de chasse »
(L’Aventure n’attend pas le destin, 1947-1948, p.216)
Voilà une désinvolture et une habileté qui placent René Guy Cadou, d'une certaine façon, dans la lignée des Fantaisistes. On pourrait aussi évoquer les acrobaties d'Aragon. Je préfère y reconnaître un petit côté Arsène Lupin et Rouletabille qui ne me déplaît pas ; ils furent aussi ses maîtres, comme il l'a lui-même revendiqué (p. 392).
La rime-esclave, donc, réduite à l'obéissance, et le plus souvent à l'assonance, dans le deuxième sens du terme, celui qui nous vient du Moyen Age, c'est-à-dire l'identité de la voyelle accentuée, quelles que soient les consonnes d'appui ou autres. On n'en finirait pas de dénombrer les assonances finales du type ballastes/astres (p. 130), battre/délicate (p. 309), herbe/ferme (p. 231), tournesol/ Van Gogh (p. 290), etc.
Mais ces assonances ne se cantonnent pas à la fin des vers. Si l'on examine, par exemple, « Destin du poète », composé de vingt octosyllabes, on voit apparaître tout un réseau de correspondances : les vers 1, 3, 7 riment entre eux (oreille/abeille/veille). De veille (vers 7), on passe par assonance à pierre (vers 9) ; de là, on passe par « rime » à réverbères (vers 11), etc. Un autre dessin se révèle ensuite. Le mot roule, au vers 15, n'a pas de rime. Mais du vers 13 au vers 16, la mélodie est soutenue par les assonances en ou :
« Le trou d'aiguille par où passe
Le fil ténu de la clarté
La bobine du temps qui roule
Sous les lauriers sous les sommiers
Le poème prend alors appui sur des allitérations en s :
Sous les lauriers sous les sommiers
Mais se savoir parmi les hommes »
(L'Aventure n'attend pas le destin, 1947-1948, p. 203)
On imagine la richesse des réseaux que pourraient ainsi dessiner de minutieuses analyses.
Pour rester dans la lignée des Fantaisistes, on peut ajouter de délicates contre-assonances : l'âge/l'horloge (p. 207) ; calèches/affiche/fraîche (p. 263) ; conciliabules/parabiles (p. 267) ; tombent/nimbent (p. 288) ; campagne/châtaignes (p. 300) ; etc.
Le passe sur les césures, les hiatus, les diérèses, sur l'absence presque générale de ponctuation qui marque bien une volonté d'imposer une diction plus musicale que logique.
Je vais m'arrêter et conclure pour respecter deux impératifs : celui du temps qui m'est accordé et le rappel à l'ordre de René Guy Cadou lui-même, qui l'a noté expressément : « Le poète n'est créateur de beauté que dans la mesure où l'objet créé se passe de commentaire » (Usage interne, p. 390).
Corpus mémorable
Avec un peu plus de cinq cents poèmes, René Guy Cadou nous a laissé une œuvre très riche qui est non seulement étudiée, mais aimée, apprise, récitée, pour reprendre un terme que nous n'avons pas à refuser, répondant par là au vœu de l'auteur : « Je ne demande pas à être jugé : je demande à être lu » (p. 411).
L'étude rapide que je viens de mener, trop superficielle à mon goût, de sa versification, met en lumière un certain nombre de constantes que j'ai symbolisées, à l'instigation même de l'auteur, par l'alliance de la liberté audacieuse et du filet de la prosodie classique, laissant à d'autres le soin de mettre en lumière d'autres richesses de cette poésie, qu'il s'agisse des thèmes ou des images.
Bien entendu, toute analyse est toujours plus ou moins une dissection. Elle risque de tuer le poème sous prétexte de mieux le connaître. Toute analyse est toujours illusoire, car elle prétend enseigner au poète ce qu'il a voulu dire, comme s'il avait tout concerté, tout machiné, tout fabriqué. Mais non ! René Guy Cadou lui-même nous a prévenus : « La mémorabilité est une grâce, elle ne peut être préméditée » (p. 399).
Pour moi, la vertu principale de cette versification, à la fois structurée et très libre, c'est de nous permettre d'entendre une voix prenante, celle d'une Personne toujours présente. On peut évoquer le ton de ses poèmes, son style, son vocabulaire, ses images, etc. C'est d'abord une présence très forte, qui rend le poète toujours proche de son lecteur.
J'entends dans ses poèmes à la fois le chant fondamental qui est celui de la poésie française depuis toujours, et une voix originale qu'on ne peut confondre. Elle dit avec une savante simplicité l'émotion venue du cœur, allant au cœur ; c'est pour cela que sa poésie est si aisément mémorisable, redonnant toute sa noblesse à la vieille expression : c'est une poésie à savoir par cœur.
* Toutes les références renvoient à Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes, préface de Michel Manoll., Édition en un volume, Seghers, 1977.
 |
Un exemple de l'influence de Reverdy sur les premières œuvres de René Guy Cadou,
Par Jacques Lardoux,
Professeur à l’université d’Angers. |

(Retour au sommaire archives)
Hélène Cadou a dit à plusieurs reprises à quel point René, son mari, a pu être influencé dans la première partie de son œuvre par Pierre Reverdy 1. Cadou ne déclara-t-il pas : « Je crois que je devrai toujours quelque chose à Reverdy. Reverdy est le seul homme au monde qui m'émeuve. » La rigueur, l'exigence extrême, le caractère immédiat, abrupt de l'écriture poétique de l'auteur de Main d'œuvre ont guidé le jeune poète dans sa propre création. Si les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, ils ont correspondu et exprimé leur admiration réciproque. Dans un récent ouvrage collectif, Pierre Reverdy et l'Éсоlе de Rochefоrt 2, nous avons essayé de montrer le détail de leur relation et vu comment l'aîné, pourtant peu enclin à admirer un tempérament aussi différent du sien (mais l'était-il vraiment ?), avait néanmoins reconnu chez son cadet un vrai poète.
À partir d'un exemple emprunté aux Brancardiers de l'aube, premier ensemble poétique de Cadou publié en 1937 3, nous voudrions essayer de retrouver comment certaines dispositions d'écriture ont pu avoir quelque chose de commun à l'un et à l'autre.
Publication
Brancardiers de l'aube constitua la cinquième publication des Feuillets de l'Îlot, tirage mensuel de quelques pages « qui avait fait le choix d'exalter les valeurs de la vie et des relations humaines en s'opposant aux abstractions ». Jean Digot, depuis Rodez, en assurait la direction, et il publia Cadou sur la recommandation de René Lacôte (« Cadou m'a envoyé une douzaine de poèmes et ils sont excellents »). Cadou écrira plus tard avec ironie : « Lacôte sympathisait avec mes Brancardiers de l'aube qu'il dirigea sur l'îlot de Rodez (Gouverneur Bigot).» Jean-Daniel Maublanc, animateur de revues dès 1927, et qui avait fait connaître Cadou à ses amis, rédigea une préface 4 dont voici un extrait : « Les poèmes que "L'Îlot" présente aujourd'hui sont écrits par un jeune homme de dix-sept ans, perdu dans une lointaine province, mais bien planté dans la vie, qui ne fait pas la fine bouche devant la réalité, ni le bec pointu devant le rêve. Il montre que ses dents de lait sont de rudes canines et que l'atlas de ses sens n'est pas de papier de soies. »
Michel Manoll avait lui aussi composé une introduction pour cet ouvrage, mais elle fut écartée par Cadou au bénéfice de celle de Maublanc, sans doute pour remercier celui-ci d'avoir facilité la publication. Manoll écrira plus tard : « Il y avait dans Brancardiers de l'aube, comme dans Forges du vent (1938) et Années-Lumière (1940), "un jaillissement de puits artésien". On y pressent cette attirance pour une poésie enfin ouverte, libérée des mots d'ordre et vivant de ses seules substances » 6. L'une et l'autre préfaces étaient élogieuses mais tout autant imprécises quant aux référents, pour la bonne raison justement que l'intérêt majeur de ce type de poésie résidait dans cette liberté inaccoutumée visant à éluder toute forme de « métadiscours » comme disent les linguistes. Reverdy pratiquait depuis toujours cette manière de faire : pas de nom de lieu, pas de date, pas de nom de personnages, pas d'intrigue, mais une série de notations et d'actions visant à restituer une ambiance, un paysage, une émotion ; dans Le Livre de mon bord, Reverdy écrivait : « Un poète ne vit guère que de sensations, aspire aux idées et, en fin de compte, n'exprime que des sentiments. » 7
Le nom de Pierre Reverdy ne figurait pas parmi ceux des poètes et amis retenus pour le service de presse des Brancardiers de l'aube ; de fait, Cadou et Reverdy ne sont entrés en relation que plus tard.
Le titre
D'où vient le titre Brancardiers de l'aube? Les brancardiers sont souvent des infirmiers préposés au service des brancards pour les blеssés, spécialement en temps de guerre. Selon Christian Moncelet, le titre Brancardiers de l'aube rappelle un peu les « aubes navrantes » de Rimbaud, « mais on ne sait s'il faut comprendre que l'aube est portée pantelante par des brancardiers, ou s'il s'agit simplement de brancardiers qui officieraient au point du jour.» 8 Comme Hélène Cadou a eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler, il était fréquent que René débute la composition d'un poème à partir d'une chose vue. « Les "brancardiers de l'aube", ce sont ceux de l'Hôtel-Dieu (de Nantes) dont l'adolescent observe le ballet tragique depuis le quai Hoche de l'autre côté du fleuve », écrit Jean Rouaud 9. Doit-on considérer également la possible influence des souvenirs de la première guerre que le père de René lui racontait et tels qu'il les consigna dans Mon enfance est à tout le monde 10? Par ailleurs, le titre Brancardiers de l'aube et la date de publication, 1937, peuvent faire penser à la guerre civile espagnole et même évoquer certains passages du roman d'André Malraux L'Espoir — on se souvient en particulier de cette scène emblématique au cours de laquelle des colonnes de blessés descendent de la montagne 11
En 1939, deux ans après la publication des Brancardiers de l'aube, Cadou envoya un poème sur la guerre d'Espagne au Populaire de Nantes, journal socialiste, et il écrivit au directeur du journal: « Je suis profondément ému par l'exode de nos camarades de Barcelone. Je ne puis que leur offrir mon cœur. Le poème ci-joint en est le témoignage.» Ce poème, intitulé « Épisode», 12faisait nommément référence à la guerre d'Espagne (on remarque au passage qu'« Épisode » compte treize vers, une structure proche de celle du premier texte des Brancardiers de l'aube). Pierre Reverdy, né à Narbonne, ami de Picasso et Juan Gris, fut lui-même très sensible à la tragédie de la jeune république espagnole victime d'un coup d'État mené par le général Franco, mais il est difficile d'en trouver une trace précise dans son œuvre tant il intériorisait les événements. Selon Christian Moncelet: « Épisode » est sans doute « le premier poème lié ostensiblement à un événement politique que l'on puisse lire sous la plume de Cadou qui ne prend pas parti mais se place d'un point de vue humain » 13.
La seule allusion à la « guerre civile » dans Brancardiers de l'aube était la suivante :
« Jе t'offrirai un beau gâteau de ciel
Ô mariée d'équinoxe !
Et vous conterai à tous
Des guerres civiles d'étoiles. » 14
Cette citation est extraite du onzième et avant-dernier poème de l'ouvrage, mais on n'y lit rien de circonstancié, ni là ni ailleurs.
L'influence de Reverdy
Ce premier poème des Brancardiers de l'aube est le plus long de la série des petits textes en vers qui composent le recueil 15. Outre le thème majeur énonçant certains épisodes probables d'une lutte armée, ce poème semble dès le premier vers habité par une sorte d'annonciation religieuse, mais transposée dans un univers profane. Reverdy lui-même avait habitué ses lecteurs à ces va-et-vient, et l'on se souvient que c'est en partie à la suite de sa conversion au catholicisme qu'il avait décidé de venir s'isoler avec son épouse dans le village de Solesmes, tout près de l'abbaye du même nom. Cette référence religieuse n'étonne pas non plus venant de Cadou, poète de l'Ouest dont la petite enfance s'est déroulée dans le village de Sainte-Reine-de-Bretagne en Loire-Atlantique, tout près d'un sanctuaire.
Le motif de l'enfance demeura certainement encore plus fondateur dans l'œuvre de Cadou 16 que dans celle de Reverdy. Hélène Cadou disait : « Pour René, l'enfance fut moins une étape, un état, moins un point de départ qu'une manière d'être au monde. »17 Hélène fit aussi remarquer que si le premier vers du premier poème commençait par parler des prophètes, on retrouvera ces mêmes prophètes tout à la fin de l'œuvre.
Dans ce premier poème, l'attention du lecteur est retenue par plusieurs images insolites. On sait que Reverdy, pour sa part, avait préconisé et pratiqué en poésie l'usage d'images d'autant plus intéressantes, disait-il en substance, qu'elles traduisent des réalités les plus éloignées les unes des autres. Cette façon de procéder, qui lui assura le succès auprès des surréalistes, facilitait l'expression de sentiments et de sensations indéfinissables entre le rêve et le réel, ce qu'il appelait « le lyrisme de la réalité ».18 Comme Reverdy le dira encore dans En vrac (1956) : « Le poète doit susciter ce qui est à comprendre. Il n'a pas à ramasser la traîne de ce que tout le monde a compris avant lui. » Cadou eut pour sa part cette formule qu'il consigna dans Usage interne: « Il ne faut pas confondre les œuvres hermétiques (Mallarmé) et les œuvres fermées (Reverdy). Les premières ne nous donnent pas la possibilité d'y entrer, les secondes d'en sortir ».19 Cadou ne recherchait certainement pas l'hermétisme.
D'autres ressemblances entre l'art de Reverdy et celui de Cadou s'affirment a priori. Tout d'abord la brièveté du propos : 14 vers, comme on l'a dit, en ce qui concerne ce premier poème, ce qui correspond à un sonnet quoique dans le cas présent il n'y ait ni strophe, ni rime, et seulement quelques vers réguliers, les vers 1, 3, 5 et ii composés de 12 syllabes. Ensuite se remarque, chez les deux poètes, une composition apparemment simple dans la juxtaposition d'éléments (nous comparons uniquement les poèmes courts). Enfin, si l'on arrête là cette première approche comparative, Reverdy comme Cadou avaient un goût très prononcé l'un et l'autre pour une énonciation énumérative — un peu comme si le monde une fois pour toutes correspondait à une sorte de paysage à inventorier, conception qui semble assez proche de la « phénoménologie » selon laquelle il faut poser le savoir comme près des choses elles-mêmes et se concentrer sur celles-ci. Le monde à l'entour reste cohérent mais second par rapport à l'élan de poésie.
Yves Cosson rappelait l'influence profonde de Max Jacob, dans sa préface du Cornet à dés, lorsque celui-ci écrivait qu'un poème doit être situé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un décalage avec le réel tout en restant dans le réel 20. Dans le poème de Cadou, l'évolution de l'action paraît pour une large part guider le propos et une certaine précision se manifeste ne serait-ce que dans le fait que les marqueurs temporels délimitent une période de trois jours tandis que les marqueurs spatiaux évoquent un paysage rural, une route, un pont, les étoiles, etc.
Lecture suivie et commentaire
Dans cette poésie immédiate (revoir l'article de Jean Bouhier, « René Guy Cadou, un poète de l’immédiat » 21), l'important demeure donc ce qui est ressenti, l'émotion en elle-même et non le contexte historique.
Avec les deux premiers vers : « Ils sont venus au jour prédit par le prophète, / Dans leur gangue de l'enfance », l'une des questions serait de savoir qui se trouve désigné par le pronom personnel pluriel « ils ». Selon notre hypothèse, ce « ils » de départ pourrait bien faire état de combattants de la liberté qui ont une mission de sabotage — on le verra — à exécuter. Mais alors une seconde question se pose immédiatement : en quoi vont-ils accomplir le message du prophète ? Si l'on admet que ces hommes sont peut-être des républicains de la guerre d'Espagne, il est intéressant de remarquer que le locuteur les investit d'emblée d'une mission placée sous le signe du sacré alors qu'en principe les nationalistes franquistes prétendaient être les seuls du parti de Dieu. Mais ne limitons pas ce poème à un contexte précis, car nous aurions certainement tort de le faire.
De son côté, Jacques Charpentreau proposa ce commentaire : «Tout est enclos dans ces deux premiers vers : la présence de l'enfance que Cadou voulait "préserver" comme il le dit dans ses notes ; la coexistence de deux vers dont l'un, le premier, est un alexandrin, et même un superbe trimètre romantique, dont l'autre a le charme d'une mesure un peu floue, imprécise, comptant б ou 7 syllabes suivant qu'on y fasse ou non l'apocope de gangue; l'harmonie de l'allitération entre prédit et prophète et de l'assonance entre gangue et enfance; et enfin la puissance de l'image qui étincelle comme un diamant dans cette gangue »22.
Dans la seconde partie du poème, du vers 3 au vers ii, vont se dérouler une série d'actions secrètes et violentes destinées, comme il est dit, à briser « les complots »:
« Les soleils matinaux dévissaient les serrures;
Personne ne les avait vus passer.
Aussitôt qu'un homme rebondissait sur la route,
Tout un buisson se mettait en marche
Pour cacher leur départ.
À chaque pont s'allumait un feu derrière les mains.
Le second soir,
Une averse d'étoiles s'abattit sur les tentes:
On brisa les complots.»
« Les soleils matinaux dévissaient les serrures »: est-ce à dire que chaque matin des portes de maison s'ouvraient et que des hommes partaient secrètement en mission ? Mais pourquoi cet emploi du verbe « dévissaient » ? Doit-il être pris à la lettre ? Peut-être que la mission de ces combattants était d'abord de s'introduire subrepticement dans des locaux (afin par exemple d'y trouver des explosifs), puis de faire sauter des ponts ? L'énigme persiste, à tel point qu'un critique a pu dire que les images de ce poème, en considérant également leur caractère inouï et merveilleux, semblaient à la limite d'une épiphanie. Cadou en 1946 écrivit, et la remarque valait pour lui-même : « Porté par un œil suffisamment vigilant, Reverdy se trouve posté à l'orée du miracle. C'est de là qu'il confronte les scènes plus ou moins rassurantes qui l'entourent à l'idée qu'il se fait lui-même de ce spectacle. L'émotion du poète ne vient pas de ce qu'il voit mais de ce qu'il endure »23.
Comme le notait Christian Moncelet: « Les mentions d'un temps matinal sont aussi nombreuses dans les poèmes que celles d'un drame imprécis, d'un tragique décelable [ ... ], des images de guerre, mais seul, pour reprendre l'expression rimbaldienne, le poète a la clé de cette parade »24. D'ailleurs Reverdy lui-même ne se réclamait-il pas de Rimbaud : « J'aurais voulu être dans la fulgurance comme Rimbaud ou Lautréamont. Je suis un raté » ?
Dès le vers 5, l'action s'accélérait : « Aussitôt qu'un homme rebondissait sur la route, / Tout un buisson se mettait en marche / Pour cacher leur départ » (vers 5, 6, 7). Cette dernière proposition n'est pas sans faire écho à la forêt qui marche dans Macbeth de Shakespeare; notons que le verbe « se mettre en marche» annonce aussi les termes (« départ» et «partir») qui vont suivre.
À partir du vers 7, d'autres actions se voient prises en compte d'une manière systématique : « À chaque pont s'allumait un feu derrière les mains. » Les vers suivants tendent au fantastique : « Le second soir, / Une averse d'étoiles s'abattit sur les tentes. » Sont-ce de vraies étoiles ? Mais des étoiles ne « s'abattent » pas, à moins qu'il ne s'agisse d'étoiles filantes. Cela correspond-il à une métaphore désignant par exemple des fusées liées à une action de combat du type même de celles qui faisaient dire à Apollinaire dans Calligrammes: « Que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit / Elles montent sur la cime et se penchent pour regarder »25. ? Rappelons que Cadou, dans Mon enfance est à tout le monde, écrivait : « Mon père insistait surtout sur le côté "joli" de la guerre au sens où Guillaume Apollinaire disait : "Ah ! Dieu que la guerre est jolie", pour mieux me laisser deviner aussi les souffrances et les horreurs cachées »26.
Le vers 11 introduit une chute décisive ; le substantif « complot » désigne le plus souvent une conspiration contre une institution, conspiration qui, en l'occurrence, grâce aux actions de sabotage, pourrait avoir été déjouée. Est-il question de tous les complots en général qui nuisent à la légitimité, ou du putsch des franquistes contre la jeune république espagnole en particulier ?
De toute manière, nous parvenons à la troisième et dernière partie du poème :
« Au lendemain, quand l'aube secoua ses poches,
Les visages avaient perdu leurs lanières
Et il fallut pаrtir »27.
Si le vers 12 semble particulièrement énigmatique, un lecteur attentif de Reverdy pourrait penser à un vers de « La coupe sombre » extrait de Ferraille (1937) : « Quand je compte mes jours le soir au fond des poches.» Les poches tiennent-elles lieu de synecdoque d'une humanité simple, laborieuse, courageuse ? En ce qui concerne l'expression « perdre ses lanières » du vers 13, employée pour un visage, elle est à son tour difficile à interpréter même si elle apparaît concrète et non dénuée de force — dans ce cas, un autre rapprochement s'avérerait possible avec une phrase de Malraux: « Les fumées verticales des torches s'abattent comme des lanières de fouet », phrase par ailleurs relativement comparable au vers 10 de Cadou: « Une averse d'étoiles s'abattit sur les tentes.» Bref, et cela est fondamental, on perçoit que la lecture de ce type de poésie ne se fonde pas tant par rapport à des référents concrets que selon des correspondances avec d'autres textes, et que l'ensemble définit bientôt un nouveau style.
Le dernier vers du poème formule une action qui semblait devenue inéluctable. Faut-il comprendre que, leur mission étant accomplie, les hommes doivent rapidement quitter les lieux ? Souvent, dans les poèmes de Reverdy de cette époque, les dénouements constituaient aussi la poursuite d'une action, la voie d'un départ. Le motif du « partir », fondamental chez Mallarmé, Rimbaud, Cendrars, se retrouvait dans de nombreux poèmes reverdyens tels « Buveur d'horizon » ou « La Coupe sombre » (extraits de Ferraille, 1937). Cadou lui-même n'avait-il pas écrit dans Mon enfance est à tout le monde: « J'ai toujours eu envie de partir. Je rêve de canaux et d'écluses, de larges halages pleins de promesses » 28? Signalons que la racine latine du verbe « partir» est partire, «partager », « multiplier », comme si, d'une certaine façon, après ce poème inaugural, l'ouvre de Cadou allait pouvoir elle-même démarrer, essaimer, se multiplier. À tel point qu'une lecture symbolique pourrait apparaître rétrospectivement: il appartiendrait (aux poètes, aux jeunes générations, aux hommes d'action généreux?), illuminés qu'ils sont par le sacré et la beauté de la nature, de faire sauter les ponts de la tradition pour pouvoir prendre leur envol...
En guise de conclusion, nous voudrions, sans faire d'autres commentaires et à la suite de Cadou lui-même dans Le Miroir d'Orphée, citer le poème de jeunesse de Reverdy intitulé précisément «Départ» :
« L’horizon s'incline
Les jours sont plus longs
Voyage
Un cœur saute dans une cage
Un oiseau chante
Il va mourir
Une autre porte va s'ouvrir
Au fond du couloir
Où s'allume
Une étoile
Une femme brune
La lanterne du train qui part »29.
Ainsi aurons-nous constaté que décidément lа manière de René Guy Cadou n'était pas sans ressemblance avec celle de Reverdy. Pas de doute que Pierre Reverdy, comme le rappelait encore Hélène Cadou dans l'entretien avec Luc Vidal, ait influencé une bonne part de la poésie française du XXème siècle en général ; il nous faudrait citer au moins René Char, Guillevic, Yves Bonnefoy, Du Bouchet et notre contemporain le poète angevin Antoine Emaz.
Notes :
1.Hélène Cadou, interview du 5 Juin 1984 par Luc Vidal à Orléans, in CD La Cinquième Saison, Môrice Bénin chante René Guy Cadou, Éd. Le Petit Véhicule, Nantes.2. Pierre Reverdy et l'École de Rochefort, ouvrage collectif sous la direction de Jacques Lardoux, voir « L'autre ou le même » (Cadou et Reverdy), Presses universitaires d'Angers, 2007, p. 33-45.3. René Guy Cadou, Brancardiers de l'aube, préface de Jean-Daniel Maublanc, Les Feuillets de l'Îlot, 1937. Nous utilisons pour notre part l'édition de 2001: René Guy Cadou, Brancardiers de l'aube, in Poésie la vie entière, Seghers / Laffont.4.Pour ces renseignements, voir l'article de Michel Décaudin, «Jean Digot et les Feuillets de l'Îlot », in L'Éсоlе de Rochefort, Presses universitaires d'Angers, 1984, p. 24-31.5.Ibid.6.Michel Manoll, René Guy Cadou, Seghers, coll. « Poètes d'aujourd'hui »,1954, p. 45.7.Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord (1930-1936), Mercure de France, 1948. Selon Raymond Queneau aussi, la caractéristique essentielle de la poésie serait de proposer peu d'informations mais beaucoup de communication, d'émotions, in Entretiens avec Georges Charbonnier,
9.Jean Rouaud, pour le film de la série télévisée « Un siècle d'écrivains » consacré à René Guу Cadou, réalisation Jean-Pierre Prévost, 1999.
10. René Guy Cadou, Mon enfance est à tout le monde, J. Munier, 1969 et Éd. du Rocher,1985.
11. La Sierra de Teruel, le film d'André Malraux réalisé d'après son roman L'Espoir, qui devait sortir en 1939, ne fut diffusé qu'après la guerre, en 1945, sous le titre L'Espoir.
12.R.G. Cadou, « Épisode »:« Je ne sais rien de plus que vous / J'arrive de la ville le cœur barbouillé / Je parle seul et vite / Je suis pressé de tout me dire / Comme si j'allais perdre la mémoire / Il est midi / et je me fais des signes / Car la lumière est transformée / D'un moment à l'autre / Les visages vont s'éclairer / —Quand il sera trop tard. / Des femmes et des enfants quittent Barcelone / à pied », in « Retour de flamme », Poésie la vie entière, op. cit. note 3, p. 29.
13. Ch. Moncelet, op. cit. note 8, p. 123-140.
14. R. G. Cadou, Brancardiers de l'aube, Poésie la vie entière, op. cit. note 3, p. 78.
15. Sur les douze poèmes qui composent Brancardiers de l'aube, un seul est en prose, le dernier, et lui aussi est très bref.
16. Voir l'article de Serge Brindeau, « Enfance et métaphysique à l'École de Rochefort », dans lequel il est beaucoup question de Cadou, in L'École de Rochefort, op. cit. note 4, p. 50-58.
17.Un oiseau dans la tête, choix de poèmes de René Guy Cadou, Seghers,1973, Éd. Ouvrières, 1987, introduction d'Hélène Cadou, p. 7.
18. Pierre Reverdy, « Prière d'insérer », dans Gant de crin (1927).
19. R. G. Cadou, Usage interne, in Poésie la vie entière, op. cit. note 3, р387-
20. Yves Cosson dans le film de la série « Un siècle d'écrivains ».
21.Jean Bouhier, « René Guy Cadou, un poète de l'immédiat », Unir du 7au 13mai 1945.
22. Jacques Charpentreau, « Poésie mémorable. La versification de René Guy Cadou », Colloque de l'université de Nantes, textes réunis par D. Briolet, R. Miannay et C. Robin, René Guy Cadou, Un poète dans le siècle, Joca Seria, 1999, p. 41.
23. René Guy Cadou, « Pierre Reverdy », in Le Miroir

Montage R.Duguet, Cadou et la Brière... |
L’Univers végéral de René Guy Cadou,
par Alain Germain. |

(Retour au sommaire archives)
Il est des « chemins creux » 1 où personne ne passe, chemins désaffectés et « menant nulle part ». Il en est d'autres aussi, bien fournis d'herbe vive, chemins secrets du cœur et de la poésie, qui guident une vie, suscitent les rencontres, allument les fenêtres et les grands feux du soir. J'eus le bonheur de découvrir l'un d'eux, il y a bien longtemps maintenant, et d'investir « la mansarde bleue » 3 d'un poète de la Loire dont j'écoute encore aujourd'hui le « bruissement d'eau claire sur les cailloux » 4. René Guy Cadou : une eau vive trop vite emportée dans « la crue noire du temps », en prise directe sur le sentiment et sur le monde et dont le cœur bat désormais « dans la délicate horlogerie de la terre ».
Mais peu à peu, avec le temps, ou plutôt sous l'éclairage d'un temps nouveau, le visage du poète « enfoui (alors) dans les feuilles » 6 réapparaît à ma grande joie et pour tous en pleine lumière, dans la transparence du végétal qu'il s'était approprié.
Dans les années quarante du siècle dernier, le monde de la poésie, encore agité par les deux courants majeurs qui l'ont porté du paysage romantique à celui, quasi lunaire, du surréalisme, voyait arriver, avec ces « poètes de la Loire » comme se plaisait à les appeler Marcel Вéаlu, une nouvelle vague, celle du surromantisme. Il faudra encore du temps pour entrer dans ce nouvel univers, attachant bien sûr, mais parfois encore déroutant.
En ce qui concerne René Guy Cadou, l'adhésion du cœur, malgré souvent sa fulgurance, demeura pour beaucoup difficilement traduisible. En effet, dans sa poésie, les mots perdent leur sens premier et se font médiateurs entre leur acception végétale et ce sens affectif que le poète leur accorde de par le vécu de sa « première enfance ? ». Ainsi naît un nouveau lexique pour un langage neuf, comme autant de clés offertes aux seuls initiés et ouvrant sur des territoires encore inconnus. C'est là tout le paradoxe d'un poète à la fois si proche et si complexe. Il s'avance dans un paysage peuplé de mystères et constellé d'autres mystères éclairants ceux-ci, « apprivoisables », en quelque sorte. Sa forêt de métaphores « souriantes » est le signe de cette liberté dont il parle, métaphores qui naissent au cœur du poème, se développent et s'ordonnent à leur guise, mais avec rigueur, comme les branches autour d'un fût. C'est à l'originalité profonde de René Guy Cadou. Mais « on peut être original sans être étrange » 9, dit le poète à ceux qui le comprennent si bien ! Encore faut-il, si l'on souhaite avancer plus avant et pouvoir décrypter son langage, remonter jusqu'à la source même de sa poésie finement tissée dans un réseau de fibres végétales.
Toutefois ce n'est pas seulement un beau livre d'images qu'il nous offre. Leur remarquable cohérence nous aide à apprécier la richesse et la profondeur de sa pensée qui nous attache autant affectivement qu'intellectuellement à son œuvre. Il ne faut donc pas voir dans cette démarche une quelconque élégance stylistique mais au contraire une évidence profonde jaillie des plus authentiques sensations si souvent déchirées aux ronces de l'esprit. « En poésie dynamique, dit Gaston Bachelard, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, elles sont ce qu'elles deviennent. » À quoi Cadou répond comme un écho : « Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublime l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âmе » 10. Alors, dans l'univers caducéen, l'homme devient arbre et l'arbre prend une « dimension humaine » 11. Ensemble ils gagneront le ciel, glorifiant ainsi un règne intermédiaire où la femme occupera une place privilégiée. Le dynamisme de la poésie de Cadou lui donne un élan cosmique qui se débarrasse, au cours de son ascension, de son enveloppe temporelle. Elle circule alors « entre avenir et souvenir » 12, sous l'impulsion d'une constante, celle de l'enfance, sans cesse appelée, sans cesse renouvelée. L'univers végétal lui ouvre le chemin de son éternité.
La liberté des feuilles
C'est donc avec l'encre verte des métaphores attachées au monde végétal que René Guy Cadou signe l'acte de sa poésie. Pourquoi ce choix s'est-il imposé à lui immédiatement ? En interrogeant Le Miroir d'Orphée on peut mieux comprendre sa démarche. « Nous avions toujours cru avec Julien Lanoë, dit-il, que la présence d'un seul mot abstrait dans un poème faisait obstacle à toute poésie.» 13 Et il ajoute ailleurs: « Notre ambition a toujours été d'ajouter à la connaissance du monde, de matérialiser celui-ci, de nous attacher le lecteur par une puissance émotionnelle. » 14 Voilà dégagés les deux fils conducteurs de son écriture : concrétiser l'univers poétique pour mieux appréhender notre monde et élaborer une véritable cosmogonie par la médiation du végétal. Et ce concret « médiateur » de sa poésie, Cadou, dont « les premiers pas (furent) brodés d'herbes » 15, le puisera dans nombre d'éléments du monde végétal qu'il déclinera avec méthode et beaucoup de bonheur au nom d'une affectivité constante et très forte au service de l'enfance, de l'amitié comme de l'amour.
Il est intéressant de comparer, à partir d'un exemple comme celui de la feuille, le traitement qu'en font Apollinaire puis Cadou, qui a beaucoup écrit sur son aîné qu'il admirait. Pour les deux poètes, elle demeure, de par sa forme, naturellement associée à la main, mais une main coupée qui évolue en toute autonomie :le surréalisme demeure en mémoire.
« L'automne est plein de mains coupées
Non non ce sont des feuilles mortes
Ce sont les mains des chères mortes
Ce sont les mains coupées »
a écrit le poète d'Alcools avec une certaine tristesse.
En revanche, pour celui d'Hélène ou le règne végétal, si elles « traîne(nt) encore sur la cheminée » 17 ou « sur la table », c'est sur « une table encombrée de feuillages et de mains » 18, dans des circonstances autrement amicales. L'image, de facture surréaliste certes, retrouve avec Cadou tout son dynamisme, cette « liberté couleur des feuilles » 19, ce « caractère de liberté unique » de la poésie qui brusquement « s'est mise à bouger dans le sens des feuilles » 2O et surtout tout son poids d'affectivité : « Tout est là dans cette tendresse de feuilles. » 21 C'est donc à l'écoute de la nature que le poète trouvera sa liberté. Et la métaphore s'éclaire alors : « Si ma raison vaut par les feuilles / qui parlent bien quand on les aime » 22, dit-il, « c'est dans l'espoir de (m')habituer / jour après jour à (mon) espoir », c'est pour arriver enfin à ce « matin de délivrance » qu'il ne cessera d'attendre, à ce crépuscule de lumière qui fait flamber le monde purifié, lavé du temps qui le ternit un peu plus chaque jour que Cadou écrit très vite dès ses premiers poèmes :
« Je m'évade
Sous les coquilles rompues du soir
Avec mon sac d'étoiles dans ma poche,
Ma fronde à tuer les heures
Et mon sifflet de merisier,
En échange de quelques larmes
De quelques morsures sous le sein
-Que je comptai à ma jeunesse -
Une nuit vierge de sang.
Tout est là dans cette tendresse de feuilles. » 23
Toute l'architecture métaphorique qui porte sa poésie était déjà en place et sa « fronde à tuer les heures » permettra d'accorder ce pouvoir de liberté aux feuilles délivrées de l'arbre et qui, telles des mains amicales, l'accompagneront dans sa quête d'atemporalité. C'est pourquoi, beaucoup plus tard, il continuera en toute logique de dire :
« Les feuilles qui tombent des arbres
Réchauffent les statues de marbre. » 24
L'écriture végétale
Cet enfant que j'étais qui donc me le rendra ?
Que je le serre comme une brassée d'herbe dans mes bras ! » 25
De Sainte-Reine-de-Bretagne à Louisfert, l'enfance éclairera le chemin de Cadou. C'est elle qui donnera à son écriture son véritaЫe sens. Ses vertus ? Un pouvoir d'émerveillement que les sens encore tout neufs de l'enfant, grand ouverts sur le monde qu'il découvre, le monde de la nature dans lequel il s'immerge avec délices, vont entretenir bien au-delà de ses premières années et le faire vivre en poésie :
« Je retranche mon enfance de ma vie
Mes premiers pas brodés d'herbes
Mes jeux dociles
Le vis avec lenteur,» 2б
L'herbe de l'allée du calvaire qu'il ramassait à pleines brassées restera donc étroitement associée à son enfance et mieux encore à son écriture. Elle demeurera ainsi, pour lui, un rempart contre le temps. Derrière l'homme et ses rides sur fond noir, se cache toujours l'enfant qui fait bouger un rideau d'herbes tissé des premiers fils de son réseau métaphorique. Désormais, dans la chambre du poète, «l 'herbe pousse un peu partout » 27; c'est elle qui « penche sa longue écriture sur la page » 28. Le poème avance et le temps se déconstruit. Mais quand, parfois, le ciel de Cadou s'assombrit, quand le temps reprend ses droits, on peut lire alors sous la plume du poète : « Il n'y a plus assez d'herbe dans mes allées. » 29 Ainsi toutes les sensations qu'elle réveille en lui parlent-elles de l'enfance, la maintiennent vivante et la racontent. Peu à peu, Cadou avoue lui-même qu'elle est devenue « seule parole » 30 puisqu'elle « couvre les mots », à déconstruire comme le temps, pour que le silence s'installe, un silence qui passe par le bruissement de l'herbe qu'il perçoit et le regard de l'enfant qu'il était et qu'il ressuscite. Le travail du poète consiste donc à préparer, à travers l'effervescence que l'état de poésie provoque, la désagrégation d'une réalité apparemment stable au profit d'un double du réel en constant mouvement. Et ce nouveau réel voit les frontières disparaître, celles des âges et des paysages, du songe et de l'état de veille. Il est naturel qu'après un travail aussi minutieux le terrain ait été bien préparé pour que le réseau des métaphores puisse se dévеlоppеr en toute liberté.
L'herbe, seule parole
C'est ainsi que le champ lexical de l'herbe se décline alors du gazon aux pelouses et du foin aux prairies, attribuant à chaque déclinaison une fonction bien précise, toutes bien évidemment liées à l'enfance, moteur indispensable à ces métamorphoses qui s'emploient toutes à la conservation du possible. Le gazon, sans cesse coupé, repousse dru, déplaçant indéfiniment sur la ligne de vie du poète l'index de ses premières années. « Que les graminées se poussent jusqu'à la margelle de mon établi» 31, lit-on dans Le Chant de solitude. L'enfance arrive alors en force comme le signe de l'inspiration. « Que tous [...] viennent voir ce miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles. » « Parmi les herbes tapageuses » 32le poète retrouve aussitôt ses sept ans, loin du monde et du temps. L'univers réel bascule alors et les constructions des hommes connaissent aussi leurs métamorphoses. « Les pelouses du toit jonchées de pierres grises » 33investissent de leur douceur les foyers amicaux. Le toit est alors comme un pré angevin. C'est pourquoi le poète lui-même quitte parfois sa chambre pour installer sa table au bord de la prairie. Et il a bien raison puisqu'il y retrouve les chevaux qui « parlent mieux que les hommes » 34 puisqu'ils « n'ont pour eux que l'herbe », l'herbe ou « le foin qui ne ment pas » 35 et avec lequel ils ont « des conciliabules ». Voilà la vérité: «Toute la vie / au bord des sombres pâturages. » «Le fond de la pеnséе » 36 se lit dans le regard des bêtes qui se taisent et qui observent « par déférence pour les hommes / un silence qui convient mieux / à la tristesse de nos cœurs » 37 et dont le visage apparaît « plus lumineux » que celui du poète.
Et pour témoigner davantage encore de cette correspondance saisissante entre l'herbe et l'écriture, entre tout ce vert libre et le langage qui aspire tant à le devenir par le truchement de la main qui rêve de la même liberté, Cadou souhaite faire entendre « ce minutieux mouvement d'herbe de (ses) mains » 38, en marge de la parole, que par l'écriture elles avaient fixé et qui n'aspirent plus désormais qu'à un silence originel auquel l'univers végétal, par ailleurs catalyseur de l'enfance, peut seul donner accès. Déjà Walt Whitman parlait de ces « mots aussi simples que l'herbe ». Cadou reprend d'ailleurs la comparaison à son compte mais au profit d'Apollinaire : « Comme sous l'herbe rase il y a le cœur brûlant de la terre, sous ses mots on découvre l'infinie tendresse de l'homme. » 39 Walt Whitman et Guillaume Apollinaire : deux poètes auxquels Cadou se réfère bien souvent. Ce langage tendre de l'herbe et du feuillage qui parle d'enfance et d'amitié est bien celui auquel le poète aspire. Quand le temps des métamorphoses sera arrivé, Cadou aura alors atteint son objectif et réussi sa vie en poésie. Art pоétique 40, poème à priori déroutant, offre la clé du mystère de sa démarche artistique, du choc générateur de la création poétique telle qu'il la conçoit. Tout est codé dans ce poème et il faudrait bien des pages encore pour analyser l'enchaînement de ses faisceaux de métaphores à décrypter et pour en apprécier la cohérence profonde. Ayant traversé la nuit de notre réalité temporelle, apparemment perdu sur « une route de forêt », mais en fait sauvé, le poète, hors de lui-même, aura enfin trouvé ce qu'il cherchait : l'art et la beauté certes, mais surtout la réalisation de sa personnalité autant rêvée que vécue dans son intégralité. Poésie, la vie entière !
« Tu es couché tout près de toi dans la verdure » et « tu disposes de toi-même / secrètement pour un destin / qui ne peut plus te laisser seul. »
Entre avenir et souvenir
Insensiblement, la fonction poétique du langage végétal de René Guy Cadou dessine ses contours. À travers sa lente progression dans l'univers des essences, c'est la dissolution du temps qui se poursuit. Ne lit-on pas dans « Les secrets de l'écriture » 41, poème au titre révélateur: « J'écris pour dépasser la crue noire du temps » ? Hélène ou le règne végétal 42, recueil majeur du poète, confirme son objectif. La femme aimée y tient la place centrale, au carrefour de l'Amour et du Temps. Elle appelle l'enfance et se fond dans le paysage; « Entre avenir et souvenir » 43, elle porte en elle l'existence même du poète engagé dans sa double recherche : celle de son identité et de son éternité.
« J'accède à présent
Par le puits de tes yeux aux sources de ton âme
Où n'ont jamais plongé les racines du temps. » 44
Ainsi, pour Cadou, si la femme, « dans son poids d'herbe », garde en elle l'enfance, elle est aussi promesse d'avenir, comme le grain de blé, lui aussi hors du temps et auquel elle est très souvent associée : « Toute ma vie pour te comprendre et pour t'aimer / Comme on se couche à la renverse dans les blés. » 45 La graine, à la fois « promesse de plante» 41 et « citation sur le souvenir », renferme, non encore dépliée, toute la ligne du Temps. N'ayant pas encore « choisi entre avenir et souvenir » 47, elle cristallise l'image figée d'une atemporalité à laquelle aspire le poète. C'est pourquoi le végétal, bien au-delà de ses métamorphoses saisonnières, laisse transparaître la grille de son éternité. Dès sa rencontre avec Hélène, Cadou est en communion parfaite de pensée avec celle « qui rêve les étés » 48, saisons des moissons et perspective d'avenir. Hélène : inspiratrice du poète et génératrice de ces instants d'éternité qu'il savoure, tant par l'écriture que par l'amour, par l'écriture de son amour. En ces moments privilégiés de bonheur parfait et de temps suspendu, « une tige de blé sépare leurs genoux ». L'élan du cœur fait alors éclater le Temps. Que le blé ruisselle sur la table ou s'enfouisse dans la terre, le poète pourra toujours écrire que « le souvenir n'est que cette connaissance du futur que nous percevons à travers le passé. » 49
Le cœur définitif
C'est donc autour du grain et de toutes ces images végétales du chemin de son éternité, que Cadou a vécu dans son imaginaire et de toutes ses forces « le rêve intérieur des semences ». Il faudrait aussi parler de l'arbre qui s'enracine dans la chair de la terre pour y prendre sa dimension d'homme. Alors, des branches du poète s'envolent les oiseaux portant le grain au ciel. Le blé crépite sur la table que les feuilles disputent aux mains de l'amitié. C'est l'heure de l'abondance et celle de la joie. Ce regard tissé d'épis, celui de la femme ou celui de Dieu ? Le Temps s'est arrêté sur tout le paysage. C'est l'herbe de l'enfance, l'heure de l'éternité. Le règne végétal assemble ses cordages. Des pans d'ombre s'écroulent, découvrant tout l'espace.
Il est donc impossible, c'est une évidence, d'enfermer la poésie de René Guy Cadou dans le monde artificiellement clos des poètes de la nature. Son large message est très profondément le témoignage d'une émouvante appréhension : celle du monde et celle du langage, celle du monde par le langage. C'est sans nul doute l'objectif essentiel de tout poète, qui, selon Apollinaire, sera « épris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens » 50. Et Cadou ne déroge pas à la règle : « Il y a tous ces mots qui reprennent un sens / et que je dis si mal parce qu'ils sont en moi / comme une liberté nouvelle et végétale» 51. Pourtant, il se défend d'écrire «pour quelques-uns retirés sous la lаmpе » 52, pour des intellectuels assoiffés d'exégèse, même si pour nous, ses lecteurs, l'analyse est toujours nécessaire à la qualité d'écoute du chant secret de sa pensée. Il parle d'homme à homme à celui qui, « dépassé par l'orage, n'entend pas la rumeur terrestre de son sang »53. C'est en l'éveillant au monde, aux valeurs essentielles, en redonnant aux mots leur saveur originelle, avant tout celle des choses usuelles érodées par tant d'années et tant de pluies, et en les lui livrant tels quels, que Cadou fait œuvre de poète. Peu à peu la parole libérée retrouve son vrai sens et l'homme est alors en mesure d'entendre le message, de sentir qu'il appartient à cette terre dont il peut désormais écouter la rumeur... et atteindre du même coup sa dimension cosmique.
« Encore un soir où je m'en vаis
Sur le grand livre des marais
Tracer les mots de mon епfаncе
D'un geste fondre les saisons
Au bercement des horizons
Et des hoquets de la souffrance » 54.
À la lecture de la poésie de René Guy Cadou, ce ne sont pas les saisons qui passent avec le temps, c'est une saison en poésie, « la cinquième saison »55, celle de l'amour dans sa dimension la plus vaste, qui s'installe dans notre « cœur définitif » 56.
Notes
1. René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Seghers, 2008, p. 306.
2. Rainer Maria Rilke, Poèmes français, Gallimard, 1978, p.117.
3. R. G. Cadou, op. cit. note 1, p. 161.
4. ibid., p. 35°.
5. René Guy Cadou, Le Miroir d'Orphée, Rougerie,1976, p. 29.
6. R. G. Cadou, op. cit. note 1, p. 392.
7. Ibid., p. 254.
8. R. G. Cadou, op. cit. note 5, p. 29. 9.Ibid.
10. R. G. Cadou, op. cit. note 1, p389.
11. Ibid., p. 133.
12. Ibid., p. 267.
12. R. G. Cadou, op. cit note 5 p.23
14.Ibid.p.52.
15. R. G. Cadou, op. cit note 1 p.32
16.Apollinaire, Alcools, Gallimard, poésie, p85.
17. R. G. Cadou, op. cit note 1 p.52.
18.Ibid.p148
19. Ibid.p181
20. Ibid.p11
21. Ibid.p21
22. Ibid.p215
23. Ibid.p21
24. Ibid.p356
25. Ibid.p320
26. Ibid.p32
27. Ibid.p233
28. Ibid.p292
29. Ibid.p365
30. Ibid.p121
31.1bid., p. 336.
32.lbid., p. 59.
33.Ibid., p. 148.
34.Ibid., p. г62.
35.Ibid., p. 267.
36.1bid., p194.
37. Ibid., p. 267.
38.1bid., p. 347.
39.René Guy Cadou, Le Testament- d’Aроllinaire, Rougerie, 1980, p. 12о.
40.R. G. Cadou, op. cit. note 1, Р 290-
41.Ibid., p. 371.
42. Ibid., p. 249.
43. Ibid., p. г62.
44. lbid., p. 340.
45 Ibid., p. 21 б.
4б. Ibid., р. 335.
47.Ibid., p. 262.
48.Ibid., p. 165.
49.Ibid., P. 394.
50.Apollinaire, note 16, p58.
51.RG Cadou, note 1 p175.
52.Ibid.p371.
53.Ibid.
54.Ibid.p154.
55.Ibid.p.149.
56.Ibid.p.184.
 |
Celui qui entre par hasard,
par Christian Moncelet. |

(Retour au sommaire archives)
Celui qui entre par hasard dans un poème de Cadou... Ce fut mon cas à l'âge de seize ans au Conservatoire de Clermont-Ferrand. Une camarade lut « Alphabet de la mort ». Révélation fulgurante, immédiatement bouleversante, aux conséquences infinies ! Â l'époque j'apprenais, par pur plaisir, des poèmes d'Aragon. Une fois découverte, la poésie de Cadou m'attira davantage, durablement, ensemença ma vie. Puis vint le temps de l'étude d'où naquirent un mémoire universitaire puis une grosse thèse d'État.
Ayant eu la charge, à plusieurs reprises, de former des enseignants de lettres, j'ai beaucoup œuvré pour faire connaître la poésie cadoucéеnne, proposant aux étudiants ou aux professeurs en formation continue des dégustations de textes... J'ai pu remarquer combien le poème « Celui qui entre par hasard » touchait mes auditoires successifs. C'était, à l'évidence, une bonne entrée dans l'œuvre. De surcroît, on pouvait se servir de l'amorce « Celui qui entre dans la demeure... » pour inviter tel ou tel à écrire un nouveau texte, dans la perspective d'un mimétisme créateur.
Voici le poème, publié dans Les Biens de ce monde, typographié ici avec — en gras et pour les besoins de la dégustation — les syllabes accentuées ainsi que les césures :
« Celui qui entre / par hasard / dans la demeure / d'un poète
Ne sait pas que les meubles / ont pouvoir sur lui
Que chaque nœud du bois / renferme davantage
De cris d'oiseaux / que tout le cœur / de la forêt
Il suffit qu'une lampe / pose son cou de femme
À la tombée du soir / contre un angle verni
Pour délivrer soudain / mille peuples d'abeilles
Et l'odeur de pain frais / des cerisiers fleuris
Car tel / est le bonheur / de cette solitude
Qu'une caresse / toute plate / de la main
Redonne à ces grands meubles / noirs et taciturnes
La légèreté d'un arbre / dans le matin.»
Celui qui entre par hasard dans un poème entre aussi dans une sorte de demeure que le poète a bâtie de ses mains et de ses mots.
Surprise initiale : pas d'intitulé ! Le lecteur n'est pas prévenu, explicitement, du thème central ; il est, comme le visiteur, dans un état d'attente floue. Le visiteur sait-il d'ailleurs que le maître des lieux est un poète, ou bien le comprendra-t-il à la seule révélation des prodiges ? L'évocation de ces prodiges n'en sera que plus surprenante.
Pour qui connaît l'univers de Cadou, le verbe « entrer » résonne favorablement. Connotant l'accueil, la communication, l'échange, l'amitié, l'amour, bref la chaleur humaine sous toutes ses formes, « entrer », si l'on peut dire, est un mot clef. On notera que s'introduire dans la maison se fait sans problème : le lieu de vie n'est pas, contrairement à un stéréotype répandu, une tour d'ivoire sèchement et orgueilleusement fermée.
Quant à la précision « par hasard », elle situe l'événement dans le registre de la rencontre et non d'une visite programmée. On peut songer au distinguo du poète suisse Georges Haldas, dans Les Minutes heureuses : « Ne suis disposé qu'aux rencontres, jamais aux rendez-vous. » Toute rencontre vibre des potentialités de la surprise. Aucune préméditation, souvent raisonneuse, ne vient parasiter les émotions ni contrôler les réactions au vivant en partie imprévisible.
Le vers d'ouverture est long (16 syllabes), ne contient qu'un sujet pronominal (« celui ») et son expansion en relative (« qui entre... »). La longueur du vers semble augmentée en son milieu par la répétition rapprochée du son vocalique le plus ouvert (six « a» ou « an » : « entre », « par », «hasard», «dans », «la»). Tout commence donc dans une tonalité prosaïque animée néanmoins par un rythme régulier (on sent deux moitiés octosyllabiques, elles-mêmes accentuées en leur milieu).
Cette entrée en matière qui se veut sans grand éclat va se révéler une indication thématique primordiale. Pour avoir ses entrées partout, il faut d'abord en avoir une chez un poète. Après avoir pénétré au cœur de l'intimité banale, le visiteur (et par voie de conséquence, le lecteur) entre, comme naturellement, grâce à l'ouverture métaphorique, dans ce qui semble impénétrable, « un nœud » ligneux. Miracle d'une entrée en douceur dans le dur ! Au fil du poème, le franchissement du seuil concret est complété par d'autres franchissements (dans les deux sens, entrée et sortie), qui sont autant d'affranchissements des lois de la vie normale, de la physique la plus éprouvée.
Passer des seuils ne saurait se faire sans intercesseurs. La femme joue ce rôle, ici fermement mais indirectement, très discrètement. Partie prenante du jaillissement des merveilles, la féminité est subtilement présente par le détour d'une métaphore : «Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme. » La lampe est femme peut être grâce à ses formes arrondies et par sa fonction positive — elle libère les abeilles (insectes nobles) pourvoyeuses de miel ainsi que l'odeur du pain (nourriture essentielle, prosaïque et sacrée). La métaphore est réversible : la femme est lumière, révélatrice des mystères du monde.
La progression du poème
Le texte est vivifié par une progression d'ensemble, tressée (comme une corde et ses torons) de plusieurs progressions particulières.
On passe d'abord du réalisme et de la banalité d'une visite impromptue au merveilleux poétique (suite de floraisons, d'éclosions miraculeuses dans un univers d'apparence normale et sans histoires). Derrière la dynamique d'une explication logique que signale le mot « car », il y a, en fait, un surcroît de merveilleux : le miracle de la première libération est justifié par celui de l'amour concrétisé dans une simple caresse.
Si l'attention est immédiatement fixée sur les meubles, s'il n'y a pas de déplacement spatial, en revanche le visiteur est invité à constater un passage à rebours du soir au matin, à — excusez du peu ! — une réjuvénation. Le mouvement général du poème est résumé par l'explication finale de la métamorphose, véritable métamourphose.
Du sombre (« noirs ») procède le lumineux (« le matin »), et l'horizontalité stable (la caresse qui épouse la surface des meubles est qualifiée, par hypallage, de « plate ») génère la verticalité montante d'un arbre au moment où le jour est dans sa jeunesse. De la gravité — presque la pesante heure —, du poids de ces meubles massifs que qualifient trois adjectifs en cadence majeure (« grands », « noirs », « taciturnes », 1/1/3 syllabes) on passe à la « légèreté » quasi onirique de l'arbre (qui semble avoir largué des racines, comme un vaisseau ses amarres). À noter que pour suggérer le poids des meubles imposants et allonger le mouvement horizontal de la main caressante, le vers contient une césure lyrique (la coupe est séparée de la syllabe accentuée par une syllabe atone qui compte). Ce type de césure affaiblit l'accentuation et oblige à dire le vers d'un seul tenant (« redonne à ces grands meubles / noirs et taciturnes »). Le contraste du pluriel (les meubles) et du singulier (un arbre), outre qu'il conforte deux oppositions (le pesant vs l'aérien, l'immobile vs le dynamique), reprend, en inversé, l'antithèse « chaque nœud » / « cris d'oiseaux ». D'ailleurs, l'agglomérat d'oppositions du final prolonge certaines évocations antérieures. Le nœud, redouté par les menuisiers, est le moins stérile des endroits, il regorge de cris oiseaux. Voilà que le dense, apparemment inerte, recèle une danse tapageuse. Dans la maison aux sortilèges familiers, les contraires sont magiquement abolis, le vivant gît dans le mort, la nature (les cerisiers en fleur) dans la culture (le bois travaillé par l'artisan). L'hiver qui se cache, comme en verlan, dans les sonorités de « verni », génère une vision printanière (les « cerisiers fleuris »). Entrer dans l'antre, entrer dans l'autre, dans son intimité, revient paradoxalement à retrouver le dehors.
Une autre progression est perceptible du point de vue formel, le poème devient de plus en plus musical. Un rythme régulier rapidement installé après le vers long initial est entretenu, jusqu'à la fin, par des alexandrins le plus souvent coupés au milieu. Mais des variations de rythme donnent de nouvelles impulsions sans faire désordre. Au vers 10, les deux coupes (après « tel » et après « bonheur ») délimitent des blocs grandissants de syllabes (2/4/6) propres à suggérer, par leur cadence majeure, un dynamisme que confirme le contenu sémantique des trois vers qui suivent. Les vers 4 et 10 contiennent deux coupes qui créent un trimètre romantique (trois fois quatre syllabes) avec néanmoins deux effets différents. Dans le vers 4, les coupes suivent les mots accentués, tandis que dans le vers 10, les coupes tombant au milieu des mots se trouvent comme estompées dans le mouvement de la diction, ce qui oblige le locuteur à ne pas faire de pause vocale. Les coupes des trois derniers vers du poème sont de ce type, d'où une impression de flottement rythmique.
Du point de vue des sonorités et plus spécialement des fins de vers, on constate qu'il n'y a pas de rimes stricto sensu mais des homophonies inégalement riches. Les échos ne sont vraiment perceptibles que dans les quatre derniers vers qui ressemblent à un quatrain aux rimes croisées. Après de rares homophonies en fin de vers dans la première moitié du poème (« poète» / «forêt », « lui» / «verni» / «fleuris ») complétées par quelques échos intérieurs (« demeure» / «meubles »), on entend des reprises explicites (« solitude» / «taciturnes»: trisyllabes et «itu»). « Main » semble croître, tel un végétal, en « matin ». L'explication ultime (l'efficacité d'un geste d'amour sur la vie des meubles) tient précisément dans ces quatre vers où la musique est la plus audible. La forme et la signification s'épanouissent conjointement.
Les secrets de la poésie
La simplicité se retrouve dans tous les aspects de cette scène mystérieuse. La demeure est celle « d'un poète », homme parmi les hommes, et non « du Poète » (magnifié dans une pose avantageuse de prophète). À la fin du deuxième vers, survient une ambiguïté pronominale qu'il n'est peut-être pas opportun de lever. Que représente « lui »? S'agit-il du poète ou de son hôte inattendu ? Si « lui » renvoie à l'habitant de la demeure, la formule est particulièrement souriante. Elle devient l'affirmation modeste d'un renversement. On s'imagine d'ordinaire Orphée ayant prise sur le monde grâce à son « Carmen» (son chant versifié et son charme agissant sur les choses), ici c'est l'inverse. S'il s'agit du visiteur du soir, il va bénéficier, à son tour, du merveilleux qui règne dans la maison, tout comme le lecteur lie son destin, le temps de l'écriture, à celui de l'écrivain.
C'est sur les mots que le poète a une certaine prise, pour le reste — le rapport sensible et affectif au monde — les forces sont en perpétuel dialogue, l'aimantation (le « pouvoir ») est réciproque. La main qui caresse est aussi, chez le poète, l'organe de l'écriture. À la lettre, le poète est celui qui a le cœur sur la main à plume. On peut donc parler d'une «po-éthique » : la générosité du monde est la réponse à une attention appuyée (un acte d'attention, une marque d'amour) et suscite une création verbale d'une superbe densité.
On est enchanté par la plénitude de l'expérience orphique. En l'espace de quelques vers et par la grâce de quelques courts-circuits analogiques, tous les registres sensoriels sont présents ou suggérés : la vue (« fleuris », «noirs », «plate »), l'ouïe (« cris », «taciturnes »), le toucher («caresse»), l'odorat et le goût (« l'odeur de pain frais »). Au transport immédiat d'un règne à l'autre (l'humain, le végétal, l'animal) s'ajoute, sans autre forme de procès, le déplacement temporel évoqué plus haut. Le masculin et le féminin sont aussi appariés tandis que sont liés intimement le corporel et l'affectif (« pose son cou », « caresse »).
Un thème est particulièrement remarquable, c'est celui du « il suffit » (la causalité miraculeuse) explicite à propos de la présence libératrice de la lampe (« Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme... ») et implicite dans le micro-récit de la caresse produisant un effet d'envergure (rien moins, pour le bois, qu'une jouvence retrouvée, un peu comme dans la genèse à rebours du poème « Page d’écriture » de Prévert). Le petit contient, génère le grand, le grandiose même. C'était déjà — aux vers 3 et 4— la disproportion entre la vitalité spacieuse et un simple nœud du bois !
On quitte ce poème avec, chevillée au cœur, une ferme confiance dans la pluralité et l'excellence des « biens de ce monde », qu'un rien peut faire passer du latent au patent et, qui plus est, à l'épatant.
Ce poème est un condensé de la matière et de la manière poétiques de Cadou. Pour en saisir la sapide originalité, il suffit de le comparer à des textes analogues : « Le Buffet » de Rimbaud, « La Salle à manger » de Francis Jammes (De l'angélus de l'aube à l'angélus du soir,1898). Cet intérieur sent tout sauf le renfermé !
Le poème — sans titre et sans strophes — est comme l'un de ces meubles massifs, et contient, de même, des trésors de beauté. Le caresser délivre un crépitement d'images, tant il est vrai que chanter le magnétisme des « choses usuelles » est une forme envoûtante de ce que j'ai cru bon d'appeler « le réalyrisme ».
Dans Usage interne, Cadou distingue les œuvres hermétiques, qu'il n'apprécie pas, et les œuvres fermées. Les premières, écrit-il, «ne nous donnent pas la possibilité d'y entrer », les secondes « ne nous donnent pas la possibilité d'en sortir ». On pourrait adapter ce distinguo aussi drôle que profond à notre poème. Sous des aspects qui refusent le tape-à-l’œil, sa beauté est prenante, attachante. On peut certes en sortir, mais avec l'envie forte d'y revenir souvent.
 |
Max Jacob, une présence terriblement agissante » pour René Guy Cadou,
par Antonio Rodriguez. |

(Retour au sommaire archives)
Les liens de Max Jacob et de René Guy Cadou sont fondés sur une abondante relation épistolaire, qui a duré de 1937 à 1944. L’« épaisse liasse de lettres» de Max Jacob dépasse les deux cents envois 1. Une seule rencontre entre les deux hommes a eu lieu en février 1940 à Saint-Benoît-sur-Loire, durant deux jours, et, bien qu'agréable, cette rencontre ne fut sans doute pas le moment le plus intense de leur amitié 2. Mais quel lien y a-t-il entre un auteur de plus de soixante ans, reconnu comme une figure marquante du Montmartre du début du siècle, haut en couleur, juif converti au catholicisme, et un jeune homme de dix-sept ans, issu d'un milieu laïque, achevant sa première plaquette poétique, les Brancardiers de l’aube ? Plusieurs études ont déjà été consacrées à cette question 3, et j'aimerais montrer ici que c'est la mort tragique de Max Jacob ainsi que certains de ses conseils esthétiques et éthiques, davantage que son œuvre poétique ou romanesque, qui ont eu un impact important pour René Guy Cadou.
La rencontre entre les deux hommes s'est produite par le biais de plusieurs intermédiaires. Mais c'est notamment sur les conseils du libraire et poète Michel Маnoll 4 que René Guy Cadou adresse des vers à Max Jacob, qui deviendra avec Pierre Reverdy un auteur de référence pour les poètes regroupés sous le signe de Rochefort. René Guy Cadou est aussi un compagnon du fils du peintre nantais Pierre Roy, qu'avait connu Max Jacob chez Apollinaire, ou encore de l'éditeur Julien Lanoë. Ces liens n'expliquent cependant pas la prise de confiance rapide de l'auteur du Cornet à dés. En effet, le jeune âge de Cadou et la qualité de ses premiers vers et de son écriture épistolaire suscitent l'intérêt de Jacob pour mener une correspondance « pédagogiques », faite de conseils esthétiques, moraux et religieux. Durant cette même période, Max Jacob entretient des correspondances du même type avec Marcel Вéаlu, Louis Guillaume ou encore Michel Manoll. Cette situation d'aîné à cadet rend la relation en partie asymétrique : elle aura par conséquent un impact sur l' œuvre nettement plus important chez Cadou que chez Jacob. Ce dernier n'hésite pas à avoir des propos parfois sévères sur son jeune correspondant lorsqu'il écrit à d'autres poètes. Bien qu'une certaine distance se manifeste chez Cadou, la présence de Jacob, « ce Pascal moderne mâtiné de Jarry », ne cessera de s'accroître, notamment à partir de sa mort : « Ah! Comme notre cher Max me manque. C'est maintenant qu'il n'est plus que je m'aperçois de la place envahissante qu'il avait prise dans ma vie »; «Il n'est de jour où je ne pense à Max. »7
De prime abord, les liens esthétiques entre les œuvres poétiques de Max Jacob et de René Guy Cadou sont plutôt maigres. Il y a peu de rapports entre les poèmes du Cornet à dés, de la Défense de Tartufe, des Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel et l'écriture déployée dans les recueils de Cadou. Le détournement des genres littéraires, les calembours cocasses, la dominante de l'angoisse et de la culpabilité, les vertiges ironiques de l'identité, le conflit entre les multiples facettes de la personnalité, les rimes décevantes ne concordent pas véritablement avec la fluidité, la continuité et la transparence des vers de La Vie rêvée. Des rapprochements esthétiques avec l'œuvre poétique de Reverdy seraient par conséquent plus fructueux 8. Ce qui marque davantage le lien se situe dans la reconnaissance, les conseils, parfois les reproches, que Jacob adresse à Cadou afin de le guider pour déployer davantage sa puissance poétique. Il l'aide à se situer : « Je tiens [ ... ] à te répéter ma prédilection pour cette poésie douce et bonne, imprévue, où tout d'un coup le sublime s'installe à côté d'un sourire. » 9 Cette formule caractérise d'emblée ce qui lui paraît à valoriser dans la démarche de Cadou : la sensibilité, la surprise légère qui engage une élévation esthétique, en maintenant une distanciation par l'humour, le décalage, et non par l'ironie. À côté de certaines qualifications liées à des orientations esthétiques, l'auteur du Cornet à dés distille ses conseils pour mener une carrière littéraire, comme il l'avait fait auparavant avec d'autres jeunes poètes (Leiris, Jabès, Sachs) et le fera encore par la suite. Ainsi, Max Jacob occupe auprès de Cadou, comme pour d'autres membres de « l'École de Rochefort », un rôle tutélaire 10, en tant qu'acteur marquant, voire en tant que légende, de l'histoire de la poésie moderne, hors de la vogue surréaliste alors dominante. Mais, à partir de sa mort, il devient davantage une sorte de « père » littéraire. Son décès tragique au camp de Drancy réactive un investissement particulier chez Cadou, lié à la mort précoce de ses parents. Dès lors, la rencontre de l'homme, avec sa figure d'écrivain reconnu et ses conseils avisés, l'emporte sur son œuvre qui n'aura, stylistiquement et thématiquement parlant, pas de réelle influence sur l'écriture de Cadou.
Ce que Cadou retient de l'esthétique jacobienne
La théorie littéraire de Max Jacob est une des plus importantes de la première moitié du XXème siècle. Elle se développe de 1907 à 1944, avec des notions particulières et une précision constante, à travers des préfaces, des aphorismes, des articles critiques et aussi à travers sa correspondance. Il n'est ainsi pas étonnant que René Guy Cadou ait retenu, pour une publication, les éléments d'une esthétique à partir de la correspondance qu'il avait eue avec Jacob. Celle-ci reprend dans les grandes lignes les points principaux qui guident sa démarche : le style, la vie intérieure, la surprise (ce qu'il nomme « la situation »), le lyrisme, l'art chrétien. Toutefois, Max Jacob insiste sur des différences dans son parcours, notamment entre les années vingt (date de publication de L'Art poétique) et les années quarante : « L'Art poétique était utile ou agréable en 1921— c'étaient bien là nos curiosités et la poésie, le coin-coin du vers à plusieurs sens diversifiés et unifiés, l'art gratuit sans support, le grain de surprise, le bourrage de crâne hamlétique [ ... ] la camelote cubiste transposée en poésie, c'est-à-dire une composition à la Edgar Poe [...].glus les conversions au catholicisme. » (E, 61.)
Il lui préfère désormais une poésie plus épurée où la « vie intérieure » l'emporte sur les effets de déstabilisation chez le lecteur. Ainsi distingue-t-il son Esthétique à Jacques E., qui sera publiée de manière posthume chez Gallimard en 1945 sous le titre Conseils à un jeune poète, de ses propos antérieurs : « Je pense que mon Esthétique à Jacques E. est plus proche de la Poésie ; Vie intérieure du poète, arrachages des racines stomacales, meilleur style, effort vers la clarté à l'encontre de l'hermétisme en retard, tendance à la grandeur. » (E, 62.)
Ces différences entre les deux époques ne sont pas aussi nettes que Max Jacob voudrait l'établir, mais il est vrai que René Guy Cadou retient principalement les traits qui s'associent à sa propre démarche et aux approches concomitantes de l'École de Rochefort, en tenant plus ou moins compte des propos de la préface au Cornet à dés ou de L'Art poétique. Il s'intéresse avant tout à la pratique plus proche des registres folkloriques et populaires ainsi que d'un lyrisme en apparence plus immédiat des poèmes de Morven le Gaëlique, production sous pseudonyme de Max Jacob 12: « Morven le Gaëlique se situe par rapport à Max Jacob comme la cathédrale de Chartres par rapport au Modern-Style. Il peut se faire d'ailleurs que ce Modern-Style se situe un jour sur le même plan que la cathédrale de Chartres » (OРC, 401), synthétise Cadou. Pourtant, Max Jacob reprend de manière discrète certains des propos théoriques associés à cette première période dans sa correspondance ie, mais ceux-ci semblent moins marquer le jeune poète. Que retient-il principalement des conseils de Max Jacob ? Ce sont avant tout, comme l'a déjà suggéré Alain Germain 14, les notes d'Usage interne, de Liens du sang ou encore des notes esthétiques recueillies dans Poésie la vie entière qui le révèlent. Un des principaux conseils que René Guy Cadou retient des propos de Max Jacob est celui de l'accroissement de la « vie intérieure », avec ou sans moyens religieux, pour trouver davantage ce qui est de son propre ressort (« sa voix », « le style », comme l'y invite Jacob) et ce qui relève des effets de mode ou de l'écriture de figures tutélaires. Dans Usage interne, Cadou écrit par exemple : « Certains partent de la réalité pour aboutir à eux, gymnastique scolaire qui n'intéresse qu'une étendue restreinte de la pensée. Mais d'autres, à partir d'eux-mêmes, se créent une réalité plus durable, plus immédiate, et dont les bornes sont sans cesse reculées » (OPC, 388). Cette dimension est traitée par Max Jacob depuis les premières formulations de son esthétique — « Quand un chanteur a la voix placée, il peut s'amuser aux roulades » — mais elle prend une ampleur particulière à la fin de sa vie, comme dans les Conseils à un jeune poète. Il n’est donc pas étonnant que ce soit un des principaux conseils qu'il adresse à Cadou, et qui sera déterminant pour le jeune homme.
La volonté d'échapper aux effets de mode, qui revient constamment dans les propos de Jacob et dans l'esthétique de Cadou, prend position plus particulièrement par rapport au mouvement surréaliste, certes en partie éclaté dans les années quarante, mais qui maintient un impact puissant sur le public. Outre les conflits personnels — « Je prends X pour un blagueur, ainsi que tous les surréalistes : ils s'amusent, c'est bien » (E, 53) les dimensions révolutionnaires de la poésie ainsi que les principes d'une écriture étroitement liée aux automatismes de l'inconscient posent de nombreux problèmes aux deux auteurs. C'est notamment par le biais du rêve ou encore de l'inspiration que reviennent des propos sur un inconscient surveillé : « Le rêve ne nous fait voir que le côté nocturne de l'homme... [mais] il y a d'abord la clarté du jour », écrit Cadou, tandis que Jacob synthétise sa pensée par une formule, «la Poésie est un cri, [mais] c'est un cri habillé » (E, 33). Nous trouvons donc un accord sur une poésie qui échappe à ce mouvement, ainsi que plus largement aux effets de mode des années quarante. L'inscription dans les principes de l'École de Rochefort ne contredit d'ailleurs guère cette perspective, dans la mesure où la structure, les recherches et les rapports entre les poètes de ce courant n'ont eu ni la puissance ni les limites liées au mouvement surréaliste 15. Ainsi, il était possible de prôner une « poésie à hauteur d'homme » tout en maintenant sa liberté personnelle.
Parmi les apports esthétiques majeurs de Max Jacob à la poésie du XXe siècle, nous trouvons dès 1907 ses considérations sur l'émotion en lien avec le mouvement, qui ont eu une influence importante sur la théorie de Pierre Reverdy.. Or, la conjonction (fondée sur l'étymologie) entre le mouvement et l'émotion se retrouve également quelques décennies plus tard chez Cadou : « L'émotion d'un poème ne vient pas tant de ce qu'il représente que de son mouvement. Plus l'allure sera rapide, plus le poème aura de chances d'atteindre son butin » Toutefois, si l'auteur d'Hélène ou le règne végétal insiste sur le mouvement, il se détache davantage des principes d'étrangeté, d'éloignement, de tension si importants pour Jacob. Au contraire, les dimensions de l'immédiateté vont apparaître chez lui comme des éléments centraux : « J'appelle immédiat cette faculté que possède l'esprit de s'immobiliser comme un coup de feu » (OPC, 388). S'éloigner de la « préméditation » pour atteindre l'« invention» et la « promptitude » dans l'immédiateté du rapport entre le poète et son poème, oser aller vers une « effusion» qui soit « fraternelle », ces éléments ne s'apparentent qu'en partie aux propos jacobiens. Il ne faudrait cependant pas occulter combien Cadou rétablit aussitôt dans un souci d'équilibre la catégorie de « style », qui est au centre d'une esthétique et d'une éthique de la maîtrise de l'écriture en poésie moderne, notamment prônée par Max Jacob, mais en l'inscrivant dans un lien existentiel au poète davantage que dans une cohésion et une autonomie de l'oеuvге.
Le dernier élément marquant des liens étroits entre les deux esthétiques est celui de la souffrance. Max Jacob insiste dans sa correspondance pour que le fondement de la démarche poétique soit celui d'une profonde sensibilité ouverte par la souffrance et la compréhension de celle-ci: « La souffrance ne doit pas être une faiblesse ; ça doit être une profondeur de sensibilité et le fait de ressentir davantage. » (E, 32.) Ses propos sur la souffrance, rattachés aux perspectives d'un « art chrétien » et à une œuvre qui met en son centre l'angoisse, la culpabilité en quête de l'unité religieuse, pourraient paraître éloignés de la démarche du jeune Cadou. Cependant, à partir de la fin de la guerre et de la disparition de Jacob, cette question déjà présente dans sa poésie va prendre une ampleur nouvelle dans son esthétique. La thématique du sang a souvent été soulignée dans les poèmes de Cadou 17, mais il est également intéressant de voir la nécessité de lier souffrance et bonheur dans les notes de cet auteur: « On n'œuvre, il est vrai, que dans la souffrance, mais cette souffrance désirée, consentie et pure de tout sentiment, n'altère en rien la joie rayonnante du poète.» (OРС, 391.) La formule « il est vrai » de cet aphorisme semble alors une concession adressée à Jacob, avec un équilibre propre trouvé dans la « joie » et le « consentement ».
L'esthétique de Cadou reconnaît sa dette envers la théorie de Max Jacob, en le plaçant haut dans la tradition littéraire, c'est-à-dire en lui donnant une aura d'éternité : « Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. » (OPC, 390.) De nouveau, la mort de l'auteur agit comme un révélateur de sa puissance véritable sur l'époque et sur son compagnon.
Max Jacob dans la poésie de René Guy Cadou
La présence de Max Jacob se fait sentir dans les poèmes de Cadou à partir de 1944. Certains textes évoquent explicitement la référence à l'auteur par leur titre, « Cornet d'adieu », « Encore une lettre à Max », « En liaison avec Max », mais nous trouvons également des mentions plus disséminées dans les recueils. L'arrestation et le décès tragique de Jacob à Drancy alimentent en grande partie les poèmes consacrés à cet auteur. Cela renvoie au choc important que cette mort a causé à Cadou et à la résonance qu'elle a créée avec le décès de son père, voire de sa mère. Ainsi est-il marquant de constater que les trois poèmes de « Série noire », consacrés aux morts marquantes de sa vie, renvoient d'abord à la mère, ensuite au père, enfin à Max Jacob: « Est-ce le Christ ou un ami / Qui frappe si tôt à la porte ? / Ils sont quatre pour l'emmener / Et le conducteur de taxi. » (OРС, 266.)
Le fait de le placer dans cette mauvaise « série » parentale donne la mesure de la place accordée à l'ami-poète, qui devient un véritaЫe « père » littéraire. Il n'est pas étonnant que le recueil Pleine poitrine soit dédié à Max Jacob 18, car non seulement celui-ci est un père symbolique mais il est aussi un emblème des morts tragiques de la guerre. La dédicace mentionne la relation personnelle, « mon ami », tout comme son statut de victime de l'histoire, « assassiné ». Le poème « Cornet d'adieu » (OРС,171) est un texte d'hommage, dans le genre du « tombeau » et dans la tonalité du deuil, où l'évocation se fonde sur des traits identifiables du parcours : nous retrouvons des références à Saint Matorel, au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, au Laboratoire central. Aussi témoigne-t-il dans ce poème de l'importance de la correspondance entre les deux hommes : « Tu m’écriras encore / J'attends tes reportages sur la mort. » Cette volonté de poursuivre la relation épistolaire par-delà la mort se retrouve dans les vingt-quatre alexandrins d'« Encore une lettre à Max». Dans ce poème débutant par l'adresse « Mon cher Max», nous avons le récit d'une visite de Julien Lanoë et le souvenir ému des deux hommes : son « fantôme quotidien » est celui d'un « ange maudit », mais qui réconforte et aide à se construire. Aussi n'est-il pas étonnant que la mention du nom « René Guy Cadou », qui apparaît pour la première fois dans l'écriture poétiquе 19, soit parallèle « [au] courage de ne ressembler à personne » donné par Jacob qui « pèse comme un oiseau sur [s]a feuille ».
Les poèmes confirment l'importance donnée par Cadou aux poèmes de Morven le Gaëlique. Ce pseudonyme revient souvent : « Un Noël de Cadou ça sent le Gaëlique ! » D'autres traits comme la lampe, le lorgnon et les sabots, les prières dans la basilique, apparaissent également pour caractériser Jacob, en engageant constamment des métaphores sur les figures religieuses de l'au-delà. Or, l'ambivalence du « pénitent » se résout généralement par un éclaircissement : « C'est Belzébuth dans un corset / Mais tel qu'enfin le clan adverse / Des Anges pareils à l'averse / le considèrent le grandissent / En un sublime sacrifice. » (OРС, 31 1.) Cadou ne tombe pas ainsi dans la vénération fantasmée du disparu — même si, parfois, il reprend les termes qui forment sa « légende » —, car il maintient une tension propre à l'homme qu'il a connu.
La « présence agissante » de Max Jacob, jusqu'au « terrible » selon Cadou, ne concerne guère les dimensions stylistiques. Les comparaisons de la métrique, du travail des rimes, des tensions métaphoriques montrent d'emblée des différences radicales, notamment en ce qui concerne le travail de l'écart et du mouvement. Il suffit, à titre d'exemple, de mettre en parallèlе des poèmes comme « Déménager » ou « Déménagement » de Cadou et « Avenue du Maine » ou « Bourlinguer » de Max Jacob pour se rendre compte de la distance qui sépare les deux écritures. Si, en raison de l'espace limité de cette étude, certaines démonstrations stylistiques ne peuvent être ici déployées, il importe d'être conscient des limites de l'influence jacobienne sur l'écriture de Cadou, ce qui correspond d'ailleurs bien aux préceptes d'indépendance et d'affirmation de soi qui étaient recommandés au jeune poète. Cela n'enlève en rien l'importance de la rencontre épistolaire entre les deux hommes, la figure de « père littéraire » accordée après la mort de Jacob, mais il est nécessaire de souligner combien les « filiations » littéraires, surtout lorsqu'elles sont choisies, sont composées d'éléments complexes et conduisent rarement à de simples continuations ou répétitions.
Notes
1. Les lettres de Max Jacob n'ont, hélas, été publiées que partiellement dans un ouvrage posthume édité par René Guy Cadou, Esthétique de Max Jacob, récemment réédité sous le titre suivant: Max Jacob, Esthétique, Lettres à Rепé Guy Cadou, Nantes, Joca Seria, 2001. René Guy Cadou a choisi des extraits des lettres de Max Jacob et les a assemblés à l'instar des « conseils à un jeune poète » parus en 1945. L'édition complète des lettres devrait cependant se faire prochainement.
2.Voir le compte rendu chaleureux et distancié qu'en donne René Guy Cadou dans La Gazette des lettres en 1950: « Allais-je reconnaître mon vieil ami? À la lueur d'un méchant phare d'auto, sous un béret de garde-côte,je distinguai un petit homme à l'allure de bizarre charpentier de village, inquiet des mains, le nez surmonté d'un lorgnon d'or comme en portaient les notaires dans les romans de Balzac.»
3.Je renvoie notamment aux travaux suivants: Alain Germain, « Du Cornet à dés au "Cornet d'adieu" ». René Guy Cadou "en liaison avec Max" », dans André Guyon (dir.),MaxJacob à la confluence, Brest, PUBO, 2000, p. 285-296; Alain Germain, « Les Amis de Rochefort », dans Jacques Lardoux (dir.), Max Jacob et l'École de Rochefort, Angers, Presses universitaires d'Angers, 2005, p. 15-23;Jean-Yves Debreuille, « René Guy Cadou », dans Jacques Lardoux (dir.), op. cit., 2005, p. 47-64; Christian Moncelet, Vie et passion de René Guy Cadou, Le Cendre, BOF éditeur,1975, p. 131-137; Patrick Denieul, «"En liaison avec Max": correspondances réelles et fantasmatiques entre René Guy Cadou et Max Jacob », dans Un poète dans le siècle: René Guy Cadou, Nantes,Joca Seria, 2002, p. 105 m.
4. Michel Laumonier pour l'état civil.
5.Selon la terminologie de René Plantier, L'Univers poétique de Max Jacob, Paris, Klincksieck, 1976.
6.Lettre à Marcel Béalu du 15 février 1945, dans Correspondance Marcel Вéаlu -René Guy Cadou, Mortemart, Rougerie, 1970.
7.ibid., lettre du 17 Juin 1949.
8.Diverses études ont été consacrées à ces liens: Alain Germain, « Cadou et Reverdy: sur le chemin du temps », dans Le Centenaire de Pierre Reverdy, Angers, Presses universitaires d'Angers, 1990, p. 31 7-323; Jean-Yves Debreuille,« Reverdy vu de l'Ouest », dans Alain Germain (d i r.), Rochefort et ses marges, Bob, Baudelin,1993, p. 39-49; Jacques Lardoux, « René Guy Cadou », dans Jacques Lardoux (dir.), Reverdy et l'École de Rochefort, Angers, Presses universitaires d'Angers, 2007, P. 33-45.
9.M. Jacob, Esthétique, op. cit. note 1, p. 47. Nous adoptons l'abréviation E., suivie des page.
10.Voir Christine Van Rogger-Andreucci, «Max Jacob et l'école de Rochefort: poétique et pédagogie », dans Alain Germain (dir.), op. cit. note 8, p.19-38.
11.Je renvoie au dernier numéro des Cahiers Max Jacob, n° 8, sur « Max Jacob, personnage de romans », où l'on voit que la légende de Max Jacob se construit dès la fin des années dix et le début des années vingt dans des romans à clés écrits notamment par Reverdy, Carco, Soupault, Apollinaire, Aragon ou encore Salmon.
12. Rappelons que Max Jacob a fait paraître des poèmes inspirés du folklore breton sous le pseudonyme de Morven le Gaëlique; voir Max Jacob, Poèmes de Morven le Gaéliquе, Paris, Gallimard (Poésie), 1991. Sur Cadou et les dimensions populaires, nous renvoyons à l'étude de Denise Martin, « René Guy Cadou et les croyances populaires », L'École de Rochefort, Angers, Presses universitaires d'Angers, 1984, p. 143-150.
13.Le fait de « transplanter » le lecteur n'est ainsi pas du tout abandonné : « L'oеuvrе doit être éloignée du lecteur. Elle doit être située dans un espace lointain, entourée d'un monde, vivante dans un au-delà tout en reflétant la terre, portée sur une nuée tout en étant claire. / Oui, il faut transplanter.» Ibid., p. 34.
14.A. Germain, art. cit. note 3.
15.Sur les principes de l'École de Rochefort, nous renvoyons à l'étude majeure de Jean Yves Debreuille, L'École de Rochefort - Théories et pratiques d'un mouvement poétique,1947-1961, Lyon, Presses universitaires de Lyon,1987. Par rapport au mouvement surréaliste, l'étude de Bruno Gelas, « L'École de Rochefort: après le surréalisme? », dans L'École de Rochefort, op.cit. note 12, p. 58-65, peut servir d'introduction.
16.René Guy Cadou, Poésie la vie entière: Œuvres poétiques complètes, Paris, Seghers, 1996. Abrégé OPC, suivi du numéro de page.
17.Voir l'étude de Francine Caron, « Cadou ou les rêveries du sang ou Pluton à la lumière de la poésie », dans L'École de Rochefort, op.cit. note 12, p. 123-133.
18.Le titre même du recueil de Cadou se retrouve dans les échanges épistolaires avec Jacob: « Cette opinion est peut-être due à ce que je ne puis songer à un livre de lui sans songer à toute son intéressante personne, peut-être aussi à ce que chaque œuvre est une étincelle et qu'il ne marche que rarement à pleine poitrine [...] la poésie est la pleine poitrine et les grands poètes Pouchkine, Byron, le Dante [...] ont été des "pleines poitrines" », E, 43.
19. Yvan Leclerc, « René Guy Cadou d'une école à l'autre », dans L'École de Rochefort, op.cit. note

« II ne s'agit point de hurler
Pour se faire entendre » |
L'expérience de la guerre chez René Guy Cadou ou « vivre Uniquement pour l'essentiel »,
par Clotilde Ladre
|

(Retour au sommaire archives)
« Nous n'avons que vingt ans mais pour avoir notre âge.
Il faut avoir vécu des siècles dans l'hiver
Avec le cœur béant et les yeux grands ouverts. »
La guerre a été omniprésente dans la vie de René Guy Cadou. Si ses dates (1920-1951) font apparaître d'emblée qu'il n'a connu réellement que le second conflit mondial, son lien avec le phénomène de la guerre est bien antérieur à 1939. Toute sa vie est marquée du sceau de ce fléau, et cela transparaît de manière plus ou moins consciente dans son œuvre. Il a connu d'abord, pendant son enfance, le traumatisme d'un premier conflit que les récits de son père, Georges, combattant « du côté de Tracy-le-Mont ou de la France », ont rendu mystérieux à ses yeux. Georges Cadou avait en effet été grièvement blessé par un éclat d'obus dans la poitrine.
Mais le rapport de René Guy Cadou à la guerre a aussi été préparé par une confrontation directe avec la mort. L'agonie de sa mère l'a bouleversé, de même que la vision funeste transcrite dans Brancardiers de l'aube lorsqu'il habitait quai Hoche, à Nantes, il voyait passer le matin sur la Loire les brancardiers qui emmenaient à la morgue les accidentés de la nuit. On comprend dès lors pourquoi la mort constitue un leitmotiv dans toute son œuvre poétique. Sa sensibilité exacerbée par ces souffrances précoces rend plus forte encore sa relation à la guerre.
En 1936, la guerre d'Espagne ne laisse pas le jeune homme indifférent. Dans « Les camarades », il déplore la mort de Federico Garcia Lorca, fusillé par des rebelles anti-républicains :
« Et toi le jamais vu Hamlet pâle en tricot
Qui reçus dans tes bras le cher Federico
Ce matin d'hiver en Espagne. »
Enfin, en 1940, peu avant sa mobilisation dans le Béarn, René Guy Cadou est très affecté par la mort de son père ; elle accroît en lui le malaise créé par l'atmosphère générale de cette première année de guerre. Les années qui suivront seront autant de blessures pour le jeune homme, qui verra sa maison bombardée et ses amis mourir (nous pensons notamment à la disparition de Max Jacob, déporté et mort au camp de Drancy, qui laisse René Guy Cadou « comme orphelin »).
« II ne s'agit point de hurler
Pour se faire entendre »2
Un constat s'impose cependant à la lecture de l'ensemble des poèmes écrits entre 1939 et 1945 3: nombreux sont ceux qui n'ont pas de lien — au moins apparent — avec les événements qui secouent l'Histoire. L'amour, en revanche, y est un thème récurrent, comme s'il y avait urgence à le manifester et à le vivre.
Jamais ce poète n'a remis en question le rôle ou l'importance de la Résistance, qu'il compare même dans Conseils et notes à un « miracle d'amour ». Mais il est sévère quant à la « poésie de la Résistance », rappelant à de nombreuses reprises son idéal d'un lien minimal de la littérature avec l'Histoire. À une époque où l'engagement de la poésie apparaît comme un véritable enjeu, René Guy Cadou adopte une position en marge : pour lui, il ne faut pas compromettre l'art en le mêlant à une quelconque idéologie.
La guerre apparaît donc comme une angoisse sous-jacente, une manifestation potentielle de la mort, mais la référence est discrète, implicite, souvent métaphorique. La « morte-saison » qu'il met en mots dans son recueil de 1940 en constitue un bon exemple. En dehors de Pleine poitrine, dont on qualifie souvent les poèmes de « patriotes », les évocations de la guerre sont pudiques, intériorisées.
Mais ces années livrées « aux loups » sont aussi celles de la rencontre d'Hélène, en 1943. Cela explique peut-être le fait que le chant d'amour prenne le pas sur les cris de souffrance. Hélène Cadou écrit joliment à ce propos : « La vie continuait et nous ramenait l'un vers l'autre en cet été de la rencontre, si beau que nous en venions à douter qu'il fût un été de guerre. » 4 A la mort minérale va donc succéder le règne végétal, la célébration de la vie.
« Déchire sur mes dents le bâillon du silence »5
Les poètes ont souvent utilisé la parole comme une arme. Hélène Cadou rappelle cependant que la grenade qui est une munition est aussi un fruit et que chez René Guy la poésie est avant tout la saveur du fruit qu'on veut offrir aux hommes. Mais s'il a choisi de ne pas faire de son art un moyen de propagande des grandes idéologies de l'époque, il n'est pas pour autant resté insensible aux événements qu'il vivait. Au contraire, il a, semble-t-il, voulu être en première ligne pour préserver la dignité humaine. Une large place est faite, dans son œuvre, à la symbolique du corps. Ce qui apparaît finalement, c'est l'importance de l'homme au centre de la poésie. C'est pour préserver ce qui restait d'humanité et de sentiments humains qu'il a choisi de ne pas laisser trop de place aux événements monstrueux, déjà trop présents dans la vie quotidienne. L'engagement de René Guy Cadou pendant la guerre avait donc pour but de réhabiliter l'homme et la poésie. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, d'ailleurs, c'est dans Pleine poitrine qu'on lit le mieux l'explication de sa conduite face à la guerre, notamment dans le poème « Pour ma défense » :
« Je n'ai pas vécu à l'arrière
Mais dans les postes avancés de notre joie. »
Le poète se met en scène au milieu des rafales, cherchant au péril de sa vie à humaniser ce qui peut encore l'être, grâce à son chant. Il y a bien eu un combat de René Guy Cadou; il ne s'agit cependant pas d'une lutte, pied à pied, contre l'occupant ou dans le maquis, mais d'une bataille pour la « joie ». Loin de s'exclure de la communauté humaine, il évolue en son cœur:
« Mais se savoir parmi les hommes
En un présent aventureux
Une petite lampe à huile
Oui peut encore mettre le feu. » 6
Rappelons que cette expression « mettre le feu » signifie aussi bien risquer l'incendie qu'apporter la lumière.
« Toute l'atrocité de la guerre tient justement dans ce miracle d'un oiseau porté par sa complainte et qui souligne de son étrange douceur toute l'étendue du désastre.» 7
Au sein de cette production poétique, nous pouvons conférer au recueil Pleine poitrine un statut particulier. En effet, les dix-neuf poèmes qui le constituent ont tous à titre exceptionnel un lien très proche et revendiqué avec la Seconde Guerre mondiale. Ils dénoncent ouvertement l'horreur et l'absurdité de la guerre, à l'image de ces vers tirés de « Ravensbrück » :
« À Ravensbrück en Allemagne
On torture on brûle les femmes...»
Cette particularité du recueil a d'ailleurs été ressentie par le poète lui-même et ses amis proches, tel Michel Manoll qui lui a reproché à ce moment-là d'« éluardiser ». L'analyse de ces poèmes en prise directe avec l'événement permet cependant de comprendre aisément l'attitude du poète : René Guy Cadou a opposé aux atrocités de l'Histoire la résistance des sentiments humains les plus beaux, dont le chant et le rire sont les symboles. Ces deux motifs reviennent à plusieurs reprises dans Pleine poitrine et apparaissent comme capables de lutter contre les malheurs de la guerre. On les relève, par exemple, dans « Chanson de la mort violente », qui évoque un enfant chantant pour ne pas entendre les bruits de la guerre. L'expression «c hantait à tue-tête » y reprend le thème de l'acte meurtrier, pour le convertir en quelque chose de beau. Les mots du poème ont le pouvoir de transformer et de sublimer toute chose. La chanson de l'enfant est aussi partagée :
« Il chantait la fenêtre ouverte
Et si loin portait sa chanson
Qu'on l'entendit dans les prisons
Où sur les murs blancs de salpêtre
Des hommes reposaient leur front. »
Les hommes qui souffrent sont apaisés par cette chanson et les prisonniers évoqués ici représentent tous les individus alors privés de liberté. Le message est clair : la poésie, comme cette chanson, a le pouvoir magique de transmuer l'immonde en « monde ». Le terme « chanson » est justement utilisé pour désigner le poème lui-même. Il faudrait donc en souligner la portée métapoétique : le poème en général est un acte d'amour, offert au monde pour soigner ses blessures. Conserver cette volonté dans une période si troublée dénote une grande confiance en l'homme.
Jean Rousselot utilise une expression heureuse en parlant au sujet de René Guy Cadou d'une poésie « à hauteur d'homme ». Dans le même ordre d'idées, son ami Michel Manoll dit combien sa poésie est dotée « d'une respiration, d'une chaleur directement transmissible ». Le chant de René Guy Cadou est donc universel, dépassant le cadre d'un conflit précis, fût-il vaste. La poésie est autre chose qu'un engagement dans quelque bataillon que ce soit. Mais l'expérience qu'il a vécue fut tellement vive qu'il n'a pu s'empêcher de la retranscrire dans sa poésie ; celle-ci devint alors une sorte d'antidote aux malheurs qui l'accablaient et il a souhaité la faire partager.
« Parce que la vie est belle et désirable...» 8
Certes, René Guy Cadou n'envisage jamais la guerre comme un état de choses normal, mais il pense — et nous incite à penser — au réveil prochain, à l'importance de l'espoir. On constate dans de nombreux poèmes de Pleine poitrine qu'une bascule s'opère entre les horreurs dénoncées et une impulsion vers l'avenir, tel l'assassinat des « Fusillés de Châteaubriant » où s'impose la fraternité éternelle. Les derniers vers de ces textes expriment systématiquement une survivance de la vie, de la liberté...
Quand la guerre sera finie, il faut que s'opère un renouvellement du monde : demain ne doit pas être une reproduction d'aujourd'hui. On relève dans les poèmes de René Guy Cadou la réitération de l'image du printemps comme métaphore de la renaissance du monde. Il parait bon de rappeler que toutes les atrocités de la guerre contrastaient avec la végétation du printemps 1945 qui était, aux dires d'Hélène, particulièrement belle. Dans « Le 12 août au matin », qui décrit la Libération, on voit combien la beauté de la nature tranche sur les crimes humains : « Il y a des jardins fleuris de flammes rouges... » Le rouge des fleurs fusionne avec le sang versé. Le monde végétal signifie la part de beauté qui reste sur terre et qu'il convient à l'homme de faire resurgir. René Guy Cadou, qui avait passé les premières années de sa vie en Brière, est très sensible à la végétation qui l'entoure, il semble rechercher le corps à corps avec la nature. On comprend donc que le « règne végétal » soit pour lui, plus peut-être que pour tout autre poète, synonyme de vie. La liberté est ainsi dite « couleur des feuilles » (expression qui prend un sens plus fort encore si l'on souligne le parallèle avec le titre d'un poème d'André Breton, « Liberté couleur d'homme ») et « Le 12 août au matin » s'achève sur l'expression « Comme une liberté nouvelle et végétale ».
Le poème « Les Camarades » se termine sur un véritable acte de foi en la résistance de la vie :
« Je serai avec vous au champ à l'atelier
Dans les grands entrepôts silencieux de la vie
Et s'il le faut encore au milieu de l'orage
Dressé
Comme un bel arbre dans le vent.»
Une large part de son œuvre poétique a été composée pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-on envisager qu'un être sensible soit contemporain de tels cataclysmes et n'en souffre pas ? L'écriture peut-elle ne pas être radicalement modifiée lorsqu'il a vécu de telles horreurs ? Qu'on se souvienne, par exemple, de ces vers poignants :
« Sous mon épaule il fait bien froid
Et j'ai des trous noirs dans les ailes. » 9
Sans être véritablement inscrit dans tel ou tel groupe de Résistance, René Guy Cadou a « résisté » et sa poésie, éprise de la grandeur de l'homme et de la liberté, nous invite encore à résister à la haine qui déforme l'homme, lorsque « la vie est enjeu ».
Laissons à notre poète les derniers mots de cette approche ; ils nous éclairent comme l'ensemble de l’œuvre : « L'indice de résistance d'un poète ne s'évalue pas en fonction d'un moment précis mais de l'éternel » 10.
Notes :
1)Le temps qui court, Pleine Poitrine.
2)Usage interne.
3)On compte parmi les recueils composés pendant la Seconde Guerre mondiale les recueils suivants : Années-Lumière, Morte saison, Bruits du cœur, Lilas du soir, Grand élan, La Vie rêvée, Ma Vie en jeu, Hélène ou le règne végétal
4)C’était hier et c’est demain, Hélène Cadou, Editions du Rocher, 2000.
5)Les Poètes prisonniers, Années-lumière.
6)Destin du poète, 1947-1948.
7)Notes.
8)Dernier communiqué, Pleine poitrine.
9)Lettre à des amis perdus, Pleine poitrine.
10)Conseils et notes.
 |
Cadou critique littéraire,
par Jean-Luc Pouliquen. |

(Retour au sommaire archives)
Un poète aussi engagé dans son art que René Guy Cadou ne-pouvait limiter son écriture au poème. Il lui était nécessaire de l'accompagner de notes, de lettres, d'articles, de livres même, pour se situer, dire ses choix, ses préférences, témoigner de ses sympathies.
Ainsi, sans l'avoir prémédité, il s'est retrouvé être lui-même critique littéraire alors qu'à l'origine il manifestait à l'égard de cette activité une certaine distance pour ne pas dire méfiance ou hostilité.
C'est dans Usage interne, cette suite de notes écrites entre 1946 et 1949 à Louisfert, qu'il nous le dit, nous expliquant ce qu'il reproche à la critique, ce qu'il attend d'elle et comment il l'envisage. C'est dans ces notes, en fait, qu'il définit sa propre conception de la critique, celle qu'il s'est attaché lui-même à pratiquer.
Attardons-nous sur trois d'entre elles qui méritent un commentaire. La première commence de la sorte : « Jean Rousselot, dans des "Réflexions sur la poésie", écrit que "si les poètes, à leur tour, se mettent à parler de poésie, ils ne tarderont pas à ne plus pouvoir en faire" (Profil littéraire de la France, n° 17). » Voilà Cadou entraîné par son ami Rousselot, ce compagnon de la première heure, dans le vieux débat entre le faire et le dire, ceux qui agissent, qui créent, et ceux qui parlent, qui glosent. Rousselot est méfiant, Cadou est plus optimiste. « Voilà une opinion quelque peu aventurée », écrit-il, mais il cherche tout de suite à comprendre la position de son ami en ajoutant: «Je sais que durant la période où furent écrites ces notes (aux environs de 1944) toute une nuée de poètes plus esthéticiens que poètes, généralement professeurs de lettres ou de philosophie, s'employèrent du haut de leur chaire à considérer et surtout à déconsidérer la poésie. Cet épisode seul de la vie littéraire peut justifier l'interdit jeté par Rousselot.»
Notre poète se réfère à ce qu'il pense être un épisode de la vie littéraire. Nous savons qu'il s'est répété depuis et que la catégorie des professeurs continue d'occuper sa place dans la critique de la poésie. Peut-être même que celle-ci a pris encore plus d'importance aujourd'hui. Nous comprenons bien que Cadou, bien qu'enseignant lui-même, n'est pas de leur côté, par les mots qu'il emploie à leur égard : « Plus esthéticiens que poètes, du haut de leur chaire, surtout à déconsidérer la poésie. » Il n'a rien à attendre de ces gens-là.
Mais cela ne signifie pas pour lui qu'un discours sur la poésie soit impossible. Il en a lu, qui l'ont nourri, l'ont aidé dans sa recherche et son aventure avec la langue. Alors il le dit et propose une liste d'écrits qui vient faire contrepoids à toute cette prose qu'il refuse. Sur cette liste figurent Mon cœur mis à nu, la préface du Cornet à dés de Max Jacob et son Art poétique, Self-défense et Le Gant de crin de Pierre Reverdy, Tel Quel de Valéry, Armes et Bagages de Michel Manoll, Le Paysan de Paris d'Aragon ou encore des essais d'André Breton. Dans des articles qu'il a lui-même donnés à des revues de poésie (Les Lettres, Les Essais ou encore Le Journal des poètes), il a déjà eu l'occasion de le faire savoir. On reconnaît dans les noms cités ses Maîtres, quelques grandes figures historiques de la poésie et ses pairs. Le point commun à tous ces livres est qu'ils ont été écrits par des poètes. Pour Cadou, ils « ont plus fait pour la compréhension et pour l'honneur de la Poésie que les études souvent très judicieuses d'une critique assermentée qui a nom : Thibaudet, Arland, Caillois, Lalou, Paulhan, Béguin, etc. » Il est évident qu'il se range du côté d'une critique buissonnière, spontanée, en marge, écrite par ceux qui forgent la langue, et qu'il prend ses distances avec ce qu'il considère comme la critique établie envers laquelle il émet des doutes. Mais on remarque au passage qu'il la connaît bien et a lu ses représentants les plus éminents.
Mais quels sont au juste les reproches de Cadou ? La deuxième note nous l'apprend : « Il manque à tous les spécialistes cet amour qui est le bien inaltérable des hommes du bâtiment. » Voilà le pavé lancé dans la mare. Tout cela manque d'amour. On pourrait le redire encore aujourd'hui et retomber sur ce clivage entre une province qui se veut à la fois le corps et le cœur du pays et une capitale qui en serait la tête. La tête privilégie le raisonnement, la théorie, le calcul ; elle est dans une logique de dessèchement. Cadou veut l'éviter à tout prix. Ses fidèles n'ont pas oublié ses vers :
« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris?
Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys ! »
Cadou n'ira pas à Paris et restera fidèle en poésie comme en critique littéraire à une conception première de la vie, irriguée par les élans du cœur. Sa référence aux hommes du bâtiment est à lire à deux niveaux. Ces derniers travaillent dans la sueur et durement avec leurs mains, ils appartiennent au peuple, à ce peuple dont il ne veut pas se séparer. Il ne troquera pas sa solidarité contre une gloire littéraire parisienne dont il a bien vite mesuré toute la facticité. Les hommes du bâtiment sont aussi ceux qui érigent les monuments, les autres ne font que les regarder et dans le pire des cas, émettre des jugements.
Dans la troisième et dernière note apparaît tout le rejet du poète pour cette attitude. « Les critiques, écrit-il, installent la poésie sur une table à dissection au marbre froid comme leur encre. C'est dans la mesure où la poésie vérifiera telle loi, s'approchera le plus près de telle constante, qu'ils se prononceront en sa faveur ou en sa défaveur. » Nous sommes bien loin d'un élan amoureux. Et Cadou d'enfoncer un peu plus le clou : « Le rôle de la critique est de constater, c'est une opération de simple police. Le procès-verbal rédigé, dans le style huissier ou adjudant de service, ne permet pas au poète de se justifier. "Vous aurez huit jours" ou bien "Je vous fous dedans". Voilà quelles sont les formules en usage dans les tribunaux de poésie. »
Ses propos sont abrupts et certainement excessifs. C'est un homme qui n'a pas trente ans qui s'exprime. Il a la fougue de sa jeunesse. Personne ne songerait aujourd'hui à associer cette attaque incisive aux noms de Marcel Arland, Jean Paulhan, Roger Caillois ou Albert Béguin par exemple, tant leur apport à la critique littéraire est inestimable. Mais il était utile pour Cadou de la porter, ne serait-ce que pour lui-même, pour asseoir sa propre critique. Elle a une valeur fondatrice. Dans une perspective similaire, on peut penser aux jugements sévères et blessants de François Truffaut avant qu'il ne commence lui-même à tourner, du temps où il écrivait des critiques de film. Il lui fallait certainement en passer par là pour qu'une nouvelle vague du cinéma vienne recouvrir l'ancienne, sans toutefois l'effacer.
Alors que nous propose Cadou comme critique littéraire ? Grâce à l'éditeur René Rougerie, nous disposons de deux ouvrages qui en rassemblent l'essentiel et sur lesquels nous allons nous attarder. Le premier s'intitule Le Miroir d'Orphée. C'est un regroupement de différents articles parus en revue ainsi que de transcriptions d'émissions données à la radio, entre 1946 et 1950. Le second, Le Testament d'Apollinaire, est une monographie consacrée au poète d'Alcools. Elle a été écrite entre 1943 et 1944.
Commençons par Le Miroir d'Orphée. Il nous renvoie la propre image du poète au travers de tous ceux dont il nous parle. Ce livre est un partage, une offrande que Cadou nous fait de sa vie en poésie. Alors on le suit aux côtés de Pierre Reverdy, Blaise Cendrars, Apollinaire, Michel Manoll, Francis Jammes, Max Jacob, Saint-Pol Roux, Roger Toulouse, Louis Parrot, Robert Desnos, Tristan Corbière, Milosz. On sait désormais que son écriture est guidée par l'amour. C'est par Max Jacob qu'il a appris que l'on pouvait « changer son cœur en encrier ».Avec passion, le poète nous guide aussi dans l'œuvre d'Eugène Dabit, sur les pas de Fantômas. Il veut nous faire goûter au merveilleux poétique dans le roman populaire. Plus tard il nous entraînera dans sa ville de Nantes, transfigurée par lui en « cité d'Orphée ». Et parce qu'il croit à ses vertus, il nous montre encore quelle place peut occuper l'humour dans la poésie.
Cet ensemble est à contextualiser. Cadou s'inscrit dans une histoire de la poésie dans laquelle il veut jouer un rôle. Il appartient à la génération qui succède au surréalisme. Il est critique à son égard, il en a mesuré tous les apports ainsi que les impasses. Les liens étroits qui l'unissent à Pierre Reverdy et Max Jacob, eux-mêmes aînés des surréalistes, lui donnent légitimité à vouloir proposer une autre voie, celle-ci a pour nom « surromantisme ».
L'article intitulé « Présence d'un surromantisme » peut être considéré comme la clef de voûte du Miroir d'Orphée. Il condense toute la singularité et le génie d'une écriture critique venant d'un poète. « Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, doit en effet se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire par un phénomène de prémonition, se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore mais sûrement deviendra », y affirme Cadou.
Seul un être inspiré pouvait écrire ces mots. Ils nous font comprendre pourquoi, comme poète ou comme critique — nous pourrions ajouter comme romancier —, René Guy Cadou est toujours vivant parmi nous.
Le second livre, Le Testament d'Apollinaire, porte en sous-titre le mot témoignage. On saisit bien que là encore le poète n'a pas voulu faire œuvre de froide érudition. Il s'en explique d'ailleurs lui-même dans la préface : « Si j'ai enfin décidé de me "mettre à table" (c'est bien ainsi que dans l'argot de police on désigne la parole forcée) c'est qu'il est vraiment nécessaire de cerner par le langage toutes les forces vives qui taraudent le cœur à la lecture d'Apollinaire. Aussi n'est-il pas question de faire un livre avec les livres. Il s'agit pour moi de concrétiser un élan, une flamme, d'élever dans vos yeux la claire statue de mon amour. »
La ligne de conduite reste la même. Elle n'a pas empêché un travail de recherche, de collecte de données, d'échange avec des proches d'Apollinaire. Mais celui-ci reste subordonné à l'élan de sympathie. Si bien que parfois la fable a remplacé la stricte vérité factuelle. Aussi, comme le montre avec pertinence Georges-Emmanuel Clancier dans son introduction, l'essentiel est ailleurs :
« Au vrai, ce qui fait le charme et l'intérêt du livre du cher Cadou, c'est de nous faire entendre la résonance profonde qui s'établit entre la sensibilité émerveillée émerveillante des deux poètes. »
En somme, pour René Guy Cadou, la critique littéraire n'aura été qu'une autre manière d'incarner et d'approfondir sa condition de poète.
 |
La maison poésie,
par Jean Claude Valin. |

(Retour au sommaire archives)
La maison d'école, je n'ai pas trop de peine à en habiter le thème, j'y ai vécu une bonne partie de ma vie.
La poésie, c'est ce qui fait que le mot maison est habitable, par la rêverie mémorisante, imaginante et éventuellement écrivante sur de la matière bachelardienne oscillant entre vécu et langage. Et ce que les mots disent c'est, dans l'ouvert des sens multiples, la polysémie des possibles, un arrière-pays des mots qu'ils masquent autant qu'ils le révèlent avec sa coquetterie des sous-entendus. « Gedichten das heiszt unter dem Wort das Urwort flnden », écrit Novalis, c'est-à-dire « Faire poème, cela signifie derrière le mot trouver l'arrière-mot. »
Les mots parlent dans le poème comme l'école bruissante des premières jouissances langagières de l'enfant, mais ce n'est pas pour se réduire et nous réduire à « Passe-moi le sel, s'il te plaît », à la fonction objective et pratique du langage. Dans sa Poétique de l'espace, Bachelard tourne autour du mot « maison » avec l'arbre, la hutte, le nid, la coquille, le rond, l'immensité de l'intime, la miniature, les coins, le dedans-dehors et le dehors-dedans, les portes et fenêtres, la cave, le grenier, les tiroirs, coffres et armoires, la maison-univers, car la maison c'est le prolongement du corps vers l'univers et l'album de notre « métaphysique concrète », autre définition de la poésie selon Bachelard.
Les institutions en charge de la poésie à Paris s'appellent l'une « Maison de Poésie » et l'autre « Maison de la Poésie », il fallait que la pulsion imaginante associant les deux mots fût forte pour qu'on prît le risque de la confusion. Deux mots clefs, et l'association de mot et de clef illustre aussi la prégnance de cette poétique de la maison aux origines du langage et de la poésie.
C'est sa propre maison fantasmée que l'enfant apprend à revivre sans cesse dans les formes d'un imaginaire codifié par le langage de l'école et c'est soi-même qu'il apprend à connaître ainsi, comme le montrent abondamment et significativement les dessins et peintures de la maison archétypale et spontanée par l'enfant qui vient d'accéder à la parole, à l'expression possible des fantasmes les plus originaires mais refoulés et défoulés dans dessins et peintures.
Tout enfant à l'école vit cette ambivalence entre l'interdit et le permis, le code et la spontanéité, la règle et l'expression libre, le soi et le groupe, la maison familiale et la classe. Quand moi, l'enfant d'« instits» et de la bonne confusion, j'eus à en vivre la rude opposition, c'était dans le dur hiver 1945 où il n'y avait pas grand-chose et rien de bon à manger à l'internat du collège, et où il gelait dans les dortoirs et la salle d'eau qui ressemblait aux abreuvoirs d'étables, le pion à qui je demandais une couverture de plus sur mon lit, « Msieu chez moi j'ai un gros édredon et plein de couvertures », m'envoya rudement balader : « Oui mais ici t'es pas chez toi, mon bonhomme!»
L'enfant de l'instit qui habite la maison d'école vit l'ambiguïté entre famille et village ou quartier, la confusion des genres quand, à la table de la cuisine ou de la salle à manger, le père ou la mère incarne le censeur de la table de multiplication et de toutes les règles de grammaire et de tous les règlements sociaux, et quand la petite histoire familiale est l'occasion de rappeler la grande Histoire avec un grand H et une grande hache. Les enfants Brontë, le petit Vincent Van Gogh ou Ingmar Bergman ont fait parfois dans la douleur germinatrice de créativité l'expérience du père pasteur et recteur puritain un peu terrifiant dans un environnement de même. Les « hussards noirs » de la IIIe République française n'étaient pas dépourvus d'un certain puritanisme dans leur morale et leur mise vestimentaire, tout en étant aussi les passeurs de l'imaginaire à travers des textes émouvants, des poèmes pour la récitation, fussent-ils d'une poésie convenue corsetée à la Heredia, Leconte de Lisle, Coppée, Samain ou Sully Prudhomme, les Parnassiens ayant la prédilection des manuels scolaires et du goût des instits d'avant la dernière guerre.
Quand bien même le père de l'enfant n'en écrivait pas, de ces poèmes néoparnassiens bien moulés dans la forme, mais parfois portant trace d'une certaine folie langagière, d'un daïmon poétique. Mon père fut prix Verlaine de l'Académie française. Le père Cadou montra à son fils, avec qui une complicité s'établit après la mort de sa mère, de gros cahiers de ses poèmes et ce fut, et c'est toujours, un avatar du complexe d'Œdipe bien original et bien originel d'une émulation passionnée.
Si l'imprégnation de la classe s'infiltre dans la maison, l'inverse se produit également. Infiltration de la vie extérieure dans la vie intérieure de la maison organiquement unies dans le vécu. J'avais tout enfant éprouvé ce sentiment de profanation, mais pouvant être délicieuse, par les écoliers envahissant la cour de l'école qui était aussi la nôtre privative, la classe où j'étais chez moi avant leur arrivée. Ils y apportaient des senteurs de terre, de végétal, de ferme, des odeurs de corps humains et animaux, des parlers criards, des patois, de la bousculade, de l'imprévu, cela pouvait me fasciner, m'attirer ou m'agacer selon. J'étais jaloux des bouquets de fleurs que les galopins apportaient à ma mère. De l'écureuil mort, du hérisson vivant, des fossiles trouvés en labourant qu'ils apportaient à mon père. Chaque matin, la rentrée était porteuse de cette invasion de sentiments mélangés, ambigus, récusant mes privilèges d'enfant-roi dans mon fief. Et que dire de la rentrée après les grandes vacances où j'avais oublié ces grandes invasions des barbares ? Parfois, c'était la réunion, le soir dans la classe, des chasseurs ou des parents d'élèves, et j'entendais de mon lit ces voix étrangères. Quand ce ne fut pas, même, la réunion, convoquée par un sous-officier de la Kommandantur, des producteurs de Kartoffeln ou de porcs quand la salle de la mairie s'avérait trop petite. La profanation elle-même participe du sacré.
Et tant de vases communicants, de tuyaux, de fuites et d'entrées entre le village et notre maison me donnaient des chances et de l'importance : mon père secrétaire de mairie, maître des tickets de ravitaillement, monnaie de tous les échanges, mon père résistant engagé dans des actions clandestines risquées auxquelles il m'associa (poste émetteur vers l'état-major allié, apporté via l'Espagne par le colonel Rémy et caché dans un pailler de ferme, parachutages, atterrissages de nuit dans un champ de maïs entre des torches, bombardements par les Lightnings P 38 de Thouars, sa gare de triage importante et son usine d'armement, pendant lesquels nous nous réfugiions dans la profonde cave taillée dans le roc d'Ulysse le bouilleur de cru et vigneron ami). J'ai aidé mes petits camarades paysans aux travaux des fermes. Les Allemands exigeaient que les classes ramassent les doryphores verts bariolés et leurs larves rouges sur les feuilles de pommes de terre, le tout gluant et répugnant dans les seaux fabriqués avec les grands pots de confiture en fer-blanc ou les boîtes de conserve, percés de deux trous pour l'anse d'un bout de fil de fer. Tous accroupis 2, et les garçons regardant entre les cuisses des filles.
L'enfant de l'instit est à la fois choyé et détesté par les élèves de l'école, bien entendu.
Envahissement de mon domaine par la vie du village et même invasion de nos bâtiments par des centaines de réfugiés du Nord et de l'Est pendant l'exode de mai-juin 1940, ils sont restés tout l'été sur la paille dans les deux écoles et dans les salles désaffectées de la mairie, j'ai joué ensuite pendant des années avec des vêtements, des jouets, des sacs à main, des miroirs, des photos, des objets mal identifiés abandonnés là. Un officier polonais m'a fait cadeau d'un petit appareil photo en bakélite que j'ai sous les yeux en écrivant cela. « Et c'est ainsi qu'on écrit l'Histoire » était une formule rituellement répétée par mon père. Le drapeau tricolore était rangé au milieu de nos balais dans un placard. Un jeune crocodile empaillé offert à l'école par un officier colonial en 1900 faisait partie de mes dieux lares. Le public et le privé se mêlent dans la maison d'école, son « espace potentiel » et ses « objets transitionnels » pour reprendre les concepts du psychanalyste anglais Winnicott, et l'ambivalence y entretient son va-et-vient entre le dedans et le dehors propre à un certain délire fertile.
La classe de mon père ou de ma mère et celle de ma femme furent reliées à la maison-mère (habitée par notre être profond) par le cordon ombilical de la naissance à la communication sociale, la parole et l'écrit qui donnent son sens au mot « classe ». Couloir, corridor, escalier, entre l'intime, le vécu viscéral et sentimental de l'habitation et le solennel, le code social et linguistique de la classe, j'ai plusieurs fois par jour passé de l'un à l'autre versant, et parfois seul, la nuit, en tâtonnant avec la seule aide d'un rayon de lune dans les hautes croisées pour marcher pieds nus, pour ouvrir sans bruit les portes, pour me faufiler entre les rangées de tables, pour m'asseoir à ma place habituelle déshabituée alors, ou celle d'un condisciple admiré ou haï, ou bien à la place de mon père ou de ma mère ou de ma femme dans le silence pesant de la nuit entre les cartes de géographie et d'anatomie au mur, le globe terrestre qui tournait en le frôlant, les pots en étain avides des rayons de lune sur l'armoire, les livres derrière la vitre de la modeste bibliothèque. « Prenez vos cahiers, écrivez la date en haut de la page, puis le titre : Louis XIV, le Roi-Soleil, quatorze en chiffres romains » ...
À l'école de La Ronde, village frontalier de la Vendée chouanne, mes parents ne remplissaient leurs deux classes de l'école publique qu'avec les enfants des dissidents de la Petite Église, communauté de réfractaires au serment des prêtres à la Révolution dans la commune voisine de Courlay (patrie d'Ernest Pérochon, prix Goncourt 1920 avec Nêne qui enchanta mon enfance, et passé comme mon père par l'École Normale d'Instituteurs de Parthenay), les parents respectant plus que les catholiques le carême avant Pâques, les enfants n'avaient qu'une pomme et une tartine de pain pour le repas de midi, ils pleuraient d'avoir faim, étaient inattentifs l'après-midi, mes parents étaient tentés de les nourrir et alors mécontenter les parents qui enlèveraient leurs enfants de l'école publique. L'école de La Ronde a fermé. Les cinq classes sont passées à l'école privée.
Germaine habitait tout contre notre préau. Elle me gardait en l'absence de mes parents. J'ai adoré me blottir contre ses seins de treize ou quatorze ans. Les grandes filles du Certificat aidaient à la maison. Les grands garçons, au jardin. Dans le monde entier, la maison d'école est le lieu de ces ambiguïtés nourricières, de ces confusions équivoques et ambivalences vécues par l'enfant comme des failles dans le réel où le poétique peut germer.
Chez mon grand frère, le poète René Guy Cadou (et il me plaît que ses souvenirs Mon enfance est à tout le monde aient été achevés d'écrire à Murols en Auvergne où nous nous sommes probablement croisés autour de la fontaine-abreuvoir des bovins au cœur du village où j'accompagnais le soir les bêtes que je gardais au pied du château féodal en ruine avec le compaing de la ferme voisine de notre maisonnette de vacances), chez Cadou qui avait vécu avec en lui le sceau, marqué au fer des origines, de sa maison d'école natale de Sainte-Reine-de-Bretagne en Brière ou celle du quai Hoche à Nantes, la maison pleinement sienne d'adulte encore à venir a été d'abord réduite à une chambre d'hôtel ou de location passagère précaire et pauvre, réduite dans certains poèmes à une mansarde à peine meublée, comme en navigation dans le ciel, une sorte de maison nomade pareille à une roulotte de bohémiens, une chambre au dépouillement obsédant comme le dénuement du jeune Cadou, orphelin de mère puis de père, et prenant conscience d'une condamnation à une solitude essentielle qui peut être aussi le signe d'une grâce et d'une grandeur d'âme (« Il faut être seul pour être grand mais il faut déjà être grand pour être seul »), cette chambre dans son œuvre de 1938 à 1942 est pareille à celles qu'on trouve dans l'œuvre de ses maîtres Pierre Reverdy et Max Jacob, triste et chaulée et nue. La vraie maison, meuЫéе et peuplée, attendra que la vie de Cadou se meuble et se peuple.
J'ai déjà (dans «Le chant profond de René Guy Cadou », in Un poète dans le siècle, actes du colloque de Nantes en 1997, éditions Joca Séria, 1998) sinon soutenu la thèse du moins avancé l'hypothèse que la mutation (vers 1942-1944 avec La Vie rêvée et Lilas du soir) entre la dissémination reverdienne des images analogiques et centrifuges où séminent à tous vents le sens caché (caché aux yeux et à la main du poète lui-même : créer, c'est faire ce qu'on ne sait pas faire) et la raison d'être existentielle, biographique, du poème d'une part et d'autre part, cette dissémination étant cependant maintenue par principe car elle est le moteur et le mode de fonctionnement mêmes de la pulsion poétique passant par le langage, les poèmes de moins en moins hachés et de plus en plus liés du point de vue syntaxique, plus soumis à une cohérence, un recentrement logique, l'hypothèse donc que cette évolution passant aussi d'une lecture plutôt visuelle (et cubiste) auparavant à une lecture plutôt vocale (à haute voix de la «pleine poitrine »), et même comme je l'ai indiqué dans l'étude citée, à une propension au dialogue, fût-ce avec soi-même (un toi qui est une partie du moi) ainsi que Christian Moncelet l'avait bien vu dans son livre Les Liens de ce monde (éditions Champ Vallon), l'hypothèse que biographiquement cela correspond à une moindre errance de village en village, à une vie moins aléatoire, à la rencontre avec Hélène, à l'amour et le don de soi concentrés sur une personne, et un œuvre à faire dont la nature et l'envergure et l'ambition se dessinent plus nettement, à l'espoir de l'ancrage de longue durée dans un paysage, un village, une maison, une famille, un mode de vie et le style d'écriture qu'il engendrera.
On part des « Maisons du destin » (in L'Aventure n'attend pas le destin) :
« Il y a des maisons dont je n'approche guère
Que par un mouvement timide de la main
Des maisons qui n'ont rien pour elles que des portes
Toujours béantes sur la tartine d'un enfant »
où tout est triste et désespérant, le vent maigre, la pluie ne chante pas, le ciel vacille, le poète veille avec sa lampe-phare dans la nuit sur les pauvres affamés de bonheur.
On passe par « La Maison du Crève-cœur » (in La Vie rêvée), encore peu réalisable, fragile, frêle, flottant dans l'imaginaire, marquée par les blessures fantasmées mais dont le visage de craie chante (volets de verdure, oiseau, horloge, rideau, voix, noms marins, soir, sang, cheminée, une étoile descend...)
« Maison de solitude ô maison vagabonde
Toi qui flottes plus haut que la poussière blonde
Et tends vers Dieu tes joues plus fraîches que nos mains
Le ciel est dans tes murs, montre-nous le chemin »
Maison qui ouvre, qui permet le départ, le voyage de la vie, la quête du sens. N'est-il pas remarquable que le seul roman qu'écrivit Cadou, La Maison d'été (éditions Le Castor Astral), ressasse ce thème ? On arrive à « Moineaux de l'an 1920 » (in L'Héritage fabuleux,1948-1949)
« Je suis debout dans mon jardin
[…]
l'inclinaison natale ... Les oiseaux...)
Un train sans voyageurs passe dans la forêt3
Je vais jaillir du sol comme une tulipe
L'appareille tout seul vers la Face rayonnante de Dieu
Crachez sur moi
Crachez bien droit
Comme des hommes
Cadou s'en moque. »
C'est-à-dire qu'il est parvenu à une forme de souveraineté, sinon de sérénité. Voilà ce que permet la vraie maison définitive, celle du « cœur définitif», c'est-à-dire bien définie, où l'on sait ce que l'on peut en attendre, où le poète a trouvé ses « marques » comme on dit, ses repères pour le voyage vers le sens, le salut.
La chambre des pauvres commencements était une barque à la dérive, la maison finale est une Arche du salut personnel et aussi bien collectif à travers l'œuvre de poésie : « La blanche école où je vivrai » (in Les Amis les anges) tiendra sa vie de la poésie, de l'osmose avec le pays, de l'amour d'Hélène et pour elle, et des enfants-fleurs de l'école à défaut d'être les enfants de René et d'Hélène. Maison-mère, maison-femme, maison-terre, maison-paysage, maison-souvenir, maison-avenir (« Le souvenir n'est que la connaissance du futur que nous percevons à travers le passé »), la maison-totale permet d'être au centre de son propre monde et, si l'on peut dire, au centre de soi-même, et de pouvoir dire qu'avec quelques êtres et choses privilégiés, choisis, essentiels, « Je recommence le monde» (dans « La Solitude », in Les Sept Péchés capitaux,1949).
Dans « La Saison de Sainte-Reine» (dans Les Visages de solitude, in Hélène ou le règne végétal), qui commence par « Je n'ai pas oublié cette maison d'école », se mêlent le familial privé et le scolaire public, dans l'équivoque et l'ambiguïté que j'ai tenté d'évoquer.
« J'ai toujours habité de grandes maisons tristes » (dans Les Visages de solitude, in Hélène ou le règne végétal 4) insiste sur la maison comme révélation du Soi, le secret de mon identité :
« J'ai choisi mon village à des lieues de la ville
Pour ses nids sous le toit et ses volubilis »*
« Louisfert » (in L'Aventure n'attend pas le destin), c'est le terme du voyage, René y mourra dans la chambre du haut alors que la tempête qui accouche du printemps secoue la maison d'école, dans le village « emmuré de forêts » pour être plus aisément mystique, légendé :
« Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps
Je marche les pieds nus comme un petit enfant »
(et un saint François d'Assise), alors la prosodie a pris son ampleur, l'amble de sa marche à l'étoile, la métrique a pris la liberté totale de dérouler de longues laisses au souffle claudélien (sans oublier Whitman, Segalen, Saint-Pol Roux, Paul Fort, Francis Jammes) alternant avec des vers courts, versets de plus en plus libres, avec des jeux de sonorités subtils.
Hélène a bien résumé le parcours : « Il nous parle, avant tout et toujours d'une maison d'école qui n'est jamais la même, mais une école vingt fois répétée entre Sainte-Reine et Louisfert, entre la naissance et la mort. Une école, c'est une grande bâtisse, un peu en marge du village, à la fois lieu d'attraction et lieu de désertion. La vie de l'éсоlе bat comme un pouls. On accourt à l'école, le matin, de tous les hameaux, dans la journée celle-ci bourdonne puis se vide, soudain, le soir, en un instant. Des volées d'enfants se dispersent, seul demeure celui qui habite l'école de par sa propre destinée. La vie de Cadou, de même que sa poésie est rythmée par celle de l'école. Il a besoin de ce lieu en porte-à-faux pour écrire. Il habite, en quelque sorte, l'inhabituel et cette singularité lui convient et l'angoisse tout à la fois. » (Une vie entière, éditions du Rocher.)
Avant de terminer sur les deux poèmes célèbres célébrant la maison, je salue mon plus qu'intime ami, frère d'âme, le poète Daniel Reynaud (1936¬2004), digne héritier de Cadou — dont je publie les Œuvres complètes (éditions Le Vert Sacré) — et qui aima tellement écrire des poèmes à la craie blanche sur le tableau noir de la classe de ma femme, dans un état second de rêverie régressive et parfois trop alcoolisée, que tard dans la nuit sur la pointe des pieds je l'abandonnais à ce suspens du temps. Ces poèmes que le matin Helyett devait recopier avant de les effacer avec l'éponge humide, il aurait fallu pouvoir en photographier la belle écriture calligraphique où scolaire et poétique se rejoignaient.
On ne peut terminer une telle ébauche d'une étude pour laquelle il faudrait tout un ouvrage, sans citer les deux poèmes suivants parmi les plus cités et récités de Cadou. Dans le premier, la maison du poète a trouvé sa plénitude (et Cadou avec elle), elle est devenue quasiment cossue avec ses grands meubles noirs et taciturnes qui ont pouvoir poétique et magique de ranimer l'inanimé, de lui rendre la vie avec la complicité de l'arbre en fleur, de tout le cœur de la forêt avec ses cris d'oiseaux, la complicité dans le jeu analogique de la dissémination des mots clefs de l'imaginaire cadoucéen, lampe, femme, pain, légèreté, solitude fertile, matin, comme si la maison de poésie permettait de revivre le temps retrouvé du premier matin du monde, ce que Rilke appelle « tant de beauté dans tout ce qui commence ».
Enfin, sur le mode chantant bref et simple comme sont les poèmes patinés qui semblent venir du fond des siècles, « Automne » (saison mentale du grand frère Apollinaire, qui n'est pas étranger à cette image de l'odeur du temps) : pluie et soleil ensemble tenus par l'arc-en-ciel serait une assez juste analogie de la mémoire. L'effet tragique dans sa douceur (et mystique au sens d'une espérance indéfinie) que produit le dernier soleil de la vie pour un enfant de sept ans SE retrouvant dans SA maison (il faut marquer la force du redoublement par l'insistance de la voix, et en cela l'oralité acquise de la poésie de Cadou à son épanouissement montre bien son importance), cet effet ambivalent explique le succès de ce poème dans les anthologies. Je n'ai jamais rencontré de lecteurs et mieux encore de mes anciens élèves de lycée par milliers qui ne se souviennent avec émotion de ces merveilleuses poussières du temps déposées sur la mémoire, qui aura toujours sept ans (ici l'âge de raison et l'âge de maison !).
Nombre d'écrivains et poètes enfants d'instits ont écrit ce qu'ils doivent à leur maison d'école parentale, on n'aurait pas de peine à composer sur la maison d'école une Anthologie (ou Hante-au-logis). On voudra bien me pardonner d'avoir présenté en quelque sorte un plaidoyer pro domo.
« Automne
Odeur des pluies de mon enfance
Derniers soleils de la saison !
À sept ans comme il faisait bon
Après d'ennuyeuses vacances,
Se retrouver dans sa maison !
La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées,
Sentait l'encre, le bois, la craie
Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été.
Ô temps charmant des brumes douces,
Des gibiers, des longs vols d'oiseaux,
Le vent souffle sous le préau,
Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau... »
Notes
1. Gaston Bachelard (1884-1962), philosophe des sciences et de la poésie.
2 On dit «à-tchu-pia » en poitevin, c'est plus imagé 1
3.Alexandrin que Daniel Reynaud considérait comme l'un des plus beaux, plus émouvants.
4.Règne Végétal, et Rendez-Vous (final).
5.« Celui qui entre par hasard », in Les Biens de ce monde.
 |
Cadou et les noms propres,
par Christian Bulting |

(Retour au sommaire archives)
Les noms propres dans l'œuvre poétique de René Guy Cadou : vaste question puisqu'un relevé systématique en dénombre environ 600, sur les 345 pages grand format de Poésie la vie entière 1(nous avons ôté les dialogues poétiques de « Lilas du soir » pour ne nous attacher qu'aux poèmes). Soit près de deux noms propres par page. Ce qui confirme notre intuition issue de la lecture nomade de l'œuvre à travers les années : la présence constante, essentielle de ces noms propres dans la poésie de René Guy Cadou. Être poète c'est nommer, et particulièrement nommer en propre.
Dans cette nébuleuse, on peut distinguer plusieurs ensembles. Tout d'abord l'être le plus nommé, et de loin (120 fois) est l'être par excellence, Dieu (également appelé Seigneur). Et ceci du début de l'œuvre, « Les lettres à Dieu que j'avais commencées » (p. 17, troisième page de poèmes), jusqu'à son point ultime : « Seigneur vous moquez-vous de moi ? / Serait-ce là mon fils ? » (« Tout amour », dernier poème, 1951). Dieu est ainsi nommé à travers toute l’œuvre de manière permanente, récurrente, insistante. On pourrait s'étonner de cette persistance. En effet, Cadou vient d'un milieu laïc. Qui sema cet appel vers Dieu qui résonne à toutes les pages de son œuvre ? Sœur Chantal, qui dirigeait la maison hospitalière à Sainte-Reine-de-Bretagne, le village de son enfance ?
Autour des noms « Dieu » et « Seigneur », toute une galaxie de noms liés à la religion chrétienne se déploie : Jésus-Christ (21 fois), Marie (appelée parfois « Vierge », 9 fois), Véronique (5 fois), Joseph (4 fois) mais aussi saint Antoine, sainte Madeleine, Joseph d'Arimathie, Job, Noé, Hérode, Jérusalem, Golgotha... Simple imprégnation de culture catholique ? Influence de Max Jacob (272 lettres et méditations spirituelles envoyées à Cadou entre 1937 et 1944) ? Ou foi profonde ? Évidence ? « Je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement » (p. 318). Rapport personnel d'être à Être. Indifférence à l'Église, aux rituels, au merveilleux. « Je ne crois pas au miracle de Lourdes » (« Credo », p. 339). Ce qui retient, ce sont les Écritures, qui mettent en scène des personnages à la fibre authentiquement humaine'.
Deuxième ensemble, les noms de lieux. Ce sont les plus nombreux (environ 150). La géographie qu'ils délimitent est avant tout affective. Beaucoup sont liés à l'histoire du poète : le village d'enfance, Sainte-Reine-de-Bretagne en Brière (ce dernier nom étant lui-même plusieurs fois utilisé), le quai Hoche à Nantes (3 fois) où l'adolescent vécut, et où de sa fenêtre il voyait sortir les brancardiers de l'aube de l'Hôtel-Dieu, en face, sur l'autre rive de la Loire. De Nantes, il retient en outre la place Bretagne (3 fois), où Michel Manoll tenait une petite librairie, la rue du Bocage où Breton soignait les blessés de guerre, où il rencontra Jacques Vaché, le même « qu'on trouva mort en un hôtel place Graslin» (« La cité d'Orphée », p. 298), suicidé d'après la légende que construisit l'auteur de Nadja — en fait ayant succombé à une overdose d'opium. Les villages où le jeune remplaçant fit des suppléances sont mentionnés : Mauves-sur-Loire, Saint-HerЫon, Saint-Aubin-des-Châteaux. Louisfert, de 1945 jusqu'à sa mort en 1951, Cadou fit la classe, est nommé à différentes reprises avec un poème qui lui est entièrement consacré (p. 228-229). Les lieux où vivent les amis sont désignés : Bourgneuf-en-Retz (Chiffoleau), Saint-Calais (Manoll)... Et bien sûr, Rochefort-sur-Loire où Cadou retrouvait les membres de cette « cour de récréation », selon l'expression de Jean Rousselot, passée dans l'histoire littéraire sous l'appellation «École de Rochefort ». Presque tous les lieux ci-dessus se situent en Loire-Atlantique 3. À noter que le premier nom propre de lieu de l'œuvre est « Barcelone» (p. 29) : « des femmes et des enfants quittent Barcelone / À pied. » Cadou écrit combien il est sensible à l'exode du peuple républicain espagnol après la victoire des troupes franquistes. Cette sensibilité à l'histoire se retrouvera dans maints poèmes, notamment ceux de Pleine poitrine 4.
Troisième groupe de noms propres, celui des poètes. Une centaine de citations. Elles constituent une anthologie des poètes que Cadou aimait. Les maîtres sont peu nommés : Verlaine, Laforgue, Corbière, Goethe, une seule fois chacun, Villon, mais plus comme mauvais garçon que comme poète. Lautréamont apparaît deux fois, dont une sous son véritable patronyme d'Isidore Ducasse, avec cette curieuse déclaration (à prendre au premier degré?) : « Avec toute cette saloperie de littérature qui était sa propriété » (p. 334). C'est Rimbaud, appelé parfois « Jean-Arthur », ce qui indique la proximité ressentie par Cadou avec l'auteur d'Une saison en enfer, qui remporte la palme avec six citations.
Ceux qui viennent sous la plume de Cadou sont plutôt soit des pairs, soit des aînés. Pour les pairs, on ne sera pas surpris de retrouver des noms de poètes de l'École de Rochefort comme Rousselot ou Manoll, l'ami entre tous, souvent appelé Michel, ou proches de cette École comme Lucien Becker, Louis Parrot ou Jean Follain. Parmi les aînés, les surréalistes. On relève les noms d'Antonin Artaud ; Cadou répète « Antonin... Antonin », comme on le fait du prénom d'un familier. Antonin Artaud parce qu'il est le plus déchiré, le plus authentique, le moins « faiseur », parce que Cadou est en empathie avec la tragédie vécue par l'auteur de Van Gogh ou le suicidé de la société. Mais aussi Eluard, Aragon, Breton, Péret, Vaché, ces trois derniers étant liés à l'histoire de Nantes (« La Cité d'Orphée », p. 298). Plus que ceux des surréalistes reviennent les noms d'indépendants, précurseurs du surréalisme comme Pierre Reverdy, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire — le créateur du mot surréalisme — ou ses héritiers comme Lorca. Les liens entre Max Jacob et Cadou mériteraient à eux seuls un ouvrage entier. «
Max », comme il est souvent nommé, apparaît une vingtaine de fois. Un long poème est consacré à Serge Essenine.
Outre les pairs, les maîtres et les aînés, les patronymes de différents poètes contemporains sont présents : Cocteau, Jouve, Saint-Pol Roux, Milosz, Jammes, Claudel. Et puis il y a Jules Supervielle, sur qui Cadou devait écrire un article et à qui il adresse une lettre-poème (p. 21-213). Jamais son écriture n'a été si libre, dans la forme comme dans le contenu.
Il est un autre poète que Cadou cite à six reprises : c'est Cadou. La première fois qu'il se nomme lui-même se trouve dans « Encore une lettre à Max », en 1947-1948, aux deux tiers de l'œuvre qui se déploie de 1937 à 1951.Il faut en effet de l'audace pour écrire son propre nom dans le poème. Cadou, à ce moment de son travail poétique, est sûr de ses moyens. Et ce nom de Cadou vient dans le poème après ceux de « Max » et de Julien Lanoë. Cadou le met dans la bouche de ce dernier : « Lanoë dit au curé: Pour René Guy Cadou?» Saint Thomas, dans le poème éponyme (P. 303), dit « Poète René Guy Cadou ? / Mais montre-moi trace des clous. » Il est question ici du poète René Guy Cadou, mais sous forme interrogative. Cadou, droit dans sa voix, quoi que l'on puisse lui reprocher, déclare : « Vous ne pourrez jamais rien contre ce chant qui est en moi et qui s'échappe par ma bouche » (p. 319). Face à l'adversité, à l'incompréhension, au mépris, à l'indifférence, « Cadou s'en moque » (p. 320). Cet homme libre qui revendique son nom sait qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne, comme le fut son père à qui il s'adresse dans son dernier poème (p. 350).
Si Cadou se nomme, il écrit aussi le nom de la bien-aimée, de celle qui le sauva de la nuit : Hélène. Pas d'autres prénoms de femmes aimées dans la poésie de Cadou. Il est le premier à être prononcé et le dernier. Des amours de René Guy avant Hélène nous ne saurons rien. En tout cas, aucune n'a mérité à ses yeux d'être gravée dans l'œuvre. Dès le 17 juin 1943, il a le sentiment de prendre « rendez-vous dans le ciel / Avec toi pour des promenades éternelles. » Le prénom « Hélène » apparaît pour la première fois et en titre dès le poème d'ouverture de La Vie rêvée, seconde section de l'ouvrage qui portera le même titre, et sera publié en 1944 chez Robert Laffont, alors éditeur à Marseille. La première section, Grand Élan, est datée, dans le livre même, de 1942. Avec Hélène, une autre vie commence. « Je t'atteindrai Hélène », ainsi débute le chant d'amour de Cadou. Aimer, c'est nommer. « J'aime, dit Cadou, cet être-là qui se prénomme Hélène, je donne les lieux, les dates, les circonstances, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je prononce mon amour au grand jour.» Dans « Hélène », Cadou emploie le futur, le présent, le passé : cet amour est de toujours, maintenant et pour toujours.
Après avoir nommé Hélène en titre (3 fois) et à l'intérieur des poèmes (6 fois), il faut rendre cet amour encore plus visible. Même ceux qui ne liront pas n'ignoreront pas le nom de la bien-aimée : Hélène ou le règne végétal, titre du livre à venir et titre d'un poème (p. 258-259)6. Désormais Hélène accompagne au quotidien la vie du poète, elle est « mon Hélène»; «Je songe à vous auprès d'Hélène dans le fouillis de ma maison» (p. 319). La dernière fois où dans l'œuvre Hélène est nommée (« Lied », p. 335) résume tout : « Hélène dans mon verre comme une goutte de rosée. »
Pour terminer, intéressons-nous à un ensemble de noms propres concernant des personnages de la vie ordinaire. Ce qui capte l'attention du poète chez eux, c'est justement leurs noms propres. Il ne les invente pas, comme on pourrait le croire : il les recueille autour de lui. Comment résister à la tentation quand on aime les mots comme Cadou les aime, d'écrire un poème à partir du merveilleux prénom d'Anonyme — « Éveillez-vous braves gens / Anonyme Châtelain est mort... » (p. 343) - ou celui d'Anodin — « Anodin valet de ferme / Valet chez mon cousin » (p. 358). Ici, le nom propre engendre le poème, il lui donne sa saveur particulière. Et comment, quand on a un élève qui se prénomme Clovis, ne pas en faire le héros d'un poème (« Le diable et son train », p. 297) : « Clovis mon bel enfant...» Clovis Glédel, que je rencontrai, quarante-cinq ans plus tard, dans la salle de classe où Cadou enseignait, et où l'ancien « bel enfant » se souvenait surtout des leçons de morale de l'instituteur et de la phrase qu'il écrivait chaque jour au tableau. Pour être complet, il faudrait évoquer bien d'autres noms propres, ceux des peintres par exemple.
Les noms propres deviennent de plus en plus nombreux au fil des années. Comme si l'univers de Cadou se peuplait, s'enrichissait : amour, amis, lieux, personnages. À l'ascétisme des premiers recueils succède un lyrisme qui s'ouvre de plus en plus aux autres. La sécheresse délibérée, toute reverdyenne, des premiers recueils, malgré leur lyrisme retenu, est abandonnée pour un chant de plus en plus ample, de plus en plus personnel, ne refusant plus l'effusion, et donc la présence des autres dans le poème. Cadou le poète se dénoue, Cadou l'homme s'épanouit, approfondissant son expérience poétique et humaine jusqu'à ce grand livre qu'est Hélène ou le règne végétal, jusqu'à l'ultime poème, « Tout amour » (p. 350), où il signe l'œuvre : « J'ai voulu que ce nom de Cadou / Demeure un bruissement d'eau claire sur les cailloux. »
 |
Cadou dans le paysage,
par Jean-François Dubois. |

(Retour au sommaire archives)
Depuis le temps que je l'ai découvert — c'était à l'occasion du vingtième anniversaire de sa mort —, je ne relis plus guère, pour ainsi dire plus du tout (1951 Louisfert-1920 Bretagne-de-Reine-Sainte) Cadou Guy René.
Tellement il est dans le paysage.
Qu'il suffit d'un rien dans l'air, d'un coin de ciel ou de mur, pour faire lever un poème, un ou deux vers, un fragment de sa biographie.
Quand j'entre dans Nantes par le boulevard Schuman et qu'apparaît, à l'angle avec Léon Jost, l'ancien bâtiment d'octroi, aujourd'hui « BiЫiothèque pour tous », avec son inscription toujours gravée dans la pierre blanche des bandeaux de façade, il y a cette autre banderole, elle virtuelle, qui déploie aussitôt son texte dans ma mémoire : « Je n'irai pas beaucoup plus loin que la barrière de l'octroi. »
Et si je roule vers Châteaubriant, ma ville natale, c'est aussi, en voix off, à travers le « pays plat barricadé d'étranges pommiers à cidre » et la « grande ruée des terres » qu'il nous a donnés à voir (selon la formule d'Eluard, qui me parait définir une des fonctions essentielles du poète).
Je me rappelle que, dans les maintenant bien distantes années 1970, lors d'une partie de pêche où j'avais accompagné en spectateur mon frère aîné — la scène est au bord d'un étang près de Martigné-Ferchaud, au-dessus de Châteaubriant —, comme à un moment je m'étais éloigné de l'eau pour aller chercher quelque chose, la vision du pré en pente qui nous séparait de la petite route où était garée la voiture s'est imposée à moi avec la force et le bonheur d'une révélation. En même temps que me revenaient à l'esprit, comme en une épiphanie joycienne, ces trois vers de Retour de flamme:
« Quelque part dans un champ clos
Mon corps pend aux fils de fer
Avec tout le ciel sur le dos.»
Telle est la correspondance, l'osmose, qui s'est établie pour moi entre l'œuvre poétique de Cadou et ce pays qui nous est commun, même si nous ne l'avons pas partagé ensemble... sauf à compter les cinq pauvres mois, de la mi-automne 1950 à la veille du printemps 1951, où nous fûmes, de fait, contemporains !
C'est bien par son entremise que l'étudiant en lettres, et l'apprenti poète, pareillement conformiste, que j'étais, fut introduit à la fréquentation de ses grands aînés nommés ici et là (notamment dans « Anthologie »), ainsi que de ses compagnons de récréation de l'École de Rochefort-sur-Loire. Mais je lui suis au moins autant redevable de l'accès qu'il m'a ouvert à ce territoire humble, secret et pourtant immédiat et prégnant, dont je n'avais pas encore perçu consciemment la présence et l'emprise sur ma psyché : un univers de coqs et de sergents, de chevaux qui passent la tête, campagnes solitaires, villages accroupis, pluies frappant de biais, barrières de champs et de villes, petites gares grelottantes, petites rues tristes, hauts vaisseliers solaires, compotier de pommes sur la table, dernier dahlia dans un jardin perdu. Etc., ad libitum, pourrait-on ajouter.
Toutes choses dont, en les relevant et en leur imprimant — selon le prisme de sa sensibilité, son histoire personnelle et les accidents de sa destinée — le sceau du définitif, de l'éternel, il m'a transmis la saveur et la nostalgie.
Je connaissais ainsi depuis l'enfance les coteaux de Saint-Aubin-des-Châteaux baignés parla Chère, et les étangs de Chahin et de la Petite Fenderie entre Ruffigné et Sion-les-Mines. Mais il fallait donc qu'il ait inscrit là, en 1941-1942, une étape de ses errances de jeune instituteur remplaçant, et qu'il en ait tiré, parmi d'autres, ce poème de «L'Héritage fabuleux» (un titre qui dit tout!) — où il est question aussi du Néant, qui est seulement le nom d'un cours d'eau —, pour que j'enregistre à jamais sa vision de « village épais comme un fond de citerne / Juste sous la gouttière de l'éternité », et l'association d'images des étangs à canards voisins avec celui, gelé, où l'on retrouva le Téméraire, le visage mangé par les loups, comme une vignette de manuel d'histoire primaire.
Dans la micheline qui m'emmenait à Rennes pour mes études, et m'en ramenait chaque fin de semaine, je regardais par la vitre défiler entre les gares la marqueterie des labours et des pâtures, le lacis des chemins, les fermes disséminées, les horizons cousus au ciel à grands points roux et noirs par les ramures d'hiver des bois et des haies, toute la scénographie rurale dont il avait transposé les éléments dans sa propre représentation mentale. J'entendais énoncer les noms des stations : Martigné, Retiers, Le Theil, Janzé, Corps-Nuds, Saint-Armel, Vern, et vice-versa, en pensant à toutes celles-là, « sur le réseau de la souffrance », où il voyait une des images de son destin trop circonscrit.
Pendant ces décennies (les premières années de façon très juvénile, très... sans doute trop fervente : voir plus bas), par un mouvement de révérence et d'appropriation toute fraternelle (fraternité : le grand mot — avec jeunesse et liberté —) le grand liant du rassemblement de Rochefort-sur-Loire), j'ai souvent retracé ses chemins de vie et d'écriture, parcourant les campagnes, inventoriant les lieux que son œuvre a transfigurés ou seulement affectés, en les nommant, d'un coefficient particulier : montée de Pont-aux-Moines, allée du calvaire de Sainte-Reine, place des Terrasses et rue Pasteur, quai Hoche et place Bretagne, la Boule d'or, la Haie-Longue, Béhuard.. . jusqu'à Saint-Benoît-sur-Loire et Germigny-des-Prés (sans parler des rives de la Seine ou des cafés littéraires du boulevard Saint-Germain qu'il ne cite guère, on le sait, que pour mémoire, en les repoussant à distance). Et il y a peu encore, durant un séjour estival en Béarn, c'est le même protocole implicite et incontesté qui conduisit mes pas entre Narp et Arrau, à Navarrenx et à Oloron-Sainte-Marie, où il vécut son unique et bref épisode militaire durant la belle — autant qu'historiquement morne, dramatique — saison de 1940.
Oh, cela ne va certes pas, ces recensements, ces... pèlerinages, sans quelque chose de sentimental, d'effusif, qui n'a qu'un rapport accessoire, pour ne pas dire superficiel, avec l'empreinte que doit laisser une grande œuvre, même si c'est par ce degré de familiarité que celle-ci nous touche plus vivement, nous est plus proche. S'agissant d'un jeune homme un rien sensible et malléable, ce peut être au risque d'une certaine identification — forcément paralysante et réductrice de la personnalité — à l'objet de sa vénération. Et j'ai bien dû aussi, autrefois, faire un effort plus ou moins délibéré pour ne pas me dissoudre dans l'empathie ni me stériliser dans l'imitation, mais vivre et produire, aussi modestement que ce soit, par moi-même, selon ma voie, avec ma voix.
S'il ne faut pas vouloir être original à tout prix, dont celui de l'ingratitude, en niant les influences qu'on a subies, voire en s'aveuglant sur leur réalité, c'est néanmoins en se détachant des maîtres qu'on recueille, par décantation, le meilleur de leur exemple et de leur enseignement (cet autre «héritage fabuleux»), en s'affranchissant d'eux qu'on peut accéder, une fois la dette identifiée et admise, au seul mode de fidélité et de reconnaissance qui leur est dû, comme il en va aussi des filiations de la chair.
C'est dans ce nécessaire processus d'émancipation, la maturation naturelle et l'épreuve ordinaire de l'existence aidant, que j'ai peu à peu remisé René Guy Cadou (Sainte-Reine-de-Bretagne 1920-Louisfert 1951), avec ses livres et leur geste lyrique si poignante, dans un coin contigu de ma vie, ni oubliette ni purgatoire, mais réduit toujours accessible où je sais pouvoir le retrouver à tout moment, avec quelques autres, tels Follain, Fournier, Genevoix, Mac Orlan, Cendrars, Cabanis, Hardellet, Guilloux, Reverdy... qui me sont également chers, pour des raisons et à des degrés différents.
Il se trouve là, à portée de cœur, et en bonne compagnie, dans une de ces confréries idéales et réelles comme il aimait en dresser, où sa place est indisputable.
Et puis, ainsi que j'ai essayé de le faire comprendre dans ce qui précède, il y a de toute façon cette assimilation en profondeur qui s'est accomplie malgré moi, sorte de transfusion ou de greffe spirituelle par quoi il est passé quelque chose de lui dans le sang et le regard, de sorte qu'il est là, puissamment incarné, installé comme un logiciel poétique d'appoint dans mon paysage intérieur.
 |
« Sur le réseau dangereux de la beauté » ou autour du Diable et son train,
par Françoise Nicol.
|

(Retour au sommaire archives)
C'est vrai, Cadou a peu écrit sur la peinture et les peintres et n'a jamais exhibé une culture savante dans ce domaine. On s'arrête à son amitié pour quelques peintres dont Roger Toulouse, évidemment, dans le cadre de l'École de Rochefort. Et si Yves Cosson a proposé une première synthèse de ses relations avec les peintres, personne après lui n'a suivi une des pistes qu'il suggère, pourtant toute simple : répertorier dans l'œuvre écrite les traces des tableaux que le poète aimait, par exemple ceux du musée des Beaux-Arts de Nantes qu'il fréquenta assidûment dans son adolescence 1. Et pourtant, pour peu que l'on s'y intéresse, la relation de Cadou à la peinture se révèle un continent inexploré.
Une visite à la maison d'école de Louisfert ouvre déjà grande la porte : dans la chambre à la fenêtre qui donne sur la forêt, semblable à « l'avant d'un navire qui fend les hautes vagues de la campagne » 2, les tableaux, à la place des amis, se rassemblent autour de « la table à poèmes », si bien nommée par Hélène Саdоu 3, comme prêts à appareiller à leur tour. De fait, pour Cadou, œuvres et artistes sont indissociables.
Au cœur de la chambre, à tout seigneur, tout honneur, la gouache de Max Jacob, le poète qui était aussi peintre : un coq aux plumes rouges, planté sur ses ergots, porte dans cette chambre désertée le sourire, tendre et moqueur, de l'ami de Saint-Benoît. Il est dédicacé : « À mon doux René Guy Cadou, 10 novembre 1942, Max Jacob ». C'est près de ce coq que se trouvait La Cabane d'André Lenormand dont Cadou, la recevant, avait promis de ne jamais se séparer 4; mais aussi des œuvres de Guy Bigot, d'Yves Trévédy, d'Oscar Dominguez, de Jean Jegoudez, d'Édouard Goerg et d'Yves Boré ainsi que la réplique du visage de « l'inconnue de la Seine », à laquelle Cadou a consacré un poème 5. Les unes étaient là du vivant du poète ; d'autres ont été offertes à Hélène Cadou après sa mort comme cette très belle encre de Trévédy intitulée Dernier signe à Levanti, en hommage à un poème б. Toutes disent l'amitié partagée. L'émotion d'Hélène Cadou, interrogée sur ce point, est d'ailleurs intacte : elle se souvient d'une fraternité confiante et tendre entre son époux et les peintres, parfois plus forte qu'entre poètes. Au-delà de l'anecdote, elle relie spontanément à son tour poésie et peinture lorsqu'elle évoque le peintre Guy Bigot : « Il était notre témoin de la vivacité d'une poésie réelle », dit-elle.
Pour aller plus loin, lisons quelques pages, comme cette digression sur Max Jacob dans un texte que Cadou consacre à Roger Toulouse : « Max Jacob qui le premier sut découvrir Roger Toulouse, m'écrivait : "Refuse-toi à écrire des choses sans importance, c'est la plaie de la poésie actuelle... Qu'un poème repose sur une pensée [...]." Et en pleine marge, en grosses capitales d'imprimerie : "INVENTE". Ainsi pour la peinture. Et Toulouse le sait bien qui s'est toujours refusé à reproduire [ ... ] . » 7
Ces lignes parmi d'autres sont exemplaires de l'agilité avec laquelle le poète circule entre poésie et peinture ; non qu'il nie les frontières entre les arts (il a appris de Reverdy l'attention aux « moyens propres ») mais à ses yeux les questions esthétiques se posent dans les mêmes termes aux peintres et aux poètes. Comment pourrait-il en être autrement pour celui dont la formation artistique est très largement tributaire des trois grands poètes qui, au début du siècle, ont fondé la réflexion sur cette question, Apollinaire, Reverdy et surtout Max Jacob duquel, sans doute, il a appris cette agilité. La préface de Cadou à Esthétique de Max Jacob en témoigne à nouveau : elle s'ouvre sur l'évocation des toiles de Pierre Roy, qu'il a découvertes durant l'été 1937, à la faveur de vacances au bord de la mer auprès de Denys, le fils du peintre. Cadou relie le souvenir de cet été-là aux destins des peintres et des poètes : il passe de Pierre Roy à Apollinaire, d'Apollinaire à Max Jacob. Et il explique que c'est une conversation avec Denys Roy sur Max Jacob qui l'a décidé à écrire pour la première fois à ce dernier.
Au jeune poète qui lui a confié son admiration pour Pierre Roy, Jacob répond ainsi : « Cher monsieur, Je suis, depuis de nombreuses années, l'ami et l'admirateur de Pierre Roy. Nous nous sommes, en effet, connus chez Apollinaire [...]»8.
Ainsi, c'est sur la peinture que se fonde la rencontre capitale entre Jacob et Cadou. Et c'est elle qui est souvent l'objet des échanges entre eux. Ainsi un jour, Cadou qui rêve d'être peintre s'en confie à Max Jacob qui répond... en peintre: «Ne regrette pas de ne pas savoir peindre. On ne sait jamais peindre ! La peinture est un martyre, un tonneau des Danaïdes — si avancé qu'on soit, on a toujours à apprendre. Je ne sais pas ce que pensait Raphaël mais je connais le mot d'Hokusai mourant à 98 ans "Quel dommage de mourir ! Je commençais à savoir ce que c'est que le dessin !" Et remarque qu'il ne parlait pas de peinture.»
De ce continent, peinture et poésie chez René Guy Cadou, on ne peut ici qu'esquisser les contours. À quel moment et à la faveur de quelles circonstances les liens ont-ils été les plus intenses entre Cadou et les peintres ? Quel en est le fruit principal et plus largement, quel regard le poète porte-t-il sur la peinture ?9
1947-1949, entre Châteaubriant et Louisfert...
« Entre Châteaubriant et Louisfert, la poésie et l'art vivaient d'amitié et comme en symbiose.» Prenons la mesure de cette déclaration du peintre Guy Bigot, bien des années plus tard 10. On doit à Yves Cosson la reconstitution des liens entre Cadou et ses amis artistes, au pays de la Méе. Et c'est avec plaisir que je m'inscris ici dans ses traces. Son article « Cadou, les peintres et le pays de Châteaubriant » recompose le groupe des compagnons auquel lui-même appartint. Trois peintres et un sculpteur en sont les acteurs principaux : Yves Trévédy, dont les parents vivent à Châteaubriant depuis que son père y a été nommé juge en 1938 (et qui rejoint sa famille à l'occasion des vacances) ; Guy Bigot, réfugié en 1942, après les bombardements de Lorient et qui a ouvert un atelier de photographe au 1, rue Pasteur ; André Lenormand, chassé, lui aussi, de Lorient par la guerre mais fixé à Nantes et qui prend régulièrement l'autocar pour Louisfert. Le sculpteur est Jean Fréour, qui s'installe au début de la guerre chez ses grands-parents à Issé, près de Louisfert. Le plus célèbre d'entre eux est alors, sans nul doute, Yves Trévédy, auréolé par le prix de Rome qu'il a obtenu en 1943 et qui a déjà une belle carrière parisienne. Il va jouer un rôle de « catalyseur » auprès de Guy Bigot et d'André Lenormand 11. Autour de ce noyau, d'autres peintres, nantais pour la plupart, sont de passage, Jean Jegoudez, Yves Boré ou Lean Bruneau. René Guy Cadou, lui, est nommé à Louisfert en octobre 1945 avant d'entrer, au bras d'Hélène, en octobre 1947, dans la maison d'école du bout du village 12. Il y achèvera sa vie, rappelons-le, le 20 mars 1951. Dans un article écrit quelques années plus tard, le même Yves Cosson date ce réseau de fraternité des années 1942-1950 13. Mais la période qui s'étend du début de l'année 1947 à l'été 1949 en constitue sans doute l'apogée.
C'est probablement en 1947 que Guy Bigot prend contact avec Cadou, par une lettre déférente, non datée mais, sans doute, écrite au début de l'année : « Monsieur, Habitez-vous réellement Louisfert ? Avec cette certitude pouvons-nous faire connaissance ? Suis émigré à Châteaubriant. Je peins, mais en tout honneur, comme je ne vends jamais rien, je photographie »14.
L'amitié entre les deux artistes commence sur les chapeaux de roues : Cadou est le premier à saisir la valeur de ce peintre encore inconnu qui vient auprès de lui « s'initier à la poésie »15. Aux côtés de Trévédy et Lenormand, il va l'épauler autant que possible et les résultats ne se feront pas attendre : le 13 décembre, Bigot obtient une « bourse de voyage au Prix Nationale », première récompense, avant une exposition chez Denise René (en 1949) qui confirme la justesse de l'intuition du poète.
Dès le mois de mai 1947, Cadou écrit une première préface pour une exposition de Bigot à Châteaubriant (26 mai-8 juin). En octobre, pour une exposition collective de Bigot, Lenormand et Trévédy à la galerie Bourlaouen de Nantes, il écrit le beau poème « Peinture » dans lequel le peintre «à la cigarette allumée» pourrait être le jeune artiste 17. La troisième préface sera signée en février 1948 pour une nouvelle exposition de Bigot à Châteaubriant 18. Si le terme d'« École de Châteaubriant », utilisé par Yves Cosson, va peut-être un peu loin, c'est bien autour de ce tandem Cadou-Bigot, lui-même soutenu par Trévédy et Lenormand, que va se dérouler la «merveilleuse aventure» du livre Le Diable et son train, point d'orgue d'une période d'échanges artistiques fertiles 19. Or, à la fin de l'été 1949, Bigot quitte Châteaubriant pour Lorient, abandonnant celui qu'il appelle son « petit frère »20.
À aucun autre moment de sa vie, Cadou qui connaît alors une période très féconde 21 n'aura autant parlé peinture, autant écrit sur la question, autant fréquenté de peintres, autant dessiné lui-même.
C'est en 1948 que Cadou dessine les portraits évoqués plus haut, ceux d'Hélène, de Max Jacob, de Michel Manoll, de Follain ou son autoportrait. En 1948 encore, il consacre deux articles à Roger Toulouse dont il fait la connaissance en septembre (« Roger Toulouse », Arts en province, РАB, mai 1948, et « La peinture et Roger Toulouse », Cévennes, 12 juin)22. Un article, « Apollinaire devant la peinture », date d'octobre 1948 23. Par ailleurs, durant ces deux années, les peintres accompagnent la parution de cinq recueils comportant des dessins, avec la complicité de Chiffoleau à Nantes et de Pierre André Benoît à Alès : les premiers sont, en 1948, Quatre poèmes d'amour à Hélène (dessin de R. Toulouse, Les Bibliophiles alésiens) et Guillaume Apollinaire ou l'artilleur de Metz (portrait de R. Toulouse, Chiffoleau). En août 1949, Bigot dessine la couverture des Sept péchés capitaux avant de quitter la région ; la même année, РАВ édite des dessins originaux de Roger Toulouse pour un texte de Cadou ; l'ouvrage se nommera Roger Toulouse 24. Mais le livre le plus important est évidemment le seul livre « de peintres », Le Diable et son train, illustré par Bigot et Trévédy, publié en 1949 mais daté, symboliquement, de 1948.
1947-1949, à Nantes
Avant d'évoquer ce livre, il faut insister sur le fait que ces échanges créateurs entre trois artistes du nord de la Loire-Inférieure ne peuvent être dissociés de la vie artistique nantaise et française de ces années d'après-guerre, même si la question ne peut être qu'esquissée ici.
Cadou, comme ses amis, fréquente les lieux importants dont la galerie Bourlaouen où exposent les peintres qu'il défend (dont, en 1947, Jean Bruneau, Yves Trévédy, Guy Bigot et André Lenormand) et les musées, en particulier le musée des Beaux-Arts, qu'il connaît bien 25. Le musée vient de payer un lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale mais retrouve sa place dans les débats artistiques du temps, en particulier le débat figuration versus abstraction dont les présupposés, à Paris comme à Nantes, sont politiques autant qu'esthétiques. La ville retrouve sa place sur le terrain artistique comme l'indiquent deux expositions importantes, « Nantes, capitale de l'Ouest », en mai 1945 (au château des Ducs) et l'« Exposition d'art sacré », en 1947, au musée des Beaux-Arts. Le musée acquiert, à cette occasion, le très beau Salve Regina de Manessier, peint en 1945, considéré comme le premier tableau non figuratif du peintre. En 1948, c'est une toile de Fernand Léger, Feuille verte, qui rejoint le fonds du musée. En octobre, pour la première « exposition d'octobre », sous l'autorité des Amis de l'art, Fernand Léger est invité 26.
Parmi les nombreux noms à citer, évoquons au moins une personnalité essentielle de la vie culturelle nantaise, Julien Lanoë, président de la Société des amis du musée des Beaux-Arts de 1936 à 1970 27. C'est sous son impulsion qu'en 1944 une section des « Amis de l'art » se crée à Nantes, comme dans toutes les grandes villes de province. André Lenormand en sera le secrétaire. L'initiative de cette société revient au grand critique parisien Gaston Diehl qui, après la libération de Paris, fonde un mouvement culturel destiné à diffuser des formes artistiques innovantes, « Les Amis de l'art ». Dès 1941, à Paris, Diehl (avec l'appui de Jean Follain) a soutenu « vingt jeunes peintres de tradition française », dont son ami Manessier justement 28. En 1943, il fonde le Salon de mai, qui, lors de sa première exposition parisienne, en 1945, présente le tableau de Manessier acheté par le musée des Beaux-Arts de Nantes 29. Quelques années plus tard, le 30 mars 1949, une lettre adressée par André Lenormand à Cadou laisse deviner les liens qui se sont tissés, annonce-t-il avec plaisir au poète 30.
Que ces quelques rapprochements, auxquels il faudrait évidemment ajouter le contexte de l'École de Rochefort, convainquent notre lecteur du fait que les peintres et le poète de Louisfert sont en prise sur l'actualité artistique française. Leur formation esthétique les rapproche. Tous ont une approche admirative du cubisme ; tous aiment Braque. Cadou, grand lecteur d'Apollinaire et initié à l'art par Reverdy et Jacob, ne pouvait être à meilleure école. Il a tout compris de la ligne de crête que le cubisme tentait d'arpenter entre refus de la représentation et refus d'une abstraction qui ferait perdre à l'art sa volonté de dire le réel ; il sait l'apport essentiel de Braque dans la création d'un espace spécifique (la leçon de Cézanne et les papiers collés). Quarante ans plus tard, le cubisme a perdu une partie de sa puissance révolutionnaire et demeure, paradoxalement, à la fois un idéal et une école, devenue « classique », pour les jeunes peintres qui vont y puiser l'art de la composition et l'effort vers l'essentiel. Bigot qualifie ainsi ses propres peintures de l'époque : « Issus sans doute à force de rigueur et souci d'équilibre d'une certaine idée que l'on se fait du cubisme — du classique en sommeil »
Sans doute les peintres, en particulier Lenormand, revisitent-ils le cubisme à travers le purisme d'Ozenfant dont Lenormand se réclame et qui s'attache « aux formes simples [ ... ] dans l'espace abstrait où il semble les situer pour l'éternité »32. Le mot « pureté » revient souvent dans les conversations entre eux et avec Cadou. C'est que les acquis du cubisme et les textes théoriques d'Ozenfant sont des appuis contre l'éloge surréaliste du hasard, en particulier. « L'ennemi c'est le hasard », disait Ozenfant. Yves Trévédy, qui vit dans la capitale, se fait aussi l'écho des débats du moment. Fasciné par Maurice Denis auprès de qui il a travaillé en 1936 (dans les Ateliers d'art sacré), il va puiser chez ce peintre des moyens propres à épurer à son tour les formes 33. La peinture religieuse l'attire dont on vient d'évoquer les liens avec l'art abstrait. A sa manière, différente de celle de Cadou, il a de l'art une très haute idée. Il admire aussi Vuillard et Bonnard, que Maurice Denis lui a fait connaître, comme le confirme Yves Cosson. Guy Bigot, lui, a été formé en 1938, à Montmartre, par Othon Friesz qui, sans être cubiste, fut l'ami de Braque. Lui aussi aime Bonnard et Braque. Quant à André Lenormand, le plus âgé des quatre, il a le sentiment de naître à la peinture, encouragé par ses deux amis : « Mon vrai départ date de 1945. En 1947 [date de l'exposition avec Bigot et Trévédy à la galerie Bourlaouen], j'avais déjà l'intention de passer à l'abstrait. En 48, cinq toiles abstraites pour une figurative ; en 50, uniquement de l'abstrait »34.
Ainsi, ces artistes, un poète et trois peintres, loin de vivre une aventure isolée, appartiennent à un vaste réseau, qui associe Nantes et Paris, lieux de création et de débats dont les échos se font entendre au fond d'une maison d'école d'une bourgade de Loire-Inférieure. Entre eux, la discussion porte sur la vanité du débat abstraction/figuration; la nécessité d'ancrer la peinture comme la poésie dans le réel et en même temps la recherche d'une forme pure.
Quand les Ouessantines s'en mêlent...
Bigot décrit ainsi la période du Diable et son train : « Les Ouessantines participaient, aussi les bateaux bretons et le jardin castelbriantais, aussi Jules Daniel, le poète du dimanche, ou le père d'Yves Trévédy »35.
En cette année 1947 durant laquelle se succèdent les expositions à Châteaubriant et à Nantes, c'est un voyage qui est à l'origine d'un livre qualifié de « merveilleuse aventure ». Après l'exposition qui les a réunis, en août, à La Baule, Trévédy, Bigot et Lenormand partent pour Ouessant 36. Yves Boré est aussi du voyage. À l'extrémité de ces terres de l'Ouest, «suffisamment nostalgiques pour être vraies »37, fascinés par cette « Bretagne dure, impressionnantе »38, Trévédy et Bigot réalisent deux cent dix-sept dessins. Ouessant est sûrement pour ce dernier un moment, âpre et douloureux, de révélation. « J'ai parlé à l'époque [1947-1948] de mes exercices de purification [ ... ] . Ce fut pourtant mon tremplin aux transmutations venues bien plus tard : ce monde occulté plein de trouble et de tumulte, d'équivoques, d'imprévu et pourtant immuable et silencieux dans ses contradictions »39.
La lettre qu'il écrit d'Ouessant à Cadou, le 27 septembre, souligne la tension entre la fascination pour la nature et la nécessité d'opérer un détachement pour trouver à la fois une composition et un rythme. Travail d'épure, de simplification, d'arrachement : « Pas moyen de s'arracher à cette sacrée Nature. De quoi empoisonner tous les huiliers. Impossible de peindre sur nature — trop de choses. Pas de composition. ImpossiЫe de trouver la vraie cadence de la ligne » 40.
Pourtant, la « cadence » de cette ligne qui passe des coiffes des femmes aux coques des bateaux fascinera aussi le poète quand, à son retour, Bigot lui montrera ses dessins. Ce sont eux qui, le 18 octobre, inspirent « Femmes d'Ouessant », poème dédié par Cadou aux « filles de la pluie ». Celui-ci est tout entier consacré aux lignes qui relient humains et nature, « feston doré des balustrades » et « noire dentelle [des femmes] / qui pend de leurs cheveux comme un oiseau blessé ». Dans le recueil, ce роètе, le premier écrit après le voyage des peintres et le septième dans l'ordre chronologique de l'écriture, prendra aussi la septième place, emblématique.
Entre-temps continuent à se tresser liens d'amitié et liens artistiques : le 11 octobre 1947, Trévédy, Bigot et Lenormand exposent les dessins d'Ouessant à la galerie Bourlaouen et Cadou leur offre le beau poème « Peinture » en guise de préface au catalogue 41. En février 1948, Bigot expose Ouessant et la Bretagne (douze toiles et quarante dessins) à Châteaubriant cette fois, et Cadou écrit à nouveau une préface pour faire l'éloge de « cette qualité dans le drame, cette précision douloureuse qui sont le signe de la grandeur ».
À quel moment se prend la décision de réaliser un livre à partir de ces dessins ? Selon Trévédy, ce serait un an plus tard, soit après un nouveau voyage de Bigot et Trévédy à Ouessant (en avril 1948) : « C'est à cette époque, pendant l'été 48, que nous avions décidé, tous trois, de faire un livre manuscrit »42.
Les poèmes sont écrits entre le 10 mars 1947 (date de « Je me situe », placé ensuite exactement au centre du recueil, comme en hommage à Max Jacob) et le 14 juin 1948. Cette dernière date est celle de « Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? », poème de tête. (Cadou a peut-être pensé à Apollinaire qui, dans Alcools, en 1908, offre la première place au dernier poème écrit, « Zone ».) À quel moment le titre du recueil a-t-il été trouvé ? C'est celui d'un des poèmes (le seizième poème écrit, qui est aussi le seizième poème du recueil, s'il faut encore souligner la rigueur de la composition). Il raconte l'histoire burlesque d'un enfant qui dit avoir vu Satan, sous l'emprise de son imagination... ou de la boisson. Hélène Cadou, interrogée sur ce titre, sourit de l'expression populaire qui désigne une succession d'ennuis. Faut-il songer à la chanson d'Édith Piaf, « C'est comme ça », popularisée en 1947 par le film de Georges Freedland, Neuf garçons, un сoeur 43 ? En tout cas, ce livre sera une histoire de partage dans la ferveur et l'ascèse. Mais c'est surtout la manière dont se pose la question de l'illustration qui est intéressante.
En effet, l'aventure est d'abord sous le signe de la ferveur, comme le confirme Bigot : « On a vécu un moment magnifique de travail en commun [ ... ] avec Trévédy. L'atelier était un haut lieu d'amitié et de fièvre créatrice. » En quoi consiste ce travail ? Il s'agit de choisir et d'associer vingt poèmes et dessins, puis de reproduire à la main les dessins et de recopier les textes, à vingt-trois reprises. Seule la couverture est imprimée (dans une police égyptienne, chez Chiffoleau). Précisons que les poèmes du livre de 1948 ne correspondent que partiellement à ceux qui sont dans le recueil publié par Seghers. Sept poèmes se trouvent dans Le Cœur définitif (CD). Treize font partie du Diable et son train (DT) selon l'ordre suivant :
« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris? », «Si la neige du temps », «Avec la langue des muets », « Interdit aux nomades » (DT) ;« Comme un Christ de Gauguin » et « Le Jardin du juge» (CD) ;
« Femmes d'Ouessant », « Les Chiens qui rêvent », « L’Idiot », « Je me situe » et « Je te prendrai » (DT), «Traduit de l'amour» et «Les Poètes du dimanche » (CD) ;«L'Envers du décor» (DT) ;« L'Enfant prodige » (CD) ; «Le Diable et son train» et «Art poétique» (DT) ;«Vers cinq heures du soir» et «Les Paroles de l'amour» (CD) ;
« Aller simple » (DT), dont Yves Cosson a souligné la dimension prémonitoire.
« Les réunions se tenaient dans notre cuisine », se rappelle Hélène. « Nous nous réunissions dans l'atelier », soutient Bigot, qui évoque, lui, le rez-de-chaussée de la rue Pasteur. Qu'il ait été réalisé à Louisfert ou Châteaubriant (vraisemblablement les deux), l'important est que ce livre n'est plus le seul fruit de l'activité poétique qui se déroule à l'étage de la maison d'école, dans la chambre solitaire. Ces jeudis après-midi ou ces soirées autour d'un verre sont un temps de confrontation entre les arts et de solitude occultée. Trévédy se souvient : « Je revois René recopiant inlassablement de sa belle écriture Le Diable et son train pendant que Guy Bigot et moi-même faisions les illustrations. » Et Bigot d'enchérir : « Cadou protestait contre la fastidieuse besogne de répéter vingt-trois fois le même poème avec une plume sèche et méchante et de l'encre de Chine collant sur un papier choisi très peu encollé. Nous les dessinateurs, on travaillait avec un brin de roseau et la tâche partagée, il a fallu reproduire 24 fois 20 dessins. C'était long ! »44.
Le départ de Trévédy pour Paris (sans doute en octobre) ralentira les derniers travaux. Mais chacun a mis la main à la pâte : l'instituteur a fait ses pages d'écriture comme l'indique, dans le dossier des manuscrits du centre René Guy Cadou, une feuille sur laquelle les titres des poèmes sont accompagnés d'une croix au crayon noir, bleu ou rouge : une pour chaque texte recopié probablement. En octobre, Bigot s'impatiente. Le 11 novembre, cri de victoire : « Cinq livres made in Yves. Me reste une seule planche à terminer. »45.
Ce temps d'amitié est aussi un temps d'ascèse. Il s'agit de contourner les pratiques éditoriales à la mode au bénéfice d'une certaine frugalité, pour ainsi dire : à la faveur de l'après-guerre, chez Maeght par exemple qui vient d'ouvrir sa galerie parisienne, les projets éditoriaux les plus somptueux fleurissent. À Châteaubriant, on ne peut se permettre de telles dépenses. Mais l'idée est surtout l'économie des moyens : le répertoire des signes est volontairement limité et le pittoresque banni; des corps nus, simples silhouettes, ou des visages se déploient d'une page à l'autre (dix des vingt poèmes sont accompagnés de nus ou de portraits, tel celui de Jules Daniel, poète du dimanche, ou celui du juge dans son jardin, le père d'Yves Trévédy). La même encre de Chine, sert au poète et aux peintres ; chacun s'adonne à la copie, modestement. On ne peut évidemment dissocier cette démarche à la fois de l'esthétique de Cadou, qui limite en poésie le répertoire des éléments qu'il utilise, et de la quête cubiste de la composition de l'espace qui manifestement inspire les dessins, surtout les Ouessantines et les natures mortes 46. Reverdy n'est pas loin.
Mais surtout ce livre inverse la question de l'illustration. Ce terme, utilisé par Trévédy, mérite l'examen. Dès septembre 1947 (dans sa lettre d'Ouessant), Bigot suggère avec humour au poète d'écrire à partir des dessins : « De quoi pondre deux cent dix-sept poèmes surromantiques pour illustrer un livre ouessantin à l'usage des âmes en quête d'éternel »47.
Plus largement, une grande partie des poèmes de ces années-là est écrite à partir de dessins ou de peintures, comme en témoignent les tables des recueils : certains titres désignent des artistes (Bigot, Picasso, Toulouse ou Jegoudez)48, d'autres, des œuvres plastiques : « Comme un Christ de Gauguin », « L'Homme de Jean Lurçat» et, dans Le Diable et son train, « Femmes d'Ouessant », « Le Jardin du juge » ou « L'Homme au képi de garde-chasse ». Bigot le confirmera : « Cadou, à cette époque, écrivait des poèmes sur des peintures et dessins de ses amis peintres : Toulouse, Trévédy, moi-même ou d'autres et cela devenait "Femmes d'Ouessant", "Le Jardin du juge" ou "L'Homme au képi de garde-chasse"»49.
Mais la suite du témoignage éclaire la genèse de ces textes : « On retrouverait facilement les images poétiques qui se déclenchaient en face de notre monde de représentations et qui n'étaient que prétexte à l'univers intérieur de Cadou. Cette forme de participation totale m'a suggéré un livre poème-dessin qui est devenu Le Diable et son train, grâce aussi à l'accord et à la coopération de notre ami Trévédy. L'aventure était audacieuse. »
Qu'il s'agisse de scènes d'Ouessant (pour trois des images du livre), des nus ou des portraits déjà signalés, des trois natures mortes ou d'autres images (un Arlequin, le chien ou le train d'« Aller simple »), Bigot semble décrire d'abord un procédé d'illustration à l'envers, le poème « illustrant» le dessin. Pourtant, à aucun moment, le peintre ne se place en inspirateur ; il a trop d'admiration pour le poète. Le verbe pronominal (« se déclencher ») comme le mot « prétexte » donnent la primeur absolue à la source, qui est celle de la poésie seule. L'œuvre plastique, elle-même en écho avec le monde qu'elle est appelée à représenter, est bien là. D'ailleurs, un lien thématique est toujours ménagé, même précaire, entre texte et image 50 Cependant les images poétiques surgissent « en face », au contact des images à voir, mais « d'un lointain intérieur plus proche de la réalité que la réalité même »51.
Ainsi l'esthétique s'écarte-t-elle à la fois de l'imitation (au moins l'imitation servile qui subordonne l'image au texte) et du seul modèle intérieur des surréalistes. Le projet du livre est donc de rétablir ce face à face entre peintres et poète, images et texte, dont rend compte le mot composé, forgé pour la circonstance par Bigot : « un livre poème-dessin ». Or, c'est exactement à ce face à face que répond la composition formelle de l'ouvrage (qui comporte quarante-trois feuillets) : chacun des vingt poèmes est accompagné d'un dessin mais sur deux feuillets séparés : un pour le texte, un pour le dessin, les deux modes d'expression se déployant sur l'ensemble de la page (au recto du feuillet) ; l'un comme l'autre étant constitués de lignes tracées à l'encre noire sur le blanc du papier. En outre, les deux peintres, refusant de distinguer leurs interventions, se placent sur le même plan, face au poète, puisque chaque image est accompagnée de quatre initiales, «YT GB ». On peut lire là l'extrême élégance de Trévédy qui s'installe modestement aux côtés d'un peintre alors au début de sa carrière ; mais il faut aussi mesurer la discrétion des deux artistes, partageant la même page face au poète qu'ils admirent 52. La numérotation de I à XX, redoublée sur les deux feuillets, celui du texte celui de l'image, ce qui est rarissime dans un « livre de peintre », souligne la confrontation. (L’absence de brochage permet au lecteur qui le souhaite de placer le dessin face au texte, la double numérotation évitant l'interversion des poèmes des illustrations.)
Précisons cependant que si tel était le projet initial, il a bifurqué ensuite, faute sans doute pour ses auteurs de parvenir vingt fois de suite à établir ce face à face. Bigot le précise, toujours en 1971: « Il a fallu élargir le thème de tableau-poème et j'ai eu cette joie de choisir les poèmes parmi tout un paquet d'inédits de cette époque. » Dans ce cas, le dessin vient probablement, à l'inverse, après le texte, dans une logique plus traditionnelle, mais sans qu'aux yeux du lecteur la grande cohérence formelle de l'ensemble ne semble altérée.
Le Diable et son train fait exception dans l'œuvre de Cadou, attaché à l'autonomie du poème. Dans un article contemporain écrit sur Apollinaire (« Apollinaire devant la peinture », décembre 1948), il se moque des Calligrammes, pour insister sur l'autonomie des « poèmes-objets » : « C'est que le poème, lui aussi, comme le tableau du peintre, est appelé avant tout à être un objet, à se suffire à lui-même »53.
Il est clair que les poèmes du Diable et son train ne perdent en rien leur autonomie par le dialogue instauré avec des images. Mais, cette fois, ils consentent à entrer en résonance avec elles, dans une période de création partagée, particulièrement féconde. Retenons, comme nous l'avons montré plus haut, l'extrême déférence des deux peintres, modestement associés ici, à l'égard du poète et considérons cet ouvrage comme un moment unique.
Un livre manifeste ?
Si déconcertant qu'il apparaisse dans l'œuvre du poète, Le Diable et son train, fruit de débats intenses entre un poète et des peintres, exprime et condense les acquis, les goûts et les convictions de Cadou sur la peinture. Cette question mériterait une étude approfondie, par une confrontation précise des poèmes, des écrits théoriques (Le Miroir d'Orphée et les Notes inédites de 1948-1949, en particulier) et de la forme même du Diable et son train. Encore une fois, un lecteur passionné d'Apollinaire, un jeune artiste qui a eu pour mentors un des plus pertinents analystes du cubisme, Reverdy, et un poète qui était aussi un peintre, Max Jacob, un ami très proche de peintres aussi doués que Toulouse, Trévédy et Bigot, ne se contente pas de quelques intuitions. S'il a adopté la conviction de Reverdy que chaque art a ses « moyens propres» (ce qui exclut, par exemple, l'idée d'une poésie cubiste), il associe peinture et poésie sur trois points au moins, que l'on peut résumer par le verbe « situer », l'alliance de la pureté et de la gaucherie comme choix esthétique ainsi que la célébration de la ligne, voire de « la ligne de cœur », pour voler son beau titre à la revue de Julien Lanoë. Ce sont ces points qui amènent Cadou à donner aux peintres (Guy Bigot en particulier) le titre de « poètes ».
D'abord, au premier poème écrit pour Le Diable et son train, « Je me situe », font écho un certain nombre de déclarations des Notes inédites ou d'Usage interne, comme ces lignes où le poète prend littéralement la place du peintre au moment de la création : « On ne peint pas de nature morte. On tente de limiter sur la toile ou sur la feuille un mouvement parfois à peine perceptible. Il serait vain de vouloir lui attribuer une attitude définitive, c'est-à-dire de la décrire. Simplement la situer dans un univers nouveau auquel elle s'adaptera, qui sera pour elle un nouveau tremplin, une nouvelle base de lumière »54.
L'artiste situe son travail comme il se situe lui-même. Max Jacob, lui, résume au passif: « Tout ce qui existe est situé. » Cette ouverture de la préface du Cornet à dés, en 1916, moment où, comme Reverdy, il réfléchit sur l'aventure cubiste d'avant-guerre, vaut pour la peinture et la poésie. Les artistes comme les poètes ont vocation à « atteindre à cette réalité qui fixe l'œuvre d'art », pour citer, cette fois, Reverdy. Le commentaire de Cadou trace la même ligne de partage, qui est d'abord celle de Braque, le peintre qu'il aime. C'est toute la difficulté à dire une peinture qui n'est pas « abstraite » sans être « un art de reproduction »55. On peut y voir des pommes et des poissons mais l'espace créé entre pommes et poissons (dont parle sans cesse Braque) les installe dans un univers autonome, proprement artistique, auquel l'anecdote n'a pas de part. « INVENTE », a conseillé Jacob à Cadou, en capitales, et ce conseil est rappelé par ce dernier à propos d'un peintre, Roger Toulouse, dans un article de mai 1948 (toujours cette aisance à passer d'un art à l'autre)56. Mais, sans doute, l'originalité du poète est-elle d'insister sur la spécificité de cet « univers nouveau » : l'image du « tremplin » est familière aux lecteurs de Cadou. En effet, l'œuvre réussie est celle qui se conjugue à la fois au présent (non le présent « ponctuel» mais celui que la grammaire désigne par le « présent étendu »57, celui de « la présence »), et au futur. À propos de Roger Toulouse, encore, il unit ces deux temps : « Peinture abstraite, diront les faibles devant une gouache de Toulouse : c'est s'attacher bien davantage à l'apparence qu'à la présence. » Et quelques lignes plus loin : « Ce qui fait la force secrète de ce peintre [ ... ] tient [ ...j en ce qu'il est perpétuellement hanté. Je n'entends point par hantise une figuration rétrospective du passé, ou immédiate du présent, mais une longue promenade dans l'avenir, un appel du pied, qui proprement vous transporte, ne laisse plus l'âme en repos » 58. «Tremplin », « appel du pied », l'œuvre peinte ou écrite est, cette fois, envisagée du point de vue de son destinataire comme ce qui relance le désir, suscite cette émotion qui était déjà au cœur de la pensée de Braque et de Reverdy.
Le deuxième point est le parti pris esthétique. Dans Le Diable et son train, les dessins sont à la fois raffinés et presque maladroits ; fruits de la leçon cubiste, d'ailleurs évoquée sur le mode de la citation par les natures mortes et l'introduction de chiffres dans le dessin (la date de 1928), ils allient pureté et rudesse, évoquant tour à tour les figures linéaires et épurées de Maurice Denis et les saints de bois des églises bretonnes ou les silhouettes un peu gauches de Gauguin. La maladresse voulue, sans doute plutôt signée de Bigot, émeut Cadou qui y retrouve les personnages populaires qui inspirent ses poèmes. Cela aussi fait partie de leurs conversations. C'est en tout cas ce que laisse deviner cet extrait d'une lettre adressée par Bigot à Cadou, le 11 août 1950, après son retour en Morbihan : « Nous avons parcouru la campagne du Faouët à la recherche de vieilles chapelles abandonnées. J'ai découvert une chose extraordinaire qui m'a bouleversé. La beauté des dieux populaires, l'émotion d'un sculpteur maladroit, émouvant dans le don de son cœur. J'ai fait des photos formidables de ces morceaux de pierres et morceaux d'âmes » 59.
L'éloge de la maladresse est une constante des écrits théoriques de ces années-là, autant que des poèmes de Cadou : la technique de Toulouse est assimilée à « ce tumulte à la fois grandiose et malhabile qui pousse la main vers la surface lisse des journées°» ; d'Henri Rousseau, il loue la gaucherie ; d'Apollinaire, sa critique de « l'habileté », associée à l'imitation б0. Si Cadou célèbre une certaine gaucherie, dans les sculptures de Saint-Benoît comme chez Gauguin ou Bigot, dans les vieilles chansons de France comme chez Paul Fort ou Francis Jammes, c'est qu'elle est à la fois le signe de l'ingénuité de l'art populaire et de la distance prise avec l'art de représentation.
Le troisième point est la question de la ligne. Cadou y fait souvent référence et elle joue évidemment le rôle principal dans Le Diable et son train, livre entièrement manuscrit, dans lequel trois mains se sont activées pour la laisser courir d'un mot et d'une forme à l'autre. Cette ligne-là le comble car elle incarne le paradoxe auquel il est tellement attaché (et qui est déjà la préoccupation de Reverdy et Jacob): l'art doit fixer le mouvant sans le paralyser. « C'est dans la mesure où toute création [ ... ] se situe par rapport au mouvant et non plus au tangible, que l'artiste se donne les gants d'épiloguer longuement sur la beauté foncière de l'art »62.
Le trait de plume par lequel Cadou dessine les visages sans lever la main est d'abord celui de sa « belle » écriture, qui glisse au rythme des pleins et des déliés. « S'il n'avait pas été poète, René aurait été dessinateur », répète Hélène Cadou. La ligne est d'abord rythme, « cadence » dit Bigot, signe de la vie qui palpite. Pour Cadou et ses amis, elle trouve sa source dans ce passé antérieur à la Renaissance qu'ont valorisé les cubistes. Il s'agit d'abord du passé médiéval : les manuscrits dans lesquels la ligne est tracée par le copiste et l'enlumineur ou les visages au ciseau des chapiteaux de Saint-Benoît-sur-Loire que Jacob comparait à des Picasso б3. En amont, la ligne trouve sa source dans la préhistoire néolithique qu'aime le poète : quand elle saisit ensemble le renne et son chasseur sur les parois des grottes de la Vézère, elle représente non l'aptitude à reproduire mais la capacité de l'artiste à s'extraire de l'épaisseur du monde dont il est partie prenante pour isoler, choisir et mettre à distance. C'est donc aussi échapper à l'informe inquiétant, en trouvant l'essence de la forme, « l'os », ce qui est une autre interprétation de « situer ». Ce geste inouï du peintre chaman de la Préhistoire a débouché ensuite sur l'écriture. Et c'est cette parenté dans l'invention que réitère l'œuvre commune de 1948. Les « rennes affrontés » des grottes de la Vézère suscitent chez Cadou cette réflexion sur l'œuvre de Toulouse : « Tout ce qui s'attache à l'os rend compte. De là le secret des dessins de Toulouse, cette ligne d'âme qui délimite et grandit son objet » 64.
« L’âme » n'est-elle pas, à la fois, celle de la poutre que travaille son ami le menuisier et celle des êtres ? Aux yeux de Cadou, la ligne de la Vézère qui suit le tracé de l'os est bien un repère. Offrons pour conclure au lecteur cette dernière exhortation magnifique qui résume la vision de Cadou, en associant poésie et peinture : « Il faut revenir à la fresque, à la muraille — et ceci vaut aussi bien pour nous autres poètes que pour les peintres. On nous attend tout en haut de l'échelle. Échelon par échelon tout en haut. Et qu'on me suive bien, je n'entends point cette grande œuvre murale comme obtenue par un procédé d'agrandissement г...] mais tout entière fondue dans cette matière incandescente de l'âme, creusée profondément comme les rides de la terre » 65.
Le temps qui a manqué
Il aurait fallu évoquer plus longuement André Lenormand, qui participa aux débats que nous venons d'esquisser; Boré, Bruneau sont restés dans l'ombre. Mais en centrant notre attention sur ces quelques mois de travail et d'amitié, au pays de Châteaubriant, à quelques dizaines de kilomètres de Nantes, nous espérons avoir convaincu le lecteur de la qualité et de la cohérence de la pensée de Cadou en matière de peinture, même si le temps ne lui a pas permis d'aller plus loin. Les preuves de l'amitié entre Trévédy, Bigot et Lenormand demeurent, des années après la mort de Cadou, comme le révèle en particulier le catalogue de la rétrospective Bigot de 1975, dans lequel Trévédy et Lenormand prennent la parole. Tous les textes confirment la dimension initiatique de cette période féconde. De Bigot, par exemple, Lenormand affirme que « tout était dans les toiles de 1948-1949. Tout est parti de cette période âpre, cruelle »66. Même si chaque peintre a poursuivi sa route, ils se retrouvent périodiquement comme à Nantes, en 1966, où Bigot, Lenormand, Trévédy, mais aussi Jean Bruneau exposent ensemble (l'exposition se nomme Soixante-dix-huit peintres et son catalogue est préfacé par Ozenfant). Bigot et Lenormand ont fini par choisir l'abstraction mais sans avoir rien oublié de la dimension réelle du débat : « Abstraction ? figuration ? C'est exactement la même chose. Le reste n'a pas d'importance », affirme « Len » qui date de 1948 son passage à l'art abstrait б7. Et Bigot confirme : « Qu'est-ce qu'être figuratif ou non ? Et la peinture abstraite ? Comme je préfère dire "peinture secrète" et tellement secrète que chacun peut en voir autant sur l'écorce de chaque arbre, sur un mur écorché, dans une poussière au soleil, dans la lumière d'une eau noire, sur un caillou, dans la terre ou dans l'œil endormi » 68.
Quant à Cadou, qui, j'en suis sûre, aurait aimé ces mots, il savait depuis le début que la poésie était invention d'une forme. Max Jacob le lui avait très vite confirmé. Ses amis peintres l'ont accоmраgné en tenant avec lui « le fil d'Ariane » qui lui a permis de circuler sur « le réseau dangereux de la beauté » б9.
Notes
1.Yves Cosson signale une référence à L'Assassinat de Marat du peintre yonnais Paul Вaudry, dans le poème « Mémoires » (in Hélène ou le règne végétal, Poésie la vie entière, œuvres poétiques complètes, Seghers, 1976 -abrégé ensuite en PVE-, p. 324). Nous recommandons son article « Cadou, les peintres et le pays de Châteaubriant » (in Un poète dans le siècle, René Guy Cadou, Actes du colloque de l'université de Nantes, réunis par Daniel Briolet, Régis Miannay et Christian Robin, Nantes, Éditions joca seria, 1999, p. 154). De même, « La Charmeuse de serpents » (« La Vie rêvée », PVE, p. 161) fait référence à un tableau de Pierre Roy (musée des Beaux-Arts de Nantes).
2.René Guy Cadou, «Usage interne », PVE, p. 409.
3.In Hommage à René Guy Cadou, Maison de la culture de Bourges, exposition du 13 au 31 janvier 1965.
4.Aujourd'hui, c'est un paysage du même peintre qui est à cet emplacement.
5.In « Que la lumière soit », PVE, p. 24o. Le masque mortuaire de « l'inconnue », retrouvée sans vie dans la Seine dans les années 1900, est célébré dans les milieux artistiques de la première moitié du siècle (Aragon, Supervielle ou Tardieu ont écrit à son sujet).
6.R. G. Cadou, PVE, p. 68.
7.R. G. Cadou, « La peinture et RogerToulouse » (4 mai 1948), Le Miroir d'Orphée, Mortemart, Rougerie, 1976, P. 80.
8.Lettre 82, in Lettres à René Guy Cadou, 1937-1951, Nantes, Centre René Guy Cadou, 1997, p. 38.
9.Max Jacob, Esthétique, Lettres à René Guy Cadou, Nantes, Éditions joca seria, 2001, p. 48.
10.Noëlle Ménard (clin), catalogue de l'exposition René Guy Cadou, bibliothèque municipale de Châteaubriant, 28 mars-2 mai 1971.
11.Le terme est utilisé par André Lenormand dans un article d'Ouest-France intitulé «Guy Bigot au musée de Nantes en avril» (mars 1975).
12.Y. Cosson, « Cadou, les peintres et le pays de Châteaubriant », article cité note 1, p. 153.
13.Les hasards de la guerre firent se rencontrer Yves Trévédy, André Lenormand, Guy Bigot, René Guy Cadou, Jean Fréour. Entre 1942 et 1950, ils formèrent un groupe d'amis passionnés de création artistique. Yves Cosson, « Mort du peintre Trévédy », Presse-Océan, 11 septembre 1986. (Lenormand :1901-1993; Trévédy: 1916-1986, Bigot: 1918-1998.)
14. Lettre n° 179, p. 23. Les lettres sont classées par correspondant et par année. La deuxième lettre présentée dans ce recueil est datée du 17 mai 1947. Bigot y tutoie Cadou; le 17 mai est donc une date postquam non.
15.Edmond Humeau témoigne du fait que Cadou fut le premier qui « discerna sa grandeur ». Préface de l'exposition Guy Bigot, à la galerie La Roue, Paris,1962 (texte cité dans Guy Bigot, quarante ans de peinture, musée des Beaux-Arts de Nantes,1975).
16. Lettre n°191 du 13 décembre 1947, in Lettres op. cit. note 8, p. 24.
17.R. G. Cadou, PVE, P. 375 (poème daté du 7 octobre 1947).
18.On trouve les deux préfaces des expositions de Châteaubriant dans le catalogue de l'exposition Guy Bigot de 1975.
19.C'est Edmond Humeau qui parle de « merveilleuse aventure » (lettre du 28janvier 1975 in Guy Bigot).
20.Rappelons (est-ce un hasard ?) que Bigot porte le deuxième prénom de Cadou, celui du frère mort avant sa naissance.
21. Hélène ou le règne végétal (tome I) paraît en 1952 chez Seghers mais a été écrit entre 1944 et 1948.
22. À propos de la relation entre Cadou et Toulouse, nous renvoyons à la communication de François Garnis, « René Guy Cadou, Roger Toulouse, affinités du regard », in Un poète dans le siècle, René Guy Cadou, op. cit. note 1, p. 163-171.
23. Le premier article sur Toulouse et celui sur Apollinaire seront intégrés au Miroir d'Orphée.
24. Avant 1948, on trouve seulement trois recueils comportant un frontispice: Morte-saison (Pierre Penon), en 1941; Grand d'an (Robert Le Ricolais), en 1943; Pleine poitrine (Marguerite Le Ricolais) en 1946. Dans la période qui nous intéresse, signalons encore Guy Bigot, petit ouvrage non illustré et constitué du poème du même nom, « composé et tiré par l'auteur le 10 avril 1949, à 10 exemplaires, sur la presse de Sylvain Chiffoleau », comme un cadeau à l'ami qui se prépare à le quitter. Évoquons encore Moineaux de l'an 20, qui contient un très beau dessin de Bigot. C'est une plaquette tirée à dix exemplaires, en avril 1950. L'image est dédicacée « à René, douloureux poète, cette unique image de mon émotion ».
25.Il faudrait aussi évoquer l'École des beaux-arts de Nantes, « la plus vivante de lа province», selon le catalogue Douze peintres de l’école de Nantes (musée des Beaux-Arts de Nantes, 20 juillet-17 septembre 1961). Elle est dirigée par Paul Deltombe, un des fondateurs du salon des Indépendants. Mais il est impossible de prétendre reconstituer ici la vie culturelle nantaise de l'après-guerre; le lecteur peut consulter les archives du musée des Beaux-Arts.
26.En 1967, grâce à une exposition venue du musée Galliera de Paris, Une aventure de l'art abstrait, le musée reviendra sur l'histoire de l'abstraction (voir le livre éponyme de Michel Ragon, publié en 1956 chez Robert Laffont).
27.Julien Lanoë (1904-1983) fut le fondateur de la revue La Ligne de cœur, à laquelle collabora Max Jacob.
28. L'exposition Vingt jeunes peintres de tradition française, qui déjoue par son titre la censure de Vichy, se donne pour objet de résister au concept d'art dégénéré. Le catalogue de ce premier Salon est préfacé par Gaston Diehl, avec des textes de René Bertelé et André Rolland de Renéville, des poèmes de Jacques Prévert, Lucien Becker, André Frénaud, Jean Follain et Guillevic. Voir Gaston Diehl, La Peinture en France dans les années noires, 1935-1945, Nice, les éditions, 1999.
29.Cette exposition se déroule à la galerie Pierre Maurs (3, avenue Matignon, Paris), du 29 mai au 29 juin 1945.
30. Lettre K11, in Lettres I..J, op. cit. note 8, p. 52.
31. Guy Bigot, catalogue de la rétrospective Guy Bigot, quarante ans de peinture, musée des Beaux-Arts de Nantes, 1975.
32. Ces mots de la galeriste de Lenormand, Katia Granoff, sont rapportés par ce dernier dans le catalogue de l'exposition Rencontres de Nantes, musée des Beaux-Arts de Nantes, 21 octobre-25 novembre 1966. Lenormand rencontre Ozenfant en 1963,à la galerie Katia Granoff. Le purisme est représenté en peinture par Amédée Ozenfant (1886-1966) et en architecture par Le Corbusier. Voir l'ouvrage d'Ozenfant Après le cubisme (1918).
33.On connaît la célèbre définition du tableau que donne Maurice Denis: «Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.» (Art et Critique,1890.) Le peintre a un lien familial avec Jean Follain, qui est son gendre.
34.Catalogue de l'exposition André Lenormand, musée des Beaux-Arts de Nantes, 25 octobre-25 novembre 1974.
35.G. Bigot, in catalogue de l'exposition René Guy Cadou de Châteaubriant, op. cit. note 10, p. 34.
3б. L'exposition à La Baule est évoquée par Bigot dans une lettre à Cadou (lettre n° 184 juillet 1947, in Lettres p...], op. cit. note 8, p. 23).
37.R. G. Cadou, in catalogue de l'exposition André Lenormand, op. cit. note 34.
38.André Lenormand, in Maisons et décors de l'Ouest, décembre 1974, n° 99.
39.G. Bigot dans le catalogue de l'exposition Guy Bigot, quarante ans de peinture, op. cit. note 31.
40.Lettre n° 189 du 27 septembre 1947, in Lettres j..], op. cit. note 8, p. 23.
41. R. G. Cadou, « Poèmes inédits », PVE, p. 375.
42. Yves Trévédy, in catalogue de l'exposition René Guy Cadou de Châteaubriant, op. cit. note 10, p. 32. Une lettre de Bigot sur laquelle nous reviendrons suggère une date antérieure.
43.« Il était une amoureuse / Oui vivait sans être heureuse. / Son amant ne l'aimait pas.! C'est drôle, mais c'était comme ça. / Elle courut à la fontaine / Afin d'y noyer sa peine / Et tout le diable et son train / La poussaient dans le chemin.» On sait que Cadou et ses amis aimaient les chansons populaires. Il pourrait y avoir un lien entre l'étang de la chanson et la fontaine du poème par laquelle passe l'enfant.
44.G. Bigot, in catalogue de l'exposition René Guy Cadou de Châteaubriant, op. cit. note 10, p. 34. La question se pose du nombre d'exemplaires, 23 selon le Colophon, une dizaine selon Bigot. Moins de 23 en tout cas, selon Yves Cosson.
45.Lettre n° 11о5, in Lettres j..J, op. cit. note 8, p. 24.
46.Renvoyons sur ce point à l'article de Jean-Claude Valin, «La poéthique de René Guy Cadou »,Signes, n° 12-13, Nantes, Le Petit Véhicule, 1990, p. 53.
47.Lettre n° 189, in Lettres [..j, op. cit. note 8, p. 23. On peut constater ainsi un certain décalage entre ce mot de Bigot en 1971 et l'affirmation de Trévédy en 1971. Il semble que ce soit bien Bigot qui ait le premier imaginé sinon le livre, du moins des poèmes à partir des dessins.
48.Par ailleurs, des allusions aux peintres et à la peinture parsèment les poèmes de Cadou (par exemple, une allusion à Van Gogh dans «L'Idiot», 9' poème du Diable et son train).
49.G. Bigot, in catalogue de l'exposition René Guy Cadou de Châteaubriant, op. cit. note 10, p. 34. « Femmes d'Ouessant » et « Le Jardin du juge » appartiennent au Diable et son train. « L'Homme au képi de garde-chasse » évoque un tableau de Toulouse.
50. Il arrive que le motif majeur du texte et de l'image soit le même : par exemple, la silhouette d'un chien couché se trouve face au poème VIII, « Les Chiens qui rêvent ». Ce sont les plus proches de l'illustration traditionnelle, dirons-nous, sans toutefois que l'image soit subordonnée à la lettre du texte. Mais souvent l'image fait écho à un seul vers du poème, par exemple celle qui accompagne « Avec la langue des muets » (III), une lampe, s'accorde à ce seul vers: «Lorsque toute la salle est comme une petite lampe-pigeon à l'agonie.»
51.R. G. Cadou, « Usage interne », PVE, p. 404.
52.La page de titre le confirme. Dans nombre de livres de peintres, le poète et le peintre se partagent la vedette: le nom du poète précède le titre; celui du peintre le suit. Ici, on peut lire « Le Diable et son train, 20 poèmes de René Guy Cadou ; dessins de Guy Bigot et Yves Trévédy» : les peintres, on le voit, se cantonnent à un rôle d'illustrateurs.
 |
Le vers de guingois de René-Guy Cadou,
par Michel Décaudin. |

(Retour au sommaire archives)
Parle-t-il de poésie, Cadou n'insiste pas sur le faire, comme Mallarmé (on sait sa réplique à Degas : « Ce n'est point avec des idées que l'on fait des vers... C'est avec des mots »), ou Valéry (« Je cherche un mot, dit le poète, un mot qui soit : féminin, de deux syllabes, contenant P ou F, terminé par une muette, et synonyme de brisure, désagrégation ; et pas savant, pas rare. Six conditions — au moins ! »). Il s'attache à définir l'état poétique, qui est amour, la création, qui est Passion : « Je ne conçois d'autre poète que celui chez qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé (...) » et « La création poétique est à proprement parler une Passion, c'est assez dire par là le peu de cas qu'elle fait du calvaire, de la crucifixion et de la renommée ».
La poésie est pour lui un don : elle est « donnée à quelques-uns comme une antenne supplémentaire, un sens étroitement lucide qui permet de percevoir l'indicible ». Et si, après ce « don », qui est « à la base », il envisage le « travail », c'est en l'associant à la « compréhension », comme un « miracle », « une poussée contre la parole abrupte du réel ». Même mouvement dans la préface à Hélène ou le règne végétal :
« Je n'ai pas écrit ce livre. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer, comme un muet, l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du monde. La parole m'a été accordée par surcroit, afin de retransmettre quelques-unes de ces étonnantes vibrations, quelques-unes de ces mystérieuses palabres qu'il nous est donné d'intercepter, parfois, dans les couloirs de la détresse ».
Avec sa fulgurante perspicacité, Reverdy avait déсеlé en lui, dès ses premières œuvres, un « poètе sans effort » (ce qui ne veut pas dire qu'on travaille sans peine). Mais l'acte d'écrire — et l'acte préalable à l'écriture — n'est-il pas nécessairement effort ? La main à plume n'opère jamais dans une pleine spontanéité et il y aurait beaucoup à dire sur les douleurs de l'improvisation S'il y a une rigueur qu'il « exècre », la « rigueur mallarméenne », Cadou se réclame aussi de celle que lui enseigna Reverdy, « le raccourci poignant, l'image de guingois, lа phrase comme un morceau de rail luisant où l'esprit haut-le-pied dérape ». Toutefois, là où Reverdy crée sa propre forme, poème en prose ou vers libre, Cadou reste dans la mouvance de la prosodie traditionnelle et d'un certain nombre de ses schémas.
Non qu'il s'astreigne à l'ascèse valéryenne et au bon usage des contraintes : c'est là le genre de rigueur dont il ne veut pas. Mais la rime, les mètres, loin de constituer des moules intangibles, sont au contraire une source toujours renouvelée de variations; la dynamique d'un jeu référentiel succède à une pratique normative.
Ainsi dans un même роèmе, de la rime riche à l'absence totale de correspondance sonore, en passant par l'assonance, toutes les relations peuvent se rencontrer, sans système cohérent, selon, semble-t-il, le seul hasard de leur apparition. La malice du poète va jusqu'à éviter, parfois par un détail minime, l'impression d'un ensemble organisé. Les distiques du роèmе bien connu « Anthologie », par exemple, sont tous à rimes plates,
« Max Jacob ta vue et ta place
Pour lorgner les voisins d'en face ! »
— sauf l'antépénultième et l'avant-dernier, qui se présentent sous lа forme АВ - ВА :
« …Mais aussi mon Serge Essenine
Ce voyou qui s'assassina
Et la grande ombre de Lorca
Sous la pluie rouge des glycines ! »
Léger découpage, qui ne met pas en danger la structure du poème — l'équilibre n'est-il pas rétabli aux deux derniers vers ? — mais l'empêche de s'enfermer dans un automatisme formel que pouvait favoriser le distique à rimes plates. Dans d'autres cas, la glissade est plus longue, ou plus raide, sans jamais se transformer en exercice périlleux : il ne s'agit pas de subversion, ni d'acrobatie, mais de faux pas — voulu ou non — dans la marche cadencée, de pulsion survenant dans le rythme respiratoire.
Il n'en va pas autrement de la mesure et de l'organisation des vers. La simple apparence typographique du poème sur la page donne souvent l'impression d'une belle régularité, avec des distiques d'alexandrins, des quintils d'octosyllabes, des quatrains, ou de longues coulées d'une vingtaine de vers. Ne nous y laissons cependant pas prendre. La répétition litanique de « La Solitude », soutenue par les reprises rhétoriques des « avec », « quand », « dans », inscrite dans une seule phrase, trouve sa forme dans une succession de vingt vers — des octosyllabes, sauf trois, le second, le neuvième et le dernier, qui n'ont que sept syllabes. Passe encore pour celui en qui se résout le poème, « Je recommence le monde »; mais quelle motivation aux deux autres, sinon qu'ils sont là — à peine sensibles dans la texture de l'ensemble —, pour rappeler qu'un principe d'incertitude traverse les constructions qui peuvent paraître les plus rigoureuses ? Mieux, on verra Cadou, dans « Mourir pour mourir », rompre la mesure des distiques alexandrins avec le vers :
« …Qu'en dites-vous Isidore Ducasse et toi Rimbaud »
alors que « Lautréamont » lui permettait de retomber sur ses pieds, et, plus loin, avec un «encor» qui, s'il n'est pas une coquille, détruit une mesure qu' «encore» aurait conservée.
Diversement, on pourrait dire que le vers libre de Cadou n'est jamais entièrement libre. Il ne répugne pas plus à la rime que le vers régulier ne l'exige absolument. Son découpage typographique dissimule à peine une prédominance de mètres canoniques — le plus souvent l'alexandrin ou l'octosyllabe — dont les rythmes s'imposent en transparence. Telle la dominante 6 — demi-alexandrin — qui s'impose dans la première partie de « La Fuite éperdue » :
« …Plus seul d'être à la fois/ lui-même
Et son ouvrage /
Absent toujours présent / au procès de sa vie /
C'est moi
C'est encor lui /
Voguant sans océan / qui n'est jamais parti. »

La chambre d'écriture à Louisfert et la main de bronze:"Et la main oubliée macule le décor..."(Chambre de veille) |
René-Guy Cadou, une poésie à la « la lumière des mains »,
par Antoine Gérald. |

(Retour au sommaire archives)
Voilà vingt ans déjà, René Lacôte appelait de ses vœux le chercheur qui donnerait « sur l'œuvre de Cadou l'étude attentive et précise dont le public (...) a besoin ». (1)
Par le fait, il y faudrait plusieurs veilleurs postés au carrefour des sens et des formes où ils s'incarnent, épiant en particulier au fil des poèmes les jeux de constant va-et-vient entre deux règnes privilégiés, l'Humain et le Végétal. Les pages qui suivent sont tout au plus l'extrait d'un journal de
guet consacré à l'observation d'un mot-thème fascinant, ne fût-ce que par la fréquence de ses retours : main, au singulier et davantage au pluriel, apparaît à 368 reprises sur 522 pièces de vers, la plupart très courtes comme on sait. L'abondance révèle et engendre l'obsession. Saisir la nature profonde de celle-ci à travers la bigarrure de celle-là : tel est notre souhait.
*
Certes, Cadou n'est pas le premier créateur que l'image de la main ait captivé. Mais s'agit-il bien toujours d'une image, et n'est-elle pas pour lui, plus souvent, un signe ? En quoi il s'inscrit dans la lignée des artistes modernes qui, selon Matisse, remonterait à Delacroix : « Il y a deux catégories d'artistes, les uns qui font à chaque occasion le portrait d'une main, (...) par exemple Corot. Les autres qui font le signe de la main comme Delacroix » (2) :
« Jе suis là…
Ne sachant si la main est un signe » (Présente )
Une légion de ses poèmes est là pour répondre : peut-être ne sait-il pas, mais sa vision de l'univers, terre, homme/femme et ciel confondus, est toute peuplée de mains qui nous font signe et qui sont autant de signes, non point algébriques ni abstraits, mais sources de tous les pouvoirs, où l'esprit, le cœur, la chair sont à la fois ou tour à tour impliqués. L'évocation haletante d'Antonin Artaud ne dit pas tout, mais peut servir d'ouverture :
« Avec tes mains
Tes mains sur les barreaux de l'asile Antonin
Tes mains sur les fils électriques
Sur l'espagnolette sur la poésie partout
Antonin partout
Tes mains sur ton front pressées
Sur tous les corps de jeunes filles
Sur la campagne de Rodez… »
Les mains du malheureux Antonin, projetées ainsi en avant, signes à la fois de la résistance à l'enfermement, de la maîtrise de l'expression créatrice, des paroxysmes affectifs qui se traduisent par ce geste en plusieurs endroits, décrit (et toujours dans un moment pathétique) des mains autour du front, des appels de la passion amoureuse, de la communion enfin avec la nature, — ces mains se retrouvent en effet, selon l'adverbe répété, partout dans les poèmes de Cadou comme dans la tragique destinée d'Artaud.
Autant énumérer tout de suite, avec un peu d'ordre, les principaux champs thématiques sur lesquels s'étend l'empire de la main/des mains, d'un bout à l'autre de l'œuvre, sans qu'on puisse vraiment y distinguer, du moins de ce point de vue, de variations bien nettes. On relèvera seulement une moindre fréquence dans les dernières années, comme si l'auteur avait été mis en garde (peut-être par lui-même) contre les périls d'un excès.
Le premier leitmotiv, qui en recouvre plusieurs autres et d'ailleurs clairement solidaire de la mission signifiante des mains, est celui de la main détachée, « voyageuse », aérienne. On pourrait le croire d'inspiration surréaliste, ou encore apollinarienne (et sans doute l'est-il pour une part) ; mais deux traits au moins assurent sa spécificité.. L'un nous est indiqué par Usage interne : « Plus le poète se rapprochera de la terre, plus il est aérien ». Grâce à quoi se comprend beaucoup mieux, par exemple, la séquence en forme de scènes dramatiques Aveugles - Lilas du soir - Liens de la terre : les mains que le poète confond « dans la clarté du schiste » (I, 168) (3) ou qu'il étend « au ras des plaines » (I, 170) sont les mêmes qui « s'envolent de ses bras » (I, 132) pour devenir feuilles ou colombes.
L'autre trait, plus original encore, se résume également en un couple : à la main détachée répond la main nouée au poignet, au bras, à l'épaule (autre thème richement traité ; celui de l'épaule, symbole de force et de refuge), à toute la membrure du corps dont le regard du poète s'enchante. Main solitaire et solidaire, comme Hugo disait de l'arbre en regard de la forêt !
Le second motif majeur est celui de la main végétale, participant de la nature jusqu'à pouvoir se changer en tous les éléments qui la composent.
Les thèmes suivants nous ramènent à la condition de l'homme, fait avant tout, selon le poète, de la main, du visage et du cœur. La main alliée au cœur est le signe naturel de toutes les communions, de la douceur, de l'amitié, de l'amour; celle qui s'allie au visage apparaît plus proche des mouvements de l'esprit; mais le plus souvent la main unit l'un à l'autre pour se faire créatrice — d'objets, d'images, de paroles, jusqu'à devenir l'interprète — le signe — de Dieu même.
N'ayant ici à satisfaire nulle fringale d'exhaustivité, on s'épargnera les frais de fastidieux inventaires pour réserver un sort meilleur à quelques témoins de choix.
Un objet et un personnage peuvent rivaliser s'il s'agit d'illustrer la signifiante quasi magique de la main, C'est d'un côté, dans Ciel de Pâques
« La main de l'ami qui bat
Comme une enseigne »
et de l'autre - il fallait s'y attendre - Le Mime :
« Seules ses mains parlaient qui suivaient le visage
…
Mais penché sous la lampe oblique de ses mains
Cet homme remuait un visage d'eau douce »
Des mains détachées, aériennes, celle « de l'ami qui bat comme une enseigne » est un exemple assez éclatant; mais il n'est pas seul de son espèce et l'on ne sait trop comment choisir entre les cinquante que nous avons dénombrés. Un titre de poème sonne du moins lе branle : La Main dénouée (II 230), avec ces vers où parlent à la fois la Majuscule, la présence du mot « signe » et l'invitation à l'amour :
« ll y a cette Main dénouée qui se révèle
Au signe le plus clair d'une belle journée
Et j'apprends à aimer… »
Sans vouloir classer toutes les variations auxquelles se prête ce thème capital on peut discerner les plus insistantes, L'une, d'apparence très surréaliste, est le motif des mains qui « traînent » ou « planent » on sont « disposées » sur la table, la cheminée, les meubles (cf. I, 107, 140,269,326); mais prenons garde : la main parente de la table est d'abord celle qui écrit, signe de celui qui ordonne les signes :
« Table où sont nées mes mains
Falaises de la lampe »
Elle n'est pas éloignée non plus, grâce à la valeur double du mot « feuille », du motif si cher à G. Apollinaire : les mains qui tombent des bras comme la feuille de l'arbre :
« Une table encombrée de feuillage et de mains »
( Les Amis de Rochefort )
« lI y a des mains des feuilles qui tombent »
( Voir venir )
Cependant, la hantise de la main détachée peut rencontrer chez Cadou des accents beaucoup plus intimes et profonds, liés aux visions de la mort tant humaine que divine. Comment ne pas communier dans le secret à la déchirante douceur de ces paroles du fils à son père, devant le lit où repose celle qui vient de les quitter :
« Tu pleures
Et cette nuit nous avons le mêmе âge
Au bord des mains qu'elle a laissées »
(30 mai 1932)
Ce signe des mains léguées atteint sa plénitude mystique lorsqu'il s'agit de celles du Crucifié. Écoutons « Le Poète » dans la scène III des Lilas du Soir :
« Il dort toujours, Marie, vois ses mains qui se sont
faites colombes... »
Mais le plus extraordinaire se situe entre les deux scènes précédentes. La première est une Descente de Croix et les premiers mots du Poète sont : « Seigneur, prends mes mains et sèche ton visage ». Or Jésus, si l'on ose dire, le prend et les prend au mot si bien qu'à la scène II la Femme du Poète peut lui crier :
« Toi ici. Non jésus. Non. Mais ces mains ?
Tu lui as volé ses mains. Voleur. Voleur. »
Et Jésus de répondre : « Ce sont les miennes », avant de dire aux moissonneurs : « Allez. Mes paroles sont moins douces que vos mains ». Tant il est vrai que les mains qui créent sont faites à l'image de la Main de Dieu.
*
De même que se confondent les mains entre la créature et son Créateur, ainsi s'échangent-elles entre l'homme et la création embrassée dans toute son étendue, de la mer aux vents et aux nuages, de la terre au soleil, des racines de l'arbre à ses feuilles et aux ailes de l'oiseau. Ici encore l'observateur ploie sous la richesse des exemples. A ne regarder que les modes d'expression qui figurent les mains en les transfigurant, on retiendra entre autres les mains pétales (I, 41), les mains feuilles et feuillages (I, 97, 130, 286; Il, 11, 58, 59, etc..), pampres (1,215), herbe (11, 176), mousse (I, 59), racines d'arbre et plantes (l, 167; l I, 152). Voilà pour l'assimilation au « Règne végétal »; mais il faudrait encore citer les « mains fluviales » (lI, 32; cf. I, 276), la pluie ou l'averse des mains (1, 16, 225, 318), la main du vent sur les sapins ou sur la plaine (I, 92, 126), et surtout, pour finir, les mains oiseaux et leurs divers visages : « main-ramier du printemps » (1, 103), « mains qui glissaient dans le vent» et que le poète a charge d'appivoiser (1,139), sans omettre une trilogie discrète mais pleine de sens : le lecteur trop prompt n'en apercevra que le premier sujet, celui de l'oiseau dans les mains (I, 333, 343...) alors que deux autres lui répondent. Son symétrique d'abord, même s'il est nié :
« Ne croyez pas non plus
Que des oiseaux lâchés ont tenu dans leurs ailes
La liberté de ce visage et de ces mains »
(Pour une défense )
L'audacieuse synthèse ensuite que réalisent les mains d'homme recueillant des mains-oiseaux, soit colombes foudroyées (Les Camarades, 1, 335) :
« Et si parfois des mains descendent dans les vitres
En temps de neige agonisantes comme un oiseau
Ouvrez vos mains
Et nichez y ces deux colombes »
soit pigeons réchauffants (I, 368) :
« Tu tiens comme un pigeon
Mes deux mains dans les tiennes. »
A qui réclamerait encore les clés de cette magie s'offre le choix entre plusieurs textes que l'on dirait à l'usage des lecteurs perdus ou affolés. Ainsi cette parce du Poète à Jésus (1, 159) :
« je ne suis pas un, mais tout ce qui rampe, qui danse, qui dort,
je suis le chèvrefeuille brûlant de la lampe, la parole
des ramiers, le pas des sources, je suis présences. »
et cette autre à l'Aimée, dont il est malaisé de savoir si sa figure est marine, humaine ou végétale (mais est-il besoin de savoir ? Rappelons-nous : « Il y a..., Des fleurs / Des femmes / Des fleurs belles comme des femmes. » (I,359) :
« Tu es pleine de poissons dans ta chevelure
…
Tu es celle que j'aime
Davantage que le pain
Et davantage que mes mains étendues
Sur chaque versant des collines )
(Toi)
*
Le mariage des mains et du cœur paraîtra plus rassurant, et ses fruits plus comparables à ceux que continue d'offrir à nos imaginations habituées le vaste verger romantique : communion, douceur, tendresse, désir et nostalgie, amitié, amour.
De ces fruits l'on dira donc peu, sinon qu'ils mûrissent en abondance, que la présence de la main très souvent se joint à celle d'un signifiant de douceur :
« Tu glisses avec les algues de douceur
Entre les rameaux blancs les mains » (I, 40)
« Un doux clochard abrite en ses mains un oiseau »
(Rue du Sang, II, 12)
qu'enfin R.-G. Cadou fait une large place à l'expression de deux thèmes jusqu'alors assez rarement exploités par les poètes : l'amour filial, et l'amitié née du compagnonnage. Cette seconde veine se retrouve, il est vrai, dans divers chants de l'épopée clandestine ; mais ce qui reste propre à la poésie des Amis d'enfance, c'est précisément la tendre tyrannie du signe de la main. Quelques rapprochements parleront d'eux-mêmes; celui-ci d'abord :
« O mon père et ma mère
Partagez-vous mes mains » (Avant-sommeil)
« Amis lequel de vous s'est réservé mes mains ?)
( Les compagnons de la première heure)
Puis un autre, redoublé :
« La main qu'il faut donner
Pour entrer dans la ronde » ( Nuit facile )
« Une main reconnue qui se fond dans ma main »
( Au pied du mur )
« Et ma main sur ta main tout mon sang passe en toi »
( Lettre à Michel Manoll )
Ces derniers vers vous reconduisent vers le motif commun où le poète puise ses variations : celui de l'union, volontiers marquée du sceau sacrificiel, entre les mains et le cœur. Trois textes, triés avec peine parmi d'autres, aideront à mieux l'entendre, chacun étant au surplus enrichi d'une note particulière. La Fille sauvage, à qui s'adresse le poète, est l'emblème accompli de la créature humaine incorporée à l'univers végétal, Or que lui dit-il :
« tu guides dans l'ombre épaisse de tes mains
Ce cœur ensanglanté par les griffes du lierre »
Mais à cette aide vaillante des mains guidant, le cœur blessé réplique, de manière bien plus forte encore, le concours réciproque. Ici c'est un Christ de Gauguin qui en témoigne :
« Merci de tes présents dit tout bas le Seigneur
Mais laisse-moi puiser à deux mains dans ton cœur »
Là c'est le poète, mais derechef à la suite de Jésus, s'adressant à Max Jacob éternisé dans la mort :
« Maintenant que tes mains ont trouvé sous la terre
Enfin le battement initial de ton cœur
J’entends ta voix »
Nul besoin de savoir-faire herméneutique pour capter un double message : la main ne saurait créer, dans l'ordre éthique aussi bien qu'esthétique, si elle n'est d'abord à l'écoute patiente et passionnée du cœur. « Le poète est un homme d'amour », est-il écrit dans Usage interne.
*
On y lit, il est vrai, un autre axiome en forme non point du tout de contradiction, mais de complément : « Je n'invente pas, je crée. Qui dit invention dit intelligence. Qui dit création dit amour ». Ce qui, dans le registre analogique, se transcrirait à peu près de la sorte : la main remontant au visage inventen, la main touchant le cœur crée. Mais ceci n'exclut point cela, et le signe en définitive le plus précieux que puisse constituer la main est un trait d'union entre l'un et l'autre. Très révélateur à cet égard est, dans Lilas du Soir, le dialogue entre l'Aveugle et... la Main :
L'Aveugle : O main dе tous les hommes, main coupante comme le fiel, je t'aime,
La Main : Est-ce bien vrai?
L'Aveugle : Je t'aime et te déteste aussi fort que la vie, pont jeté entre ton cœur et moi, ô mon ami. Tu es seul dans la mansarde de ton sang, mais ta main retrouvée soupèse mon visage.
L'Aveugle est un inestimable protagoniste de cette alliance entre la main et le visage que la main façonne et dessine. Le Mime, on s'en souvient, en est un autre :
Seules ses mains parlaient qui suivaient le visage
Mais l'homme voyant et parlant doit savoir, lui aussi, se recueillir dans la nuit et le silence, le front entre ses mains (motif fréquent, répétons-le, chez le poète), s'il veut prendre conscience à la fois de ses impossibilités et de ses pouvoirs de faire et de dire :
« J'aurai tout oublié
Les pampres les visages les paroles déliés
La tête et les mains vides
…
Prisonnier de mes mains
Et de ma face d'homme
Je suis là
Et j'attends »
(Point mort)
« Tu peux te relever
Composer ton visage
Étaler tes deux mains
Comme un objet de prix »
(Quand tout s’en est allé)
« O fleur je t'ai gardée mes mains et mon visage
Qu'ils servent à jamais pour un meilleur usage »
(Le Coquelicot )
Pour quel usage donc, sinon les deux tâches que le poète ne cesse de leur assigner et qui en vérité n'en font qu'une : le travail, c'est-à-dire la création, et l'amour. En cela l'homme, mains, visage et cœur confondus, ne fait qu'un avec la Nature et avec Dieu. Plusieurs vers déjà cités nous ont préparés à mieux l’entendre ; en voici quelques autres. D'abord sur les mains ouvrières comme eût dit Péguy :
« Le soleil maintenant...
Les mains vont s'habituer à devenir abeilles »
( La visiteuse )
Et ces fragments qu'on a peine à dissocier du chant où ils s'insèrent :
« Je vous donnerai bien davantage que le soleil
Je vous blanchis de mes mains lavandières »
(Octobre)
«
« Ce soir je te confie ces mains pour que tu dises
A Dieu de s'en servir pour des besognes bleues »
(Hélène ou le Règne végétal )
Par où se trouve rejoint le thème de la main humaine, sœur et servante de celle de Dieu
« Car Dieu sur la montagne est bien près de me plaire
Qui dans la double écuelle de ses mains
Assaisonne la soupe noire de la terre
D'un peu de sel puisé dans les yeux du matin »
(Credo)
« O mon Dieu que la nuit est belle où brille l'anneau de
Votre Main »
( Nocturne)
Mais que l'homme, surtout, veille à s'en souvenir : sa main n'obéira point au Signe miraculeux si par malheur elle abandonne le cœur en chemin; et par un trait assez remarquable, ce n'est pas au poète manieur de mots, mais au peintre artisan des lignes et des couleurs que Cadou en appelle pour nous signifier cette vérité, première et ultime :
« Au-devant de la toile
Il n'y a pas que cette main qui va
Comme une bête vers l'abattoir du couchant
Il y a même autre chose qu'un mouvement,
Le coeur définitif en proie à sa conquête »
(Peinture )
Sans nul doute y aurait-il beaucoup d'autres choses à faire voir, s'il fallait épuiser les trésors qui s'élaborent « dans la confrontation décisive des mains » (Comme un seul homme). Par exemple l'accord de la main à l'épaule que nous n'avons qu'indiqué en passant. Ou encore celui de la main et du soleil : soleil sur ou dans les mains, ou bien même main du soleil
« Dans la main du soleil où bourdonne midi »
(Partie perdue)
« Et la main du soleil qui tourne sur le toit »
(Le Printemps mène l'aventure)
Ou enfin connivence de l'un à l'autre créatrice :
« Si je lève la main le soleil se dessine »
(Visage ou paysage )
« Je commence un poème qui ne doit pas s'achever
Il a tourné dans le soleil et dans ma main »
(Avec l'amour )
Le lecteur aura pu songer à un autre absent : le thème de la main violente, meurtrière, répliquant à celui de la main aimante et féconde. Mais ce silence-là reproduit celui du poète : face à des centaines de vers chantant les mains de la fraternité, de la tendresse, de l'amour, nous avons juste découvert trois passages (dont l'un, déjà cité, est à double entente) évoquant la main brutale (II, 203) ou féroce (L'homme au tablier de boucher). Signe négatif, mais clair : le poète a élu les mains de douceur et non de cruauté ; parfois celles qui souffrent et qui saignent à l'image de celles du Christ pour répandre l'Amour et la Beauté (Jour de Dieu, La Beauté, Le dernier verre), non celles qui font souffrir et mourir.
Ce qu'a mission d'exprimer le Cœur définitif, c'est la Présence de l'Amour où jaillit l'un des plus beau Cantiques des Mains, telles que la vie ne cesse de les recréer :
« Tes mains plus douces que des mains
Toutes les mains renouvelées
Un seul instant entre les tiennes. »
Notes :
(1) Rеné-Guy Cadou. L'Herne - 1961 -p80
(2) Aragon ; Henri Matisse, roman - t.1, p.112
(3) Ces chiffres renvoient à l'édition des Ouvres poétiques complètes en deux volumes, Paris, Seghers, 1973.