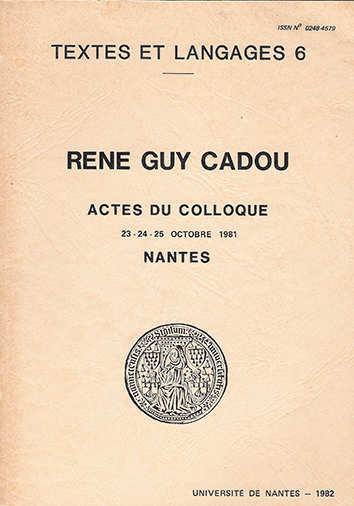
23-25 octobre 1981
Actes du colloque René Guy Cadou, Nantes...
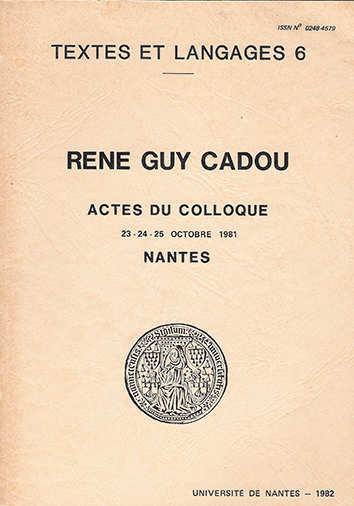
23-25 octobre 1981
Humour et lyrisme chez René Guy Cadou, par Serge Auffret
Actes du colloque de Nantes - 2325 octobre 1981
La rencontre de l'humour et du lyrisme dans la personnalité du poète René Guy Cadou dont peuvent témoigner ceux qui l'ont connu, rencontre qui se retrouve dans son œuvre, est peut-être l'un des éléments qui expliquent le mieux la singularité de sa voix.
Cadou en était conscient, lui qui écrivait dans ses « Notes sur l'Humour en poésie » (Le Miroir d'Orphée, p. 110) :
En 1919, Jules Supervielle intitulait son premier livre poèmes de l'Humour triste. Ce titre admirable est un pléonasme. Si je ne conçois pas de tristesse sans humour - à moins qu'il ne s'agisse d'un Vigny, le plus actuel de nos modernes avec Essénine et Lorca - il m'est bien difficile de séparer l'humour d'un certain élément de tristesse, absolument pas élégiaque, et qui est celle du grand Chaplin lorsqu'il affronte les monstres usuels de la quotidienneté.
et se donnait pour grand frère Charlot, et pour petit frère ce Kid dont il parle à maintes reprises.
Cette rencontre, qui prit du temps et fut le fruit d'une longue réflexion poétique et humaine a pour achèvement ce qu'on peut appeler l'humour lyrique de René Guy Cadou.
La rencontre de l'humour et du lyrisme
C'est parfois par leurs contraires, ou en tout cas par ce qu'elles ne sont pas, que les choses se définissent le mieux. Si Cadou n'est pas ironique ou élégiaque, nous pourrons par-là mieux comprendre son humour et son lyrisme.
Dès l'abord, il convient de distinguer ce qu'on entend ici par le mot « humour », mot dont Cadou dit qu'il est intraduisible, et, pour ce faire, d'utiliser un repoussoir, l'ironie. On trouve en effet à la source de l'humour et de l'ironie deux attitudes diamétralement opposées. Humour et ironie sont souvent confondus, et pourtant ces deux frères siamois ne laissent pas d'être fort différents. On pourrait avancer que l'humour recèle une part de sympathie pour son objet, tandis que l'ironie se refuse à toute complicité. Dans les deux cas, il y a bien recul, distance, jeu, mais là où l'humour accueille, l'ironie exclut, rejette. Il est des cas où la frontière est difficile à tracer, particulièrement lorsque l'ironie se fait souriante ou l'humour grinçant. Lorsque Cadou écrit :
«J'aimerais assez cette critique de la poésie la poésie est inutile comme la pluie» ( Usage Interne, p. 250, II).
le poète fait un clin d'œil paradoxal ; il faut lire que la poésie, loin d'être « ennuyeuse comme la pluie » est autant qu'elle nécessaire à la vie : la critique n'est qu'un compliment déguisé.
En revanche, lorsque Cadou écrit :
« Certains poètes ne font leur œuvre que derrière les vitres. Aussi cette œuvre ne nous apparaît-elle, le plus souvent, que maculée de chiures de mouches ». ( Usage Interne, p. 257,
par l'emploi des termes péjoratifs « font leur œuvre » et « chiures de mouches », le poète se veut dénonciateur, ironiste et non complice, lui qui aime à rappeler que sa poésie est « de pleine poitrine ».
L'ironie de Cadou s'exerce surtout dans ses œuvres théoriques aux dépens du monde littéraire, des faiseurs, des modes, des salonnards. L'ironie est une arme, elle attaque, et il semble que Cadou ne la maîtrise pas totalement, probablement parce que cette forme d'esprit est peu familière à sa sensibilité comme à son caractère. Cadou est l'homme de l'amitié, de l'accueil, sa pente naturelle est plus à sympathiser qu'à vilipender. Le sourire de Cadou est plein d'humour et rarement ironique.
De même, le lyrisme élégiaque est quelque chose dont Cadou a appris à se méfier, parce que le meilleur de soi donné directement peut ne pas être compris, peut être bafoué.
Cadou revient à plusieurs reprises sur le fait que l'émotion ne peut être la seule base du poème, car elle pourrait mener à un sentimentalisme facile. Il donne au mot sentiment le sens qu'on lui trouve dans des expressions comme : « Faire du sentiment » ou « avoir quelqu'un par les sentiments ». Lorsqu'il écrit :
« L'effusion n'est pas le sentiment. La sensibilité n'est pas non plus le sentiment » (Usage Interne, p. 259, II),
il valorise effusion ou sensibilité qui appellent aussi une « fraternité » entre le poète et son lecteur ; il récuse toute complicité larmoyante, toute exposition impudique du sentiment individuel et secret. Cadou refuse l'état d'âme pour l'état d'âme. Lorsqu'il parle de « chasteté en art », il veut dire par là qu'il faut de la pudeur. Il évite de se prendre au sérieux, de tomber dans le piège de l'indulgence vis-à-vis de lui-même, dans le piège qu'on pourrait appeler élégiaque. Le garde-fou intérieur du poète, nous dit-il, est l'ironie qu'il exerce à son propre égard ; le garde-fou intérieur du poème est l'humour.
Ironie et lyrisme sont incompatibles par essence : ils peuvent, cocktail surprenant, coexister dans un même poème ; en aucun cas, ils ne peuvent se fondre. L'ironie est destructrice, elle arrête l'élan, enraye la spontanéité : elle sape les fondements mêmes du lyrisme. Or Cadou est poète de l'élan, poète de la spontanéité. L'humour, lui, n'est pas incompatible avec le lyrisme. Il peut même le requalifier, lui donner un sang neuf, lui offrir des voies nouvelles, comme l'ont senti Corbière, Laforgue, Apollinaire... tous poètes dont se réclame Cadou et qu'il cite avec précision dans ses Notes sur l'Humour en Poésie.
Cadou n'est pas venu tout de suite à une telle maturité de réflexion et d'écriture. Nombre de ses premiers poèmes sont menacés par le danger du sérieux, et c'est souvent le jeu de mots que comporte le titre : Coeur sur Table, Coeur à l'Ouvrage, Glace Rompue, Condamnation à Vie qui est la seule note évoquant une éventuelle distance. Le propos est parfois presque dogmatique, ce qui exclut ce doute salvateur découvert ensuite :
« Or l'humour est une forme du doute, et je ne conçois guère de poésie sans doute, sans une interrogation constante (...)» ( Le Miroir d'Orphée, p. 122).
Les poèmes de jeunesse prêtent le flanc à cette critique dogmatique, mais avec le temps, il devient de plus en plus difficile de trouver matière à ce reproche.
Cadou découvre peu à peu la nécessité d'un « écran » qui permette en même temps de laisser parler la sensibilité et de ménager la discrétion. La première forme de pudeur, de réticence qu'on découvre chez lui est l'emploi de la métaphore atténuant l'expression directe de l'émotion. Dans le poème 30 Mai 1932 (p. 209, I), poème à proprement parler élégiaque puisque c'est la plainte de l'orphelin qui assure son père veuf de son amour d'enfant, l'affection humaine est identifiée au liseron, cette fleur simple et vivace, comme savent l'être les « mauvaises herbes ».
Cadou n'a jamais abandonné la métaphore au profit de l'humour. Celui-ci est venu comme une richesse supplémentaire, et s'est affiné au fil du temps. Dans les grands poèmes lyriques des derniers recueils : La Barrière de l'Octroi, La Saison de Sainte-Reine, Moineaux de l'An 1920, Mémoires, Le Chant de Solitude, Lettre à Pierre Yvernault, curé de campagne, Jugé, Nocturne, cet antidote au sérieux, ce garant de la discrétion occupe une place immense. Les poèmes de la maturité qui ne sont que plainte sont rares : La Lettre d'Avril (p. 166, II) où Cadou laisse échapper le reproche :
« Quand on revient sur la fin de l'hiver d'une très longue et monacale maladie
Ah ! c'est trop de ce silence abrupt et de la défection finale des amis ! »
un instant tempéré par la note d'humour triste :
« Dans ma pensée tu me servais de brise-vent» se clôt sur le sentiment d'abandon du poète :
« Mais tu as craint de te perdre avec moi sur cet océan de tristesse ».
Toutefois, la métaphore finale :
« Où les épaules vous pleuvent le long du corps en coups de fouet
Comme une averse ! »
restaure silence et noblesse et atténue le caractère élégiaque d'un poème qui aurait pu n'être que plaintif.
La fusion à laquelle Cadou aboutit entre humour et lyrisme porte peut-être un nom : ne serait-ce pas ce « surromantisme » que Cadou crée sur romantisme et surréalisme? Le mot lui-même indique un dépassement du romantisme. Cadou écrit :
« J'appellerai surromantisme toute poésie qui, ne faisant point fi de certaines qualités émotionnelles, se situe dans un climat singulièrement allégé par le feu, je veux dire ramenée à de décentes proportions, audible en ce sens qu'elle est une voix, aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle surréalistes...» ( Usage Interne, p. 276,
et ce n'est pas forcer sa pensée que de remarquer d'une part l'affirmation de la nécessité des « qualités émotionnelles », et d'autre part ce seul mot : « Décence ». Cette décence n'a rien à voir avec un code moral préétabli, elle est affaire de pudeur individuelle et de respect. C'est en cela que le poème est « allégé ». Cadou rêve en fait d'équilibre, et l'humour est le contrepoids d'un lyrisme que guette l'élégie, tandis que le lyrisme balance un humour qui, sans lui, aurait pu glisser à l'ironie.
Humour et lyrisme s'épaulent et se marient ; l'équilibre qui en résulte, s'il est réussi du point de vue esthétique, est surtout profondément humain. C'est en fait d'une aventure humaine personnelle que résulte ce style, et non d'une série de choix, esthétiques purement théoriques. On retrouve ici la personnalité de Cadou, vérifiant par la même occasion la profondeur de la remarque : « Le style, c'est l'homme même ». Lyrisme comme humour sont des façons d'être au monde, des attitudes devant la vie, sourire en pleurs, larmes consolées par le rire.
Telles sont ces deux attitudes positives de l'œuvre de Cadou : l'humour empêche le lyrisme de devenir élégiaque, le lyrisme interdit à l'humour de devenir ironie.
L'humour lyrique
Il reste encore à rencontrer plus précisément cet humour lyrique qui devient la voix de Cadou -peut-être pas sa voie unique, mais sans doute celle où il met le plus de lui-même-, à trouver ses sujets de prédilection, à identifier ses modes d'expression.
La pudeur de Cadou s'exprime d'abord dans la conjonction de l'humour et de la tendresse. La première personne que Cadou se refuse à prendre trop au sérieux, c'est lui-même, l'enfant qu'il a été et l'adulte qu'il est. Le récit qu'il fait de sa naissance dans Mon Enfance Est à Tout le Monde :
« Malgré les assurances maintes fois réitérées de mon père, je n'ai jamais très bien compris comment j'avais pu venir de si loin dans cette caisse aux planches disjointes, mal rabotée et toute hérissée de clous comme une bogue de châtaigne.
« Il fallut qu'on m'apportât en vrac tout un fouillis de vrillons et quatre paillons à bouteilles -un pour chaque membre, bien sûr- pour que je me convainque à demi. Commande passée, envoi fut fait de ma jeune personne de cette ville dont jamais oncques ne sut le nom, et j'arrivai en gare de Sainte-Reine-de-Bretagne, un dimanche gras de février 1920, sur les dix heures du soir. L'employé des Messageries -il n'y avait pas de messageries- mettons le guichetier de service, bien que l'heure du dernier voyageur fût depuis longtemps passée, me conduisit lui-même, ménagements dûs, sur une brouette, au domicile de mes parents, jouxte la mairie, une maison d'école aux volets clos, à la façade proprement ravinée ».
refuse le mythe et constitue l'exemple même d'une page d'humour lyriques Par le commentaire sous forme d'incises («un pour chaque membre bien sûr», «-il n'y avait pas de messageries-», «ménagements dûs»), par l'alliance de mots («à la façade proprement ravinée»), par le voisinage du noble et du familier, par le ton détaché qui est celui de la constatation scientifique («Commande passée, envoi fut fait...»), le poète désamorce ce qui aurait pu être grandiloquent. Grâce à l'humour tendre, on ne verse pas dans la complaisance autobiographique.
L'humour est aussi possibilité de complicité avec sa propre enfance, lorsque le poète montre un petit garçon affolé par l'absence de son père, qui lui revient d'« une Amérique à trois cents mètres de chez nous » (La Saison de Sainte-Reine, p. 56, II).
Après l'enfant, l'instituteur, qui sait bien qu'on parle encore de l'« école du diable » pour parler de l'école laïque, se rit du personnage dont on pourrait l'affubler :
« Lanoê dit au curé : Pour René Guy Cadou ?
Quelques mètres, au fond de l'enfer tout au bout !»
(Encore une lettre à Max, 425, I).
Face à son intime conviction qu'il va mourir jeune, il sait encore garder la légère distance de l'humour :
« Je ne ferai jamais que quelques pas sur cette terre
Et dans cette grande journée
Je ne passerai pas pour un vieil abonné »
( La Barrière de l'Octroi, p. 55, 11).
Sa poésie elle-même n'échappe pas à cette remise en question, à cette distanciation de l'humour :
« Et tant pis si je m'emploie de travers à résumer le Mélodieux »
(Cantique d'Automne, p. 460, 1)
et :
« Voici que je dispose ma lyre comme une échelle à poules contre le ciel
Et que tous les paysans viennent voir ce miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles»
(Le Chant de Solitude, p. 154, II).
Le gauchissement du lyrisme qu'apporte l'humour a pour parallèle exact sa conception de la Beauté légèrement « de guinguois ».
En amitié, la tristesse devant la fragilité de l'être humain et des relations entre les êtres lui inspire des poèmes pleins de pudeur, où l'affection se refuse à l'effusion « élégiaque ». L'enjambement des deux vers à propos de Michel Manoll :
«Toi dont la iambe traîne un peu comme une brume D'été» (La Haie Longue : 1 KM, p. 31, II)
exprime silencieusement toute une fraternité insaisissable.
Cette amitié s'étend aux objets, telle sa table de travail : les vers :
« O ma table
Boiteuse dont le pied est un môle berceur»
(A travers les Branches, p. 2 79, I).
où le procédé d'enjambement interrompt provisoirement le flux du lyrisme, sont bâtis sur le même modèle ; l'humour consiste en cette harmonie imitative du vers boîteux ou bancal qui évoque terme à terme l'ami boîteux ou la table bancale.
L'un des procédés que Cadou emploie volontiers pour parvenir à l’« humour lyrique » est le jeu sur les mots, qui permet de leur en faire dire plus, ou leur confère un pouvoir magique. C'est ainsi que Cadou parvient à l'étymologie poétique suivante :
« Je ne parvenais jamais toute de suite à m'endormir, ressassant, dans ma tête les événements infimes de la journée, événements que je grossissais, qui, à la lueur de la petite lampe Pigeon - pourquoi Pigeon ? A cause du roucoulement qu'elle fait avant de s'éteindre - prenaient des proportions. funèbres ». (Mon enfance Est à Tout le Monde, p. 93)
Etymologie autant lyrique qu’humoristique
Un traitement humoristique est souvent chez Cadou le gage d'une profonde sympathie : le poète emprunte à l'humour populaire pour mieux dépeindre en retour des héros presque épiques qui sont, suivant la formule, de « petites gens », comme Victor le garde-chasse :
« Victor le garde-chasse aurait quatre-vingts ans
Mais toute l'eau qu'il a bue lui a fait mal avec l'anis qu'il ajoutait dedans
Il est couché dans le soleil et pour ce qui est de son chapeau melon, il n'ira plus à personne.
Quand un verre roule sous la table c'est comme le repos de son âme qui sonne » (Mémoires, p. 136,
ou comme l'Idiot (p. 77, II) :
« On voit le long d'un mur encor chaud un vieil homme
Au visage d'enfant et pressant sur son cœur
Deux ou trois touffes de plantain souriant comme
Une épousée de dix-huit ans ou un noceur
Si limpide est son œil son sourire si grave
Qu'on l'aime d'un seul coup et qu'on oublie qu'il bave
Il est là avec sa main tremblante qui fait mal
Et sa pauvre coiffure de papier journal
On y lit « Réunion du Conseil des Ministres »,
dont le dénominateur commun est justement qu'ils sortent du commun, et risquent en tant que tels d'être rejetés, comme peut-être le poète :
« Cher ami ! sans doute êtes-vous comme moi dans un village
Encadré par les candélabres de la pluie
Recevant à dîner d'inquiétants personnages
Comme Rimbaud ou Max Jacob ou Jésus-Christ ».
( Lettre à Pierre Yvernault, Curé de Campagne, p. 157, II)
Cadou restitue poétiquement le caractère de la langue populaire, avec ses familiarités, mais aussi parfois ses préciosités (Ce que Disait l'Epicière de Saint-Benoît-sur-Loire, p. 1 12, II) :
« Lorgnons d'or fin et gros sabots
Monsieur Jacob sait ce qu'il faut
On voit beaucoup gens de Paris
Hocher la hure quand il prie
Mais je sais bien moi qui vous parle
Que Monsieur Jacob ça lui tarde
De frotter l'huis du Paradis
Croyez-vous c'est un érudit !
Disent personnes bonnes à battre
Plus raisonneuses que savates
Monsieur Jacob moi je le sais
Et vous le dis sauf le respect
C'est Belzébuth dans un corset »
Le contraste entre vocabulaire lyrique et vocabulaire familier est cultivé ici et là :
«... dans un chemin creux de Saint-Gervais-La-Forêt
Qui est sûrement un patelin merveilleux ».
( Lettre à Jules Supervielle, p. 400, I)
où le mot « patelin » sert de caution au mot « merveilleux ».
Un fait mérite d'être signalé : que ce soit lorsqu'il évoque Hélène ou ses parents, le poète ne choisit pas l'humour tendre, comme s'il ne voulait pas tempérer sa tendresse ; c'est alors le jeu des métaphores qui remplace l'humour dans sa fonction de garant de la discrétion.
L'humour lyrique peut aussi être essentiellement libérateur. La relation du poète avec Dieu est placée tout entière sous le signe d'une ferveur pleine d'irrévérence :
« Saint-Antoine bien aimé de Jésus
Faites-moi trouver ce que j'ai perdu
Un jour aux courses de Craonne
Perdu mon Dieu en trois personnes »
(Saint-Antoine, p. 99, II)
d'une foi marquée de doute. Ces hésitations nous font comprendre la vocation assignée à l'humour par Cadou lorsqu'il écrit :
«Or l'humour est une forme du doute et je ne conçois guère de poésie sans doute, sans une interrogation constante». ( Le Miroir d'Orphée, p. 112).
reprenant la formule de Max Jacob : « Là où il y a humour, il y a une pensée et une douleur».
L'humour libérateur du poète s'en prend à Dieu de deux façons ; la première consiste à jouer sur l'image traditionnelle et naïve qu'offrent de Dieu les catéchismes à un sou ou les couturières bretonnes (Mon Enfance Est A Tout le Monde, p. 41) :
« Mon Dieu ce n'est pas parce que tu as coupé ta barbe
Rouge et verte comme des côtes de rhubarbe
Ni parce que tu ne te vêts plus à l'antique
Comme les jeunes gens dans les sociétés de gymnastique
Que je ne suis plus capable de te reconnaître ». (p. 239, II)
Les métaphores lyriques du jugement particulier (qui précède le Jugement Dernier) sont la « composition », l'examen, le jugement suivis de la proclamation des résultats, de l'arrestation et de la distribution des prix ; le maître d'école Cadou se sent de cœur avec l'enfant turbulent (mauvaise tête, bon cœur) renvoyé du catéchisme - Paradis pour mauvaise conduite :
« J'ai tant besoin d'amour
Mon Dieu, tu ne peux pas me rayer de ton cour s»
(Monts et Merveilles, p. 307, I)
et :
« Oh ! attendre les résultats d'un examen toute sa vie !
Menteries à tous les étages de l'esprit !
Jugé ! Mais cet oral comment le préparai-je ?
Soue à cochons plutôt que le divin Collège !
Me voici devant l'Agrégé final moi l'impétrant»
(Jugé, p. 167, II)
Dieu est aussi présenté non plus comme le maître d'école, mais comme l'aubergiste ou le patron de café qui fait crédit tout en tenant ses comptes :
« Me voici dans la vingt-neuvième année de mon âge
Avec beaucoup de litres vides derrière moi
Compte jamais réglé sur l'éternelle ardoise » (p. 116, II)
«Oh ! sur l'ardoise du Ciel si l'on tient compte
De ce pays sans charme ou je suis né
Si l'on juge à propos de mes larmes
Seigneur ! je suis exonéré !»
(Nocturne, p. 174, II)
ce qui se paye étant aussi ce qui s'expie.
La deuxième façon de s'en prendre à Dieu consiste à faire voisiner brutalement humour et lyrisme, au moyen de plusieurs procédés. Le jeu sur les mots, hérité souvent de confusions enfantines, est une source particulièrement riche et originale :
« C'est dans ce voisinage que grand-mère Benoiston avait choisi de m'apprendre le « Notre-Père », sur un banc de pierre au ras du sol et tout inondé de soleil. Le temps avait disjoint les moéllons, et furtifs, des lézards glissaient entre nos pieds.
Donnez-nous, aujourd'hui, notre pain quotidien !»... « Quotidien », c'était pour moi un nom inscrit en caractères rouges sur le journal que chaque jour le facteur apportait à mon père. Pourquoi, le pain ? je n'en manquais guère et lui préférais les gâteaux à étoile de sucre, les castilles et le reinet gris de la mère Couvrant ».
«Il laissa tomber : «J'ai appris officieusement (mot que je ne comprenais pas et me faisait songer aux cuisiniers des grands hôtels ou à la Sainte Messe), j'ai appris officieusement que nous étions nommés à Nantes...»
(Mon Enfance Est A Tout le Monde, p. 21-23 ; et p. 171)
et :
« O mon Dieu ! j'ai tellement faim de Vous tellement besoin de savoir
Qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires
Que la cuisine soit bonne ou fade nous ne sommes point ici à l'Office »
(Nocturne, p. 172, II).
Cadou joue sur les niveaux de langage ; « votre visage » et « votre tête » sont deux possibilités concurrentes d'apostropher Dieu :
« Considérez que je vous suis parent par quelque femme de village
Et par quelque vaurien d'ancêtre
L'une adorait Votre Visage
L'autre s'est payé votre tête »
(Nocturne, p. 173, II)
il joue sur les proximités phonétiques :
« Et si c'était mon Dieu ce marin saoul qui est entré ce soirdans ma maison ?
L'éternité ! dont vingt-trois ans de navigation !
Nazaréen ou Nazairien ! Peu importe l'état-civil »
(Si c'était lui, p. 156)
L'emploi des majuscules (qui marquent traditionnellement le respect de Dieu) est subverti de façon humoristique par le choix des mots qui les portent :
« Je crois en Vous Hôtelier Sublime ! Préparateur des Idées justes et des plantes
N'allez pas redouter quelque conversion retentissante !»
(Nocturne, p. 172, I)
Les invocations lyriques, loin d'être soutenues, ont souvent une contrepartie humoristique, avec le jeu sur le mot patron (à la fois le saint patron et le patron qui peut mettre l'employé ou le client à la porte) :
« Mon Dieu mon cher patron vous m'avez bien berné
Je n'ai vu que le ciel et le bout de mon nez »
(Burger, p. 411, I)
Enfin, l'emploi du point d'exclamation chez Cadou est parfois volontairement ambigu ; il s'agit là peut-être du procédé le plus discret -mais non le moins efficace- qui permette la fusion de l'humour et du lyrisme. Dans :
« Oh ! sur l'ardoise du ciel si l'on tient compte
De ce pays sans charme où je suis né
Si l'on juge à propos mes larmes
Seigneur ! Je suis exonéré ! »
(Nocturne, p. 1 74, II)
L’exclamation peut dévoiler la surprise de celui qui ne s'y attendait pas, peut pas y croire (humour).
La juxtaposition du familier et du lyrique caractérise aussi le traitement réservé à la Sainte-Famille : la situation biblique est présentée sous un jour apparemment anodin :
« Tous les hôtels sont fermés à Bethléem Où dormira celle que j'aime » (Noël, p. 356, I) qui contraste avec le titre du poème : Noël. |
nimbent est un mot lyrique et moitié le contre-poids humoristique.
Cadou a naturellement tendance à s'interroger de façon métaphysique sur les origines et les fins. Qui sommes-nous ? D'où venons- nous ? Où allons nous ? Face à la peur que peuvent susciter la mort ou la rencontre de la transcendance, il aboutit dans ses derniers recueils au seul exorcisme qui manifeste une fois de plus sa liberté : l'humour lyrique et libérateur.
Ainsi, l'humour lyrique de Cadou, c'est peut-être le « bonheur des tristes » dont parle Luc Dietrich, ou encore la force de la faiblesse (non la force des faibles) face à tout ce qui est inéluctable. On pourrait alors appliquer au poète lui-même ce qu'il écrit de son ami Max Jacob :
« Il y a là un homme sans défense qui se cherche des armes, qui se les forge lui-même au feu du ridicule, afin d'en faire peut-être cette épée de Saint-Georges qui terrassera le dragon ».
( Le Miroir d'Orphée, p. 95 ).
Témoignage d'un ami, par Pierre Béarn
Actes du colloque de Nantes - 2325 octobre 1981
Contrairement à la plupart de ses amis, je n'ai rencontré Cadou que deux fois, à Paris. Jamais à Rochefort-sur-Loire ou à Louisfert. La vision que nous avions l'un de l'autre s'imposait en esprit, par l'intermédiaire des facteurs.
Récemment, cherchant à mettre de l'ordre dans deux ou trois mètres cubes de correspondances fort variées, j'ai découvert un dossier Cadou égaré dans la paperasse du Passé.
17 lettres manuscrites.
La première remonte au 3 janvier 1947. Les précédentes, et surtout celles du temps des Vous, sont probablement perdues pour jamais.
Cette lettre, la voici :
« 3 Janvier 47 à Louisfert, Loire Inférieure.
Mon Cher Béarn,
Veux-tu m'adresser les trois numéros de la N.R.F. demandés, en même temps que :
Une orgie à Saint-Pétersbourg, de Salmon,
et Bringolf, de Cendrars.
Si cela te passe entre les mains, veux-tu me mettre de côté
Supervielle : La fable du monde, Le forçat innocent, Gravitations,
Salmon : La négresse du Sacré-Cœur,
Reverdy : Ecumes de la mer,
Max Jacob : Visions infernales.
Je n'ai malheureusement pas reçu tes deux livres. Le 58 Bd. Victor Hugo, à Nantes, a été rasé par une bombe le 8 Juin 44, et j'y ai tout laissé. Je m'étonne qu'on ne t'ait pas retourné ton envoi qui devait cependant porter ton adresse. J'aurais bien aimé te consacrer un papier dans Horizon.
Excuse l'encre groseille de cette lettre. Je t'écris de mon bureau de magister parce que j'ai hâte de recevoir une partie de ton trésor, heureux Alibaba.
Bien fidèlement tien. Cadou. »
Pour éclairer cette lettre, je dois ajouter qu'elle s'adressait aussi bien au poète que je suis qu'au bouquiniste que j'étais alors, au Quartier-Latin de Paris.
Les titres des livres qu'il recherchait dans mes rayons sont éloquents. Quant à la N.R.F. il la pourchassait vraiment, découvrant à tout moment des numéros qu'il voulait lire, mais n'avait pas.
Sans doute est-ce à cause de son goût pour la N.R.F. que nous sommes devenus des amis. J'étais, en effet, l'unique spécialiste de cette revue prodigieusement riche en talents exceptionnels. J'en possédais 25 à 30 000 numéros. Cette manne, je la devais à la rancune que m'avait inspirée l'attitude de Jean Paulhan qui acceptait mes notices mais refusait systématiquement mes poèmes. Vexé, je décidai de faire le vide ; c'est-à-dire de mettre la main sur tous les numéros en liberté. Bientôt, on ne trouva plus de NRF dans les bouquineries de Paris. Quant à moi, je ne vendais qu'à mes amis les numéros dont ils avaient besoin, sur les 25 000 que je possédais !
C'est donc dans ma bouquinerie que je fis la connaissance de René Guy Cadou. Il m'arriva frais comme un maraîcher, les épaules heureuses, l'air d'un lutteur fier de sa force. Plutôt petit, mais râblé ; la main loyale. On s'embrassa. Jusqu'à cette première visite (il m'en fit deux), nous n'avions été l'un pour l'autre que des amis épistolaires. Nous prenions enfin conscience de nos voix et c'était pour découvrir que nous étions nés du même sang.
Sans doute prématurément marqué par la mort, il avait le défaut d'être toujours pressé ; du moins à Paris. Et moi, j'étais débordé de besognes.
Tout de même, un jour de l'été 42, j'enfourchai mon vieux vélo et je pris la direction de Rochefort-sur-Loire. Hélas, Cadou n'y était pas. Déçu, j'installai tristement ma tente non loin de la pharmacie de Jean Bouhier. Mais l'Ecole de Rochefort-sur-Loire, c'était surtout Bouhier ! Bouhier et sa pharmacie ! Les habitués manquaient mais Luc Bérimont était-là, ainsi qu'Adam, le dramaturge ; Jean Méningaud, le sous-préfet ; et Jégoudez, le sage, l'ami solide. Peut-être deux ou trois autres dont le nom s'est effacé dans ma mémoire. Ma tente devint bientôt, dans son environnement, une cour de récréation de l'Ecole de Rochefort-sur-Loire.
Lorsque je repris mon vélo, cahotant sur des pneus mal ressemelés par des morceaux de chambre à air, à cause de la guerre, j'étais vraiment devenu un complice du maître d'école absent, mais qui continuait de m'écrire.
Sa dernière lettre est du 17 décembre 1950, quelques mois avant sa mort. La voici :
« Mon Cher Béarn,
Il ne me semblait pas avoir lu des poèmes de toi depuis ton recueil Mains sur la mer, je crois ; mais je te retrouve bien dans les poèmes que tu m'envoies, si directs et si humains. Je ne sais pourquoi, te lisant, je pense à un Dabit-poète-en-vers, car, en prose, il l'était terriblement... Pour ce que tu me dis, Jean de Boschère a tort. Le poète n'est pas seulement un arlequin amuseur, mais il peut l'être parfois, tout en demeurant poète (exemple : Max Jacob) ; mais Jean de Boschère est un poète ésotérique, et ça, c'est la désolation de la désolation ; l'ennemi puissance A. Je préfère encore la rhétorique de Monsieur Pierre Emmanuel. Loys Masson, oui ; mais surtout Luc Dietrich, dont je n'ai jamais lu les vers, mais Le Bonheur des tristes et L'apprentissage de la ville sont l'Iliade et l'Odyssée de notre génération. C'est aussi beau que Meaulnes, en sang noir. Affectueusement tien.
Cadou. »
Le pauvre.
Dans une lettre du 23 mai 50, il me disait qu'il avait été opéré deux fois et, parlant d'un article que j'avais écrit sur lui : « Ce ne sont pas des choses à faire en ce moment où la moindre émotion me fout du rouge aux joues comme à une pucelle...»
Aucune de ses lettres n'était banale. Il continuait de me demander des livres et des N.R.F. Nous lisions les mêmes auteurs. J'aimais Luc Dietrich : je le lui avais fait aimer. Excédés, tous deux, par le silence qui entourait, déjà, les poètes vivants, sur les ondes de la Radio.
A Paris, parlant du problème de se faire lire, connaître, reconnaître, il avait eu cette boutade : « Pour réussir, il faudra bientôt naître avec un grelot à la place du menton !»
En ce temps-là, la Télévision n'existait pas. Seule, la Radio utilisait les ondes. La Poésie n'était pas morte, sur les trois chaînes, mais les poètes dont elle parlait, par l'intermédiaire de Pierre Emmanuel et de Luc Estang, si mes souvenirs sont bons, étaient tous vieux de plusieurs siècles.
Paul Gilson était alors directeur des programmes. Nous étions liés d'amitié par la même femme, une fille qui maltraitait avec énergie la langue française, et ses amants. Entre deux puissants bavardages, je fis reproche à Gilson, poète vivant, de ne mettre en valeur sur les ondes que des poètes morts.
- Que veux-tu ? me dit-il. Une émission où tu parleras de tes amis, qui sont sans doute aussi les miens ? Oui ? Eh bien, je te la donne ; mais fais très attention. Ne mêle pas la politique à tes projets. Il y a une Censure ici, et je ne tiens pas à supporter le poids de tes incartades.
J'obtins Douze minutes ; d'où mon titre Douze minutes avec un poète. J'allais pouvoir enfin aider tous ceux que j'estimais, André Salmon, Mac Orlan et Jean de Boschère, bien sûr, mais aussi tous ceux dont le nom ne parlait encore qu'à l'oreille des initiés ; c'est-à-dire : Cadou, Bérimont, Laugier, Rousselot, Seghers, René Ménard, Béalu, Jean Follain, Philippe Dumaine, Albert-Birot, René Fallet, René Hardelet, Becker, Luc Decaunes, Audisio, Houdelot, Pichette, Manoll, Yves Robert, Angèle Vannier, Fombeure, Loys Masson, Louis Guillaume, Lanza del Vasto, Pierre Emmanuel, Luc Estang, Robert Sabatier, Jean-Claude Renard, Louise de Vilmorin, Paul Chaulot, Edmond Humeau, l'Anselme, etc, etc, et jusqu'à Léopold Sedar Senghor, alors à peine connu sinon par son titre de député.
Presque toute la jeunesse poétique de l'après-guerre !
Ce fut tout naturellement à Cadou que je pensai pour inaugurer ma croisade : « Viens donc à Paris. Nul n'a encore parlé de toi à la radio. Tu diras ce que tu voudras !»
Hélas ! Quelques jours, plus tard, le 19 septembre 1950, je recevais cette réponse désolante, et désolée :
« Louisfert (Loire Inférieure).
Mon cher Béarn,
Ta proposition me va droit au cœur. D'autant plus que ce serait avant tout l'occasion de t'embrasser et d'embrasser quelques amis ; mais, mon pauvre vieux, tu ignores que je suis perclus de rhumatismes (après deux opérations cette année et le temps humide de cet été) et sans argent. Sans costume autre que du gros velours à côtes de paysan ; que c'est la veille de la rentrée des classes et enfin que je suis sûr de bafouiller au micro, n'y ayant jamais parlé. Mais je te remercie bien fort quand même, mon cher Béarn. Si tu voyais un moyen d'arranger cela, je pourrais répondre à tes questions et quelqu'un, que tu désignerais, lirait mes réponses au micro. Affectueusement tien.
Cadou. »
Pour un début, c'était le drame. Que faire ?
Lire, au micro, par un comédien, ses réponses, allait à l'encontre du but que je m'étais fixé : présenter des poètes vivants, dans une série d'émissions vivantes.
Alors, choisir quelqu'un d'autre ; le second de ma liste ? Impossible. Le programme était officialisé et l'heure de l'enregistrement fixée, car on manquait de studios.
En ce temps-là, je possédais déjà un magnétophone ; j'aurais pu prendre le train et mettre l'émission sur bande magnétique ; mais c'était alors contraire aux règlements. Aucun metteur en ondes n'osait utiliser l'invention nouvelle. On enregistrait alors sur disque ; on corrigeait les bafouillis ou les erreurs grâce à un crayon spécial qui sillonnait de blanc tout ce qui était à supprimer. C'était un travail d'artiste que d'utiliser à l'antenne ces disques mutilés.
Paris-Inter et la chaîne parisienne de Vincent-Bréchignac possédaient quelques magnétophones mais ils ne marchaient pas à la vitesse du mien, plus ancien sans doute. D'où une complication que nul technicien ne voulait prendre en charge.
Quatre ans après, en 54, j'eus les mêmes problèmes avec Louise de Vilmorin qui n'avait pas voulu se déplacer. L'enregistrement, sur mon magnétophone, en plein air, devant le château, comportait des bruits d'oiseaux et de klaxon, je dus signer une décharge au metteur en ondes, où j'affirmais prendre la responsabilité des imperfections sonores ! Tout ce qui venait de l'extérieur était automatiquement suspect et jugé méprisable !
Il fallait donc remplacer Cadou par un copain qui prendrait sa voix ; c'est-à-dire commencer ma série d'émissions par une sorte d'escroquerie sentimentale.
Tant pis. Après deux jours d'angoisse, j'alertai Bérimont. Il avait déjà une grande habitude du micro, mais sa voix est très particulière. On allait certainement le reconnaître ; surtout Paul Gilson, dont le devoir était de vérifier s'il avait eu raison de me faire confiance ! Car, je le répète, c'était ma première émission !
Le jour de l'enregistrement, nous n'étions guère en liesse, Bérimont et moi. La supercherie nous apparaissait évidente. Pourtant nul ne s'en aperçut ! Ou, du moins, nul ne s'en plaignit. Heureusement, car, profitant de l'occasion qui m'était offerte de parler en direct aux « chers auditeurs » je n'avais pas manqué de ruer dans les brancards de la routine, dès le départ :
- Beaucoup d'entre vous connaissent Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Hugo. Je n'ai donc pas l'intention d'ajouter à leur gloire. Mon propos est de vous faire connaître des poètes vivants qui seront peut-être les grands poètes de demain. Une Littérature est en péril et si elle ne se renouvelle pas...
Je fis également état de mes échecs dans la réalisation d’une telle entreprise. Certains poètes des podiums en place s'étaient montrés fort réticents. Mon choix de jeunes inconnus les plongeait dans la perplexité : « Qu'irais-je faire au milieu de ces gens-là ? » me dit Pierre Jean-Jouve. D'autres, devenus romanciers, craignaient de perdre de la notoriété si le Grand Public apprenait qu'ils étaient également poètes ! D'autres allèrent jusqu'à mettre en doute la valeur de mon heure d'émission : « A onze heures du matin, vous n'aurez à l'écoute que des concierges !»
C'était dur pour les « chers auditeurs » mais je tenais à répondre d'emblée à ceux qui s'étonneraient de certaines absences.
Cadou ? Qui donc, en 1950, connaissait Cadou ? Je l'avais choisi justement parce qu'il symbolisait à lui seul la nécessité de ma croisade.
A ma première question : « Cadou, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la poésie moderne », ce fut donc la voix de Bérimont qui répondit :
« - Je pense qu'il est encore trop tôt pour établir le bilan de la jeune Poésie. Il semble pourtant que l'on assiste, depuis une vingtaine d'années, à un assaut de tentatives personnelles plutôt qu'à une attaque concertée. Je pense notamment à Patrice de La Tour du Pin publiant, avant-guerre, sa Quête de joie ; à Henri Michaux ; à Audiberti, livrant en vrac ses Tonnes de semence. Elles m'apparaissent comme les manifestations les plus spectaculaires des années 1935-1940. L'ancien Surréalisme apparaît déjà débordé. De nouveaux poètes occupent une partie importante du ciel de la Poésie. Parmi ces poètes du Lustre noir, comme dit Audisio, je retiens les noms de Loys Masson et de Pierre Emmanuel, bien que l'un fasse une place trop grande à l'exotisme, et l'autre à la rhétorique du discours poétisé.
- Les tendances actuelles ? Je les vois surtout représentées par ce groupe appelé d'abord Poètes du dernier carré ce qui est tout un programme ; puis Poètes de la Loire, et que je nommerai volontiers surromantiques.
- L'école de Rochefort ? Oui. Surtout les compagnons de la première heure :
Lucien Becker, Jean-Rousselot, Michel Manoll Amis venus à la parole
Comme un bruit de moteur à l'orée du matin
Amis, lequel de vous s'est réservé mes mains ?
A l'auberge du Gué du Loir
Tous quatre
Lucien rapporte de Moselle
Ses forêts
Et l'alcool ardent de ses prunelles.
De Poitiers à Vendôme
C'est Jean qui se promène au bras de son fantôme
Impossible à saisir comme les oiseaux froids.
A Saint-Calais au bord du toit
Je reconnais Michel
En train de découper dans le ciel bleu des ailes !
Pour le gué du sommeil
Et la Loire à passer...
Bonsoir au Gué du Loir !
Les amis sont passés.
- Il faudrait y ajouter Luc Bérimont, Luc Decaunes, René Lacôte. Et beaucoup d'autres unis par la camaraderie mais séparés, parfois, par des querelles politiques. Ces poètes se présentent comme les héritiers de Rimbaud ; mais ils le sont aussi de Reverdy, de Max Jacob, de Milosz, d'Eluard. Ils dissimulent, sous des mots pudiques, leur profonde tendresse pour les choses de la Terre et pour l'Homme ; mais pas à la façon des Unanimistes. Ils n'ont plus le culte de l'image pour l'image, mais ils s'emploient à rajeunir les vieux mythes et à doter le langage de nouveaux proverbes...
J'intervins alors pour faire entendre un nouveau poème de Cadou : Europe.
« Nuit partout.
Le monde est plein d'ombres qui marchent.
Sang noir, coquelicots, ruisselez sur les marches.
Un cadavre inconnu empoisonne les blés.
Il y a des femmes qui pleurent,
Un vieux casque rouillé où sont poussées des fleurs,
Les odeurs de la terre,
L'œil brillant d'un fusil sous les cils des bruyères
Et la main qui retient les paupières du feu.
Les uns forcent les neiges,
D'autres ont pris la mer au sortir du collège,
Quelques-uns, crucifiés, saignent dans les haubans.
Dieu a quitté la cène.
On manque de pain blanc.
Ah ! dormir dans les branches !
Mais le ciel à son tour livre ses avalanches.
Salut les passereaux !
L'écolier dévidait son cœur sous son sarrau.
Garde ton beau visage !
Le dernier coup de feu sauve le paysage !
Et ton bras se soumet aux amis de passage. »
Puis, je lui dis : « Vous n'avez cité jusqu'ici que de grands poètes, ou des amis qui deviendront grands ; mais les jeunes ? Ceux qui vous suivent. Qu'en pensez-vous ? Et, même, que leur reprochez-vous ? »
Et Cadou répondit :
« De mettre la charrue avant les bœufs, par exemple. La Poésie ne commence pas à Rimbaud. Encore moins à Apollinaire. Il faut avoir été romantique à quinze ans pour se permettre d'être Henri Michaux à quarante, ou Max Jacob à soixante. Les jeunes poètes devraient méditer cet aphorisme de Saint-Pol Roux : « La table de travail est comme un large crucifix sur laquelle le poète s'expose pour s'éterniser.» En d'autres termes, la Poésie est ascèse, amour et renoncement. Et elle est aussi conquête sur soi-même. »
Puis je voulus lui faire préciser quels avaient été ses maîtres. Etaient-ils des classiques, au-delà de Rimbaud, ou, tout simplement, et comme une sorte de contradiction, la génération précédant la nôtre ?
Et Cadou répondit :
« Reverdy et Max Jacob. Pourquoi ? Parce que Reverdy m'enseigna la rigueur. Non pas la rigueur mallarméenne que j'exècre, mais le raccourci poignant, l'image de guingois, la phrase comme un morceau de rail luisant où l'esprit haut-le-pied dérape. »
Et il ajouta :
« Peu de temps avant sa fin tragique, mon cher Max Jacob devait parvenir, à son insu sans doute, par son propre exemple, à me détacher de la poétique de Reverdy. Il est mort comme Jammes, comme Milosz, comme Apollinaire auquel j'ai consacré deux études ; parce que si l'auteur d'Alcools n'est pas un poète immense, c'est, du moins, un poète utile. Je veux dire par là un poète qui possède une descendance. »
Et les vivants ?
« J'ai peu de sympathie pour la Poésie à tendance philosophique, comme celle de Jouve, ou moyenâgeuse comme celle de La Tour du Pin, ou ésotérique comme celle de Jean de Boschère, ou surréaliste entêté comme celle d'André Breton, ou simplement gentille, technicolore et anarchiste de Prévert. »
Je n'avais plus qu'une question à poser : Pourquoi écrivez-vous ?
« Je l'ai déjà dit quelque part. J'écris par ambition. Pour me mériter moi-même. Pour me persuader que je vis. Par innocence, sans doute. Mais, qu'un poème de moi continue de vivre dans la mémoire de quelque ami inconnu, que ce poème l'allège ou le renforce dans sa conviction d'homme, alors je suis pour toujours récompensé. »
Ce fut la fin de cette émission ; la seule qui ait été consacrée à Cadou de son vivant.
Mais je la poursuis ici par les propos que nous n'avons pu dire à sa place durant les trop courtes minutes de notre entretien sur Paris-Inter. Par exemple :
« Ce ne sont pas les festins solitaires de certains, ni les grands banquets de propagande des autres qui me tentent, mais une bonne et vieille cuisine à la française. Le poète se doit d'écrire pour des oreilles poilues. Donc, pas de poésie populiste ! Guilloux ni Dabit ne sont des écrivains populistes. Ce n'est pas parce qu'un tel aura chanté l'usine et les labours ou bien la mine, ou bien les revendications ouvrières, qu'il sera compris et aimé du peuple. »
Cadou avait, sans doute, écrit cela à cause de moi ; c'est-à-dire à cause de mes poèmes de Couleurs d'usine, que Seghers avait publiés au début de 1950 et dont les étudiants de mai 68, après avoir reçu, en prospectus, lors d'une séance tumultueuse du théâtre de l'Odéon à Paris, un des poèmes en question, tirèrent le slogan Metro Boulot Dodo, sur lequel j'ai fini par toucher des droits d'auteur fort appréciables, par l'intermédiaire de la Sacem. Cadou savait que j'avais vécu, dans mon sang, cette synthèse de la vie.
Il avait également écrit :
« Que ma poésie soit d'abord une révolte ! Qu'elle me mette en face de moi-même ! Qu'elle me distingue ! Par mes tentatives, hasardeuses souvent, timides et immodestes, je me suis donné rendez-vous dans le cœur des hommes de mon âge. Eluard cherchait à donner à voir, et je saisis bien ce qu'il entendait pas là. Mais, plus qu'à voir, il s'agit de donner à aimer. Que l'amour soit une contagion ! Apollinaire, lorsqu'il délaisse la Bibliothèque Nationale ; Milosz, quand il se souvient d'une berline arrêtée dans la nuit ; Max Jacob, lorsqu'il s'adresse à Marie, sont des poètes contagieux. »
Mais Cadou ne put pas comparer son texte avec le mien, que j'ai publié dans ma revue La Passerelle, car cette émission exceptionnelle, qui consacrait son talent, il ne l'entendit pas !
Le 22 octobre 1950, quelques jours après, il m'en avisait, navré :
« Je t'écris de mon lit, que je n'ai pas quitté depuis deux jours, cloué par une nouvelle et violente crise de rhumatisme articulaire aigu. Figure-toi que c'est à partir d'aujourd'hui seulement que Paris Inter est relayé par Nantes II, si bien que je n'ai pas pu entendre notre émission !»
Quelques jours plus tard, j'appris par Michel Manoll, combien était précaire sa situation d'instituteur malade, non titularisé. La question qui se posait était : comment lui venir en aide sans meurtrir son amour-propre ?
Un prix littéraire, créé spécialement pour lui ? Impossible.
Ce fut alors que me vint l'idée d'un Mandat, constitué par les apports de ses amis. Un don d'honneur en quelque sorte. Le « Mandat des Poètes » était né. J'écrivis à 180 écrivains, disant à chacun d'eux : « Donnez-moi mille francs, pour Cadou.» 58 me répondirent, dont quelques écrivains connus : Jean Cocteau, Vincent Muselli, André Salmon, Jules Supervielle, et tous les copains, les amis, depuis Hervé Bazin jusqu'à Jean Follain, en passant par Rousselot, Guillevic, Paul Chaulot, Edmond Humeau, Béalu, Pierre Seghers.
Le palmarès de l'amitié.
L'an passé, nous avons fêté le trentième anniversaire du Mandat des Poètes car il s'est révélé rapidement que Cadou n'était pas seul à avoir besoin d'un tel témoignage d'amitié. Il y avait Albert-Birot, absolument seul, désespéré d'être oublié, et que le Mandat remit en lumière ; André de Richaud que le Mandat, par mensualité cette fois - précaution n'est pas usage - parvint à faire sortir de l'asile de vieillards où il croupissait à Valauris et qui put écrire, dès la sortie : « Non ! je ne suis pas mort ! » Armen Lubin qui, de son sanatorium, m'écrivit : « Merci, Béarn, mais, dans mon isolement, je me serais contenté de la liste des donateurs !» Jean Germon, toujours aussi méconnu, renaissant à la joie de vivre sur son lit d'hôpital, à Nice. Angèle Vannier, retrouvant en son cœur la lumière perdue. Miatlev, le délirant lyrique, Ribemont-Dessaignes, Pierre de Massot, Georges Perros et jusqu'à Blaise Cendrars, tremblotant de malaise dans son fauteuil de malade, tandis que nous dînions, sur sa propre table, non loin de lui, sous ses yeux effrayés.
70 poètes, à une heure misérable de leur vie, ont ainsi bénéficié de l'amitié que nous portions à Cadou.
L'amitié.
Si les liens qui unissent les hommes sont semblables - en esprit - aux matériaux qui font les maisons, l'amitié fut le ciment de l'Ecole de Rochefort. La renommée de Cadou fut cimentée par l'amitié que nous lui portions.
Que serait aujourd'hui Cadou, si nous ne l'avions pas hissé, tous, sur le tremplin de nos cœurs ?
Ce grelot au menton, dont il me parlait, ce furent ses amis qui l'accrochèrent à son nom. Cadou fut poussé vers la gloire et la survie de son œuvre par les mille clochettes de l'amitié.
Cadou, le succès de Cadou, la connaissance que vous avez tous de Cadou, c'est le triomphe de l'amitié. C'est la preuve, dans notre époque de tricheurs organisés, de robotisation des sentiments, de masturbation de cervelles, que l'amitié reste encore vivante, et bénéfique.
Aucun éditeur n'était alors derrière Cadou pour justifier, sur le plan commercial, cette conviction de Charles Péguy : « Tout commence par une mystique et finit par une politique. »
Cadou ne fut pas l'élu d'une revue cherchant à s'imposer, ou à survivre, en se créant des grands hommes à force de les encenser.
Il n'était pas non plus de ceux qui trouvent, dans la vie parisienne, assez de relations donnant-donnant pour alimenter la lueur de leur bougie dans le grand orchestre, à la fois lumineux et tapageur, de la Renommée.
Simplement, Cadou avait su se faire aimer de nous. Il avait le talent du cœur.
Une amitié exemplaire, par Luc Bérimont
Actes du colloque de Nantes - 2325 octobre 1981
Je dois, avant toutes chose, présenter une série d'excuses aux brillants universitaires qui ont accepté d'apporter leur contribution à ce «Colloque», n'étant moi-même qu'un fantassin du rang, et n'ayant rien d'un spécialiste. Personne, parmi ceux qui écrivent, ne peut plus ignorer le rôle de l'Université dans la préservation, et la survie, d'une œuvre. Elle est, en quelque sorte, l'héritière morale d'une époque. Elle consigne, enregistre, et retient. Elle gère le patrimoine en le valorisant à sa manière à elle, qui est d'éclairer, de délimiter, d'explorer au scanner, de le retourner au besoin, à la manière d'une terre arable.
De méchants esprits ont dit (pour se venger sans doute) que l'on ne dissèque que les cadavres et que l'Université - pour cette raison -, n'aime que les écrivains morts ! Il est certain que le poète en action est moins facile à appréhender que l'autre - celui qui a «remis sa copie». Il est certain que le bain pétrifiant de l'éternité favorise les prises de profil... Je m'inscrirai pourtant en faux contre cette accusation de paresse : il suffit de répertorier les poètes vivants qui ont eu droit à une thèse, ou à un mémoire de maîtrise, pour s'en persuader. L'Université, en ce qui concerne la littérature qui s'écrit sous nos yeux, hâte le pas - et même (pour reprendre l'expression récente d'un premier Ministre) marche parfois «plus vite que la musique», accueillant les balbutiements «modernistes» dès le seuil de la nursery, cela avec le souci (j'imagine) de coller à l'époque et de se vouloir «dans le coup»...
«Me voici devant l'Agrégé final, moi l'impétrant» dit R.G. Cadou dans un poème. Et j'imagine un retournement de situation : moi mort, et lui vivant !... Moi, mort dans la trentaine ; lui ayant effectué le double du parcours...
Je me questionne par rapport à moi-même : où en serais-je, si j'avais dû «remettre ma copie» à cet âge. A son âge ?... Il a fermé sa porte à midi. Mais - comme pour tout «créateur» digne de porter ce nom - personne ne repassera par cette entrée ! Un poète, un peintre, un musicien, campe sur un territoire. Il annexe définitivement une parcelle de l'univers. Cet «univers Cadou» que vous avez déjà (ou allez) analysé(r) mieux que je ne saurais le faire, avec vos méthodes, je n'en retiendrai, voyez-vous, que ce qui touche à l'amitié et à l'ami... L'amitié qui, avec l'amour, était au cœur de la vie de Cadou. L'amitié dont il a toujours eu la religion exigeante et tenace...
Si peu que le temps ait accordé, il a pu amasser une œuvre qui assure sa survie puisque, comme il l'avait pressenti :
«Le nom de Cadou
demeure comme un bruissement d'eau claire sur les cailloux »
Puisque, - nous en donnons la preuve ici-même : le règne de Cadou commence !...
Conscient de son destin, il avait également écrit :
« Je pense à toi qui me liras dans une petite chambre de province
Avec des stores tenus par des épingles à linge... »
Et c'est vrai que ce sont les jeunes gens d'aujourd'hui, enfermés dans de petites chambres, qui constituent ses meilleurs lecteurs...
Cadou et moi, nous nous sommes connus à l'Ecole ! Bien sûr, pas à la communale, ni au Collège, étant donné qu'il était, lui, de ce pays nantais et moi, des pays de Sambre-et-Meuse.
L'Ecole dont je veux parler est celle de Rochefort-sur-Loire, un gros bourg entre Angers et Cholet... En l'absence des «pères fondateurs» (et, à ce propos, je dois dire que nous ne sommes pas nombreux à avoir,physiquement, posé le pied sur le territoire géographique de Rochefort !..) je vais être obligatoirement amené à retracer le pourquoi et le comment de ce groupe sur lequel on ne manque pas de m'interroger, de Nashville à Tbilissi et de Montréal à Amsterdam, chaque fois qu'il m'arrive de faire une incursion dans une Université, à l'étranger...
Cela se passait, je l'ai dit, aux rives de Loire, à Rochefort, dans un pays large et vert, bordé de collines, de châteaux et de sables. Dans cette contrée où les vignes et les roses ajoutent leurs parures à la couleur ardoise du ciel, un pharmacien : Jean Bouhier, et un instituteur : René Guy Cadou, avaient décidé d'ôter le bâillon que l'Occupant tentait d'imposer à la poésie. Souvenons-nous un instant du climat : chacun avançait à tâtons sur un parcours semé d'embûches, cherchant à reconnaître les amis sous le masque, à déceler l'adversaire sous la cordialité d'emprunt. 1941, c'est la guerre. Paris a faim. Paris a froid. L'Europe est un camp retranché. Les veilleurs de Londres et de Moscou chuchotent pendant que les bruits de bottes signalent l'approche d'une patrouille allemande dans la rue où les lampadaires sont éteints... Vichy prône une poésie «nationale et traditionnelle», pieusement enroulée autour d'un bâton de Maréchal. Aragon publie «Le Crève-Coeur». Pierre Seghers lance les premiers numéros de Poésie 41. Max-Pol Fouchet édite la revue Fontaine, à Alger. En zone occupée, la poésie, cette dignité de l'homme, a officiellement disparu...
«Nous sommes de cette opposition qui se nomme la vie !...», s'écrie René. Et je renchéris à mon tour, dans le Manifeste de l'Ecole qui déclare «la poésie en danger», en parlant de : «La vie, cette chose incroyable et menacée. Cette légende quotidienne. Cette bête aux flancs creusés avec sa langue hors de sa bouche...»
Voilà la façon que nous avions de prendre les choses à bras-le-corps, sous la protection des «grands ancêtres» : Ronsard dans le décor de la forêt de Gastine, Villon en sa tour de Meung, Rabelais dans sa campagne de Chinon, du Bellay au bord de son «petit Liré». Ceux-là veillaient, tels des vieux chênes, sur les nourrissons des Muses qui venaient se placer sous leur invocation...
On appréciait le ton révolutionnaire dans la maison de Jean Bouhier où René et moi partagions deux chambres mansardées, sans portes, qu'il fallait traverser de long en large pour sortir... Je me suis souvent demandé pourquoi ce jeune homme inspiré que j'entendais bouger derrière le mur de plâtre passait une partie de ses nuits à griffonner sur une table les textes de ce qui allait devenir, par la suite, une partie d'Hélène ou le Règne Végétal ?... Il m'est arrivé, certains matins, de lui reprocher cette hâte à vouloir l'écriture, à exiger l'expression. Je tiens, moi, qu'il ne faut jamais solliciter le poème, qu'il faut le laisser agir, se nouer secrètement en soi, l'accueillir au moment le plus opportun. René me répondait qu'une journée sans la trace d'un poème est une journée perdue !... Je l'avoue : je n'avais évidemment pas compris cette fatalité, cette hâte qui le poussait à donner tous ses fruits la même saison... Je n'avais pas compris ce que la plus obscure molécule de son corps savait, - qu'il devait dépenser son trésor, donner des fêtes quotidiennes ; écrire plus vite que nous... Et j'en profite pour redire, au passage, que l'image de ce jeune mort, abattu à trente ans, privé des enthousiasmes et des colères qu'il portait en lui, est bien ce qu'il y a de plus inadmissible d'entre toutes les douteuses initiatives du Destin...
Les Hindous des commencements comptaient, dit-on, le passage du Temps en battements de cils. Combien de battements de cils ai-je pu avoir depuis la disparition de René ?... Plusieurs millions, sans doute : chacun correspondant à une lumière, à un éclat filtré, à la prise de possession d'un espace... Et l'on aura compris que je ne suis pas venu déposer un bouquet de fleurs sur une tombe, mais bien tenter de faire revivre pour vous, le plus jeune du groupe de Rochefort, le plus aimé ! Celui dont nous n'avons jamais admis la disparition terrestre et que par une sorte de franc-maçonnerie de l'amitié, nous tenterons toujours d'arracher à la nuit...
L'«Amitié» est le leitmotiv qui revient inlassablement pour qui est «allé à Rochefort», pour ceux dont le cœur et la jeunesse sont restés dans ce village où trois ponts de fer enjambent trois bras de Loire.
Beaucoup de critiques se sont demandé, et se demandent encore, ce qu'il pouvait y avoir de commun entre Bouhier et Rousselot, entre Béalu et Guillevic, entre Béarn et Follain. La réponse, encore une fois, est «l'amitié». Le goût de la poésie, et d'un certain refus, partagés. «Dés lors, écrit Jean Bouhier, traduisant le sentiment commun, nous devions vivre des heures, des journées de liesse, d'enthousiasme, de travail fructueux, nourries par la plus prodigieuse des amitiés...» Et Cadou d'ajouter «Rochefort n'est pas une école. Tout au plus une cour de récréation. Maison de passe de la poésie ; on joue cœur sur table.»
Comme certain personnage de Molière qui faisait de la prose sans
le savoir, nous avons fait une Ecole poétique rien qu'en nous rassemblant. L'explication - qui semble aisée - c'est que, lorsque des gens de même âge et de même générosité se retrouvent dans un désert, ils ont envie de se grouper, de se rassurer par leur mutuelle présence, de se confronter et (-partant-) de s'unir. Or, quand un ami vous est arraché en pleine jeunesse, en pleine puissance de vie et de voix, il est normal (il est biologique) que les autres fassent groupe autour de sa mémoire pour le garder vivant. Rochefort c'est donc, avant tout, Cadou !... Dans la mesure où ceux qui sont venus tolèrent (ou admirent) leur différence, dans la mesure où le rire et le vin cimentent les rencontres et les échanges de points de vue, un dénominateur commun existe. Cela ne va pas jusqu'aux consignes. Chacun joue librement sa partie. Chacun prend, et a toujours pris, ses distances, par rapport à celui qui lui est le plus cher et le plus fraternel : retour au concret, à l'humain, à la poésie de pleine poitrine - je crois que nous nous sommes entendus sur ces données. Le reste est affaire de tempéraments, de perspectives littéraires et de bouteilles vidées dans les auberges.
On a pu parler, il est vrai du «surromantisme» de Rochefort (l'expression est de Cadou lui-même). On peut croire à ce surromantisme de la part de garçons qui viennent de vivre une défaite, qui ont vu les villes brûler, les moissons calcinées, qui savent le visage de la peur et de la solitude... On peut y croire comme à une communauté de cœur. Un point c'est tout. Sans autre dogmatisme. Claude Monet et ses amis ont été baptisés «impressionnistes» par un journaliste qui croyait faire une bonne farce. L'Ecole est à Rochefort ce que la classification en «isme» est aux exégètes : une étiquette facile à lire, mais qui n'explique rien...
Il m'importe plus, à vrai dire, que Cadou ait été là pour m'ouvrir la porte de la maison de La Noue, avec la clé rouillée, dans un fond du domaine de Piedgüe, à cinq kilomètres de Rochefort. Dans cette ancienne maison de métayer, isolée en pleine campagne, personne ne voulait plus habiter... Je revois René, vidant à bras-le-corps la paille entassée jusqu'au toit, puis balayant les pièces aux murs chaulés. Bouhier ayant mis à ma disposition les meubles de son grenier, il fallait encore trouver un chariot, le remplir de matelas, de sommiers, de chaises, de tables, de buffets et transporter le tout avec l'aide d'un percheron... Je revois l'équipage dans les vignes, où crissait la chaleur de Juillet. Les vipères fuyaient dans les hautes herbes. Les lièvres, les ramiers, deshabitués de la présence de l'homme, s'engourdissaient sur mon seuil. Lorsque la nuit tombait, la porte ouverte sur les étoiles, le spectacle du feu dans l'âtre, confinaient à la magie. C'est dans ce royaume de Piedgüe, sur la terre brûlée de l'été, que j'ai écrit La Huche à Pain. J'essayais de ne pas déranger la paix nerveuse, la cohabitation fragile, la trêve consentie par les animaux et les plantes. L'Ecole (c'est-à-dire Bouhier et Cadou) ; oui ! - l'Ecole, «au grand complet», me visitait au jour levé... Le lait frais moussait dans les bols. C'était notre jeunesse...
Aujourd'hui, quand je relis La Huche à Pain, avec 37 années de recul, alors que mon «esthétique» a changé, je me dis que cette histoire du pain et du blé est vieille (et simple) comme le monde. Cadou disait, à propos de ce petit livre (édité du reste par ses soins : il avait créé la Collection des «Amis de Rochefort» pour l'accueillir) qu'il «flotte dans l'odeur des gibiers et des pommes douces» (lettre du 9 décembre 1943). Quant à savoir la place que cette Huche à Pain occupe à présent dans mon œuvre, il me semble qu'elle est essentielle. Elle affirme la prééminence de l'instinct sur la pensée, du plaisir sur l'esthétisme, et laisse clairement entendre que le Verbe est dionysiaque. Je n'ai pas changé sur ce point : toute écriture est «révélation», nettoiement et mise au jour de soi-même. Toute écriture passe par l'élan panique. Les besogneux de l'intellect, ceux qui font de la poésie à partir de l'idée d'en faire, condamnent le monde dont ils sont porteurs. Toute poésie qui n'est pas destinée à l'échange est, pour moi, non seulement inutile, mais scandaleuse. J'ai pu récemment vérifier, tant en Angleterre qu'en Pologne, ou ailleurs, que nombreux sont les écrivains et les poètes qui se réclament des sources campagnardes de leur œuvre sans se sentir exclus de la «modernité». En France, on feint de croire qu'il n'est de littérature que de Paris ! Les officines, les chapelles, ignorent l'appartenance terrienne (je dirais presque «terrestre», tant ces gens-là vivent dans du béton !...).
«Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?...»
demande René dans un poème devenu célèbre.
Il se répond à lui-même (je crois dans «Moineaux de l'an 1920»?) :
« Je connais vos journaux et vos grands éditeurs
Ça ne vaut pas une nichée de larmes dans le coeur »
Lui qui venait de la Brière, de Sainte-Reine où son père était instituteur, parlait souvent de ce pays «mené de biais par les averses» ; - ce pays auquel il déclare: «mais vous gonflez mon cœur, solfège des marais...».
René a fait la découverte des plaines avec des paysans «assis sur des faucheuses». Il a regagné sa maison «Les bras chargés des longues herbes que l'on nomme «herbe à tourterelles», ou «herbes tremblantes.» La table était en bois de cerisier verni; (autrement dit : «en merisier»). Sur la fenêtre, il y avait des géraniums et des fuschias «fleurs rouges au parfum un peu triste. » C'est cet univers qu'il a tenté de recréer pour retrouver l'enfance perdue, «remonter en enfance» - comme je le dis parfois !...
« Moineaux de l'an 1920
La route en hiver était belle
Et vivre, je le désirais
Comme un enfant qui veut danser
Sur l'étang au miroir trop mince... »
Il y avait (je pense qu'il y a toujours ?...) à Sainte-Reine, une longue allée sablée, qui était celle du calvaire. L'enfant Cadou a fait là la découverte de la «forme terrible» qu'il contemple à genoux, cette forme à laquelle il dira, plus tard :
« Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre
Laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources
Heureux celui qui nait en Juin parmi les nielles
Il connaît la beauté des choses éternelles... »
De cette enfance paysanne, qui l'avait pétri pour toujours, Cadou tirait des résonances profondes. Il fréquentait des gens extraordinaires, taillés en pleine pierre, en plein bois. Je me souviens d'une auberge de pays où des diplômes de garde-chasse étaient accrochés aux murs, dans des cadres. Nous étions partis de la maison de Jean Bouhier à bicyclette, avant le lever du jour. J'ai raconté cette journée, qui m'avait marqué, dans un poème dont le titre est «Ami René». Je vais le lire devant vous afin de montrer à quel point les images de la poésie valent celles de la photographie. Et aussi, peut-être, combien la poésie - ainsi que le disait Goethe- est tributaire des circonstances :
« Ami René
Tu m'avais entraîné par un grand jour de lune
Au travers des prairies, des villages, des bois
De hideux cris d'enfant, parfois, stridaient des herbes
On étranglait la nuit dans la gorge d'un chat
Un matin de vent pur, de soleil en médaille
Vint durcir nos souliers, rongés par les brouillards
Nous eûmes, peu après, les jambes sous la table
En un lieu qui sentait le terrier de renard.
La lumière tremblait, âcre vin blanc d'auberge
Sur les forêts pelées d'où nous étions sortis
A nos pieds, le lait cuit versait sur les flammèches
Et nous coupions le pain comme un gros gâteau gris. »
La poésie est aussi (entre autres choses) cette mémoire d'images, ce livre de bord «d'un animal marin, qui vit sur terre et qui voudrait voler » dont parle le poète américain Carl Sandburg. Je me souviens d'autant mieux de cette randonnée à bicyclette que, ce jour-là, à cause d'un déjeuner trop copieux, René avait failli manquer le train de Nantes, qu'il devait prendre vers 19 heures. Je le regardai s'éloigner sur le quai, me faisant «au revoir» de la main, par la portière, puis je regagnai Rochefort. Le lendemain, Nantes était bombardée. Et Cadou nous fit une belle peur en nous laissant plusieurs jours sans nouvelles. Finalement, une carte-postale, représentant un sorcier noir, tout nu, ornée seulement de son paraphe en forme de liane, nous apprit qu'il était en vie... René parlait souvent de Nantes, de son côté fantomatique, il en parlait comme d'une ville secrète, enveloppée de ses rivières, de sable, de limons, de vent... Ici, René est allé à l'école du Quai Hoche, avant le lycée. Ici, il a écrit ses premiers poèmes. La poésie devient sa vie. Sa drogue. Sa passion... Ici, il découvre les «enchanteurs» dont il va faire l'inventaire dans «Anthologie» -la nomenclature comportant déjà Max Jacob et Reverdy, qui ne vont pas tarder à s'intéresser à Cadou - l'un et l'autre !... Max, toujours soucieux de convertir, disait de son côté :
«Mon Dieu ! ayez pitié de René Guy Cadou
qui ne sait pas que ses vers sont le meilleur, de vous ! »
René, ses mauvaises études achevées, son père mort, a fait différents métiers. Il a trié le courrier au bureau-gare de Nantes. Puis la guerre l'a pris. Il devient instituteur de villages (au pluriel !...). Il découvre sa «voie végétale» -ce qu'il appelait «la vie rêvée». Un rêve, évidemment fou, et qui peut se résumer ainsi : «avoir son rectangle de table éclairé, tous les soirs. Une fenêtre où s'inscrit la campagne...»
C'est peut-être à compter de cette période que commence ce que l'on pourrait appeler «la vraie vie» de René Guy Cadou. Pourtant, les classes d'école sont froides. Il se plaint de la solitude : «Je suis dans ma mansarde, avec ma malle éventrée dans un coin, des lilas qui se fanent...» Il éprouve la tentation de Paris. Le sentiment d'une attente de celle qui va paraître et qui sera sa femme... Hélène, ou le règne végétal ! La pierre d'angle de sa vie. L'amour unique, dont parle la Chanson du Mal-Aimé... Je répète que la poésie de Cadou est partagée entre l'amour et l'amitié.
Je nous revois (c'était «avant Hélène» !...) poussant nos bicyclettes «vers la demeure de Marie-Cécile», la bonne hôtesse de Saint-Aubin-de-Luigné, dans les coteaux du Layon brûlés comme un désert. René était rouge, suant, heureux, à bout de forces. La première auberge de campagne nous accueillait. Le goulot des «fillettes» hoquetait dans l'ombre. L’anjou, opulent, jaune, épais comme une liqueur, coulait dans nos verres. Nous revenions à la fraîcheur tombée. La maison de Colette et Jean Bouhier sentait les confitures et la cire. Une ronde de petites filles tournait au jardin, dans le soir.
Nous retrouvions la famille quotidienne et nous riions de toutes nos dents, qui étaient bonnes : nos dents de jeunes loups. On ne saurait dire que nous étions indifférents à la souffrance des hommes. Nous serrions les poings et nous étions prêts à mourir pour (ou avec) les fusillés de Châteaubriant, par exemple. Mais, sans que nous l'exprimions en clair, nous savions que ce n'était là qu'une atroce mascarade et que la grande affaire était en nous, en chacun de nous, enfermée au plus secret du silence. Ce qui compte, c'est la racine, le cheminement sous-jacent, les forces qui irriguent. Ce qui compte, plus que la mort elle-même, c'est ce qui s'élabore dans nos profondeurs pendant que nous avons encore accès à la parole... Certains désignent ces mystères sous un seul vocable : «poésie»... Le terme est sans doute impropre, c'est la démarche de l'être. Vers l'être ! L'exploration de soi. La délimitation du cadastre... La volonté de devenir qui l'on est... Chaque homme enrichit l'humanité... De sa qualité, de son «épaisseur», dépendent tous les autres. Nous avons refusé de nous comporter en mandarins, en intellocrates. En privilégiés de la culture. Et nous avons, dans l'orage de la guerre, connu un apaisement magnifique, une «immense saison d'amitié». Nous savions, avec Novalis, que «la philosophie, c'est l'hôpital de la poésie». Et, avec Max Jacob, que «les poètes tordus sont ceux qui n'ont rien à dire...»
Comme beaucoup de radio-libres, à l'heure actuelle, ceux qui revendiquent le droit à la parole sont toujours nombreux. Une fois ce droit accordé, rares sont ceux qui ont quelque chose à dire. A l'époque de Rochefort, nous tenions le poète pour une sorte de boulanger qui travaille la fine fleur des mots, qui cuit pour le village, qui - une fois la journée terminée - bavarde sur le pas de sa porte avec ses voisins. «Plus de respect, mais des outils», c'est une phrase que je retrouve dans ma contribution au Manifeste de l'Ecole de Rochefort. Le poète est un réaliste. Quelqu'un qui voit plus clair, plus juste, plus vite, que tout le monde. Qui va à l'essentiel. Qui tranche au 11000ème de seconde dans l'apparence des choses. Qui travaille au flash de l'illumination.
Cela étant bien entendu, nous avons ri comme on a rarement ri dans une «école» littéraire ; le rire étant un acte de foi, et l'insolence la forme agressive de l'espérance !...
Il fallait voir quel cérémonial chaleureux nous déployions, l'éditeur René Debresse, Bouhier, le Peintre Jégoudez et moi-même pour aller recevoir René à la gare des Forges, en rase campagne, le samedi matin ! Sur la longue route du retour, un cabaret nous accueillait aux environs des douze coups de midi. Dans la cuisine fraîche des Bouhier, Angèle -la cuisinière- gardait une alose géante à frire sur un coin du fourneau. Une joie d'écoliers en vacances présidait à nos chahuts...
Je pense à une certaine matinée d'automne, au premier vent froid. La fin était proche. Nous allions bientôt nous séparer. Nous tremblions au bord des vignes dans nos vêtements trop légers.
Je devais retrouver la même odeur d'automne, quelques années plus tard, à Louisfert, en rentrant d'Allemagne - où j'étais en Occupation. L'herbe poussait dans la cour de l'école. René, vers le soir, s'esquivait :
«Je monte dans ma chambre et prépare les feux
J'appareille tout seul vers la Face rayonnante de Dieu»
Hélène, inspiratrice, à l'intention de laquelle furent écrits quelques-uns des plus beaux poèmes de la langue, mêlée à lui comme le lierre l'est aux branches, vaquait aux occupations quotidiennes, dans la cuisine.
Non loin de la maison d'école, le propriétaire de l'auberge portait un anneau d'or à l'oreille. Dans la pièce voisine, qui servait d'épicerie, des braconniers jetaient des lièvres raides et des faisans sur le plateau de cuivre d'une balance.
Il me semble, pendant que je parle, entendre la voix de René qui s'adresse aux petits paysans, dans la salle de classe. Je suis à Louisfert, dans la cuisine. Je colle mon oreille à la porte de séparation :
« En ce temps-là, dit René, la France était pareille à un domaine dont les rois étaient propriétaires. Ils s'occupaient surtout de prélever les richesses que devaient rapporter leurs terres... »
Je discerne une nuance d'âpreté dans la voix du «maître». Voilà pour les souvenirs. Voilà pour le passé.
Aujourd'hui, les choses sont plus ou moins semblables à ce qu'elles ont toujours été : les hommes se déchirent entre eux. Les saisons passent. Les années font leurs petites boules de neige ou de fleurs d'amandier. L'école de Louisfert (la vraie «école», celle-là !...) continue de s'éventer parmi les arbres.
«Poésie, la vie entière,» disait Cadou.
Et moi, me retournant en direction de ce que furent ces années de folies, d'angoisse, de sommeil éveillé, ces années où nous avons ri et rêvé plus qu'aucune autre génération ne peut raisonnablement espérer rêver et rire, je me surprends à murmurer trois vers que René a laissés sur le bord de la table, à l'intention des visiteurs ou des errants :
«Emmène-moi dans la vallée, vers la demeure
De Marie-Cécile, en Saint-Aubin-de-Luigné
Que j'y retrouve et que j'y boive ma jeunesse...»
L'art du vers chez René Guy Cadou, par Serge Brindeau
S'agissant d'une poésie qui semble couler de source, n'est-il pas un peu risqué, voire déplacé, de s'attacher à l'étude du vers, des formes prosodiques, de la structure du poème, ou de l'arrangement des phonèmes et de la combinaison des syllabes, même si l'on cherche par là à établir un lien entre ce travail de la matière du langage, cette élaboration de la forme, et l'esprit -il vaudrait peut-être mieux dire la sensibilité, la passion, le souffle- qui anime ici la parole ?
On a écrit de Cadou qu'il était un poète universaliste. Je suppose qu'on entend par là que de toute chose il faisait poésie, que -par son chant- les plus humbles détails de la vie quotidienne prenaient la dimension d'un monde, et que ce monde, qu'on pourrait appeler l'univers familier du poète, devenait, pour le lecteur aussi, pour quiconque entre en communication avec le poème, un univers -un univers d'où rien, ni personne, ne serait exclu. Sans doute veut-on signifier encore, sans trop forcer sur la métaphysique, que cet univers familier, cet univers du chant, expriment quelque chose, mystérieusement, de ce qu'il faut bien nommer, sans oublier la majuscule, l'Univers lui-même. Universaliste, le poète René Guy Cadou ? Le mot nous paraîtra tout à fait juste. Mais universitaire ? Non, pas encore...
« L'art des vers » : l'expression se trouve chez Cadou, mais on ne peut pas dire qu'elle y soit prise en très bonne part : Tendres parents qui m'avez mis au monde avec ce cœur amoureux et si faible C'est à vous qu'à travers l'espace je dédie chacun de mes poèmes Vous ne m'avez point appris ni les façons de l'écrivain ni l'art de faire des vers Mais je suis sûr de ne pas me tromper quand je vous chante dans les manifestations de l'Univers (O.P. Il, 137)
Cadou rejette les fausses belles manières, il déteste le manque de spontanéité, de sincérité. Il restera fidèle aux simples gens de son pays natal, qui ne firent point tant de façons pour vivre et pour mourir. Les distances volontairement établies entre les êtres lui paraissent dérisoires. Poser à l'artiste, quand on se souvient des visages qui veillèrent sur l'enfance, quand on a vécu dans la familiarité des instituteurs, des paysans, des épiciers, des gardes-chasse, quand on a connu la sainteté de sœur Chantal, ou quand on se sent si proche de tous les gamins de l'école, ou bien encore quand on s'attarde à l'auberge, vraiment, de quoi aurait-on l'air ?
Cadou préfère, à la suffisance des maîtres, la bonne volonté de ces vieux élèves qui n'ont pas oublié l'émotion particulière des années d'études, quand on se penchait sur des poèmes, appelés peut-être récitations, et qui s'appliquent encore, l'âge venu, à composer des « sonnets parfaits » -entendons : où les règles sont parfaitement appliquées-, avec des rimes aussi éclatantes que banales. Ceux-là, au moins, les « doux poètes », ne trichent pas. Ils rêvent d'un ailleurs sans cesser d'être d'ici. Ils écrivent leurs vers « comme on soigne les bêtes » -mais ce serait « dans les faubourgs du ciel ». Ne sourions pas trop de ces « poètes du dimanche ». Cadou semble craindre de les avoir blessés. Il tient à les rassurer : « Croyez-moi, je vous aime bien ». Ils méritent en effet l'attention, l'amitié des poètes qui ne sont pas seulement « du dimanche ». Ils éprouvent la difficulté de faire passer dans les mots du poème ce quelque chose qui leur tient tant à cœur et qui demeure « impossible à traduire » (O.P. I, 413). Ils savent que le travail est nécessaire, mais ils éprouvent, à l'ouvrage, que cet effort ne suffit pas. Il y a de bonnes et de mauvaises années, pour les récoltes et pour les vins, pour les poèmes. Quoi qu'il en soit de la vendange, Cadou respecte ce travail et cette humilité où pourraient bien se lire comme une attente du miracle et de la grâce, un sentiment sacré de l'Univers.
S'adressant à un de ses amis -« authentique poète du dimanche » selon l'expression d'Hélène Cadou-, René Guy écrivait : «Tu te souviens de bords de l'eau et tu t'amuses à des allégories de l'Almanach des
Muses ». Le compliment ne paraît guère flatteur. Pourtant Cadou -qui, pour sa part, pratique évidemment une tout autre forme d'écriture-comprend que sous la modestie de cet amusement, quelque chose de profond se découvre. « La poésie est naissance et non pas connaissance », a écrit Cadou (O.P. II, 309). Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans Les Poètes du dimanche :
Tu as près de soixante-dix ans et tu nais
A chaque battement nouveau de ton poignet
D'une rime sonore et guère originale (...)
(0.1'. 1, 413)
En fait, souligne Cadou, la poésie n'est pas un jeu. Si le jeu est une « activité sans causes et sans conséquences », une « activité gratuite », la poésie est le contraire du jeu. Du jeu dont il est question nous ne sommes pas les maîtres, car ce qui est en jeu, c'est la vie elle-même. Cadou reproche, injustement d'ailleurs, à Maurice Scève, à Mallarmé, à Valéry, d'avoir ajouté au « malentendu ». Sans méconnaître la qualité de leur « esprit de recherche », il les rend responsables d'avoir rendu si fréquente, aujourd'hui la confusion de la poésie avec le jeu. A la suite, les « arrangements syntaxiques, euphoniques » -il ajoute le coq-à-l'âne et la contrepèterie auraient fait « perdre de vue l'objet même de la poésie » (O.P. 11, 309). Nous ne croyons pas que la poésie de Délie, du Sonnet en yx ou du Cimetière marin ne soit qu'« arrangements syntaxiques » et « euphoniques », même si l'intellect et la volonté jouent (comme on ne peut s'empêcher de dire) un grand rôle dans la façon dont s'organisent, comme par jeu en effet, hors du sérieux habituel, en tout cas de la pensée logique, scientifique, technique ou simplement utilitaire, les syllabes, les mots, la phrase, le poème. Ni Scève, ni Mallarmé -que Cadou appelait « le professeur Mallarmé » -, ni Valéry n'ont confondu les moyens (disons l'art, toujours renouvelé, du vers) avec la fin (le fameux « objet même » de la poésie). Mais enfin, Cadou se méfiait de cette conception-là, qui eût exigé de lui trop de détours par rapport à sa manière d'être au monde, d'être de son village au sein de l'univers, d'être poète.
Les détours qu'il aimait, c'étaient ceux du sentier, non ceux d'une phrase trop savante, trop inspirée de l'image des circonvolutions cérébrales, trop éloignée du cours de la vie ordinaire pour qu'elle pût le rejoindre aisément. La poésie était pour lui une exigence à ce point vitale qu'il n'aurait pu consentir à quitter trop longtemps, même pour y mieux revenir, ces chemins qui lui étaient chers. Il ne se voulait certainement pas poète au second degré. S'il lui arrivait d'écrire des notes sur la poésie, il évitait, dans le poème, d'être trop réflexif. A la différence de Monsieur Teste, il n'eût pas aimé se voir penser qu'il se voyait -qu'il se voyait écrire...
Est-ce que je sais seulement que j'écris ? mais je vais
Au bout de ma vie comme d'une route mal percée
(O.P. II, 89)
Dans cette perspective, la science du langage et les artifices de la rhétorique devraient-ils alourdir son sac de voyage ?
La sémantique ? connais pas !
dit-il, ajoutant :
Je me ris de l'anacoluthe
Dites-moi quels sont ces gravats
Qui dégringolent sur mon luth !
(O.P. II. 161)
Epris de simplicité, d'« innocence », de « spontanéité », de « fraîcheur » (M.O. 78), Cadou redoutait la rhétorique, le « discours poétisé » (M.O. 165), les poèmes trop bien construits. Voyez ces hautes fenêtres, « si claires, si ordonnées ». Elles sont « murées de l'intérieur ». Elles nous laissent « indifférents ». Pour que la poésie soit « habitable », il faut aérer, « sacrifier des pans de murs entiers » (O.P. II, 260-261). Trop accorder à une esthétique préétablie, ce serait s'exposer à édifier des monuments d'ennui. Et puis habiter la poésie, ce n'est pas s'installer dans une apparence de chef-d’œuvre, c'est se mettre en marche et courir les chemins. « Je n'écris pas pour quelques-uns retirés sous la lampe » : on se rappelle cette ouverture du poème, cette initiation aux « secrets de l'écriture » (0.P. II, 220).
En chemin, la poésie oubliera l'école, à moins que celle-ci, comme autour de Rochefort, ne devienne buissonnière. Elle n'est pas destinée à l'explication de textes. Ce n'est pas une « perfection à l'usage des gens de lettres », ni des « snobs », ni des « professeurs » (O.P. II, 280).
Déjà, au lycée, Cadou avait pris la dissertation en horreur. Faire un plan et s'y tenir, cette discipline s'opposait à sa fantaisie, à son élan. « Au grand émoi des professeurs », avoue-t-il, il partait « en flèche en toutes directions » (T.A. 12). Quand il écrira son livre sur Apollinaire, il prendra sa revanche. Il pourra suivre à sa guise le Flâneur des deux rives. Cadou se plaît à noter qu'Apollinaire « improvisait la plupart de ses poèmes en marchant ». Selon Cadou, la « phrase assez courte » qu'Apollinaire a adoptée, après avoir beaucoup pratiqué l'alexandrin et l'octosyllabe, « suit bien davantage la marche que la parole » (T.A. 66).
Après tout, selon un jeu de mots qui semble s'imposer à l'esprit de Cadou et qu'on pourrait trouver très significatif de sa ...démarche poétique, les pieds sont faits, précisément, pour marcher. A propos de la « prose rythmée » de Paul Fort, Cadou ne craint pas de se laisser aller aux suggestions de ce langage très pédestre : le vers de Paul Fort, dans les Ballades françaises, est « un vers dont les pieds chaussent de la petite à la grande pointure, du 32 fillette au 45, suivant l'émotion du marcheur » (M.O. 28). La « vraie poésie », dit encore Cadou, « s'inquiète fort peu du nombre de ses pieds » ; « la beauté boite » (0.P. II, 280). Au lycée, cette question du nombre des pieds (pour la poésie française, on aurait dû dire : des syllabes) avait sans doute occupé bien des heures de classe. Qu'on se souvienne de la Muse de Gautier qui, « pour marcher droit » sur le devant de la scène, chaussait « un cothurne étroit ». Un « soulier trop grand » eût été vulgaire, bon pour tout le monde ! L'art de Cadou ne se laissera pas confondre avec l'art pour l'art. On pourrait dire qu'il se situe aux antipodes de l'esthétique du Parnasse (puisque les antipodes, c'est encore une question de pieds). Pour parcourir dans toute son étendue l'œuvre poétique de René Guy Cadou, il faudra se munir de bonnes chaussures. Ou plutôt, il faudrait avoir appris à marcher pieds nus (« comme un Bon Père Qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières »).
Selon la rhétorique classique, ce qui se rapproche le plus de la marche, c'est la prose. Prosa oratio, quam pedestrem Graeci vocant... Mais une prose rythmée, déjà, soutiendrait mieux les longues marches. Quant à la poésie de Cadou, il lui faut aller loin (« loin dans le ciel et dans la nuit des temps »), et la vocation du poème est de s'élever. Pour cette mystique de terrien qui était la sienne, Cadou allait découvrir sa forme propre, qui emprunte à l'humilité de la prose sans jamais cesser d'être, pleinement, poésie, qui n'est ni une prose rythmée ni une poésie d'allure traditionnelle où l'on prendrait seulement des libertés de temps à autre, qui est ... disons, pour être sûr de ne pas manquer de pertinence dans le choix des termes, qui est la poésie de René Guy Cadou.
Cette poésie, en marche vers un horizon où terre et ciel sembleront se rejoindre, entraîne le lecteur. On respire bien quand on lit un poète comme celui-ci. On ne sent jamais la fatigue ni l'effort, même quand c'est la souffrance qui s'exprime. Et l'on croit s'avancer en un très beau jardin, ou s'approcher d'un Paradis, quand on se prend à penser qu'un train semblable s'arrêtera brusquement dans une gare. Puisant aux viviers de l'enfance, la poésie de René Guy Cadou garde sa fraîcheur jusque dans l'évocation de la mort. Elle est toujours « source de vie » (O.P. II, 139).
Cependant, si une telle poésie -où, malgré « la nuit des temps », le jour demeure « impérissable » (O.P. I, 332)- nous donne aisément le sentiment d'une grâce qui ne ferait jamais défaut, si elle évolue, pour reprendre l'expression de Pierre Mac Orlan, dans un climat d'« innocence absolue », il faudrait se garder de croire qu'elle est venue à nous ...j'allais dire : par simple miracle, comme si la notion de miracle, même appliquée à la poésie était simple (ou comme s'il était facile de l'admettre). Sans doute, selon Cadou, la poésie est-elle « donnée à quelques-uns comme une antenne supplémentaire ». « A la base», il y aurait bien, pour lui, un « don ». Mais précise-t-il : vient « ensuite un miracle de travail et de compréhension, une poussée contre la paroi abrupte du monde » (O.P. II, 279). On n'échappe pas au miracle, de toute façon ! Mais ce miracle-là est volontaire. Il dépend de nous -à moins que la volonté qui préside au travail du poète ne soit rendue possible que par ce miracle au sens fort que constituerait le « don ». Un miracle de travail : dans un sens plus familier, ce serait une quantité de travail extraordinaire, qui dépasse les possibilités habituelles d'un homme. Mais s'agit-il du travail de l'écriture ? Un « miracle de travail et de compréhension » : cette formule ne suggère-t-elle pas que le travail du poète consisterait à développer cette sensibilité qu'il a reçue, pour mieux saisir la réalité du monde, des autres et de soi-même ? Nous admettrions une telle interprétation. Mais nous comprendrons que ce travail de la sensibilité, qui développe la lucidité et qui permettrait de « percevoir l'indicible », ne passe pas seulement par les longs et fréquents entretiens avec les gens du village, par le temps donné à autrui, qu'il passe encore : -qu'il passe surtout, qu'il passe essentiellement- par tout le temps donné à l'écriture. Chez un poète, la poussée contre la paroi du monde s'exerce par l'intermédiaire d'une pression sur le verbe…
Il serait très instructif, à cet égard, de se pencher attentivement sur les années d'apprentissage de Cadou.
René Guy -nous l'avons rappelé- n'avait pas appris de ses parents « l'art de faire des vers ». Cela ne signifie pas que cet art ne doive pas s'apprendre, ni que Cadou ne l'ait pas appris. Michel Manoll rapporte que Georges Cadou lut un soir à son fils des poèmes -il y en avait trois cahiers qu’il avait écrits à l'âge de vingt ans, et que René Guy s'est mis le lendemain même à écrire, lui aussi, des poèmes -il devait avoir treize ou quatorze ans. Le père, instituteur, était très attaché à la poésie de Sully Prudhomme et à celle d'Albert Samain. Au lycée, les livres de français ne pouvaient qu'augmenter le poids de telles influences. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les premiers vers de René Guy Cadou obéissent à une facture traditionnelle.
Ces vers, devait dire Jean Daniel Maublanc dans la préface de Brancardiers de l'aube, « étaient des vers de potache », « très réguliers de forme ». Michel Manoll reproduit quelques strophes d'alexandrins (M.M. 36). Christian Moncelet cite, comme «l'un des plus anciens poèmes connus de Cadou», Une boucle de ses cheveux (Ch. M. 118). Ce poème, paru dans La Bohème en juin-juillet 1936, a été écrit en juin 1935. 11 est composé de trois strophes composées chacune de trois alexandrins suivis d'un octosyllabe formant refrain. L'alexandrin, l'octosyllabe : ces rythmes, liés à l'éveil de la sensibilité au poème, accompagneront Cadou sa vie entière ; ils «sont comme la respiration de l'homme», dira-t-il, remarquant qu'Apollinaire les a longtemps considérés comme le «moule idéal de toute poésie» (T.A. 66).
Au temps d' Une boucle dans ses cheveux, l'influence de Lamartine et de Musset est évidente, dans les thèmes (le soir de mai, la jeune femme et la mort, le « grand saule pleureur») et dans les rythmes adoptés. Cadou ne reniera pas ces influences, il reconnaîtra l'aspect positif de ces imitations. Il faut d'abord apprendre le métier, et, dans ce sens, « il n'est pas mauvais lorsqu'on a seize ans de compter sur ses doigts, de refaire, toutes maladresses mises à part, les poèmes de Lamartine ou de Musset » (0.P. II, 300).
La rencontre de Michel Manoll et aussi l'attention de Jean Daniel Maublanc jouèrent un rôle déterminant dans la conversion du jeune Cadou à une forme plus libre d'écriture. Manoll a demandé à Maublanc de l'aider à détacher Cadou des leçons de l'école, et Maublanc a pu écrire que son « entreprise de subversion » a été « rapidement couronnée de succès » (Ch. M. 111). « Je m'accuse », disait assez crânement le préfacier de Brancardiers de l'aube, « d'avoir détourné ce mineur de la poésie régulière et académique ».
Une hésitation se manifesta très vite chez Cadou entre le goût qu'il avait gardé des grands rythmes classiques et un besoin d'indépendance qui le poussait dans des chemins alors moins fréquentés. « Ces vers ne sont pas réguliers mais ne sont cependant point libres » (Ch. M. 108), écrivait-il à Jean Bouhier, le 24 juillet 1936, en lui adressant, pour La Bohème, le poème intitulé Soir de juin. Nous ne croyons pas, contrairement à une opinion de Christian Moncelet, que ces vers -où domine l'alexandrin mais où se comptent aussi des huit, neuf, dix, onze syllabes- soient « égrenés sans ordre ». Et si, en effet, la « hardiesse » n'est pas encore très grande, nous ne parlerons, pourtant pas de « maladresse » (C.M. 121). La façon dont Cadou, dans le dernier groupe de quatre vers, reprend, avec des variantes, les vers initiaux des trois premiers « quatrains », montre assez clairement que le poète est en train, dans la liberté, d'inventer un ordre qui lui soit propre. Il ne renonce pas pour autant aux formes traditionnelles, ainsi qu'en témoigne le poème Irréel, écrit le 24 août 1936 (C.M. 121) et qui est constitué de quatre fois quatre vers disposés selon un système de rimes alternées. Mais « si vous préférez des vers libres », écrit Cadou à Jean Daniel Maublanc, « je pourrai vous transmettre quelques poèmes composés cette année à la manière des contemporains » (Ch. M. 114). Le poème Automne, (Ch. M. 122) que Cadou envoie à Maublanc en octobre 1936, n'est plus rimé. On y trouve des vers de six (ou douze divisés par deux), mais aussi de quatre, de trois, de huit, et neuf syllabes. Dans le ton, il y a du Verlaine (« Les archers des roseaux Sur le violon du soir Pleurent de longs regrets ») et du Laforgue :
Ecoutez !
L'appareil téléphonique de Dieu
Beugle des appels de mort
L'oiseau sur ses nageoires
Porte des télégrammes de deuil...
« Les rimes ont été jetées au panier », dit Christian Moncelet. Mais a-t-on remarqué ce qui se passe d'étrange ici sous le rapport des sonorités -et, en même temps, de l'ambivalence poétique ? Dans l'œuvre de la maturité, se retrouvera ce que nous pourrions appeler l'effet « mort-nageoires ». Quelle force dans cette rime faible -et même insuffisante ! Mais ce qui ajoute le plus au caractère troublant de l'image (les nageoires de l'oiseau), c'est la façon dont, à la place où l'on attendrait une rime, de l'autre côté des nageoires et de la mort, ce qui vient répondre à « Dieu », c'est « deuil », comme à la plénitude de la présence l'absolu de l'absence. A une lettre près, et non sans analogie sonore, « Dieu » et « deuil », c'est un peu le même mot, même si le poète éprouve profondément en lui le sentiment que ce n'est pas tout à fait la même chose.
La technique de Cadou va se développer. Mais on peut voir, dès ses premiers essais, le très grand souci qu'il a de la forme. Et, ce qui est encore plus important, on peut voir, dès ce moment-là, que le poète, en faisant varier la forme, en modifiant la structure du poème, découvre l'enrichissement que cette évolution contrôlée de la forme apporte à la façon dont est vécu, en poésie, le rapport de l'homme au monde. Le problème de la forme est un problème existentiel.
Si nous nous reportons maintenant aux écrits de la maturité, nous serons amenés à penser que ce qui a le plus compté, pour Cadou, de ce point de vue formel-existentiel, c'est la ligne. S'il était peintre, il voudrait « argumenter chaque couleur par un solide propos plastique » (O.P. II, 274). Comprenons bien qu'il attache plus d'importance à la rigueur du propos, à ce qui soutient l'élan de la construction picturale, qu'à des qualités plus superficielles, telles que l'argumentation du détail ou le charme des couleurs. Dans la peinture de Roger Toulouse, il aime la « force secrète », la « longue patience », la « raison majeure » qui donnent vigueur à l'œuvre, imposent une présence. « Tout ce qui s'attache à l'os rend compte. De là le secret des dessins de Toulouse, cette ligne d'âme qui délimite et grandit son objet ». Nous nous permettons de souligner ligne d'âme. La rigueur formelle est bien ce qui permet l'expression d'une grande intensité spirituelle. « La beauté des arbres », écrit encore Cadou (M.O. 79-81), « tient à l'hiver ». Alors, les arbres, dépouillés de la « délicieuse surcharge » de leurs feuilles, « font corps avec le ciel ». Le souci d'une union intime de l'âme et du corps, et peut-être de la nature à Dieu, sont ici vécus dans la contemplation d'une forme parfaite, comme si le désir humain cherchait à s'épanouir en une réalité qui le dépasse de toutes parts. De même, « la poésie ne devra jamais être (...) une surcharge (...) mais s'inscrira en filigrane dans la page, comme une onde à longue portée en plein ciel » (O.P. II, 292). Trouverons-nous moins riche de sens l'allusion à la musculature de l'athlète ? « La beauté d'un poème ne peut résider dans des agréments de détail (...) La beauté se présente comme l'athlète sur le stade. C'est dire l'importance que nous attachons à ses muscles, à sa ligne ». Cette remarque perdrait beaucoup de sa portée si l'on négligeait cette note : « Il y a aussi cet athlétisme de la douleur qui rend la beauté bouleversante » (O.P. II, 266-267). L'amour de la beauté ne serait qu'esthétisme s'il se contentait d'une harmonie sans âme -et l'âme, en son désir, n'est jamais achevée.
L'arbre de poésie se dessine sous nos yeux. Un arbre -ou un arbuste- par poème. Un arbre pour une œuvre. Un arbre pour la vie. La publication des œuvres poétiques complètes permet de suivre, des racines jusqu'à la cime, la montée de la sève, d'assister, de participer à la formation de ce qui demeurera un arbre, l'Arbre même, l'hiver venu.
Solidité de cette architecture, où la vie circule, invente des formes sans nuire à l'équilibre de ce qui s'établit ! Architecture où le vent passe, où s'élève le chant...
Les poèmes sont de dimension variable : d'un seul vers, comme il arrive dans les premiers recueils -en souvenir, peut-être du Chantre d'Apollinaire-, à une ou deux, parfois trois, exceptionnellement quatre pages ; ils ne dépassent jamais l'amplitude qui correspond à notre climat. Ce n'est pas la forêt vierge. Les allées, les sentiers sont tracés. On peut marcher librement. D'où l'intérêt des blancs, de la fréquente disposition en strophes. Les strophes apparaissent un peu comme des portées préparées pour le chant. Et Cadou tenait beaucoup à cette « vertu du chant ». Ne confiait-il pas à Pierre Yvernaut qu'il regrettait de ne plus la trouver dans la jeune poésie depuis la mort de Milosz, d'Essénine, de Lorca, de Max Jacob (S.T., 12) ?
Du point de vue de la métrique, on observe une grande diversité, mais aussi un profond besoin d'unité.
Très souvent, l'ensemble du poème est construit sur un type de vers déterminé. L'alexandrin vient nettement en tête. Pour l'ensemble de l'œuvre, on compterait une centaine de poèmes écrits entièrement en vers de douze syllabes. Viendraient ensuite les poèmes entièrement écrits en octosyllabes (près de quarante fois), puis les poèmes entièrement écrits en hexasyllabes (près de vingt-cinq fois). Les poèmes entièrement écrits en heptasyllabes restent rares ; on pourrait en citer cinq : Liberté couleur des feuilles (O.P. I, 347), un Noël (O.P. I, 449), un autre Noël (O.P. II, 73) L'étrange douceur (O.P. II, 24), Sainte-Reine-de-Bretagne (O.P. Il, 198). On peut encore noter deux poèmes en pentasyllabes : Air triste et connu (O.P. I, 381), Des œufs dans la haie (O.P. II, 177).
N'avions-nous pas retenu que « la vraie poésie s'inquiète fort peu du nombre de ses pieds » (O.P. II, 280) ? Il serait facile de répondre -qu'on nous pardonne encore le jeu de mots !- que cette formule n'est peut-être pas à prendre... au pied de la lettre. Il sera plus sérieux de dire : -premièrement qu'il ne s'agit pas, chez Cadou, d'une inquiétude, qu'il fait ce qu'il a envie de faire, sans se contraindre à respecter à tout prix le compte des syllabes, mais aussi sans s'obliger à rejeter, quand elle répond à son attente, une certaine régularité du chant ; -et, deuxièmement, que ce qui importe, ce n'est pas le respect extérieur de la forme, mais l'esprit qui, dans un cheminement -aussi bien dans le cheminement de l'aventure formelle-, accompagne le poète.
En cours de route, Cadou peut être amené à changer de rythme, selon l'orientation, la pente, les séductions du chemin -rappelons-le : « suivant l'émotion du marcheur » (M.O., 28).
Ici, le poète semble chercher son juste pas, hésitant entre les vers de sept et huit syllabes (La Solitude, O.P. II, 105 ; Les enfants rêvent, O.P. Il, 193). Ailleurs, après avoir éprouvé plusieurs mètres, il adopte une marche paisible, un « rythme de croisière ». Tel poème (Personne au monde, O.P. II, 39) commence par un vers de quatre syllabes, que suivent vingt alexandrins. Tel autre, qui se développe également en alexandrins, commence par un décasyllabe (La Maison d'Hélène, O.P. II, 13). Dans le poème la Servante (O.P. I, 357), un vers monosyllabe, «Toi», se détache d'une suite d'octosyllabes. Ailleurs encore, après le large accueil du premier vers -seize syllabes pour « Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète » (O.P. II, 175), le poète revient à la dimension plus familière, plus « intériorisée », plus intime, de l'alexandrin. Parfois le poète ralentit sa marche, pour le repos, pour la contemplation. Ou, tout simplement, il exprime, par un vers de deux, de six ou de neuf syllabes, le besoin d'interrompre momentanément une régularité qui pourrait devenir un peu monotone. Parfois, l'allongement d'un vers donnera le sentiment d'une route très longue. Ainsi, dans Louisfert (O.P. I, 431), poème écrit en alexandrins, le deuxième vers contient quatorze syllabes : «Pieds nus dans la campagne bleue, comme un Bon PèreQui tient sa mule par le cou et qui dit des prières». Non seulement la route est longue, mais cette prière, qui vient de très loin dans le temps, ne s'achèvera pas.
Ce ne sont là que quelques exemples de la variété des petites modifications rythmiques que Cadou apporte à une prosodie relativement sage. Mais Cadou ne s'interdit pas, à l'occasion, de s'écarter davantage de la norme, dans la succession des vers, dans l'élan qu'il donne à son imagination. Il aime la liberté -« l'odeur des lys, la liberté des feuilles »-, mais cette liberté, qui n'ignore rien des pulsions de la vie, tend vers un ordre : elle s'épanouit dans la marche mesurée de l'homme, dans l'aventure intelligente du poème.
Il faut ajouter que, si la coupe du vers obéit souvent à une facture classique, Cadou se libère sans difficulté des usages de la tradition chaque fois qu'il en éprouve la nécessité. Il est maître de sa forme et pratique avec aisance toutes les techniques d'assouplissement du vers.
L'art des vers, chez Cadou, témoigne d'une maîtrise de soi solidement conquise, d'un accord au monde patiemment désiré, et d'une grande attention à autrui, d'une connaissance profonde -en l'autre et en soi-même- de la réalité humaine. Comment expliquer, autrement, que le désir de poésie, chez le lecteur, soit si généreusement satisfait, et avec tant de facilité, par l'œuvre poétique de René Guy Cadou ?
La liberté à la recherche de son ordre : est-ce bien surprenant de la part d'un poète qui s'est senti si proche d'Apollinaire ? Une étude approfondie de l'usage des rimes, chez Cadou, mettrait également en évidence ce goût de l'ordre et de l'aventure, conciliés dans la liberté créatrice de forme, dans la fidélité à la vie même.
Cadou, manifestement, aime la rime. On pourrait dire qu'il aime la rime comme il aime l'amour. La rime rapproche, unit, ce qui était séparé. La poésie est acte d'amour, effectivement. Mais la vérité humaine qu'exprime la poésie de Cadou n'aurait pas supporté de rimes systématiques. Parfois, dans un poème généralement rimé, quelques fins de vers ne riment pas. Les autres rimes n'en prennent alors que plus de valeur et plus de sens. L'amour n'est pas gagné d'avance. Mais des mots, qui ne riment pas tout à fait, peuvent se trouver en instance de retentir l'un à l'autre. L'amour est en chemin, comme dans Coeur à l'ouvrage (0.P. I, 59) :
Tout s'éclaire
L'œil fait éclater sa paupière
La main quitte son gant de mousse
Au soleil de jeunes pousses
De vieilles peaux dans les greniers
Et les hommes sortent nus
Personne ne se reconnaît • plus
Il n'y a plus de haine
On vit au jour le jour
Et tout le temps perdu
Est gagné pour l'amour.
S'éclaire rime avec paupière, pousses avec mousse. On entend : greniers, le mot greniers tout seul. Puis nus appelle ne se reconnaît plus. A la fin, le mot jour attire le mot amour. Reste haine, qui, par définition, ne peut rimer avec rien. Revenons à greniers. Est-ce sans rapport avec paupière ? La terminaison en «ier» n'est-elle pas plutôt comme le masculin d'une terminaison en -ière ? Et finalement, faire rimer le masculin avec le féminin, n'est-ce pas la vocation de l'amour ?
Il se peut aussi que l'absence de rimes, en tel ou tel poème, ne soit qu'apparente. L'amour, parfois, se cache. C'est ce qui arrive quand l'alexandrin se divise en deux hexasyllabes successifs. Il suffirait de réunir les hexasyllabes pour retrouver la plénitude de la rime.
Malheureusement, le défaut de rime correspond aussi à une réalité, à une expérience de la vie. Est-il alors irréparable ? Examinons ce qui se passe dans quelques poèmes constitués de couples de deux vers, de distiques, qui, clans la forme, ne sont pas sans rappeler le Francis Jammes des Géorgiques chrétiennes.
Dans Encore l'enfance (O.P. I, 409), nous entendons : leurs couleurs, demi-teintes - peintre. Tout se passe bien : village - attelage. Mais :
C'est un dimanche après-midi comme les autres
Avec des bonnes gens en habit sur la route
Ici, la rime est en chemin...
Dans le poème Bürger (O.P. I, 411), Goettingen, même prononcé Goetting', rime difficilement avec triste. Il en est de même pour secrète et parfait. Il faudrait s'arranger pour mettre l'adjectif au féminin !
Dans Louisfert (0:P. I, 431), ville et volubilis forment assonance, mais quand nous entendons, au milieu du poème :
(...) qui n'en a pas fini
De mener ses chevaux sur la route sans ombre
Qui a grand 'hâte et soif et ne salue personne,
Comment ne ressentirions-nous pas le tragique de ce désaccord soudain ?
Dans Lied (O.P. II, 152), aube et pendre produisent un effet analogue :
Je me suis retrouvé plus d'une fois dans l'aube
Avec tout juste ce qu'il faut de corde pour se pendre
Mais on connaît la résolution de cette dissonance, la fin merveilleuse (la fin qui restera toujours un commencement) de ce poème, émouvant entre tous, entre tous admirable :
Et c'est peut-être et c'est sûrement pour cela que je t'ai aimée
Hélène ! dans mon verre comme une goutte de rosée.
On entre toujours par hasard (jamais par effraction) dans la demeure d'un poète. On ne sait pas encore, en entrant,
« que chaque nœud du bois renferme davantage
De cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt » (O.P. II, 75)...
On nous pardonnera de nous être attardé si longuement à des questions de forme -qui ne sont pas (nous voudrions avoir contribué à le montrer) questions de pure forme... Les nœuds du bois contiennent le chant de la forêt profonde. Saluons la légèreté des arbres dans le matin !
Notes
O.P. René Guy CADOU. Oeuvres poétiques complètes. Tomes I et II. Paris. Seghers. 1973.
M.O. René Guy CADOU. Le Miroir d'Orphée. Préface de Michel DECAUDIN. Mortemart - 87330 Mézières-sur-Issoire. Rougerie. 1976.
S. T. Signes du temps. No 78. Saint-Jouin-de-Marnes - Deux-Sèvres. 1951.
T.A. René Guy CADOU. Le Testament d'Apollinaire. Témoignage. Préface de Georges-Emmanuel CLANCIER. Mortemart. Rougerie. 1980.
M.M. Michel MANOLL. René Guy Cadou. Paris. Pierre Seghers. Poètes d'aujourd'hui. 1958.
Ch. M. Christian MONCELET. Vie et passion de René Guy Cadou. La Roche Blanche. 63670 Le Cendre. Editions BOF. 1975.
René Guy Cadou : Poésie la vie entière ou la vie, l'amour, la mort, par Yves Cosson
Tout le monde en convient : n'est pas poète qui veut. Il est juste, en outre, de dire : on naît poète et on le devient. On connaît la mutation, l'éclosion à la poésie de l'enfant Rimbaud. Il en fut de même de Cadou. Un soir, le père sort, d'un tiroir, un cahier de poésie et le remuement se fait au plus profond de l'enfant :
Le soir, de retour quai Hoche, dans la cuisine rouge et blanche, après-dîner, il (mon père) me lut les poèmes qu'il écrivait à vingt ans. Il en avait trois gros cahiers serrés dans un tiroir de son secrétaire, trois registres de gros carton entourés de ficelle. Je crois bien que c'est ce soir-là que tout a commencé. Le lendemain je me trouvais devant la fenêtre de ma chambre avec une feuille blanche sur les genoux.
... Qu'est-ce que j'écris ? que signifient ces mots maladroits que je dresse comme un rempart contre la nuit.
Les soirs suivants me retrouvèrent à la même place, et je pris ainsi l'habitude de traduire, au lieu de versions latines, cette. indicible tristesse qui était en moi.
(Mon enfance est à tout le monde. p. 197 et 199.)
Il avait 12 ans. Dès lors, il ne vécut que pour la Poésie :
On écrit d'abord pour se connaître, puis pour se reconnaître, enfin pour se disculper. (Usage Interne. p. 252).
Ne faudrait-il pas ici préciser le sens de cette connaissance puisque Cadou écrit :
La poésie est naissance, et non pas connaissance. Il ne s'agit donc pas ici d'un esprit de recherche, mais sans équivoque possible, d'un esprit de création, d'autocréation. La poésie naît et renaît de ses cendres, telle un phénix. Le poète n'est rien que son intermédiaire, son valet ; il n'a aucun pouvoir sur elle. A peine a-t-il le droit de frapper ces trois coups du destin qu'on nomme bizarrement l'Inspiration. (Notes inédites. O.P. T. II, p. 309).
Connaissance, à vrai dire, fort proche de l'esprit claudélien (naître à la poésie est co-naître au monde) qui se manifeste en Cadou par un appétit des sens, une dilatation de l'être, un amour de la vie qui fait de sa poésie un chant de gorge, à « pleine poitrine «.
Il est vrai, aussi, de dire que Cadou recueille un triple héritage. D'Apollinaire, il hérite la certitude d'être-au-monde, réponse au cri désespéré de Rimbaud : « Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente «. Pour Cadou, la vraie vie est présence et présence inépuisable.
Paradoxalement, de Reverdy, il hérite du sentiment poignant de la séparation et de la solitude, sentiment que Reverdy cultive jusqu'à la névrose. Ce sentiment, Cadou l'accepte, l'utilise, le dépasse dans une complexe et incessante relation-non relation à autrui et au monde : Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul. (Usage Interne. p. 250).
De Max Jacob, enfin, il reçoit la certitude que le poète fait communiquer par le langage d'un monde à l'autre, qu'il est bien ce laboratoire central où s'élabore le poème, objet situé et fermé, qui contient finalement une image de ce monde, lui-même icône d'un Dieu :
C'est une vérité, Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous (au coeur de notre laboratoire central, cette lampe tempête sous les côtes),
point ardent de jonction entre l'inconscient et le conscient, entre la conscience et le surnaturel.
A l'égard de cette démarche de Cadou se pose le délicat problème de « l'écoute active-passive « chère aux surréalistes.
Qui est premier ? Le poète ou le monde ? Qui écoute quoi ? Cendrars, que Cadou admirait, répondait : « Le monde est ma représentation «, ce qui tendrait à reprendre l'assertion de Breton selon laquelle le modèle n'est pas dans le réel intérieur, mais dans l'imagination, dans l'imaginaire : « L'imagination seule productrice de réel vrai «.
Cadou refuse et se range du côté de Reverdy qui affirme que le poète est bien « à l'intersection du rêve et du réel « :
La poésie n'est pas dans les choses... elle est dans l'homme uniquement. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser... La poésie a sa source à ce point de contact douloureux du réel intérieur et de la conscience humaine -à ce point où l'homme se désole de constater la supériorité de sa conscience sur les choses- qui n'en ont pas et qu'elle soit en grande partie esclave de ces choses. Pour détrôner ces choses au profit de sa conscience, il les nomme -et, en les nommant, il s'en empare et les domine. Mais il ne s'en empare et les domine qu'en les nommant comme il veut et en les pliant à sa volonté pour exprimer la réalité supérieure de son monde intérieur.
Son monde est lui. (P. Reverdy. La Fonction Poétique in Mercure de France. 1.4.1950. p. 587-588).
C'est ainsi que l'on sort du pays de l'enfance, c'est ainsi qu'on en garde la poignante nostalgie et que, désormais, on lutte pour retrouver la patrie perdue. Patrie perdue, partie perdue. Tout jeune, Cadou eut l'intuition que le train de la vie, comme le diable, l'emportait vers le désastre :
C'était le 30 mai 1932, il était bien dix heures. Un camion passa sur le quai et la maison tout entière en fut ébranlée. Maman eut un petit mouvement de paupières, ouvrit tout grands les yeux, les referma à demi, ses lèvres tremblèrent. La vieille couturière s'approcha de nous et dit : « C'est fini l « (Mon enfance est à tout le monde. p. 191). ( Lire aussi le poème 30 Mai 1932 in Grand Elan, 0.P. T. I, p. 209)
Dès lors, Cadou vécut à l'écoute de La diane doucement poignante du destin (Les chiens qui rêvent. O.P.T. II, p. 65). Il vécut la poésie entière, à la vie, à la mort. Car il y eut la mort du père (31 janvier 1940. Grand Elan. D.P.T. I, p. 229), les malheurs de la guerre, les fusillés de Châteaubriant, le 22 octobre 1941 (in Pleine Poitrine. O.P. T. 1, p. 325), la mort de Max au camp de Drancy. Pleine Poitrine lui est dédié : « A la mémoire de mon ami max jacob assassiné «.
Jésus a dit
« Il n'y aura pas de printemps cette année
Parce que Max s'en est allé
Emportant les chevaux les vergers et les ailes
Parce que sur la croix le bon Saint Matorel
A lâché les oiseaux vers un pays glacé «
Et c'est vrai. Les bourgeons se taisent. Les poitrines
Voient se faner leurs seins. Tout au fond des vitrines
Une enfance à genoux se suicide et le ciel
Epuise en un regard ses réserves de miel...
(Carnet d'adieu. 0.P. T. I, p. 329).
Il y eut les bombardements de Nantes desquels il sort indemne, par miracle (le 16 septembre 1943, il avait donné rendez-vous à Michel Ragon dans un café du centre). Il y eut les massacres, les camps de concentration (Ravensbrück, O.P.T. I, p. 348, Chanson de la Mort violente, O.P. T. I, p. 349). Il y eut, incessante, en lui, l'obsession de sa mort prochaine :
Je n'irai pas tellement plus loin que la barrière de l'octroi
Que le petit bistrot tout plein d'une clientèle maraîchère
Je ne ferai jamais que quelques pas sur cette terre
Et dans cette grande journée
Je ne passerai pas pour un vieil abonné...
(La Barrière de l'Octroi, O.P. T. II, p. 55)
Ainsi, être poète, c'est bien « tenter de vivre «, être au monde, faire effort pour porter en soi ses contradictions, les contradictions tragiques de la vie et de la mort, pour se rassembler, se surmonter, chercher avec courage ce « point focal «, illuminateur, lieu d'harmonie et de paix où tout devient transparence, en dépit et à cause de tout : Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, cet œil magique béant au fond de nous...
L'émotion du poète ne vient pas de ce qu'il voit mais de ce qu'il endure. (Usage Interne. O.P.T. II, p. 251).
Et c'est cela l'amour. Cadou aimait l'amour, l'amour de l'amour, L'amour est conquête, il est possession et dépossession. Il est cette force de vivre dont la source est cachée qui nous jette hors de nous-même, vers l'autre, vers les autres.
Cadou aimait l'amitié qui est une image privilégiée de l'amour. Exigeant, absolu dans ses choix, il sommait ses amis, ses copains, de se rendre à son invitation qui était un ordre : Viens, je veux te voir. J'ai besoin de toi, de ta présence. Liens du cœur aussi forts que les liens du sang :
Amis pleins de rumeurs où êtes-vous ce soir
Dans quel coin de ma vie longtemps désaffecté ?
Oh ! je voudrais pouvoir sans bruit vous faire entendre
Ce minutieux mouvement d'herbe de mes mains
Cherchant vos mains parmi l'opaque sous l'eau plate
D'une journée, le long des rives du destin !...
(La Soirée de Décembre, O.P. T. II, p. 176).
Cadou avait le culte du facteur. Son passage était un rite. Il entretenait une énorme correspondance, avec quantité de poètes et d'amis (en particulier Max Jacob, Reverdy, Rousselot, Manoll, Bouhier, Béalu, Bérimont, les poètes de l'Ecole de Rochefort, le Père Agaesse, etc...).
Il utilisait à plein toutes les ressources du langage pour aller à l'autre, le toucher au vif. Pour vivre et se reconnaître, il avait besoin de se mirer dans l'âme des autres, non pour se satisfaire d'un regard narcissique, mais pour se retrouver en ce lieu savoureux qu'est le silence entre amis. D'où la force fascinante de son regard, la suavité de son sourire, la cascade étincelante de son rire. Briéron jusqu'aux tripes, exclusif et carré, Cadou n'admettait ni la médiocrité, ni le mensonge, ni l'hypocrisie. C'était un homme franc du collier, plein la main. Il appartenait à cette aristocratie de l'âme qui situe les êtres dans la hauteur, la fierté d'être homme. Et ce poète était un prince. (Le Père Agaesse, venant de Solesmes, entra dans la chambre mortuaire de Cadou et dit : « Je viens saluer un prince «).
Inutile d'évoquer ici ses engagements, ils procédaient essentiellement de cette générosité naturelle qui incline au respect dû à tout être vivant, à la tendresse pour les plus mal lotis, les pauvres, les démunis, les marins saouls :
Et si c'était mon Dieu ce marin saoul qui est entré ce soirdans ma maison ?
L'éternité ! dont vingt-trois ans de navigation !...
(Si c'était lui ! 0.P.T II, p. 156).
les pauvres zigues et les idiots de village (l'Idiot, O.P.T. II, p. 77) Tendresse d'âme pour les laissés-pour-compte du destin.
C'est de ce même absolu, de cette même exigence que procède en Cadou la fulgurance de l'Amour. Le poète est un homme de désir : désir de la femme dans sa totalité, sa plénitude :
Veux-tu je te prendrai en travers de ma selle
Je te prendrai ou si tu veux te jetterai
Comme une bonne couverture de laine
Sur mon cheval Je te prendrai.
(Je te prendrai. O.P. T. II, p. 72)
Fusion dans l'effusion des sens, des corps, des coeurs, des âmes.
Le 17 juin 1943, à Clisson, Cadou rencontre une jeune étudiante de Nantes, Hélène Laurent, et c'est simplement et vraiment le coup de foudre :
Tout le jour je vis bleu et je ne pensai qu'à toi
Tu ruisselais déjà le long de ma poitrine
Sans rien dire je pris rendez-vous dans le ciel
Avec toi pour des promenades éternelles.
( 17 juin 1943. O.P.T. II, p. 22)
La femme abolit la solitude. La femme est la promesse, enfin tenue. Médiatrice, elle rend l'univers ductile et transparent, soumis aux prises du poète, apprivoisé et livrant enfin ses secrets : Hélène est le règne et le règne végétal, elle est la bonne nouvelle de la délivrance. Elle est le salut. La violence de la possession est tempérée par l'immensité de la tendresse. « Innocence et pureté «. (Rimbaud)
Cette image multiple de la femme aimée, de la femme unique, aux pouvoirs magiques (voir Arcane 17) récapitule les images archétypales qui obsédaient le poète : image de la mère trop tôt disparue, image de l'enfance enfin retrouvée, de l'innocence première, de l'Eve d'avant la faute originelle.
Cette ivresse et cette certitude ne vont pas sans rappeler la célèbre rencontre de Mésa et d'Ysé. Le seul mystère inépuisable dans cette vie est bien celui des rencontres et privilégiée entre toutes, la rencontre de l'Aimée :
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux
... Tu es ...
... Et si je pense à toi c'est qu'il faut bien choisir
Entre avenir et souvenir.
(Toi, O.P. T. II, p. 25)
On est tenté de dire avec Breton : « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas. « La Beauté est magique, elle naît de la circonstance, elle fait exploser le temps et l'espace, ou, plus exactement, elle les transcende. Cadou est l'un des très grands poètes lyriques de notre temps.
Les liens du sang, les liens de la chair, les liens du cœur, les liens de l'âme, autant d'attaches nécessaires pour nous retenir à la vie, pour nous protéger des gouffres et des abîmes. Au cœur de l'Amour même, le poète demeure l'enfant fragile et menacé qui a peur de se perdre s'il vient à lâcher la main :
Mes doigts possèdent le secret De t'éveiller de t'épanouir |
|
De te perdre avant de dormir
Comme une enfant dans la forêt.
(l'Amour. O.P.T. II, p. 110).
L'amour est fort comme la mort. Mais la mort ne cesse de rôder et c'est elle, pour un moment, qui aura bien le dernier mot. Le poète se bat et Cadou s'est bien battu :
Le poète nous apporte une révélation poignante de sa destinée.
La création poétique est à proprement parler une Passion, c'est assez dire par là le peu de cas qu'elle fait du calvaire, de la crucifixion et de la renommée. Elle n'est pas dirigée dans l'espoir d'une survie, elle est dans son sommet, cette survie même. (Usage Interne. O.P. II, p. 271).
Au plain chant du poème répond le cri de l'homme en proie à la souffrance et sachant son heure venue :
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Au beau milieu de la campagne un jour d'été
... Mais ce soir-là
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Dans la petite chambre qui n'est pas encore située
Derrière la lampe qui est une colonne de fumée
Et peut-être aussi dans le parage de ces mains
Qui ne sont pas déshabituées de ma présence
Rien ne subsistera du voyageur
Dans le filet troué des ultimes voyages
Pas la moindre allusion
Pas le moindre bagage
Le vent de la déroute aura tout emporté.
(Aller simple. O.P. T. II, p. 68)
Oui, Cadou s'est battu comme un homme acculé contre un mur, sans qu'apparemment il se soit départi de son sourire et de sa joie. Mais il serait très imprudent de s'avancer dans ces territoires inconnus, de vouloir violer ces retraites intimes où l'homme se retrouve seul, face à face avec la souffrance et la mort et n'en dit mot à personne. Suprême courage et suprême pudeur dont Hélène et les amis furent les témoins déchirés.
Michel Seuphor a écrit un livre admirable : Le style et le cri (Editions du Seuil). Ces deux termes qualifient parfaitement l'écriture du poète pendant cette période ultime.
Dans l'avertissement d'Usage Interne, Cadou nous prévient : Je n'ai réuni ces notes que pour juger en tout état de cause de l'étendue du désastre. ... Peut-être n'est-il pas inutile... de se pencher avec humilité... et de s'interroger sur les raisons de sa défaite. (O.P. T. II, p. 245)
Le poète qui donne sa vie pour la Poésie en viendrait, sous le poids de la souffrance, à douter de sa fonction et de son efficacité. Plus encore, Cadou éprouve jusqu'au cri le sentiment d'être impuissant devant la souffrance et la mort.
Mais on ne refait pas l'histoire de Jeanne et il n'y a pas de raison
Pour que ce soit toujours le même qui entende
Le cri des hommes qui ont mal et le gémissement des plantes.
(Moineaux de l'an 1920. O.P. T. IL p. 126).
Oui, « cet enfant qui meurt sous la roue « est écrasé par le poids de toutes les souffrances du monde et cède enfin à la poussée atroce du mal contre ses côtes.
La Passion de la Poésie est alors la Passion de l'Amour, vie reçue, vie offerte, vie donnée, car dans la solitude ultime du poète -on meurt seul- c'est l'image, la présence d'un Dieu crucifié qui s'impose dans les poèmes de cette dernière période :
Entrez n'hésitez pas c'est ici ma poitrine
Beaux oiseaux...
Je suis debout dans l'air ainsi qu'une fenêtre Ouverte et je vois loin
Le Christ est devenu mon plus proche voisin...
(Refuge pour les oiseaux. 0.P.T. II, p. 45).
(lire également le recueil Tout Amour. O.P.T. II, p. 179, en particulier Possibilité du corps en trop. p. 180).
Le poète, finalement, se retrouve seul dans cette chambre de misère, cette chambre de douleur si chère à Reverdy et Max Jacob. Démuni, dépouillé, il ne peut que crier sa souffrance et prier. Dur à vivre (O.P.T. II, p. 171), dur à mourir. Demeure le chant profond, tissu de mots maladroits dressés « comme un rempart contre la nuit «, au cœur même de la nuit d'agonie, ce Nocturne qui déchire le cœur :
... Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre
Laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources
Et tirer quelque note sauvage de la grande forêt d'orgue des pins
O mon Dieu que la nuit est belle où brille l'anneau de Votre Main !
Tous ces feux mal éteints dans l'air et ces yeux de matous en bas qui leur répondent
Ce cri d'amour fondamental qui est celui de notre pauvre monde...
(Nocturne. O.P. T. II, p. 172).
Dans la nuit du 20 au 21 mars 1951, son ami Sylvain Chiffoleau imprima ce texte sur beau papier, l'orna d'une baguette d'or. Au matin, quand il vint à Louisfert pour le lui offrir, Cadou était mort.
Souviens-toi de l'avenir : Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, doit en effet, se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire par un phénomène de prémonition, se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore mais sûrement deviendra.
Il est possible d'ailleurs que le moyen le plus sûr d'encourager l'avenir consiste pour le poète à retrouver en lui
les vertus de l'enfance, écrivait Cadou (Le Miroir d'Orphée. p. 53) à propos du recueil inédit de Manoll ayant pour titre : Souviens-toi de l'avenir.
De l'enfance à la mort, il n'y avait qu'un pas, un pas terrible, vite franchi, mais, dès l'origine et jusqu'à la fin, Cadou avait saisi que l'unique sens et raison de vivre tient en deux mots : « Tout Amour « (dernier poème des Biens de ce monde. dernier recueil paru du vivant de Cadou en février 1951).
Le poète est le tympan du monde. Je n'ai pas écrit ce livre. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer, comme un muet, l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du inonde. (Préface d'Hélène ou le Règne Végétal, O.P. T. II, p. 7).
Oui, qui appelle et qui écoute ? Qui entend dans le brouhaha confus ou les vociférations de ce monde ? Le poète, dit Claudel, est « un invité à l'attention» .
Solitude du poète, mais solitude peuplée puisque sa parole, son chant devient une parole contagieuse :
Il faut être seul pour tous les autres, et cela ne va pas sans une démarche atroce et une solide fierté. (A Manoll in Le Miroir d'Orphée. p. 57).
Que ma poésie soit d'abord une révolte ! Qu'elle me mette en face de moi-même ! Qu'elle me distingue ! Par mes tentatives, hasardeuses, souvent, timides ou immodestes, je me suis donné rendez-vous dans le cœur des hommes de mon âge. Eluard cherchait à donner à voir et je saisis bien ce qu'il entendait par là. Mais plus qu'à voir, il s'agit de donner à aimer. Que l'amour soit une contagion...
Les surréalistes ont écrit « Les éléphants sont contagieux «. Oui ! Mais la rue grise, un printemps en panne, une larme sur la plus pauvre joue sont autrement contagieux. Soyez des poètes contagieux.
Remarquez que je ne me fais guère d'illusion sur l'audience de la Poésie. Mais qu'un poème de moi continue de vivre dans la mémoire de quelque ami inconnu, que ce poème l'allège ou le renforce dans sa conviction d'homme et je suis pour toujours récompensé. (Le Miroir d'Orphée, p.165) C'est pourquoi, Messieurs, il me plaît de chanter atrocement pour vos oreilles et pour quelques autres, afin que ce quelque chose d'atroce dans cette oreille de plomb du pauvre -de ce mendiant de poésie- tombe comme un louis d'or qui n'aura pas été sali -ou subtilisé par vos mains.
J'écris pour des oreilles poilues, d'un amour obstiné qui saura, bien, un jour se faire entendre. ( Usage Interne. Les liens du sang. O.P. T. II, p. 287).
Quand la mort passe, les visages s'effacent dans la mémoire. Mais la voix persiste longtemps à nos oreilles, au cœur même de la nuit de la séparation, comme un chant et comme un lien. Cadou, en toute humilité, savait bien que dans la mémoire des hommes, il s'effacerait, un jour ou l'autre, puisque « toute poésie tend à devenir anonyme « ( Usage Interne, O.P.T. II, p. 253).
Que le nom de Cadou s'efface, qu'importe puisque son chant demeure, ce chant qui touche au vif de l'âme et du cœur parce qu'il est traversé du cri atroce d'un homme qui souffre et sait qu'il va mourir et, dans le même temps, donne à aimer :
L'amour qui sublimise toute chose nous aura portés. Dans cette solitude aérienne que nous nous sommes créée, non comme une tour d'Ivoire, mais comme un royaume sans frontières, il aura été cette multitude vagabonde, cette parole du matin. (Usage Interne, 0.P.T.II, p. 252).
Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. (Usage Interne. O.P.T. p. 253).
Oui, Cadou est un poète rentable. parce que sa parole, la parole donnée est bien Tout Amour :
Ah ! pauvre père ! auras-tu jamais deviné quel amour tu as mis en moi
Et combien j'aime à travers toi toutes les choses de la terre ?
Quel étonnement serait le tien si tu pouvais me voir maintenant
Raclant le sol de mes deux mains
Comme les chercheurs de beauté !
- Seigneur ! Vous moquez-vous ? Serait-ce là mon fils ?
Se peut-il qu'il figure à votre palmarès ?
-O père ! j'ai voulu que ce nom de Cadou
Demeure un bruissement d'eau claire sur les cailloux !
Plutôt que le plain-chant la fugue musicale
Si tout doit s'expliquer par l'accalmie finale
Lorsque le monde aura les oreilles couchées !
(0.P. T. II, p. 182)
Notes
Les poèmes et textes de Cadou sont extraits des Oeuvres poétiques complètes en deux volumes. Editions Seghers. 1973.
Le Miroir d'Orphée. Préface de Michel Décaudin. Rougerie Editeur. 1976. Mon Enfance est à tout le monde. Jean Munier Editeur. 1969.
L'échelle de Jacob
Méditation sur le thème de la mort chez René Guy Cadou, par Hélène Cadou
Source: Actes du colloque René Guy Cadou, 23-25 octobre 1981.
L'univers de Cadou n'est jamais un univers immobile. Ce n'est pas, non plus, un univers plan où poussent les blés, où courent les rivières et la parole entre les hommes, mais un monde sans cesse en dialogue, en intercessions entre le ciel et la terre.
Le drame occupe non seulement la scène mais aussi les cintres. La surface ne suffit pas à la démarche du poète, il s'épanouit dans le volume, dans l'espace aérien et souterrain. Il lui faut toute une architecture d'arbres, de trapèzes, d'échelles, de racines, de mines et de puits pour s'accomplir.
Au cœur de son œuvre, il y a un jeu déchirant entre l'appel ascensionnel et l'adhérence, l'adhésion à la terre qui lui est tout à fait particulier. Il ne peut être pleinement terrien s'il n'interroge le ciel, pleinement humain s'il ne s'adresse à Dieu.
Mais dans la fierté du questionnement, de l'affrontement, René entrevoit une autre dimension, une sorte d'inversion propre à la condition humaine qui dément une démarche purement libérée et cosmique.
Alors que le premier élan de libération était ascendant comme celui de l'oiseau qui se veut le plus aérien possible :
Monte encore plus haut
Tu sais
On n'est jamais trop près du ciel, (1)
alors que ce mouvement semblait répondre à la part la plus ambitieuse de l'homme, à son destin le plus créatif, René fait une découverte bouleversante qui va marquer toute l'œuvre de son empreinte.
Il cherche soudain :
Le plafond par où descendre dans le ciel. (2)
Il semble qu'une intuition fondamentale lui ait été donnée avec l'usage de la poésie, une intuition qui symbolise l'incarnation comme source de lumière, l'amour puisé dans la plus totale déréliction, l'abaissement qui donne vie.
Avec Job, il peut s'écrier :
A chaque pas mon Dieu c'est vrai que je m'enfonce
Un peu plus dans le ciel. (3)
Le démiurge, l'homme fier qui se posait face à Dieu va découvrir sa liberté dans le sacrifice.
A vingt ans, René fait déjà «la part de Dieu » (4), il sait, déjà, que ce Dieu qu'il affronte lui demandera tout. En pleine profusion vitale, la mort se profile, déjà, et le poète, face à Dieu, affirme sa grandeur et son exigence.
Nous verrons, plus tard, ce Dieu patronal, ce Dieu seigneurial faire place à un Dieu de bon voisinage, mais le poète reviendra plusieurs fois sur une attitude de refus qui correspond à ses intuitions panthéistes. Si Dieu existe, il est en tout et partout, c'est-à-dire dans les végétaux, les animaux, les hommes, dans toutes les manifestations de la création.
L'interrogation du divin, l'« Adresse à Dieu» (5) se rencontre à toutes les pages. Il y a comme un commerce ininterrompu entre ce Dieu absent-présent et le poète qui s'écrie :
Mon Dieu je n'ai pas su conserver les distances
Entre le ciel et moi l'averse recommence. (6)
Cette averse c'est l'incessante relation avec les Anges intercesseurs entre Dieu et les hommes, liens tissés et retissés entre le ciel et la terre, messagers divins, paroles volantes, pollens et esprits fécondants.
René y fera allusion une autre fois au sujet de son ami le plus visité, le plus fertilisé, le poète Max Jacob :
Des Anges pareils à l'averse
Le considèrent le grandissent
En un sublime sacrifice. (7)
Mais si le poète ressent le besoin d'intercesseurs entre l'homme et ce Dieu si insaisissable qui le questionne, il se méfie de l'angélisme, de toute forme spirituelle désincarnée, de tout effort de perfection qui serait uniquement un appel vers le haut sans ancrage charnel.
Il ne « conçoit Dieu que dans l’homme » (8), mais se défie désormais de ses propres pouvoirs, de ses propres tentations de démiurge, d'homme orphique ou d'Icare dans le domaine de l'esprit.
Quand il écrit :
Cette fois
Ah ! cette fois
Le mort n'est pas un héros. (9)
il dissipe clairement toute ambiguïté. Sa destinée est celle d'un homme semblable aux autres. Il ne veut pas échapper à cette fraternité par quelque survol, mais, au contraire, l'assumer et s'efforcer de la dire, lui qui dispose des possibilités de la parole.
Orphée n'est pas, pour lui, le héros du chant tout-puissant qui a reçu mission divine. Il ne parle pas au nom des autres mais pour les autres. Il chante à en mourir car, pour devenir totale transmutation, totale expression, il doit jouer sa vie. Il ne s'élève pas, mais il descend aux enfers, il se défait de tous ses biens. Orphée est orphelin. Tout poète est orphelin et Cadou plus que tout autre. Orphelin de son père, de ce Dieu dont il doute, de la parole qui, sitôt exprimée, devient négation du seul Verbe indéfiniment recherché et jamais atteint.
C'est dans le ventre de la terre qu'il faut creuser pour retrouver l'origine et l'amour, le feu central.
C'est comme si la vie et la clarté venaient du plus profond, du plus enfoui :
« La clarté du schiste où je confonds mes mains c'est ma pâture » (10), comme si René savait déjà qu'en acceptant la destruction, l'obscurité de la terre, il trouverait l'éclat du jour véritable et du verbe :
Terre bourdonne encore. Roule tes coquillages
Et que ton noir soleil soit mon Eldorado. (11)
Cette descente, ce désistement du poète dans l'humilité et la souffrance va s'exprimer en termes de plus en plus intérieurs, avec encore, parfois, des sursauts d'élans cosmiques, des bondissements de joie vitale, des émerveillements devant cette vie d'ici, belle et chaleureuse parmi les hommes, mais aussi avec la certitude qu'il lui faudra parcourir tous les degrés de la souffrance.
Les images d'agenouillement et de creusement reviennent sans cesse comme si toute la lumière était dans la houille :
Si quelqu'un veut toucher
Mon cœur qu'il s'agenouille
Et creuse lentement
Le cœur chaud de la terre... ( 12)
L'obscurité et la lumière, la descente et la montée, le dénuement et l'amour se conjuguent, dans le mouvement qui porte René, au point de se confondre étrangement.
Accompagnant l'obsession du creusement, de la fouille, de la mise à jour d'un trésor, ou de l'acquis dérisoire qui en tient lieu sur cette terre :
Rien de moi n'est plus moi ni mes genoux dans l'herbe
Ni cette obscure main qui cherche à dérober
Un vil morceau de plomb au sommeil de la terre, (13)
accompagnant l'agenouillement, il y a l'appel, la marche glorieuse, la remontée et l'ouverture :
Je marche loin de moi sur des routes sans nombre
Une porte d'azur ouverte à mes côtés (14)
La descente qui dépouille et allège peut se confondre avec l'aspiration qui élève, si bien que le poète peut, indifféremment, monter vers la terre et descendre dans le ciel :
Il y a cette flamme en moi qui donne tort
A tout ce qui n'est pas cette montée sévère
Vers l'admirable accidenté visage de la terre (15)
Quand le poète écrit :
Il faut monter plus haut
Vers le ciel et l'étable (16)
il exprime dans cette descente ascensionnelle, dans ce glissement délesté, sa situation à un carrefour, sa mise en croix entre ce ciel et cette terre qu'il voudrait pouvoir réconcilier en lui-même.
Il souffre de cet écartèlement qui est celui de la condition humaine, de cette dissension, en chacun, entre le pécheur et l'enfant de Dieu :
O mon front riverain du ciel et de la terre
Je cours
Et je suis fait pour aller à genoux. ( 17)
Cette recherche vaut aussi bien pour la poésie, et l'on voit le poète râcler « le sol de ses deux mains comme les chercheurs de la beauté » (18), s'humiliant pour trouver quelques pépites au fond de la nuit, se dépouillant jusqu'à la plus extrême simplicité, renonçant volontairement aux privilèges de l'intelligence, pour atteindre la Parole.
René sait maintenant que pour sortir de sa prison, de cette geôle qu'est notre condition humaine, il lui faudra accepter pleinement cette condition parmi ses frères.
Il est surprenant de voir, ou plutôt, il ne faut pas s'étonner de voir l'enfant frondeur et bondissant, le poète toujours prêt à jeter un œil dans l'inconnu, cerné par une race honnie et redoutée d'agents, de sergents, de pandores et de procureurs :
Tandis qu'un coq et un sergent
Là-bas
Font respecter le règlement (18)
Surveillé, parce que soupçonné d'être celui qui «voit» et d'en savoir trop sur ce qui se passe de «l'autre côté», «absent toujours présent au procès de sa vie», (19) René redoute la toque noire que portaient «Jadis Pasteur et les juges dans les procès» (20).
Et pourtant, certes, il sera jugé :
Crucifiez-moi comme on a fait
De Jésus-Christ qui délivrait
Sur son réseau de faux billets... (21)
mais ce n'est plus par le Dieu lointain, inaccessible, des premiers temps, c'est par un Dieu qui ressemble fort aux personnages d'une mythologie quotidienne :
Me voici devant l’Agrégé final moi l’impétrant… (22)
Le cri du refus, de la protestation, de l'affrontement est devenu un commerce assumé, teinté même de tendresse et d'espérance.
D'une certaine façon, maintenant que l'amour s'en est mêlé, René a la certitude que la comparution aura lieu entre gens qui se comprennent :
Je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. (23)
Si René abandonne au seuil du Printemps, au seuil de la mort, « les Biens de ce monde », il ne faut pas croire que ce soit dans une sorte d'obéissance religieuse. Il s'agit de tout autre chose qui est, bien plutôt, une histoire d'amour et de transparence, à la fois une grâce donnée et une volonté d'épousailles.
Celui qui a chanté les germinations, qui, de tout son corps, aima la terre jusqu'à se perdre en elle, pour mieux revivre en un immense corps généreux, sera, désormais, une treille où viendront se désaltérer des « milliers d’enfants ». Le corps du sacrifice deviendra un « abreuvoir de lumière et de sang » (24).
Le voici face à la Croix, ce poète si plein d'amour, il est descendu si loin dans l'abandon de soi avec ses « plaies aussitôt pardonnées », qu'il ne peut plus revenir en arrière et constate, avec une humble innocence, dans le dénuement qui l'environne :
Le Christ est devenu mon plus proche voisin. (25)
Dans sa souffrance, le poète a la certitude que la mort est proche, même s'il ne connaît pas le jour ni l'heure :
Date approximative et faste dans l'Histoire
Où l'orgueilleux manant a rejoint Jésus-Christ (26)
mais qu'il ne disparaîtra pas vraiment :
Je mourrai mais ne pourrai pas
M'absenter des chevaux et des fleurs du lilas. (27)
Comment René concevait-il cette survie, ou plutôt cette naissance à cette nouvelle vie, sous un nouveau mode d'être ?
Lorsque le poète évoque l'éternité, c'est d'une manière ambiguë et souvent assez contradictoire.
Tantôt, il l'oppose simplement au temps, à l'épaisseur du séjour terrestre, tantôt il en fait le lieu de l'amour, la demeure de l'être.
Tant qu'il conçoit l'éternité comme un simple au-delà du temps, René n'échappe pas à l'idée du passage, du voyage, de l'errance.
Il peut bien partir :
Pour l'éternité avec un vieux sac de cuir, (28) il ne recevra pas de réponse :
Rien ne répond de rien… (29)
Mais, soudain, dans la lancée du poème, il prend conscience que son interrogation est gauchie, qu'elle ne se situe pas là où elle devrait se situer. Il cherche encore à s'évader au lieu de se retourner sur lui et c'est alors qu'il s'écrie :
Rien ne subsistera de moi dans votre Histoire
Mais mon amour et moi nous avons notre histoire. ( 30)
Dans une de ces fulgurances qui lui sont propres, il perçoit, en même temps, que l'Eternité est le terme de l'Histoire mais que, devant subir l'épreuve de celle-ci pour advenir, elle est le vainqueur de l'histoire en instaurant le règne de l'amour.
René a, désormais, pris le parti de « l’écorché vif », de cette mise à nu, à neuf, qui doit être «la sauvegarde du poète, sa façon de se confondre avec l’éternité ». (31)
Il est, désormais, donné, offert, s'étant jeté « à travers le cercle en flammes du passé » (32), pour se trouver lui-même hors de l'histoire et du destin, du règne de la mort, de la faute et de la finitude :
Je te sais maintenant éternité pareille
A cette épaule de plongeur qui resurgit
Tranquillement entre deux touffes de sommeil
Et vous n'y pouvez rien frontières de ma vie. (33)
René qui aime vivre dans la bonne épaisseur charnelle, qui pense avoir « bien mérité de croire dans la vie plus qu'en l’éternité » (33), qui va jusqu'à crier dans son désir de vivant :
Qu'est-ce que j'aurai gagné à être éternel ? (34), lui qui pose la question au plus chaud de la vie alors qu'il est en même temps, harcelé, ébloui, pris dans les phares d'un autre appel auquel il ne pourra échapper, René descend au plus creux du temps pour sortir du Temps, pour que surgisse cette différence, cette goutte d'eau qui va tout changer :
Ce bol de larmes au pied des marches de l’éternité. ( 35)
René découvre que le seul vrai voyage est en lui-même, que chaque instant peut s'ouvrir sur l'enfance de l'être, sur le matin printanier, le nouveau commencement. Cette libération est, à la fois, une découverte très simple et un profond « chambardement » :
Votre château du ciel mais c'est mon Athénée...
Le grand chambardement dans la pièce à côté
Celle qui donne juste sur l'éternité. (36)
Ce que René exprime dans l'expansion de ce qu'il appelle, lui, le « Cœur définitif » (37) :
Le cœur définitif en proie à sa conquête
Têtu
Et plus encore à même de juger
Au fond de lui les grands sursauts d'éternité (37)
Le poète au lieu de se donner des ailes est descendu au fond de lui, et là, dans son histoire d'homme, dans son corps éprouvé et souffrant, il s'est forgé son « cœur définitif ».
Chaque soir, en proie au poème, René recommence l'aventure. Il se heurte à la vitre, à la mer, aux labours, à la mine, chaque soir, il veut aller plus loin encore, malgré la fatigue de son corps, sa douleur. Il va vers un sacrifice qui le broie et le libère :
Je monte dans ma chambre et prépare les feux
J'appareille tout seul vers la Face rayonnante de Dieu (38)
La poésie est échelle de Jacob. Il faut saisir l'instant où la pesanteur s'inverse en grâce. C'est ce qu'exprime René qui vit l'appel et la contradiction avec sa foi brûlante de charbonnier :
Humilité ! Pudeur ! Donnez un nom terrestre
Au tremblement d'un cœur qui ne sait où cacher
Sous quel masque d'ajonc sa profonde tendresse
Pour ce monde où les doigts du Seigneur sont marqués. (39)
René Guy Cadou : Poésie la vie entière ou la vie, l'amour, la mort, par Yves Cosson
Tout le monde en convient : n'est pas poète qui veut. Il est juste, en outre, de dire : on naît poète et on le devient. On connaît la mutation, l'éclosion à la poésie de l'enfant Rimbaud. Il en fut de même de Cadou. Un soir, le père sort, d'un tiroir, un cahier de poésie et le remuement se fait au plus profond de l'enfant :
Le soir, de retour quai Hoche, dans la cuisine rouge et blanche, après-dîner, il (mon père) me lut les poèmes qu'il écrivait à vingt ans. Il en avait trois gros cahiers serrés dans un tiroir de son secrétaire, trois registres de gros carton entourés de ficelle. Je crois bien que c'est ce soir-là que tout a commencé. Le lendemain je me trouvais devant la fenêtre de ma chambre avec une feuille blanche sur les genoux.
... Qu'est-ce que j'écris ? que signifient ces mots maladroits que je dresse comme un rempart contre la nuit.
Les soirs suivants me retrouvèrent à la même place, et je pris ainsi l'habitude de traduire, au lieu de versions latines, cette. indicible tristesse qui était en moi.
(Mon enfance est à tout le monde. p. 197 et 199.)
Il avait 12 ans. Dès lors, il ne vécut que pour la Poésie :
On écrit d'abord pour se connaître, puis pour se reconnaître, enfin pour se disculper. (Usage Interne. p. 252).
Ne faudrait-il pas ici préciser le sens de cette connaissance puisque Cadou écrit :
La poésie est naissance, et non pas connaissance. Il ne s'agit donc pas ici d'un esprit de recherche, mais sans équivoque possible, d'un esprit de création, d'autocréation. La poésie naît et renaît de ses cendres, telle un phénix. Le poète n'est rien que son intermédiaire, son valet ; il n'a aucun pouvoir sur elle. A peine a-t-il le droit de frapper ces trois coups du destin qu'on nomme bizarrement l'Inspiration. (Notes inédites. O.P. T. II, p. 309).
Connaissance, à vrai dire, fort proche de l'esprit claudélien (naître à la poésie est co-naître au monde) qui se manifeste en Cadou par un appétit des sens, une dilatation de l'être, un amour de la vie qui fait de sa poésie un chant de gorge, à « pleine poitrine «.
Il est vrai, aussi, de dire que Cadou recueille un triple héritage. D'Apollinaire, il hérite la certitude d'être-au-monde, réponse au cri désespéré de Rimbaud : « Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente «. Pour Cadou, la vraie vie est présence et présence inépuisable.
Paradoxalement, de Reverdy, il hérite du sentiment poignant de la séparation et de la solitude, sentiment que Reverdy cultive jusqu'à la névrose. Ce sentiment, Cadou l'accepte, l'utilise, le dépasse dans une complexe et incessante relation-non relation à autrui et au monde : Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul. (Usage Interne. p. 250).
De Max Jacob, enfin, il reçoit la certitude que le poète fait communiquer par le langage d'un monde à l'autre, qu'il est bien ce laboratoire central où s'élabore le poème, objet situé et fermé, qui contient finalement une image de ce monde, lui-même icône d'un Dieu :
C'est une vérité, Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous (au coeur de notre laboratoire central, cette lampe tempête sous les côtes),
point ardent de jonction entre l'inconscient et le conscient, entre la conscience et le surnaturel.
A l'égard de cette démarche de Cadou se pose le délicat problème de « l'écoute active-passive « chère aux surréalistes.
Qui est premier ? Le poète ou le monde ? Qui écoute quoi ? Cendrars, que Cadou admirait, répondait : « Le monde est ma représentation «, ce qui tendrait à reprendre l'assertion de Breton selon laquelle le modèle n'est pas dans le réel intérieur, mais dans l'imagination, dans l'imaginaire : « L'imagination seule productrice de réel vrai «.
Cadou refuse et se range du côté de Reverdy qui affirme que le poète est bien « à l'intersection du rêve et du réel « :
La poésie n'est pas dans les choses... elle est dans l'homme uniquement. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser... La poésie a sa source à ce point de contact douloureux du réel intérieur et de la conscience humaine -à ce point où l'homme se désole de constater la supériorité de sa conscience sur les choses- qui n'en ont pas et qu'elle soit en grande partie esclave de ces choses. Pour détrôner ces choses au profit de sa conscience, il les nomme -et, en les nommant, il s'en empare et les domine. Mais il ne s'en empare et les domine qu'en les nommant comme il veut et en les pliant à sa volonté pour exprimer la réalité supérieure de son monde intérieur.
Son monde est lui. (P. Reverdy. La Fonction Poétique in Mercure de France. 1.4.1950. p. 587-588).
C'est ainsi que l'on sort du pays de l'enfance, c'est ainsi qu'on en garde la poignante nostalgie et que, désormais, on lutte pour retrouver la patrie perdue. Patrie perdue, partie perdue. Tout jeune, Cadou eut l'intuition que le train de la vie, comme le diable, l'emportait vers le désastre :
C'était le 30 mai 1932, il était bien dix heures. Un camion passa sur le quai et la maison tout entière en fut ébranlée. Maman eut un petit mouvement de paupières, ouvrit tout grands les yeux, les referma à demi, ses lèvres tremblèrent. La vieille couturière s'approcha de nous et dit : « C'est fini l « (Mon enfance est à tout le monde. p. 191). ( Lire aussi le poème 30 Mai 1932 in Grand Elan, 0.P. T. I, p. 209)
Dès lors, Cadou vécut à l'écoute de La diane doucement poignante du destin (Les chiens qui rêvent. O.P.T. II, p. 65). Il vécut la poésie entière, à la vie, à la mort. Car il y eut la mort du père (31 janvier 1940. Grand Elan. D.P.T. I, p. 229), les malheurs de la guerre, les fusillés de Châteaubriant, le 22 octobre 1941 (in Pleine Poitrine. O.P. T. 1, p. 325), la mort de Max au camp de Drancy. Pleine Poitrine lui est dédié : « A la mémoire de mon ami max jacob assassiné «.
Jésus a dit
« Il n'y aura pas de printemps cette année
Parce que Max s'en est allé
Emportant les chevaux les vergers et les ailes
Parce que sur la croix le bon Saint Matorel
A lâché les oiseaux vers un pays glacé «
Et c'est vrai. Les bourgeons se taisent. Les poitrines
Voient se faner leurs seins. Tout au fond des vitrines
Une enfance à genoux se suicide et le ciel
Epuise en un regard ses réserves de miel...
(Carnet d'adieu. 0.P. T. I, p. 329).
Il y eut les bombardements de Nantes desquels il sort indemne, par miracle (le 16 septembre 1943, il avait donné rendez-vous à Michel Ragon dans un café du centre). Il y eut les massacres, les camps de concentration (Ravensbrück, O.P.T. I, p. 348, Chanson de la Mort violente, O.P. T. I, p. 349). Il y eut, incessante, en lui, l'obsession de sa mort prochaine :
Je n'irai pas tellement plus loin que la barrière de l'octroi
Que le petit bistrot tout plein d'une clientèle maraîchère
Je ne ferai jamais que quelques pas sur cette terre
Et dans cette grande journée
Je ne passerai pas pour un vieil abonné...
(La Barrière de l'Octroi, O.P. T. II, p. 55)
Ainsi, être poète, c'est bien « tenter de vivre «, être au monde, faire effort pour porter en soi ses contradictions, les contradictions tragiques de la vie et de la mort, pour se rassembler, se surmonter, chercher avec courage ce « point focal «, illuminateur, lieu d'harmonie et de paix où tout devient transparence, en dépit et à cause de tout : Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, cet œil magique béant au fond de nous...
L'émotion du poète ne vient pas de ce qu'il voit mais de ce qu'il endure. (Usage Interne. O.P.T. II, p. 251).
Et c'est cela l'amour. Cadou aimait l'amour, l'amour de l'amour, L'amour est conquête, il est possession et dépossession. Il est cette force de vivre dont la source est cachée qui nous jette hors de nous-même, vers l'autre, vers les autres.
Cadou aimait l'amitié qui est une image privilégiée de l'amour. Exigeant, absolu dans ses choix, il sommait ses amis, ses copains, de se rendre à son invitation qui était un ordre : Viens, je veux te voir. J'ai besoin de toi, de ta présence. Liens du cœur aussi forts que les liens du sang :
Amis pleins de rumeurs où êtes-vous ce soir
Dans quel coin de ma vie longtemps désaffecté ?
Oh ! je voudrais pouvoir sans bruit vous faire entendre
Ce minutieux mouvement d'herbe de mes mains
Cherchant vos mains parmi l'opaque sous l'eau plate
D'une journée, le long des rives du destin !...
(La Soirée de Décembre, O.P. T. II, p. 176).
Cadou avait le culte du facteur. Son passage était un rite. Il entretenait une énorme correspondance, avec quantité de poètes et d'amis (en particulier Max Jacob, Reverdy, Rousselot, Manoll, Bouhier, Béalu, Bérimont, les poètes de l'Ecole de Rochefort, le Père Agaesse, etc...).
Il utilisait à plein toutes les ressources du langage pour aller à l'autre, le toucher au vif. Pour vivre et se reconnaître, il avait besoin de se mirer dans l'âme des autres, non pour se satisfaire d'un regard narcissique, mais pour se retrouver en ce lieu savoureux qu'est le silence entre amis. D'où la force fascinante de son regard, la suavité de son sourire, la cascade étincelante de son rire. Briéron jusqu'aux tripes, exclusif et carré, Cadou n'admettait ni la médiocrité, ni le mensonge, ni l'hypocrisie. C'était un homme franc du collier, plein la main. Il appartenait à cette aristocratie de l'âme qui situe les êtres dans la hauteur, la fierté d'être homme. Et ce poète était un prince. (Le Père Agaesse, venant de Solesmes, entra dans la chambre mortuaire de Cadou et dit : « Je viens saluer un prince «).
Inutile d'évoquer ici ses engagements, ils procédaient essentiellement de cette générosité naturelle qui incline au respect dû à tout être vivant, à la tendresse pour les plus mal lotis, les pauvres, les démunis, les marins saouls :
Et si c'était mon Dieu ce marin saoul qui est entré ce soi rdans ma maison ?
L'éternité ! dont vingt-trois ans de navigation !...
(Si c'était lui ! 0.P.T II, p. 156).
les pauvres zigues et les idiots de village (l'Idiot, O.P.T. II, p. 77) Tendresse d'âme pour les laissés-pour-compte du destin.
C'est de ce même absolu, de cette même exigence que procède en Cadou la fulgurance de l'Amour. Le poète est un homme de désir : désir de la femme dans sa totalité, sa plénitude :
Veux-tu je te prendrai en travers de ma selle
Je te prendrai ou si tu veux te jetterai
Comme une bonne couverture de laine
Sur mon cheval Je te prendrai.
(Je te prendrai. O.P. T. II, p. 72)
Fusion dans l'effusion des sens, des corps, des coeurs, des âmes.
Le 17 juin 1943, à Clisson, Cadou rencontre une jeune étudiante de Nantes, Hélène Laurent, et c'est simplement et vraiment le coup de foudre :
Tout le jour je vis bleu et je ne pensai qu'à toi
Tu ruisselais déjà le long de ma poitrine
Sans rien dire je pris rendez-vous dans le ciel
Avec toi pour des promenades éternelles
( 17 juin 1943. O.P.T. II, p. 22)
La femme abolit la solitude. La femme est la promesse, enfin tenue. Médiatrice, elle rend l'univers ductile et transparent, soumis aux prises du poète, apprivoisé et livrant enfin ses secrets : Hélène est le règne et le règne végétal, elle est la bonne nouvelle de la délivrance. Elle est le salut. La violence de la possession est tempérée par l'immensité de la tendresse. « Innocence et pureté «. (Rimbaud)
Cette image multiple de la femme aimée, de la femme unique, aux pouvoirs magiques (voir Arcane 17) récapitule les images archétypales qui obsédaient le poète : image de la mère trop tôt disparue, image de l'enfance enfin retrouvée, de l'innocence première, de l'Eve d'avant la faute originelle.
Cette ivresse et cette certitude ne vont pas sans rappeler la célèbre rencontre de Mésa et d'Ysé. Le seul mystère inépuisable dans cette vie est bien celui des rencontres et privilégiée entre toutes, la rencontre de l'Aimée :
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux
... Tu es ...
... Et si je pense à toi c'est qu'il faut bien choisir
Entre avenir et souvenir.
(Toi, O.P. T. II, p. 25)
On est tenté de dire avec Breton : « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas. « La Beauté est magique, elle naît de la circonstance, elle fait exploser le temps et l'espace, ou, plus exactement, elle les transcende. Cadou est l'un des très grands poètes lyriques de notre temps.
Les liens du sang, les liens de la chair, les liens du cœur, les liens de l'âme, autant d'attaches nécessaires pour nous retenir à la vie, pour nous protéger des gouffres et des abîmes. Au cœur de l'Amour même, le poète demeure l'enfant fragile et menacé qui a peur de se perdre s'il vient à lâcher la main :
Mes doigts possèdent le secret De t'éveiller de t'épanouir |
|
De te perdre avant de dormir
Comme une enfant dans la forêt.
(l'Amour. O.P.T. II, p. 110).
*
L'amour est fort comme la mort. Mais la mort ne cesse de rôder et c'est elle, pour un moment, qui aura bien le dernier mot. Le poète se bat et Cadou s'est bien battu :
Le poète nous apporte une révélation poignante de sa destinée.
La création poétique est à proprement parler une Passion, c'est assez dire par là le peu de cas qu'elle fait du calvaire, de la crucifixion et de la renommée. Elle n'est pas dirigée dans l'espoir d'une survie, elle est dans son sommet, cette survie même. (Usage Interne. O.P. II, p. 271).
Au plain chant du poème répond le cri de l'homme en proie à la souffrance et sachant son heure venue :
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Au beau milieu de la campagne un jour d'été
... Mais ce soir-là
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Dans la petite chambre qui n'est pas encore située
Derrière la lampe qui est une colonne de fumée
Et peut-être aussi dans le parage de ces mains
Qui ne sont pas déshabituées de ma présence
Rien ne subsistera du voyageur
Dans le filet troué des ultimes voyages
Pas la moindre allusion
Pas le moindre bagage
Le vent de la déroute aura tout emporté.
(Aller simple. O.P. T. II, p. 68)
Oui, Cadou s'est battu comme un homme acculé contre un mur, sans qu'apparemment il se soit départi de son sourire et de sa joie. Mais il serait très imprudent de s'avancer dans ces territoires inconnus, de vouloir violer ces retraites intimes où l'homme se retrouve seul, face à face avec la souffrance et la mort et n'en dit mot à personne. Suprême courage et suprême pudeur dont Hélène et les amis furent les témoins déchirés.
Michel Seuphor a écrit un livre admirable : Le style et le cri (Editions du Seuil). Ces deux termes qualifient parfaitement l'écriture du poète pendant cette période ultime.
Dans l'avertissement d'Usage Interne, Cadou nous prévient : Je n'ai réuni ces notes que pour juger en tout état de cause de l'étendue du désastre. ... Peut-être n'est-il pas inutile... de se pencher avec humilité... et de s'interroger sur les raisons de sa défaite. (O.P. T. II, p. 245)
Le poète qui donne sa vie pour la Poésie en viendrait, sous le poids de la souffrance, à douter de sa fonction et de son efficacité. Plus encore, Cadou éprouve jusqu'au cri le sentiment d'être impuissant devant la souffrance et la mort.
Mais on ne refait pas l'histoire de Jeanne et il n'y a pas de raison
Pour que ce soit toujours le même qui entende
Le cri des hommes qui ont mal et le gémissement des plantes.
(Moineaux de l'an 1920. O.P. T. IL p. 126).
Oui, « cet enfant qui meurt sous la roue « est écrasé par le poids de toutes les souffrances du monde et cède enfin à la poussée atroce du mal contre ses côtes.
La Passion de la Poésie est alors la Passion de l'Amour, vie reçue, vie offerte, vie donnée, car dans la solitude ultime du poète -on meurt seul- c'est l'image, la présence d'un Dieu crucifié qui s'impose dans les poèmes de cette dernière période :
Entrez n'hésitez pas c'est ici ma poitrine
Beaux oiseaux...
Je suis debout dans l'air ainsi qu'une fenêtre Ouverte et je vois loin
Le Christ est devenu mon plus proche voisin... (Refuge pour les oiseaux. 0.P.T. II, p. 45).
(lire également le recueil Tout Amour. O.P.T. II, p. 179, en particulier Possibilité du corps en trop. p. 180).
Le poète, finalement, se retrouve seul dans cette chambre de misère, cette chambre de douleur si chère à Reverdy et Max Jacob. Démuni, dépouillé, il ne peut que crier sa souffrance et prier. Dur à vivre (O.P.T. II, p. 171), dur à mourir. Demeure le chant profond, tissu de mots maladroits dressés « comme un rempart contre la nuit «, au cœur même de la nuit d'agonie, ce Nocturne qui déchire le cœur :
... Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre
Laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources
Et tirer quelque note sauvage de la grande forêt d'orgue des pins
O mon Dieu que la nuit est belle où brille l'anneau de Votre Main !
Tous ces feux mal éteints dans l'air et ces yeux de matous en bas qui leur répondent
Ce cri d'amour fondamental qui est celui de notre pauvre monde...
(Nocturne. O.P. T. II, p. 172).
Dans la nuit du 20 au 21 mars 1951, son ami Sylvain Chiffoleau imprima ce texte sur beau papier, l'orna d'une baguette d'or. Au matin, quand il vint à Louisfert pour le lui offrir, Cadou était mort.
Souviens-toi de l'avenir : Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, doit en effet, se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire par un phénomène de prémonition, se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore mais sûrement deviendra.
Il est possible d'ailleurs que le moyen le plus sûr d'encourager l'avenir consiste pour le poète à retrouver en lui
les vertus de l'enfance, écrivait Cadou (Le Miroir d'Orphée. p. 53) à propos du recueil inédit de Manoll ayant pour titre : Souviens-toi de l'avenir.
De l'enfance à la mort, il n'y avait qu'un pas, un pas terrible, vite franchi, mais, dès l'origine et jusqu'à la fin, Cadou avait saisi que l'unique sens et raison de vivre tient en deux mots : « Tout Amour « (dernier poème des Biens de ce monde. dernier recueil paru du vivant de Cadou en février 1951).
Le poète est le tympan du monde. Je n'ai pas écrit ce livre. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer, comme un muet, l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du inonde. (Préface d'Hélène ou le Règne Végétal, O.P. T. II, p. 7).
Oui, qui appelle et qui écoute ? Qui entend dans le brouhaha confus ou les vociférations de ce monde ? Le poète, dit Claudel, est « un invité à l'attention» .
Solitude du poète, mais solitude peuplée puisque sa parole, son chant devient une parole contagieuse :
Il faut être seul pour tous les autres, et cela ne va pas sans une démarche atroce et une solide fierté. (A Manoll in Le Miroir d'Orphée. p. 57).
Que ma poésie soit d'abord une révolte ! Qu'elle me mette en face de moi-même ! Qu'elle me distingue ! Par mes tentatives, hasardeuses, souvent, timides ou immodestes, je me suis donné rendez-vous dans le cœur des hommes de mon âge. Eluard cherchait à donner à voir et je saisis bien ce qu'il entendait par là. Mais plus qu'à voir, il s'agit de donner à aimer. Que l'amour soit une contagion...
Les surréalistes ont écrit « Les éléphants sont contagieux «. Oui ! Mais la rue grise, un printemps en panne, une larme sur la plus pauvre joue sont autrement contagieux. Soyez des poètes contagieux.
Remarquez que je ne me fais guère d'illusion sur l'audience de la Poésie. Mais qu'un poème de moi continue de vivre dans la mémoire de quelque ami inconnu, que ce poème l'allège ou le renforce dans sa conviction d'homme et je suis pour toujours récompensé. (Le Miroir d'Orphée, p.165) C'est pourquoi, Messieurs, il me plaît de chanter atrocement pour vos oreilles et pour quelques autres, afin que ce quelque chose d'atroce dans cette oreille de plomb du pauvre -de ce mendiant de poésie- tombe comme un louis d'or qui n'aura pas été sali -ou subtilisé par vos mains.
J'écris pour des oreilles poilues, d'un amour obstiné qui saura, bien, un jour se faire entendre. ( Usage Interne. Les liens du sang. O.P. T. II, p. 287).
Quand la mort passe, les visages s'effacent dans la mémoire. Mais la voix persiste longtemps à nos oreilles, au cœur même de la nuit de la séparation, comme un chant et comme un lien. Cadou, en toute humilité, savait bien que dans la mémoire des hommes, il s'effacerait, un jour ou l'autre, puisque « toute poésie tend à devenir anonyme « ( Usage Interne, O.P.T. II, p. 253).
Que le nom de Cadou s'efface, qu'importe puisque son chant demeure, ce chant qui touche au vif de l'âme et du cœur parce qu'il est traversé du cri atroce d'un homme qui souffre et sait qu'il va mourir et, dans le même temps, donne à aimer :
L'amour qui sublimise toute chose nous aura portés. Dans cette solitude aérienne que nous nous sommes créée, non comme une tour d'Ivoire, mais comme un royaume sans frontières, il aura été cette multitude vagabonde, cette parole du matin. (Usage Interne, 0.P.T.II, p. 252).
Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. (Usage Interne. O.P.T. p. 253).
Oui, Cadou est un poète rentable. parce que sa parole, la parole donnée est bien Tout Amour :
Ah ! pauvre père ! auras-tu jamais deviné quel amour tu as mis en moi
Et combien j'aime à travers toi toutes les choses de la terre ?
Quel étonnement serait le tien si tu pouvais me voir maintenant
Raclant le sol de mes deux mains
Comme les chercheurs de beauté !
- Seigneur ! Vous moquez-vous ? Serait-ce là mon fils ?
Se peut-il qu'il figure à votre palmarès ?
-O père ! j'ai voulu que ce nom de Cadou
Demeure un bruissement d'eau claire sur les cailloux !
Plutôt que le plain-chant la fugue musicale
Si tout doit s'expliquer par l'accalmie finale
Lorsque le monde aura les oreilles couchées !
(0.P. T. II, p. 182)
Notes
Les poèmes et textes de Cadou sont extraits des Oeuvres poétiques complètes en deux volumes. Editions Seghers. 1973.
Le Miroir d'Orphée. Préface de Michel Décaudin. Rougerie Editeur. 1976. Mon Enfance est à tout le monde. Jean Munier Editeur. 1969.
René Guy Cadou poète de la « raison ardente », par Daniel Briolet
A la fin d'une chronique datée du 15 octobre 1948 et insérée dans Le Miroir d'Orphée sous le titre « Apollinaire devant la peinture », René Guy Cadou apprécie en ces termes le portrait d'Apollinaire par le douanier Rousseau :
« La hache du pilleur d'épaves allait créer un frisson nouveau (...) Temps venu de la Raison Ardente où tout se passe de commentaires ( ...) A la frontière de l'illimité et de l'avenir, le voilà, le Poète ! Et pas question de sanglots, s'il vous plaît ! La dure réalité, la seule, mais magnifiée, mais grandie, recréée par la base, étagée sur un feu vengeur qui réchauffe tout, qui menace de durer ». (1)
On aura aisément reconnu, dans cette proclamation passionnée, l'écho presque transparent de quelques vers du dernier poème de Calligrammes, « La Jolie Rouss e», que Jean Rousselot qualifiera en 1968, dans son Dictionnaire de la poésie française contemporaine, de « charte de (...) la poésie audacieuse de notre temps » (2) :
« Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières
De l'illimité et de l'avenir
O Soleil c'est le temps de la Raison ardente
Et j'attends
Pour la suivre toujours la forme noble et douce
Qu'elle prend afin que je l'aime seulement
Ses cheveux sont d'or on dirait
Un bel éclair qui durerait
Ou ces flammes qui se pavanent
Dans les roses-thé qui se fanent »
( 3)
Visage flamboyant de la Raison, métaphoriquement confondu par Apollinaire avec celui de la « Jolie Rousse », Jacqueline Kolb, épousée moins de deux mois après la publication du poème dont le titre évoque la lumineuse présence. Rayonnement de la personne d'Hélène au centre de la vie et de l'œuvre du poète d'Hélène ou le Règne Végétal. « Raison – soleil », pour reprendre une formule utilisée par Pierre Emmanuel dans un essai paru en 1949, Poésie Raison Ardente, autrement dit, principe d'énergie sans limites réglé par une force qui l'équilibre sans le détruire :
« C'est un poète -et des plus grands- écrit en substance Pierre Emmanuel en évoquant implicitement Apollinaire, qui créa l'expression « raison ardente » pour désigner cette activité de l'esprit qui n'abandonne rien de ses possibles, mais leur impose d'être contrôlés dans leur apparition et leur progrès par une volonté d'ordre ( ...).
Raison ardente : à l'image du soleil, brûlante d'énergie généreuse, est associée l'idée d'une puissance qui tempère, qui conduit, qui règle l'équilibre sans interrompre le mouvement de la force». (4)
Qu'elle se fasse critique ou poétique, la totalité de l'œuvre de Cadou, aujourd'hui publiée sous le titre Poésie la Vie Entière -titre emprunté à un poème du recueil Le Cœur définitif- s'inscrit dans ce vaste mouvement de la poétique et de la poésie modernes qui, de Rimbaud à Apollinaire, puis au dedans comme en dehors du surréalisme, ne cesse d'accentuer une interrogation beaucoup plus ancienne sur les rapports qu'entretiennent l'expérience et le langage poétique avec l'activité de l'intelligence et de la raison connaissante. « Qui met l'accent sur la raison se trompe, écrit encore Pierre Emmanuel ; et aussi qui met l'accent sur l'ardeur ». Car « les deux termes sont ici indissociables, par une adéquation inattendue, surgie de l'être qui sait, d'instinct, résoudre la contradiction au point même où celle-ci devient intolérable ». (5)
Tel est bien le cas de René Guy Cadou réfléchissant sur l'art poétique dans Usage interne ou dans les notes rassemblées tout au long de son Esthétique de Max Jacob, poète de l'intime association entre raison, ardeur amoureuse, passion de la connaissance, au fil de ses différents recueils : l'œuvre du théoricien fait surgir les contradictions auxquelles se heurterait quiconque entreprendrait d'appréhender en termes « définitifs » la genèse d'un poème aussi bien que la nature et la signification de l'expérience poétique. Le poète réussit, par la pratique de son propre langage, constamment traversé par le jeu contradictoirement libre et contrôlé des rythmes et des images, à résoudre au moins pour un temps « la contradiction au point même où celle-ci devient intolérable »,pour reprendre à nouveau les formules de Pierre Emmanuel.
La mort de Cadou a fait d' Usage interne, publié en 1951. une sorte de testament spirituel qui ne manque pas de frapper le lecteur d'aujourd'hui par l'abondance et la richesse des contradictions qu'il y rencontre. Nombreuses y apparaissent tout d'abord les condamnations de l'intelligence ou de la raison en matière de création poétique, dans le droit fil des proclamations surréalistes les plus fracassantes - mais, à tort, les plus connues... D'entrée de jeu, « l'inspiration » est définie comme « la contre-intelligence du poète, l'agent secret » (6). Quelques pages plus loin, les « méthodes de l'intelligence » sont assimilées à « celles de l'économie dirigée », à une « balance des comptes » (7), tandis que, un peu auparavant, Cadou s'est écrié :
« L'univers du poète est un monde sensible en ce qu'il ne fixe jamais que des rapports mouvants, des états d'âme où la raison n'a que faire.
Faire appel à la raison, c'est avouer publiquement son impuissance à résoudre les problèmes de l'art, c'est se priver à jamais de sa propre estime ». (8)
Pourtant se manifeste plus souvent encore un besoin d'ordre, de clarté, d'harmonie, qui évoque sans peine les principes les plus anciennement confirmés de l'esthétique classique traditionnelle. Qu'on en juge par ces quelques formules :
« Le rêve ne nous fait voir que le côté nocturne de l'homme, sa face torrentielle sillonnée d'épées, son cœur noir. Mais il y a d'abord la clarté du jour ». (9)
« L'Abondance des images m'effraie comme un palmarès. Laquelle choisir ?» ( 10)
« Offrez-vous donc le luxe d'être simple. C'est un luxe extrêmement coûteux qui vous vaudra bien des larmes, bien des reniements, mais qui vous offrira en échange des satisfactions qui ne sont pas celles du vulgaire ( ...). Soyez essentiel et clair.» ( 11)
Nous sommes ici moins loin de Boileau que ne l'eût peut-être admis René Guy Cadou lui-même... Sa pensée se fait tension vers un dépassement d'oppositions figées au cours des siècles entre corps et langage, cri et parole, inspiration et travail :
« Oui ! Mille fois oui ! La Poésie est un cri, mais c'est un cri habillé » ( 12) pouvons-nous lire dans Esthétique de Max Jacob. Parmi les justifications fournies à l'appui d'une telle exclamation, on retiendra principalement celles-ci :
« Celui de mes poèmes qui a eu le plus de succès est La Ballade de la Visite Nocturne. Pourquoi ?
Parce que le sentiment qui l'anime est un sentiment qui a été énormément sincère.
Parce que j'avais prévu longuement la forme que je donnerais à ce sentiment ». ( 13)
Ce souci de la forme, fréquemment sensible à la lecture des poèmes de Cadou, se trouve implicitement évoqué dans ce passage célèbre d'Usage Interne où tente de se définir un idéal poétique dénommé « surromantisme » :
« J'appellerai surromantisme toute poésie qui, ne faisant point fi de certaines qualités émotionnelles, se situe dans un climat sensiblement allégé par le feu, je veux dire ramenée à de décentes proportions, audible en ce sens qu'elle est une voix, aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle stirréalistes ». (14)
Ainsi s'affirme, avec une volonté de refaire de la poésie cette « Emotion qui, disait Vigny dans son Journal d'un Poète, nous saisit le cœur par l'oreille », un désir de purifier l'émotion en la passant au creuset d'une raison qui se fait principe d'ordre, recherche d'une harmonie, combinaison de proportions sans pour autant renoncer à l'exploration de l'inconnu. Peut-être n'est-il pas indifférent de mentionner, chemin faisant, qu'il est un jour arrivé à André Breton d'affirmer que « le surréalisme s'accompagne nécessairement d'un surrationalisme qui le double et le mesure » (Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938, avec cette remarque en incise : « le mot est de M. Gaston Bachelard »)... (15)
Pour Cadou comme pour Apollinaire, et sans doute aussi pour la part la plus lucide de la réflexion des surréalistes, en poésie, raison et passion ou inspiration ne cessent tout à la fois de s'attirer et de s'exclure mutuellement. La contradiction ainsi exacerbée en termes de langage non poétique ou théorique se trouve momentanément résolue au détour de maint poème : que cette résolution doive être de plus ou moins courte durée, ne coïncide qu'avec le temps de la lecture, ne signifie nullement qu'elle puisse être illusion, fiction, fantasme... Elle est au contraire promesse de résolutions futures, projet de découvertes à accomplir. Car, ainsi que le met si justement en lumière un poète mexicain -Ulalume Gonzalez de Leon- dans un pénétrant article d'un numéro du Courrier du Centre International d'Etudes poétiques consacré en 1979 à Poésie et philosophie, la densité du langage poétique, essentiellement faite d'omissions et de raccourcis, et l'accumulation des preuves par le langage philosophique, visent des buts convergents par des moyens différents : « le philosophe veut prouver ; le poète ne veut que montrer » (16), écrit-il notamment. Pour notre part, nous pourrions dire : « le poète montre ce que le philosophe démontre ».
La poésie cadoucéenne tend avant tout à montrer, à « donner à voir », comme dirait Eluard, l'infinie variété d'un univers où reste à découvrir ce qui fait l'unité secrète du réel et de l'imaginaire :
«Un monde jamais vu voilà ce que je veux Oublier dans l'élan mes infirmités d'homme» ( 17)
peut-on lire dans « Première Traversée », poème de La vie rêvée (1944). Dès lors s'ouvre à l'aventure intellectuelle, au déploiement des forces de l'imagination créatrice et de l'émotion la plus accordée aux rythmes du cosmos, la possibilité d'un bouleversement heureux de notre relation au monde :
Enfin la terre bat j'entends son cœur sonore
De grands espaces bleus rehaussent le décor
La mer monte à l'assaut des pistes enneigées
Le ciel laisse tomber sur nous ses grains de blé
Je parle couramment le langage des pierres » (18)
poursuit Cadou dans le même poème.
Pour m'être livré à un inventaire quasi systématique des récurrences du mot « raison » dans la totalité des recueils de notre poète, j'ai pu découvrir que rares étaient les moments où ce mot s'accompagnait des connotations négatives observées à plusieurs reprises dans Usage Interne. Bien au contraire, la « raison » paraît souvent associée par le contexte l'amour, à la douceur, au bonheur, à l'espoir. Dans « Raison perdue », par exemple, autre poème de La vie rêvée, l'évocation d'un douloureux état de vide intérieur en quatre strophes de six hexasyllabes presque tous rimés se termine ainsi :
« Mes lèvres trop longtemps
Ont couvé sous la cendre
Jusqu'à mon cœur les mots
Ne peuvent plus descendre
Et n'ayant plus d'amour
Je n'ai plus de raison» ( 19)
« Les Croisades », dans Grand Elan, première partie du même recueil, donne à imaginer un départ placé sous le signe d'une douce fidélité dans l'attente d'un retour désiré sous l'ardente impulsion d'un « Amour Plus fort que notre amour Plus fort que la chaleur » :
« Femme plus douce que raison 4
Plus fidèle que la pluie
Je pars
Et c'est ainsi que tu m'attends
Bras, rose attentive à l'orée des saisons » (20)
Une équivalence presque comparable entre « raison » et « douceur » se trouve établie en un contexte tout autre dans « Miroir comme une Eau froide », un des poèmes inédits des Visages de solitude et non repris dans Hélène ou le Règne végétal :
Autrefois j'avais peur comme un petit enfant
Le soir je n'attendais jamais jusqu'au dessert
Et m'enfuyais tremblant au fond du corridor
Vers les chères, les redoutables figures de ma mort
On aurait pu m'oublier là que j'aurais cru
En un bonheur plus grand que toutes les présences
Plus doux que la raison si douce de mon père » (21)
Plus généralement -car il ne saurait être ici question de se vouloir exhaustif- la « raison » est volontiers imaginée ou conçue comme recours ultime contre la folie ou le désespoir, invitation à rétablir une connivence avec le monde par la redécouverte de pouvoirs perdus :
« A cette heure dans le monde
Il y a peut-être une petite fille qui cueille des fleurs
A cette heure dans le monde
Une fleur s'entr'ouvre
Un poète retrouve soudain la raison»
(Poème extrait de Le diable et son train, 1947-1948) ( 22)
« Hélène ou le Règne végétal » : le visage de la Raison, flamme, éclair qui consume et qui dure, attire à soi toutes les images associées au contact avec la profusion d'une nature environnante souvent porteuse d'amour et d'espoir :
« Si ma raison vaut par les feuilles
Qui parlent bien quand on les aime
C'est dans l'espoir de m'habituer
Jour après jour à mon espoir » (23)
Ces vers appartenant à un poème du recueil « L'aventure n'attend pas le destin » (1947-1948), dans Le Coeur définitif, laissent à deviner l'ampleur du désir -si fréquent dans de nombreux textes du vaste recueil dédié à Hélène- d'élargir à l'infini les limites d'un espoir dont ne cesse de se faire sentir la précarité. Espoir au-delà de l'espoir, raison au-delà de la raison, l'incarnation du pouvoir d'aimer et d'être aimé en la personne d'Hélène fait de l'amante idéale, comparable en cela à la « Dominique » d'Eluard ou à « l'Elsa » d'Aragon, l'ineffaçable trait d'union entre l'individuel et l'universel, soumis tous deux aux catégories sans limites de l'espace et du temps. Il n'est que de relire, à cet égard, le poème « Toi » pour s'en convaincre :
« Toi
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux
Un port de mer tout entouré de myosotis
Et la rivière où le nageur descend
A la poursuite de son image
Tu es l'algue marine et la plante sauvage
Comme l'arnica
Tu es pleine de poissons dans ta chevelure
Tu es une belle figure
Plus belle que moi-même
Tu es celle que j'aime
Davantage que le pain
Et davantage que mes mains étendues
Sur chaque versant des collines
Tu es la petite voisine
Du trèfle et la compagne du lézard
Tu t'ensoleilles sur les pierres
Et tu es toujours sur ma joue
Si je pense à ta voix je pense au monastère
A neuf heures du soir quand les voix se répondent
Si je pense à ta bouche il me vient à la bouche
Ce goût de lait de fruits de feuilles traversées
Par les tendres ruisseaux de sève végétale
Et si je pense à toi c'est qu'il faut bien choisir
Entre avenir et souvenir » (24)
Rythmé par le jeu toujours contrôlé des anaphores, des parallélismes métriques ou syntaxiques, des correspondances internes entre les mots constitutifs de la succession des comparaisons et des images, un tel poème fonctionne tout entier comme métaphore d'une aspiration à la plénitude. Cette plénitude s'oppose à la perception initiale d'un manque par l'être aimant confronté à l'infinité des possibles : l'être aimé devient figure de la « Raison Ardente », même si cette « raison » n'est pas nommée. C'est lui seul en effet qui garantit le pouvoir stable et mesuré d'une réconciliation passionnée avec la singularité de chacun des éléments qui composent un univers en perpétuel mouvement, partagé « entre avenir et souvenir », situés eux-mêmes « aux frontières de l'illimité et de l'avenir ». Aux résonances apollinariennes ne sont pas loin de s'ajouter des résonances éluardiennes : le « paysage féminin » évoqué par Eluard en 1947 dans « L'extase », un des poèmes de Le Temps déborde, devient chez lui « Bonne raison maîtresse (...) Et sur la terre et sous le ciel hors de mon cœur et dans mon cœur » (25), tandis que, en 1951, le poète du recueil Le Phénix écrira :
« Il y a sur la plage quelques flaques d'eau
Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux
C'est par un soir d'hiver dans un monde très dur
Que je vis ce printemps près de toi l'innocente
Notre printemps est un printemps qui a raison » (26)
Cadou entend pourtant bien affirmer son indépendance absolue par rapport à la fascination de l'engagement idéologique ou politique exercée sur une large part de la poésie française des années 1940-1950. Non pas qu'il demeure étranger aux drames, aux luttes et aux grands débats de son temps : des poèmes comme « Les fusillés de Châteaubriant », « Les camarades », « Ravensbrück », « Chanson de la mort violente », tous extraits de Pleine poitrine, recueil composé en 1944-1945 à la mémoire de son « ami Max Jacob assassiné », attestent chez cet amant passionné de la pureté de l'engagement poétique la gravité d'une attitude fort éloignée d'une simple complaisance à l'égard des événements qui ont marqué en France et en Europe la fin de la Seconde Guerre Mondiale. On peut même déceler, dans les engagements non essentiellement poétiques de cet instituteur laïc -momentanément adhérent du parti communiste après 1945, et de plus en plus sensible à l'attrait d'une permanente conversion religieuse- l'empreinte indélébile des exigences d'une « Raison Ardente » constamment mise en œuvre dans son activité proprement poétique. Mais -biographes et tenants de la critique interne des textes ne peuvent que s'accorder sur ce point :-c'est de cette activité, dont l'essence n'est autre qu'amoureuse, que Cadou tire sa principale raison de vivre. En un langage que son art de l'anaphore et de l'image rend plus proche de la technique poétique éluardienne des années quarante que des cascades de métaphores surréalistes propres à l'Eluard des années trente, Cadou parvient à donner un souffle rajeuni à l'évocation de cette identité entre « amour » et « poésie » qui dicta le titre « L'Amour la Poésie » à un célèbre recueil du poète parisien paru en 1929.
Il suffit de relire, à cet égard, le poème « Déclaration d'amour », extrait de Le Cœur définitif (Ma vie en jeu, 1944-1946) :
« Déclaration d'amour
Je t'aime
Je te tiens à mon poing comme un oiseau
Je te promène dans la rue avec les femmes
Je puis te rouer de coups et t'embrasser
O poésie
En même temps
T'épouser à chaque heure du jour
Tu es une belle figure épouvantable
Une grande flamme véhémente
Comme un pays d'automne démâté
Tu es ceinte de fouets sanglants et de fumées
Je ne sais pas si tu t'émeus
Je te possède
Je te salis de mon amour et de mes larmes
Je te grandis je te vénère je t'abime
Comme un fruit patiemment recouvert par la neige» (27)
« Belle figure épouvantable », « grande flamme véhémente », inspiratrice d'élans contraires de violence et de tendresse, de bonheur et de tristesse, la poésie exacerbe des contradictions que résout patiemment, comme l'exercice de la raison dialectique, le patient travail de l'écriture, « fruit patiemment recouvert par la neige ». C’est ce patient travail qui verenouvelle l'incessante attention accordée par Cadou aux êtres et aux choses, son attachement à un peuple provincial éloigné des fausses séductions du parisianisme, son culte vigilant et scrupuleux de l'amitié :
« Lucien Becker Jean Rousselot Michel Manoll
Amis venus à la parole
Comme un bruit de moteur à l'orée du matin
Amis lequel de vous s'est réservé mes mains »
(28)
Ainsi débute « Les Compagnons de la première heure », extrait de La Vie rêvée. Dans « Anthologie » (in Les Biens de ce monde, 1949-1950), tout un compagnonnage poétique ignorant les frontières de la vie et de la mort relie Cadou à des poètes dont l'œuvre est perçue, à des degrés divers, comme porteuse d’amitié :
«Max Jacob ta rue et ta place !
Pour lorgner les voisins d'en face !
Eluard le square ensoleillé
Un bouquet de givre à ses pieds !
Blaise Cendrars ! Apollinaire
Le bateau qui prend feu en mer
Mais aussi mon Serge Essénine
Ce voyou qui s'assassina
Et la grande ombre de Lorca
Sous la pluie rouge des glycines !
A qui s'en prendre désormais
Pour célébrer le mois de mai ?» (29)
Espace et temps défiés, sinon vaincus, « L'Amour » et « La Poésie », se voient consacrer deux poèmes figurant côte à côte dans le recueil Les sept péchés capitaux, tandis que, parmi ceux-ci, prennent place également « La solitude », « La liberté », « La beauté », « La tristesse » ...
Il arrive assurément que ce dernier « péché » l'emporte. En ce cas peut mourir l'intimité des êtres et des objets, et le vide absolu réduit la conscience en esclavage, comme dans ces vers de « Possibilité du corps en trop », extrait du recueil Tout amour (1951) :
«Rien dans la cave !
Rien dans le lit !
Rien dans le placard !
Rien sous l'escalier !
Rien dans l'armoire !
Rien sous le lit !
Rien dans ma raison !
Rien dans la folie !» ( 30)
Mais. pour Cadou, le vide n'est autre que le moment qui précède l'avènement d'une rencontre d'ordre religieux ou mystique, puisque, aussitôt après de tels vers, le poème se termine ainsi :
« Mais lorsque j'éteignis ma lampe
Jésus était là dans ma chambre » ( 31)
Abdication de la raison aux yeux du lecteur agnostique ou athée, ou nécessaire et provisoire renoncement au recours à celle-ci pour un lecteur croyant ? Peu importe pour qui, comme l'auteur, accède à une démarche poétique : le premier demeure libre de considérer le fait mystique ou religieux comme une dégradation ou un détournement du poétique, tandis que le second verra dans celui-ci la première étape de la voie qui conduit à celui-là. Il reste un point sur lequel tend à se réaliser un accord de plus en plus large, et l'exemple de Cadou est à cet égard riche de promesses : la pratique de la poésie constitue dans son ordre propre un « instrument de connaissance non moins rigoureux » que ce « merveilleux instrument de connaissance » forgé au cours des siècles qui s'appelle « la raison cartésienne », comme le faisait observer Pierre Emmanuel dans l'essai auquel je faisais référence au début de cet exposé. Dans un article intitulé La poésie étant philosophie de la création, et paru dans le Courrier International des Etudes Poétiques précédemment cité, Claire Lejeune n'hésite pas à écrire :
« Je crois que le cancer de l'Université actuelle, c'est de tout scientiser, de concevoir toute pratique à partir du théorique et non de susciter l'esprit théorique -c'est-à-dire l'esprit critique- à partir d'une pratique sur laquelle on s'interroge à la fois solitairement et communément pour en tirer les lois d'un savoir-faire, autrement dit, une philosophie de la vie à vivre». ( 32).
Cadou ne manqua jamais l'occasion de manifester ses réticences critiques à l'égard du savoir universitaire. Lire ou relire la poésie de Cadou, ce peut être apprendre à ne jamais dissocier l'une de l'autre, la « raison » de la « passion ». égales composantes d'une « ardeur » toujours à renaître. C'est aussi contribuer pour paraphraser des formules désormais presque usées, à remettre la dialectique sur ses pieds. tâche de la plus grande utilité pour l'Université et pour le corps social tout entier. l'un de l'autre étroitement solidaires.
Notes
Les miroirs d'Orphée : reflets, ressemblances, Inversions dans l'écriture poétique d René Guy Cadou, par Jean Yve Debreuille.
« Interroger, avec les moyens précaires de la critique, le miroir tremblant d’Orphée » : en ces termes, René Guy Cadou inaugurait une de ses plus importantes chroniques, celle qu'il allait donner à la revue Les Essais de février 1947 à octobre 1950 (1), consacrée à la poésie des autres, mais aussi à la sienne propre, puisqu'on y trouve le fameux Présence d'un Surromantisme. Et précisément, s'il a substitué au mot poème l'expression « miroir tremblant d’Orphée », n'était-ce pas qu'elle lui paraissait plus adéquate à la façon dont il percevait ses propres poèmes ? On peut soupçonner un poète de n'employer jamais un mot au hasard, même quand il fait œuvre de critique ou de romancier. Peut-être vaut-il donc la peine d’« interroger, avec les moyens précaires de la critique », les rapports du poème et du miroir. Non en ce que l'œuvre est le reflet de l'homme : il y a là un lieu-commun qui, en admettant qu'il fût juste, vaudrait pour tous les poètes et ne nous rapprocherait nullement de la spécificité de l'écriture de René Guy Cadou. Or, mon pari est précisément que les phénomènes spéculaires sont parmi les principes organisateurs essentiels de sa poétique, au plan de la structure comme au plan sémantique ; que le terme « miroir » peut désigner approximativement une forme-sens qui permette non de démonter le poème, mais d'y pénétrer, alors même qu'une certaine simplicité, un certain naturel de « l’évidence poétique » (2) peuvent -comme dans le cas d'Eluard à qui j'emprunte l'expression-conduire à glisser à la surface.
Une telle investigation imposera de recourir à des poèmes complets : une recherche de phénomènes spéculaires est condamnée à l'échec si l'on isole quelques vers de ceux dans lesquels ils peuvent se réfléchir. L'inconvénient consécutif sera la limitation du nombre de textes, et que je ne pourrai démontrer en extension la prégnance de cette forme-sens, mais seulement inviter à une lecture de l'œuvre appelant sa récurrence et son enrichissement. En revanche, je ne m'interdirai pas de faire appel aux notes d'Usage Interne : la théorie que Cadou, ennemi des théories, construisait sur sa propre écriture était précisément un miroir qu'il lui tendait périodiquement, dont l'image déformante ou déformée se reflétait à son tour dans sa création à venir. Le titre et la chronologie d'écriture des notes (3) confirment ce fonctionnement dialectique, de même que l'Avertissement qui les précède :
Et puisqu'aussi bien la description du fusil précède le maniement d'armes, peut-être n'est-il pas inutile, le coup parti, le but manqué, de se pencher avec humilité sur son arme et de s'interroger sur les raisons de sa défaite.
Dans nos classifications culturelles, le nom de René Guy Cadou est associé à une poésie de terroir. Et il est vrai que des titres comme Bourgneuf en Retz, Terre natale, Saint Herblon, Loires, Les Amis de Rochefort, Entrée de village, Pour un cheval paraissent témoigner d'un ancrage que n'infirme pas la présence dans les poèmes de « frondaisons », de « campagnes désertes », d’« aubépine », de « vergers pleins de tourterelles », de « vent fragile », etc... Il semble que ce soir là une poésie de paysagiste qui ne décrit pas -ce serait faire injure à la notion même de poésie-mais donne à sentir un ordre du paysage auquel elle se soumet et qu'elle ne vise qu'à reproduire. Pourtant, une note d'Usage Interne nous met en garde :
Certains partent de la réalité pour aboutir à eux, gymnastique scolaire qui n'intéresse qu'une étendue restreinte de la pensée. Mais d'autres, à partir d'eux-mêmes, se créent une réalité plus durable, plus immédiate, et dont les bornes sont sans cesse reculées.
Il y a là un premier jeu de miroir. Quand René Guy Cadou se pose au milieu du monde, et écrit entre ces deux réalités une communauté de rythme, ce n'est pas « je » qui est le reflet du paysage -ou du moins cela n'est qu'un premier temps-, mais un paysage « plus durable, plus immédiat, et dont les bornes sont sans cesse reculées », qui est créé à l'image du «je» :
Si tu traverses les forêts de mon visage
Et les ronds-points de ma poitrine après minuit
Si tu es pris d'un grand courage
Et t'égares dans mes pays
Au bercement des oies sauvages
N'espère plus trouver ce qui t'avait conquis
Tous ceux que j'abritais tendrement sous mes lèvres
Et qui me répondaient lorsque j'avais trop faim
Les boisseaux de soleil qui coulaient de mes mains
Les vents alcoolisés qui me donnaient la fièvre
Tous les arbres venus s'appuyer à mon cou
Et les rouges cerviers du soir dans mes genoux
L'odeur de mes vingt ans emportée par les lièvres
Tout cela n'était rien puisque je vis encor
Il fallait me jeter sur le plancher du bord
Dépouillé de mes biens terrestres de mes armes
Peut-être aurais-je pu répondre de mes larmes
J'ai trop couru le monde à la suite des mers
Et lorsque je reviens m'accouder à la table
C'est pour trouver la même vague au fond du verre.
La vie rêvée - Le Temps perdu (4)
Au centre de ce poème se tient effectivement un « je » qui constitue son corps par un assemblage d'éléments empruntés au paysage en leur imposant un ordre qui n'a rien à voir avec leur situation d'origine. Cette primauté du corps se marque dans la construction même des comparaisons : le « visage » et la « poitrine » sont les comparés, non les comparants ; ces derniers, « ronds-points » et « forêts », sont des images virtuelles qui apparaissent dans le miroir de la nature. Toutefois, la situation spéculaire n'est pas immuablement figée : dans la seconde strophe s'échafaude, une dialectique d'échange par appui mutuel, chaque effet étant compensé par l'effet inverse. Ce qui est abrité sous les lèvres, prêt à être exprimé, est gaiement susceptible d'être absorbé. Si les « mains » répandent comme se répand « l'odeur des vingt ans » (mouvement contrifuge), les « arbres » et es « cerviers » convergent (mouvement centripète). Ainsi est mise en place une figure centrale du corps qui donne et reçoit, reflet des éléments de la Nature et en même temps ayant pouvoir de les redistribuer en les réordonnant. Organisation sémantique qui correspond à l'organisation syntaxique : «je» est au centre de son écriture. « Le poète se trouve placé au centre de son poème comme une araignée au milieu de sa toile » (Usage Interne).
Cependant, cette organisation spéculaire assez simple (deux miroirs, le corps et le paysage, se réfléchissant l'un dans l'autre) est mise en question par une autre quête d'image, celle que le « je» cherche dans le regard du « tu ». Pourtant, les verbes qui actualisent cette quête d'un second sujet semblent entrer dans le jeu du paysage reflété, puisqu'ils appartiennent au champ lexical du parcours : « traverser », « s’égarer », « trouver ». Mais précisément, au lieu de rencontrer la solidité d'un corps at du « je » qui l'habite, le « tu » crève le miroir pour se perdre dans un lieu sans contours qu'il « traverse », où il « s’égare », où il ne « trouve » rien. « Tout cela n'était rien », et pourtant « je vis encore ». Le second jeu de miroirs a détruit le premier.
Le poète doit poursuivre la quête de son identité en dehors de ses « biens terrestres », autrement appelés biens de ce monde (5), miroir dans lequel il s'est perdu, par lequel il s'est décrit, à l'image trompeuse duquel ceux qui l'ont aimé se sont laissé prendre, alors qu'ils auraient dû le briser : « Il fallait me jeter sur le plancher du bord ». S'il peut « répondre » de quelque chose, c'est de son désespoir que tout cela n'ait été qu'images : seules ses « larmes » lui appartiennent, et aussi la table à laquelle il revient s'accouder. C'est ici qu'intervient le troisième jeu de miroirs. Où a-t-il « couru le monde », sinon dans les errances de son écriture, qui pourtant lui renvoie toujours la même énigme : le « verre », le « vers », l'homophonie est aussi synonymie. Si l'on n'a rien trouvé dans les « pays » de son corps, au moins s'est-on laissé aller « au bercement des oies sauvages », ou au bercement sauvage d'un vers libre et cependant cadencé par la rime (6). Mais c'est toujours « la même vague au fond du verre ». Ce dernier système spéculaire est une prison : espace isolé dans l'espace, instant isolé dans le temps (le présent du dernier vers s'oppose à l'imparfait et au futur impliqué dans le « n'espère pas »), tête à tête du « je » avec lui-même qui reste en fin de compte sa seule preuve matérielle d'existence : « je vis encore ». Ce n'est même pas une satisfaction, seulement une « triste force » contre pose au milieu du monde, et écrit entre ces deux réalités une communauté de rythme, ce n'est pas « je » qui est le reflet du paysage -ou du moins cela n'est qu'un premier temps-, mais un paysage « plus durable, plus immédiat, et dont les bornes sont sans cesse reculées », qui est créé à l'image du « je » : laquelle on se révolte en l'affirmant :
Et tu brises dans le jardin des vieux des digitales
Pour bien montrer ta triste force et accuser
Ton refus d'être un homme et celui d'exister.
Hélène ou le règne végétal
Ce poème, « Je pense à toi Gilles né en dix neuf cent soixante-quinze...», nous amène à un fonctionnement plus complexe du même jeu spéculaire : quand le «je», non content d'attendre son image dans les yeux du « tu », tente de passer à la place de ce dernier polir se réfléchir en lui-même :
Je pense à toi qui me liras dans une petite chambre de province
Avec des stores tenus par des épingles à linge
Bien entendu ce sera dans les derniers jours de septembre
Tu te seras levé très tôt pour reconduire
Une vieille personne qui t'est chère avec son vieux sac de cuir
Tu auras bu dans tous les bistrots autour de la gare
Tu auras peur soudain et tu rentreras dare-dare
«Mon Dieu pardonnez-moi d'être sans volonté
«Je suis malade de luzerne et je fréquente les cafés
«J'ai bu bien davantage que de coutume des absinthes
«Mais Bernadette et Sœur Chantal sont mes Saintes»
Tu t'assiéras dans le jour maigre tu liras
Mes vers «O mon Dieu se peut-il que ce poète
«Me mette des douleurs de ventre dans la tête
«Que je m'enfante et que je vive en moi comme un posthume enfant
«Qui souffre de rigueur et renifle en plein vent»
Et le Seigneur dira Bénis soient de la gare
Les bistrots pour t'avoir redonné la mémoire.
L’Héritage fabuleux - Pour plus tard
Ici, le «tu» est placé à grande distance du «je», avec lequel il ne pourra communiquer que par la médiation de l'écriture. La «petite chambre» dans laquelle il est situé en évoque d'ailleurs une autre : pose au milieu du monde, et écrit entre ces deux réalités une communauté de rythme, ce n'est pas «je» qui est le reflet du paysage -ou du moins cela n'est qu'un premier temps-, mais un paysage «plus durable, plus immédiat, et dont les bornes sont sans cesse reculées», qui est créé à l'image du «je» :
Je pense à cette petite chambre de terre
Qui est mienne qui me convient exactement
Que j'ai louée sur la foi de bizarres affiches
Qui recouvrent partout les murs nus de ma vie
Hélène ou le règne végétal
Chambre funéraire pour un poème testamentaire. Bien des poèmes de René Guy Cadou le sont et de fait, le genre testamentaire est un genre spéculaire : projection au-delà de la barrière: de la mort d'une image de soi, mais rétroaction de cette image qui rééquilibre la vie en la jugeant, tant il est vrai qu'un testament est à la fois prévision et bilan. Ici, le «tu», défini comme autre, comme le «Gilles» vu il y a un instant, est une énonciation du «je», qui lui dicte par des verbes au futur sa conduite et son être selon des rites et des valeurs que nous savons par ailleurs être ceux de René Guy Cadou : l'accompagnement à la gare et la tournée des bistrots, la saveur des derniers jours de vacances (7), le lien viscéral à la nature de qui est «malade de luzerne». Autant dire que nous ne sommes pas surpris quand insensiblement le «je» passe dans l'image de lui qu'il a ainsi créée. Le passage est d'abord grammatical : le «tu» mis en situation d'énonciation devient à son tour un «je». Mais du coup, à la place de l'ancien «je» ne subsiste qu'un être lointain, abstraitement désigné par sa fonction, «ce poète». La vraie vie est maintenant du côté de celui qui a «des douleurs de ventre dans la tête». Mais qui est-il au fait ? Le «tu» du début `? Non pas : celui qui peut parler d'«enfant posthume» est le poète lu, celui qui au départ disait «je». Il y a eu déplacement du modèle à l'image et retour de l'image au modèle, parcours spatial qui peut se métaphoriser en parcours temporel d'un homme à la fois père et enfant, déjà mort et encore à venir : «Que je m'enfante et que je vive en moi comme un posthume enfant».
Mais le corollaire est que le «je» n'existe pleinement que s'appréhendant dans cette tension : ni contemplant ni contemplé, ni présent ni futur, mais au centre d'un échange spéculaire entre ces quatre miroirs. Cette expérience cruciale et éphémère, «entre avenir et souvenir» (8), n'est possible que dans le poème, qui a même statut que le «bistrot», qui est -humoristiquement métaphorisé- le bistrot, lieu clos où se concentrent projets d'avenir et besoin de permanence, lieu de convivialité et de dialogue entre un «je» qui contemple l'autre et des autres dans le regard desquels il souhaite exister. L'amitié n'est pas seulement une valeur pour René Guy Cadou, elle est son mode d'être au monde par un jeu de reflets pose au milieu du monde, et écrit entre ces deux réalités une communauté de rythme, ce n'est pas «je» qui est le reflet du paysage -ou du moins cela n'est qu'un premier temps-, mais un paysage «plus durable, plus immédiat, et dont les bornes sont sans cesse reculées», qui est créé à l'image du «je» : au centre duquel se conquiert l'identité :
Celui qui ressemble à tout le monde, ne ressemble à aucun autre
Usage Interne
Reste que le poème se clôt sur une situation spéculaire semblable à la précédente : c'est dans la solitude, face à une table où le verre joue le rôle de boule magique métaphorisant le poème, que le poète retrouve «la mémoire». Il ne franchit rien, il ne passe pas de l'autre côté du miroir, il est renvoyé à lui-même, et cependant ce réfléchissement lui a rendu plus que lui-même :
La poésie n'est rien que ce grand élan qui nous transporte vers les choses usuelles -usuelles comme le ciel qui nous déborde.
Usage Interne
Se mirer dans les choses, dans l'autre, dans le poème, et en ressurgir plus vaste, telles sont donc les trois expériences spéculaires constitutives de la démarche poétique de René Guy Cadou. Expériences douloureuses : le «je» s'y perd à chaque fois sans certitude de s'y retrouver. Expériences positives : parce que toujours en fin de compte «le ciel déborde», il retrouve plus que sa mise. Mais cette positivité n'est rendue possible que parce que le parcours de miroir à miroir s'effectue de façon linéaire, sans interruption qui renverrait l'écrivant à lui-même et ne lui ferait retrouver dans son écriture que ce qu'il y a mis, mais aussi sans fuite en dehors du circuit vers un monde transcendental :
Qui dit Dieu dit l'homme. Je ne conçois Dieu que dans l'homme. C'est assez dire que je ne crois pas aux miracles, mais en des vertus assez exigeantes pour que celui qui n'a pas choisi de passer, mais de durer se perpétue dans chacun de ses gestes.
Usage Interne pose au milieu du monde, et écrit entre ces deux réalités une communauté de rythme, ce n'est pas «je» qui est le reflet du paysage -ou du moins cela n'est qu'un premier temps-, mais un paysage «plus durable, plus immédiat, et dont les bornes sont sans cesse reculées», qui est créé à l'image du «je» :
De cette sacralisation de chaque geste, l'écriture poétique est évidemment un opérateur privilégié. Mais il faut pour cela que s'effectue en elle un dédoublement de l'expérience, et que la part spirituelle ne perturbe pas comme l'image épurée de la part matérielle, mais s'y réinvestisse tout entière pour la transfigurer. C'est le miracle de Sainte Véronique, auquel Cadou a consacré un poème (in Saint Antoine et compagnie) (9), la transformation de ce qui «passe» en ce qui «dure», et ce que je vais essayer de décrire comme le quatrième processus spéculaire.
Entre Louisfert et Saint-Aubin-des-Châteaux
Il y a un ruisseau qu'on nomme le Néant
On le traverse à pied sec
Les yeux secs également
Et l'on marche pressé dans cette nuit soudaine
Qui bave sur les bords
Qui fait mal aux pommiers
Vers un village épais comme un fond de citerne
Juste sous la gouttière de l'éternité
Ah ! que le vin est bon quand l'amitié propose
Qu'il est doux d'écouter et de humer le vent
Quand l'ami parle de canards qui se posent
Là-bas très loin à la surface des étangs
Et comme malgré soi on pense au Téméraire
Qu'on trouva un matin dévoré par les loups
Sur un étang gelé tandis que la lumière
D'un plafond gris et blanc tombe sur nos genoux.
L'Héritage fabuleux Entre Louisfert et Saint-Aubin
Lourdeur de la description géographique empêtrée dans les noms propres, du «il y a» : c'est l'ordre de l'exposé, ou de la promenade. Mais le nom qui claque au terme du second vers nous jette brutalement hors de cette réalité, et invite à une autre expérience dont le couple de vers suivant maintient le parallélisme avec la première : expérience sensible («à pied sec»), expérience métaphysique («les yeux secs»). Le poème continue alors «également» selon les deux trajectoires : la trajectoire géographique, où «l'on marche», à travers les «pommiers», vers un «village», où l'on boit en devisant avec un «ami» qui «parle de canards» sur les «étangs» ; la trajectoire métaphysique, qui nous conduit à un village «comme un fond de citerne», «sous la gouttière de l'éternité», et à l'étang funéraire du «Téméraire» (...) dévoré par les loups». Entre les deux, une douleur, celle du «mal aux pommiers» et du «comme malgré soi».
Arrive le dernier vers qui réunit l'ensemble en le resituant «l'étang» est miroir, il renvoie sa lumière, blanche comme la glace, grise comme les loups, au plafond qui à son tour la réfléchit : mouvement de bas en haut et de haut en bas, entre le «fond de citerne» et la «gouttière de l'éternité», dans lequel nous sommes prisonniers. «Téméraire» celui qui tente de franchir la limite et de s'aventurer au delà du «Néant» : le poème dit le désir et le risque de ce franchissement. On ne peut que parler -ou écrire- de ce qui est «là bas très loin», «écouter le vent» qui en provient, mais l'essentiel se passe «sur nos genoux». Figure du regard posé sur le poème, que nous avons déjà rencontrée à l'état brut, avec «les rouges cerviers du soir dans mes genoux», ou médiatisée par la table sur laquelle se fixent les yeux de celui qui scrute son écriture. Figure tellement essentielle qu'on la trouve même dans la correspondance :
La neige tombe. Je t'écris et c'est devant le poile de ma classe, sur mes genoux. (10)
Tous les espaces enneigés de tous les temps viennent se refléter dans l'instant présent et lui conférer leur éternité (1 1). Il a suffi d'accepter non seulement de se perdre, mais de tout perdre, de quitter «les yeux secs» le paysage trop réel du début du poème, pour en trouver le reflet multiplié dans le temps et l'espace, et fragile cependant de toute la précarité d'un reflet.
La création poétique (...) n'est pas dirigée dans l'espoir d'une survie, elle est dans son sommet cette survie même.
Usage Interne
Qui parle de survie parle de mort. Largement présente dans ce poème, elle l'était déjà dans la «petite chambre de province». Il n'est pas possible que son reflet n'apparaisse pas dans ce jeu de miroirs où le réel s'éloigne de plus en plus. Soudain, l'original vivant renvoie son reflet mort.
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Au beau milieu de la campagne un jour d'été
Des jeunes filles dans le wagon crieront
Des femmes éveilleront en hâte les enfants
La carte jouée restera tournée sur le journal
Et puis le train repartira
Et le souvenir de cet arrêt s'effacera
Dans la mémoire de chacun
Mais ce soir-là
Ce sera comme un arrêt brutal du train
Dans la petite chambre qui n'est pas encore située
Derrière la lampe qui est une colonne de fumée
Et peut-être aussi dans le parage de ces mains
Qui ne sont pas déshabituées de ma présence
Rien ne subsistera du voyageur
Dans le filet troué des ultimes voyages
Pas la moindre allusion
Pas le moindre bagage
Le vent de la déroute aura tout emporté.
Le Diable et son Train - Aller simple
Là encore, le point de départ est on ne peut plus réel, surtout si l'on pense que ce poème a été écrit peu après la période d'occupation, où les «arrêts brutaux» de trains étaient chose courante. Toutefois, comme nous l'avons déjà remarqué, l'ordre des représentations n'est pas imposé par l'événement : il n'y a ni continuité narrative, ni continuité descriptive, mais isolement d'éléments signifiants pour arriver finalement à la précision détachée d'une nature morte : la «carte jouée» qui reste «tournée sur le journal». Précisément, la nature est morte. «La campagne un jour d'été» s'est figée dans l'objet (artificiel) immobilisé. De qui, de quoi «le souvenir» «s'effacera»-t-il «dans la mémoire de chacun» ?
On ne peint pas de nature morte. On tente de limiter sur la toile ou sur la feuille un mouvement parfois à peine perceptible.
Usage Interne
Ce «mouvement à peine perceptible» va précisément être esquissé dans la deuxième partie du poème. A la différence du précédent, qui menait de front les deux parcours semblables et opposés (comme peut l'être une image qui inverse son modèle en le reproduisant), celui-ci nous tend successivement les miroirs. Le «mais» annonce la différence, alors que la réitération du vers «ce sera comme un arrêt brutal du train» dit la similitude. De fait, on retrouve le train, sa «colonne de fumée», le filet à bagages, ainsi que les plans successifs de la description : l'arrêt, les voyageurs, l'oubli. Mais ces éléments sont encore plus distendus, comme près de se dissocier : quel rapport de ressemblance y a-t-il entre le train et la petite chambre (12), la lampe et la colonne de fumée, ces mains qui sont les miennes et qui existent en dehors de moi ? Mais l'image, ainsi déréalisée, est dans un mouvement contraire chargée d'un surcroît de réel par l'insertion en son centre du sujet de l'énonciation sous la forme de «ma présence». Elle n'est plus événement flottant parmi l'infini des événements possibles, mais expérience existentielle. En même temps, cette seconde version contraint à réinterpréter la première, dont on est désormais sûr qu'elle était proposée comme un équivalent métaphorique de la mort : ce qui se dresse «au beau milieu de la campagne un soir d'été», c'est une tombe, et la «carte jouée» est une vie. Les forces de la vie (les jeunes filles, les enfants) prennent garde un instant à l'accident, puis le temps recouvre tout.
Mais ne nous y trompons pas : ni la première, ni la seconde séquence ne sont la réalité. Elles en offrent seulement une image : «ce sera comme». Le réel est autre, nul ne sait ce qu'il sera, le poète ne peut en offrir que des simulacres. Mais précisément, le seul acte réel est celui par lequel il nous les présente, la seule réalité est le poème, «miroir tremblant d'Orphée» où ne se lit qu'une certitude : je suis encore là pour écrire qu'un jour, «le vent de la déroute aura tout emporté», affirmation sur l'avenir qui répond -en miroir- à une affirmation sur le passé lue dans le premier poème : «Tout cela n'était rien puisque je vis encore». Le poète, en multipliant les reflets, les réfractions, les correspondances, dit en même temps son désir et son doute d'un accord du monde avec le monde et du monde avec lui, qu'on peut aussi bien appeler «amour», ou «Dieu» :
Tu ne me rendras point cet amour que j'avais
De la vie ni ce doute inné de Ta Personne
Qui fait que je suis là et que tu me pardonnes.
Les Visages de Solitude
Adresse à Dieu
On écrit d'abord pour se connaître, puis pour se reconnaître, enfin pour se disculper.
Usage Interne
Il y a là les trois étapes du parcours spéculaire : nous avons vu le «je» rencontrer son image virtuelle, puis passer derrière celle-ci pour se la renvoyer à lui-même. Nous le voyons enfin «se disculper» en les dénonçant toutes deux comme images, mais en les avouant comme désir. Nécessité d'un pardon toujours renouvelé pour une tentation toujours renaissante, preuve et conséquence d'un «être là» qui connaît au moins une matérialisation : le poème. Celui-ci n'est pas destiné à régir le monde, mais à créer, fût-ce fictivement, un ordre accordé à celui qui l'écrit.
Amis pleins de rumeurs, où êtes-vous ce soir
Dans quel coin de ma vie longtemps désaffecté ?
Oh ! je voudrais pouvoir sans bruit vous faire entendre
Ce minutieux mouvement d'herbe de mes mains
Cherchant vos mains parmi l'opaque sous l'eau plate
D'une journée, le long des rives du destin !
Qu'ai-je fait pour vous retenir quand vous étiez
Dans les mornes eaux de ma tristesse, ensablés
Dans ce bief de douceur où rien ne compte plus
Que quelques gouttes d'une pluie très pure comme les larmes ?
Pardonnez-moi de vous aimer à travers moi
De vous perdre sans cesse dans la foule
O crieurs de journaux intimes seuls prophètes
Seuls amis en ce monde et ailleurs !
Les Biens de ce Monde La soirée de décembre
Ce poème, écrit très tard (13), est pratiquement déserté par l'ordre du réel. L'écriture rassemble des signifiants disparates, fonctionnant par couples métaphoriques : «pleins de rumeurs» métaphorise l'amitié, «le mouvement d'herbe» le tremblement des mains, «l'eau plate» l'uniformité d'une journée... Pourtant, le champ lexical est cohérent, et serait susceptible de s'organiser en une isotopie de l'eau dormante, ou plutôt de sa surface, «eau plate», «morne» eau enfermée entre les «rives» d'un «bief» «ensablé», «désaffecté». Sous cette surface, une opacité animée d'un «minutieux mouvement d'herbe». Au-dessus, «quelques gouttes d'une pluie très pure». Mais l'énonciateur ne semble pas se soucier de rassembler ces fragments du miroir brisé pour parvenir à la cohérence d'une image. Son discours est ailleurs, non dans l'espace, mais dans le temps, par rapport au présent («où êtes-vous ?»), à l'avenir («je voudrais pouvoir»), Au passé («qu'ai-je fait ?»). La voix, pas plus que le regard, ne peut pénétrer la matérialité de ce monde opaque et chaotique à la surface duquel parviennent tout au plus quelques «larmes». Et cependant, sous la surface, une tentative parallèle de regroupement des fragments épars s'esquisse, «mes mains» cherchent «vos mains». Les deux activités sont le reflet l'une de l'autre, mais «l'eau plate» est un miroir à double face, elle renvoie à eux-mêmes le monde supérieur et le monde inférieur, tout en superposant les deux images de leur commun échec. Les mains ne trouveront pas les mains, la voix ne trouvera pas la voix. Celui qui dit «je» et parle d'amitié ne fait que se tendre un miroir à travers lequel il se contemple :
C'est à travers vos pas la lumière que j'aime
Au dessus des étangs le son de votre voix
Et je rejoins la nuit
Très tard
A contre-voie
La Vie rêvée
Les Amis de Rochefort
Le sujet est renvoyé à sa parole. Cela ne nie pas l'amitié, mais le contraint d'aimer ses amis «à travers lui», parce que le «journal intime» est, pour lui comme pour eux, la seule écriture possible. Mais elle est possible, et si la demande d'un «pardon» est réitérée, la valeur de cette «prophétie» d'un monde accordé à nos désirs n'en est pas moins proclamée.
La date et les circonstances dramatiques de ce poème ne doivent d'ailleurs pas faire conclure à une écriture désespérée. Si la conviction a été acquise que le poème ne peut pas refléter un ordre satisfaisant des êtres et des choses qui n'existe ni «en ce monde», ni «ailleurs» (c'est le sens du fameux «je ne suis pas métaphysique moi» (14), celui qui écrit est mû par l'espoir qu'il pourra offrir des images, des simulacres de cet ordre désiré, et que son poème sera le miroir dans lequel lui-même et son lecteur chercheront leur vérité. Il faut seulement être conscient de la fragilité du support matériel de cette vie rêvée (15) :
Le rêve, cette face nocturne de la pensée, alors que la rêverie n'en est que le masque, le rêve nous introduit directement dans la vie dangereuse.
Usage Interne
Remarquez ( ...) que je vous admire de faire de la poésie une arme alors que je ne sais même pas l'utiliser et qu'elle retourne sans cesse vers moi son tranchant.
Notes Inédites
C'est un message identique que délivre un poème assez antérieur au précédent (16) pour n'être pas suspect d'avoir été influencé par les mêmes circonstances biographiques :
Derrière le paravent du ciel n'est-ce
Pas qu'il y a des orangers en caisse
Et sur le sol un grand chapeau de jardinier
En grosse paille avec le fond troué
C'est tout à fait comme un soleil de fin d'hiver
Quelque part dans un vieux domaine désert
On pense à des cuisines fraîches comme la vie
La vie dans les quatre heures de l'après-midi
Et l'on voudrait monter dans la tiédeur des chambres
Lire auprès d'une jeune fille très tendre
Peut-être bien que ce serait le paradis
Les vieilles odeurs de terre de l'orangerie
On n'aurait jamais plus besoin de la mémoire
Les souvenirs viendraient comme une pluie du soir
Qui mouille à peine On resterait à regarder
Des mouches mortes et des poteries éclatées
Et tout au fond de soi mais maintenant très proche
On entendrait le bruit d'étoffe d'une cloche
Qui aurait mis des siècles et des siècles avant
D'animer les myosotis du paravent.
Le Diable et son Train L'envers du décor
Ici encore s'interpose entre le «je» et le monde rêvé un écran : «paravent du ciel», ruisseau nommé Néant, surface d'une eau dormante... Et le «n'est-ce pas» suspendu pathétiquement en fin de vers ne laisse aucun doute sur l'intensité du désir : il faut qu'il y ait «ailleurs» qu'«en ce monde» un autre monde qui lui ressemble et en même temps qui soit plus conforme à nos désirs. Désirs d'enfance et d'adolescence en l'occurrence, de l'époque où l'on adhérait à la vie en pleine confiance. Les contraintes du temps et de l'espace sont abolies : les soirées d'hiver se fondent dans les après-midi d'été, les plaisirs de la tiédeur et de la fraîcheur s'allient, du soleil et de la pluie, de la solitude et de la compagnie.
Et puis, on s'aperçoit que le chapeau est troué, que le domaine est désert, que le soleil est hivernal, que certains alexandrins boitent, que l'adjectif «vieux» est réitéré. Au fur et à mesure que l'on avance dans le poème, la débâcle se confirme, jusqu'à ce qu'on se surprenne à n'avoir sous les yeux que «des mouches mortes et des poteries éclatées». Fantôme d'orangerie dans un domaine fantôme, c'est notre propre mort qui s'esquisse dans ce miroir naguère séduisant, désormais figé dans le temps où nous n'aurons «jamais plus besoin de la mémoire».
Pas tout à fait cependant : le jeu de miroirs, continuant à fonctionner, nous donne l'image en nous préservant de sa réalité. Il nous est permis de ressentir doucement cette «pluie» de «souvenirs» que nous représenterons, morts, pour les vivants. Ainsi que dans Aller simple, «c'est tout à fait comme», mais ce n'est pas vraiment. Le monde de derrière le paravent a réfléchi l'image à venir de celui qui est devant, mais ce n'est qu'une image à son tour susceptible de transformations. De même que des miroirs qui se font face démultiplient l'espace, ils démultiplient le temps, et le «je» pris entre eux rêve simultanément son enfance et sa mort :
Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, doit en effet se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire par un phénomène de prémonition, se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore et sûrement deviendra.
Il est possible d'ailleurs que le moyen le plus sûr d'encourager l'avenir consiste pour le poète à retrouver en lui les vertus de l'enfance.
Le Miroir d'Orphée
Présence d'un Surromantisme
L'enfant se «souvient de l'avenir». Son conditionnel est un conditionnel d'avenir.
Notes Inédites
Ce n'est pas dans le monde d'ici ni dans l'autre, mais dans l'épaisseur de l'«étoffe» que s'opère cette alchimie temporelle qui concentre en un instant «des siècles et des siècles», au rythme d'un «bruit d'étoffe» qui, «tout au fond de soi», se confond avec les bruits du cœur (17). Et voici que cet espace, création d'un sujet, s'«anime» d'une vie propre, reflète tous les espaces et tous les temps rêvés, tous les souvenirs et tous les avenirs de la mémoire collective. Le poète n'est pas passé derrière le paravent, il n'y a d'ailleurs rien derrière, mais il en a fait le miroir de ses rêves, et le paravent s'est animé. Que le paravent soit la métaphore du poème est une évidence ; qu'il ne soit qu'un «journal intime» dont le poète demeure le seul «crieur», ou le seul «prophète», en est une autre qui modère singulièrement la portée du triomphe. Il reste que, âprement, il a conquis sa part d'éternité, un paravent dont les myosotis s'animent, une page dont les signes subvertissent l'ordre du signifié, un «miroir tremblant».
Si vous m'aimez oh ! que ce soit difficilement
Comme on aborde un pays disgracié !
Je ne révèle ma tendresse
Que par les épines des haies
Le Cœur définitif Amitié à Jean Jegoudez
Je ne revendique pour la lecture proposée qu'un mérite : avoir respecté cette difficulté. Avoir évité la promenade en surface, avec une impression de fraîcheur et de simplicité, à laquelle une certaine modestie voulue de cette poésie semblerait parfois inviter. «Le nom de Cadou : un bruissement d'eau claire sur les cailloux», a écrit, reprenant un vers de Tout Amour, Georges-Emmanuel Clancier (18). La formule est heureuse, elle est d'un poète, mais il faut la prendre comme telle : elle ne peut exprimer qu'une façon de ressentir, en aucun cas un jugement sur la technique d'écriture. Sinon, son prolongement naturel : celui de l'académicien Emile Henriot : «Il donne de l'élan à des mouvements où il y a peu de rigueur prosodique et de composition, poussant sa chanson devant lui comme quelqu'un qui chante en marchant. Il n'a aucunement le sens du choix et du sacrifice nécessaire. Ses pièces ne sont pas centrées» ( 1 9).
Centrés, tous les poèmes que j'ai présentés le sont au contraire. Non que la forme-sens spéculaire constitue une matrice, un patron selon lequel seraient bâtis différents exemplaires avec des variantes thématiques. Elle est à la fois structure de l'imaginaire et organisation de l'écriture, mode de représentation du réel et mode de création d'un autre réel, situation de l'énonciateur par rapport à son texte et par rapport à son destinataire. Nous voyons le poète interroger le reflet du monde en lui, son propre réfléchissement dans son écriture, la réfraction de l'un dans le multiple, de la vie dans la mort ; nous voyons une écriture jouer de ses capacités de superposition et de dédoublement, de ressemblance et d'inversion, tout en ne se manisfestant elle-même que comme simulacre si elle peut dire la totalité du désir, elle ne peut le faire advenir que sous la forme de mots tracés avec application sur une page (20). Je ne prétends pas avoir prouvé que le vecteur spéculaire soit le seul axe, ni même l'axe essentiel de la poétique de René Guy Cadou, mais seulement que dans les poèmes qu'il traverse, la diversité des réponses correspond à une unité de questionnement. Depuis Mallarmé, nous savons que c'est la marque du grand poète.
Notes
Un Sainte Véronique balayeuse de Wagons dont l'ancrage quotidien est forte ment accentué, le «visage du Voyageur» apparaissent au milieu des « journaux gras» et des «coques d'oeufs».
Tite d'un article publié dans Arts, 24-30 avril 1953.
Prélude à une poétique : le vers de Cadou, par Michel Decaudin
De Cadou, on a surtout étudié les thèmes, les images, peu le vers. On a parlé de l'enfance, de la nostalgie, de l'amour, du charnel et du divin dans son œuvre, de sa relation aux êtres et aux choses, de sa langue drue, simple, directe. Mais de l'écriture du poème et de ses techniques, rien n'a été dit, ou presque. Reste toujours à faire une poétique de René Guy Cadou, ou du moins à interroger les pratiques d'un écrivain peu prodigue en considérations théoriques : entreprise de longue haleine, dont il ne sera fait ici qu'une première et élémentaire approche.
Un poème (et cela est vrai aussi de la plupart des poèmes en prose), c'est d'abord une surface typographique, une occupation de la page, une alternance de lignes plus ou moins longues et d'espaces blancs. Le premier contact avec un recueil de Cadou fait apparaître une prédominance de poèmes relativement courts -une trentaine de vers- se répartissant selon leur aspect en deux catégories : d'une part, des pièces d'une seule coulée, de l'autre, pouvant se réduire au simple distique. Une seconde observation s'impose : les vers sont aussi bien de longueur sensiblement identique que très inégaux dans une même séquence : ce qui, dans nos schémas prosodiques, fait immédiatement penser à une utilisation tantôt de vers réguliers, tantôt de vers libres.
La lecture affinera, évidemment, ces approximations grossières. Le premier poème d'Hélène ou le règne végétal, «La Fleur rouge», se compose de douze quatrains de vers de six syllabes : mais cette organisation d'une apparence parfaitement canonique s'arrête au système des rimes. La première strophe,
A la place du ciel
Je mettrai son visage
Les oiseaux ne seront
Même pas étonnés
n'est pas rimée. On pourrait, à l'audition, la percevoir comme un distique d'alexandins :
A la place du ciel je mettrai son visage
Les oiseaux ne seront même pas étonnés
perception renforcée par le découpage grammatical. Seul l'aspect sur la page donne le ton et impose un mode de lecture. Dans la deuxième strophe, premier et troisième vers riment, tandis que le deuxième et le quatrième sont assonancés en n :
Et le jour se levant
Très haut dans ses prunelles
On dira «Le printemps
Est plus tôt cette année»
Même jeu de rimes et d'assonances dans la troisième :
Beaux yeux belle saison
Viviers de lampes claires
Jardins qui reculez
Sans cesse l'horizon
mais, cette fois, la rime est aux premier et quatrième vers, l'assonance aux deuxième et troisième, et une assonance subtile, puisque claires et reculez présentent la suite de consonnes c-1-r et sa variante inversée r-c-l.
En somme, les trois premières strophes, loin de nous apporter un réseau de rimes cohérent, en rapport avec la forme de la strophe, nous offrent trois modèles différents. Soit, si l'on désigne les rimes par A, B, C, etc., les assonances par A', B', C', etc., l'absence de rime par O : 0000 AA'AA' AA'A'A.
L'analyse des strophes suivantes donne des résultats conformes à ces premières remarques. Rimes, assonances, fins de vers non rimés s'entremêlent et se répondent sans ordre ; et cela, non seulement dans une seule strophe, mais en débordant sur plusieurs. Dans la septième, le premier et le quatrième vers riment, mais point le deuxième et le troisième : AO0A. Dans la huitième, ni rime ni assonance : 0000. Cependant, si nous considérons globalement ces deux strophes, tout change. Si l'on admet que le poète du XXè siècle ne distingue plus rimes masculines et féminines, fait rimer un singulier et un pluriel, voire un e ouvert et un e fermé, nous obtenons l'entrelacement ABCA CBOA :
Qu'un enfant attardé
Passe la porte ouverte
Et devinant la joie
Demande à me parler
Pour le mener vers moi
Deux mains se sont offertes
Si bien qu'il a déjà
Plus qu'il ne désirait
Autrement dit, chaque strophe, prise séparément, laisse l'impression que domine l'absence de rimes, alors que leur succession révèle sept vers rimant sur huit. Phénomène analogue dans les deux strophes suivantes, qui donnent : ABOA OBOA (ajoutons qu'en O s'envole et or font écho en o).
Tout se passe comme si, à la netteté formelle du poème (rappelons : douze fois quatre vers de six syllabes), répondait une variation continue des signaux de fin de vers, comme s'il s'agissait pour le poète, sollicité par les attraits d'une cadence canonique, de ne pas s'y laisser enfermer, mais de concilier les séductions de l'ordre et celles de la liberté.
Exemple inverse, mais conduisant aux mêmes conclusions, que celui du poème suivant, «Chambre de la douleur». Il a une allure de poème en vers libres. Mais des vers libres qui n'écartent pas la rime : d'abord un distique (hexasyllabe + alexandrin) rimé (ferméeclé), puis, après un blanc, trois séquences de cinq vers chacune, la première en vers libres rimés AABBA, les deux autres en octosyllabes, l'une rimée de la même façon en CCDDÇ la dernière introduisant la variante EEFEF ; enfin, terminant le poème, une séquence de sept vers libres, deux seulement rimant, qui, en réalité, sont un découpage selon le sens et la grammaire de quatre alexandrins, deux rimant, deux assonançant :
Jamais plus les oiseaux n'entreront dans la chambre 11
Ni le feu
Ni l'épaule admirable du soir II
Et l'amour sera fait d'autres mains
D'autres lampes 1 1
O mon père
Afin que nous puissions nous voir.
(Les barres obliques jalonnent les mesures d'alexandrins.) Structure foncièrement ambiguë, où une forme en porte-à-faux (le distique boiteux et cependant fortement construit du début) se met en cause d'abord timidement (même jeu de rimes pour la première et la deuxième séquences de cinq vers, même mesure de vers pour la deuxième et la troisième), ensuite plus profondément avec la double lecture possible de la fin ; tension entre exigence de structuration et tendance à la déstructuration, jusqu'au mot ultime qui récupère pour la rime un alexandrin désarticulé.
«La Maison d'Hélène» est composé de quatre suites d'alexandrins (à l'exception du premier vers, qui n'a que dix syllabes, ou onze si on fait la diérèse lierre) : 7, 8, 4, 4. Les rimes se succèdent ainsi : AABBCCO DDEEFFOF GGOG HHOH. Il est clair que nous avons ici la juxtaposition de deux régimes : rimes plates de la première séquence et de la moitié de la deuxième (interrompues au septième vers par l'unique mimosa), quatrains sur une seule rime (le troisième vers, lui, ne rimant pas). A la division en séquences marquée par les blancs s'ajoute ainsi (s'oppose) une division selon les rimes en deux parties sensiblement égales : les onze premiers vers, à rimes plates (sauf un), les trois quatrains en AAOA qui suivent.
A ce point de notre enquête, quelques remarques sont déjà possibles. Peu importe à Cadou d'utiliser ou non la rime et, s'il le fait, de respecter les règles traditionnelles. Quelle que soit la forme de vers requise, l'organisation de la strophe, imprévisibles sont la présence de rimes ou d'assonances, leur répartition, la longueur et la cohérence des séries. Imprévisibles, mais non soumises au pur hasard de la fantaisie. Si la rime n'est plus la borne nécessaire qui marque la fin du vers et sa liaison avec la suite, elle n'en reste pas moins un élément de structuration, non simple repère, mais entraînement dynamique. La fixité de la prosodie canonique fait place à un système à fonctionnement variable et à auto-engendrement. Cela donne au poème une texture double, à la fois rigoureuse et souple, également éloignée de la codification classique et de l'anarchie qui s'est développée depuis un siècle dans l'écriture poétique ; mais étrangère à l'esprit de subversion simultanément apparu, car cette œuvre est toute d'accueil et de don, non de révolte ou de refus.
Pareille ambiguïté se retrouve dans l'organisation des mètres. Certains poèmes sont de ce point de vue absolument réguliers, avec des vers et des strophes d'une construction sans faille. Mais, nous l'avons déjà observé dans «La Maison d'Hélène», des variations s'introduisent à l'intérieur des moules. «La Solitude» compte vingt octosyllabes, d'une seule venue, solidement organisés en forme de litanie : les prépositions avec, sur, dans, répétées en tête de vers, soulignent et renforcent cette construction. Dans une trame aussi serrée, n'est-il pas surprenant de constater qu'à trois reprises les vers n'ont que sept syllabes ? Pour l'un d'entre eux, une explication vient aisément. Il s'agit en effet du dernier vers du poème :
(...)
Avec toi qui me dissimules
Sous les tentures de ta chair
Je recommence le monde.
Comme dans «Liberté» d'Eluard, dont cette «Solitude» peut passer pour une récriture, toute l'énumération lancinante est construite pour amener le ou les mots de la fin, qui lui donnent un sens : Liberté ici, Je recommence le monde là. Et, comme la clausule de trois syllabes «Liberté» met brutalement fin à un rythme vingt fois repris de trois vers de sept syllabes suivis d'un de quatre, l'anomalie du dernier vers de «La Solitude» ferme le poème (et en même temps l'ouvre, si on pense à la signification, «je recommence», et au caractère d'inachèvement que le vers impair revêt pour une oreille française). Mais les deux autres ? On allègue trop facilement la négligence, voire la maladresse de Cadou, qui le conduiraient à laisser passer des vers faux. Mais comment peut-il y avoir des vers «faux», sinon dans un système normatif dont, précisément, notre poète semble se désintéresser ? Contentons-nous donc, pour l'instant, de relever le fait que, sans raison apparente, deux vers de sept syllabes se sont glissés dans une séquence octosyllabique.
Plus frappant est le cas de «Mourir pour mourir» : neuf distiques, isolés par des blancs, presque tous en alexandrins rimés (sauf un Verlaine blême, assonance en 1 et écho assourdi n m). Presque, car on bute dès le troisième vers sur onze syllabes :
Comme une photographie très ancienne qui glisse De l'album sur un tapis de haute lice
et, plus loin, sur :
Qu'en dites-vous Isidore Ducasse et toi Rimbaud
ainsi que :
Bien sûr tu te tapes encor sur les cuisses.
Il est toujours dangereux de prétendre corriger un poète. Mais comment ne pas penser, ici, qu'une impérieuse pression de la mesure aurait pu le conduire à écrire :
Qu'en dites-vous Lautréamont et toi Rimbaud
et, dans le dernier exemple, substituer à encor la graphie normale encore (à supposer, hypothèse toujours possible, que nous ne soyons pas en présence d'une coquille répétée d'édition en édition) ? Tout se passe comme s'il y avait eu, dans le premier cas, renoncement à un alexandrin de coupe ternaire, comme celui qui viendra au distique suivant :
Et toi Laforgue et toi Corbière et toi Verlaine
et dans le second véritable détournement de la licence poétique encor, puisque, loin d'éviter le vers «faux», elle le crée. Ainsi un système nettement défini, le distique alexandrin rimé, s'accommode d'une absence de rimes et de trois vers non conformes : comme pour la rime, un régime dominant semble engendrer (au lieu de les exclure) des variations qui s'incorporent sans le mettre en cause.
Une confrontation de tous les poèmes en distiques ne manquerait pas d'intérêt. Elle mettrait en lumière la constance d'une poétique qui ne se préoccupe pas de la notion de perfection formelle, mais donne toute sa force à la dynamique entraînante d'un mètre.
Quant aux poèmes en vers libres, ils développent fréquemment des groupes rythmiques qui rétablissent, en partie ou en totalité, des vers réguliers. Nous l'avons déjà remarqué à propos de «Chambre de la douleur». Dans «Aller simple», poème de la déroute de la vie, on pouvait s'attendre à une déroute conjointe du rythme dans un vers libre invertébré. Or, c'est le contraire qui se produit. Après avoir claudiqué pendant quinze vers, comme s'il ne trouvait pas son équilibre, le poème se stabilise dans les quatre derniers sur une mesure d'alexandrin ou de demi-alexandrin :
Dans le filet troué des ultimes voyages
Pas la moindre allusion
Pas le moindre bagage
Le vent de la déroute aura tout emporté.
Une cadence qui connote une certaine sérénité, déphasée par rapport à la tonalité générale du poème, comme elle-même est, d'une certaine manière, déphasée par rapport aux quinze premiers vers. Point de hasard, donc, ni de négligence, mais un subtil dialogue du sens et de la forme, qui requiert ce fonctionnement variable et cet auto-engendrement déjà observés dans l'emploi de la rime.
S'il a le goût du vers qui se suffit à lui-même (non le «beau vers» parnassien, mais celui qui formule une idée, une image, qui a son unité grammaticale), Cadou connaît aussi un type d'énonciation qui semble courir de vers en vers et, dans son mouvement coulé, atténue jusqu'à presque l'effacer leur découpage. C'est la fin de «Cavalier seul» :
J'ai fait du grelot noir des nuits une belle âme
Qui tinte ; est-ce voler que de prendre en ses mains
Des fleurs et de crier : ceci est le levain
De toute vie ; est-ce voler que de confondre
Amour avec amour ; est-ce voler encor
Que de coucher son nom sur le livre du port
Lorsque le voyageur ne partira jamais ?
Encore l'alexandrin se retrouve-t-il dans la résolution des derniers vers. Dans «La Haie longue : 1 km», en revanche, la longueur de la phrase répond à la longueur du chemin :
Toi dont la jambe traîne un peu comme une brume
D'été et comme si la douleur te tirait
Lentement vers la terre ô compagnon que j'ai
Choisi pour les yeux, enfin voici que s'allume
Toute ma vie et que je vois l'éternité
Pareille à ce pays mouvant où tu t'enfonces
Avec ta jambe un peu trop lasse dans l'été
Sous les sourcils trop bleus de la nuit qui se froncent
(..
Six strophes de quatre alexandrins rimés (à l'exception de l'assonance illes inaccessibles), qui, pour plus de la moitié, sont construits sur des enjambements (dont deux de strophe à strophe). C'est toujours la double sollicitation dans laquelle s'accordent, plutôt qu'elles ne se combattent, es cadences canoniques et celles dont le poète est le seul maître.
Une perspective historique, prenant en compte le développement de l'œuvre, ne serait pas inutile. Elle permettrait, entre autres choses, de lieux cerner la sollicitude du poète pour les vers courts, de six, huit syllabes, ou de nous interroger sur une prédilection, dans la fin de sa production, pour un vers qui s'allonge au-delà de nos mesures traditionnel-es, comme l'ont parfois pratiqué Apollinaire ou Cendrars. Il est utilisé
dans «L'Enterrement d'Apollinaire», précisément, ou dans «Vieil Océan», ont on citera le passage central :
Tous les canons de Notre-Dame ne sont rien si l'on compare à ta puissance
Et le chœur du tonnerre n'est qu'un timbre distrait dans la salle d'attente du silence
Mais quel amour dans vos yeux de colchique ô troupeaux qui paissez la mer
Principauté d'un Dieu Unique et seul Transactionnaire !
Il est temps d'interroger Cadou lui-même. Peu prodigue en confidences, il nous dira :
Appuie de toutes tes forces sur le champignon de la beauté sans rien savoir ( «Art poétique»)
Est-ce que je sais seulement ce que j'écris ? Mais je vais Au bout de ma vie comme d'une route mal percée ( «Ecrire mais vivre»)
ou encore dans la préface à Hélène ou le règne végétal :
Je n'ai pas écrit ce livre. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer, comme un muet, l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du monde.
Il semble que la poésie s'arrête pour lui au seuil de l'écriture, que la fabrication du poème ne compte pas. Si cependant il lui arrive de parler de son vers, c'est pour le montrer allant «de guingois». C'est pour lui l'occasion de récuser la «rigueur mallarméenne» qu'il «exècre» et de se réclamer d'une autre rigueur, celle de Reverdy, qu'il définit comme «le raccourci poignant, l'image de guingois, la phrase comme un morceau de rail luisant où l'esprit haut-le-pied dérape». Mais, à la différence de Reverdy créant sa propre forme, poème en prose ou vers libre, Cadou s'inscrit dans la lignée des poètes du XXè siècle qui, avec Apollinaire ou Supervielle, par exemple, ont rénové ou adapté à leur modernité les structures données par la tradition. A sa poésie qui est toute accueil, réception, nullement révolte (quoi qu'il en ait dit) ou subversion, répond une écriture qui est elle-même accueil, ni soumission ni refus, absence de système niais non anarchie, réinvention de la relation forme-sens : c'est là que la poétique de Cadou trouve sa source, et forge son originalité.
La terre promise de Fombeure à Cadou, par Edmond Humeau
Si je devais prendre appui sur la concordance qui unit Maurice Fombeure à René Guy Cadou que trente années séparent, le temps d'une génération authentique, j'aurais recours à deux exemples que je tire de leur révérence commune à Jules Supervielle et de l'attitude que Fombeure eut à l'égard de René Char alors que la vision de Cadou accorde à Pierre Reverdy autant qu'à Max Jacob l'ascendant, le point focal de lumière où la modernité se loge à la frontière de la poésie et de la religion en la terre promise de leur chant parallèle en Occident.
Je m'expliquerai sur cette recherche de la terre promise dont le terme biblique est certain et paraît aussi paysan que nos terroirs, nos terrains de l'ouest en métairies, de Sainte-Reine-de-Bretagne à Jardres en Poitou, mais auparavant j'en viens aux rapports que Fombeure et Cadou eurent avec Supervielle.
Pour Maurice Fombeure, c'est Julien Lanoë qui le découvrit dès la première année de La Ligne de Coeur en 1925, comme il l'écrit, cinq ans après, dans la préface à Silence sur le toit. Fombeure avait alors 19 ans; surveillant à l'Ecole Normale d'Instituteurs à Bourges, Lanoë n'était son aîné que de deux ans, fondateur de la plus prestigieuse revue de littérature et de poésie que l'Ouest ait connue mais dont le rayonnement s'étendit
de Nantes sur la France entière. Le portrait que Julien Lanoë trace de Fombeure après leur première rencontre à Poitiers, «deux ans de correspondance et un long travail d'imagination », manifeste son émerveillement total :
«Son visage taillé avec force traduit un élan obstiné qui ne se divise pas. C'est un cœur de chêne, plein d'une sève moelleuse, fraîche et puissante, un corps d'arbre visité par les oiseaux et nerveux jusqu'au bout des branches. En le dépeignant, je n'ai cessé de rendre compte de son œuvre écrite. Il projette ses poèmes devant lui comme son ombre. Je ne connais pas de filiation plus directe naissance naturelle de la Poésie, imitant Vénus sortie de la mer. Poésie jaillie tout droit du sol ferme, à la manière des fleurs. Tendre effort de la terre lourde. Equilibre de la grâce.»
En note, Lanoë ajoute :
«Il m'en voudrait si je ne disais combien l'ont servi l'amitié et les exemples de Max Jacob, par qui je le connus, d'André Salmon, de Jean Cocteau, et combien il a profité de la lecture de Reverdy, de Supervielle, sans compter le secours de trois siècles de poésie française depuis Villon jusqu'à Baudelaire».
Lecture profitable de Supervielle, certes. J'en trouve la preuve dans Présence et grandeur de Supervielle qu'il donna à Pierre Boujut en 1938 pour ce vingt et unième numéro de Regains qui fut la première Reconnaissance à Supervielle publiée en France. Comme ce numéro, antérieur à La Tour de Feu dont le premier cahier Silence à la violence porte le nombre vingt-quatre après la césure de la deuxième guerre mondiale, doit être oublié, je cite le texte.
Présence et grandeur de Supervielle
Il y a longtemps que je n'ai pas vu Supervielle mais je me sens souvent accompagné de sa grande ombre familière. Grande, ah combien ! C'est un arbre, un pan de mur qui se déplace, un rocher de la Cordillière des Andes, ou bien cette Girafe lécheuse d'étoiles dont il parle dans Gravitations. Et sa poésie est à son image grave, fervente, abrupte parfois. Avec la grâce, la douceur et la bonté des géants affectueux qui brillent dans ses yeux clairs, si tendrement, si douloureusement humains.
Rencontres au mariage de notre ami Julien Lanoë, tandis que sonnaient les grandes orgues de la Chapelle des Invalides. Chez lui, au quarante-sept boulevard Lannes dont il a exprimé la «métaphysique». Sorties dans Paris avec Henri Michaux, le grand poète des inquiétudes et des tourments indicibles mais que lui seul sait dire. Chez le peintre Lurçat nous avons bu du rhum blanc sous les tableaux rigoureux et admirables de clarté.
Il est bien inutile de chercher à séparer l'œuvre de l'homme lorsqu'on connaît les deux. Cette vieille distinction, venue de la mécanique scolaire, n'a jamais eu sa raison d'être. Et, en ce qui concerne Supervielle, elle ne-doit plus exister. En effet, et toujours, il porte en lui ces grandes images qui bouleversent les terres, le ciel et les océans, les rapprochent les uns des autres au mépris des gravitations établies par les savants et les mêlant dans une danse profonde et solidement ordonnée. Avec lui, les étoiles, les planètes, les nébuleuses sont descendues parmi nous. Ou plutôt, sans effort apparent, mais dans un immense arrachement silencieux, elles sont entrées dans la poésie. En la grâce d'un magicien qui a mis toutes ses forces à explorer à sa manière non seulement notre monde sensible, mais des mondes inconnus. Et puis les bêtes de l'arche de Noë, au complet. Le grand souffle des Andes, la solitude des pampas argentines où sa nostalgie galope en liberté. Le tout s'élève et prend vie dans une chanson un peu triste mais puissante et douce comme un cœur.
Ces immensités découvertes, ces cosmogonies fulgurantes d'étoiles, ruisselantes de fleuves, frémissantes de forêts secrètes n'abolissent jamais l'homme. L'homme, faible et perdu, mais désespérément conscient, comme dans Pascal, de ce qui fait sa grandeur et sa dignité. Les pans de murs, les solitudes, les tempêtes et les méridiens ne sont plus rien lorsque souffle son amour. Tout fond comme neige devant un peu de la bonne chaleur humaine :
Qu'importe en sa longueur l'Océan atlantique ?
Les champs, les bois, les monts qui sont entre nous deux ?
L'un après l'autre un jour il faudra qu'ils abdiquent
Lorsque de ce côté tu tourneras les yeux.
Parfois cependant le poète aspire à se mêler à ce chaos du monde, à n'être plus qu'une paix de pierre
Montagnes et rochers, monuments du délire,
Nul homme ne nous voit, écoutez sans détours
Mon cœur grondant au fond des gorges et des jours
Et comprenez mes yeux gelés de rêverie.
Mêlons-nous sous le ciel qui n'a pas de sursauts
Que je devienne un peu de pierraille ou de roche
Pour t'apaiser, cœur immortel, qui me reproches
D'être homme, courtisan d'invisibles cordeaux.
Mais il faudrait des pages et des pages pour essayer d'énumérer seulement les richesses et les résonances. de cette poésie à nulle autre pareille dans sa démarche sûre et franche.
On parlera sans doute dans cet hommage de l'influence de Supervielle sur les jeunes poètà. Eh bien, à vrai dire, je n'y crois pas à cette influence. Malgré le ton humain de ses vers, malgré sa frémissante sensibilité, Supervielle reste toujours un peu démesuré. Il porte avec lui ses Andes et l'immensité des pampas. Sa gaucherie géniale. Sa lourdeur étoilée. C'est si j'ose risquer cette image -une espèce de plésiosaure de notre poésie. Il ne ressemble qu'à lui-même. Il est essentiellement autre, c'est bien pourquoi nous l'aimons.
Oui, nous l'aimons ce «plésiosaure de notre poésie» et c'est à cet .amour ancestral et familier que Les amis inconnus de Supervielle ont donné leur ferveur, au moment de survivre aux gigantesques métamorphoses le notre petite planète. Reconnaissance à Supervielle par les jeunes d'aujourd'hui, titrait Pierre Boujut, ce rassemblement d'essais et de poèmes où e trouvent associés aussi bien René Lacôte, Etiemble, Léon-Gabriel Gros,
Miatlev, Julien Lanoê, Armand Guibert, Gaston Diehl, Louis Emié, ean Rousselot, Armand Robin, Michel Levanti, Henri Bosco, Roger Lannes, Armand Bernier, Louis Guillaume, Marcel Béalu, Christian Sénéchal que trente autres mais je n'y trouve point le témoignage de René Guy Cadou qui avait cependant publié dans le numéro précédent de Regains une curieuse prose poétique : Le crime de Morphée et Pierre Boujut, dans ce vingtième numéro où Jean Rousselot donnait un article sur deux vers e Supervielle, annonçait la mise à l'étude de cette reconnaissance et invitait les amis à préparer et envoyer «leurs conseils, leurs témoignages ou leurs critiques».
Il est vrai qu'en 1938 René Guy Cadou avait tout juste dix-huit ans et si j'en crois Le Miroir d'Orphée correspondait déjà avec Max Jacob et que son premier article sur Pierre Reverdy est publié par la revue d'André Silvaire, Les Lettres, no 7, en mars 1946. A vingt-six ans, Cadou est reconnu par Michel Manoll depuis dix ans, Manoll qui le découvrit comme Cadou le reconnaît dans le texte de l'entretien avec Pierre Béarn qu'il écrivit à Louisfert le 20 septembre 1950,
«Manoll que je connus à Nantes alors qu'il était libraire et que je portais des culottes courtes, entreprit de me désintoxiquer par un nouveau poison. Il m'ordonna Musset et Marceline, aggravés de fortes doses de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautréamont, Corbière, Laforgue, Toulet, Apollinaire. Il y avait dans la boutique de Manoll, la première fois que j'y pénétrai, un poète nominé Frank Martin, homme sandwich de son état. Assis à califourchon, sur une chaise, le visage bizarrement retroussé par la fumée d'un mégot, celui-ci déclamait en pianotant sur la machine à écrire : «Nous chanterons encore même si vous nous étranglez, salauds I». Cette phrase, aussi, pour un garçon de quinze ans, était singulièrement dangereuse. Très rapidement, Manoll me mit en relations avec Reverdy et Max Jacob à qui j'adressai mes premiers poèmes. Aussi ne dissimulerai-je pas l'influence que ces deux admirables génies ont exercée sur ma formation poétique.»
Fort bien mais je ne relève pas le nom de Supervielle dans cette confession de 1950 reproduite par Le Miroir d'Orphée où Cadou avoue qu'il doit bien davantage aux romanciers qu'aux poètes. Péché d'omission ? Cet oubli m'inquièterait au moment où il déclare :
«Que diable ! La poésie ne commence pas à Rimbaud, encore moins Apollinaire, ou Eluard, ou surtout pas Prévert. Il faut avoir été romantique à quinze ans, pour se permettre d'être Michaux à quarante ans ou Max Jacob à soixante [...] Villon n'est pas si méprisable, ni d'Aubigné, ni Hugo, ni Corbière, ni Laforgue, ni Verlaine, ni Jammes.»
J'attendais Supervielle puisque j'avais reçu ce poème premier de la collection Le Miroir d'Orphée édité par Sylvain Chiffoleau à 300 exemplaires et qui justement se nommait Lettre à Jules Supervielle de René Guy Cadou, écrite à Louisfert en novembre 1947, neuf ans après Présence et grandeur de Supervielle du «charmant Maurice Fombeure» que cite alors Cadou parmi d'excellents poètes engagés comme Guillevic dont l'œuvre, écrit-il, a l'authenticité de celles de Rousselot ou de Follain, mais nous étions alors en 1950. Le charme a glissé comme un écureuil pour le poète qui, recommande Cadouj «se doit d'écrire pour des oreilles poilues». Voici donc :
Lettre à Jules Supervielle
Je pense à vous ce soir Jules Supervielle
Je pense à vous et c'est l'automne en ce pays
C'est toujours à tort que l'on parle l'amour en tête
Mais je vous parle Jules Supervielle
Entre nous de longs enfants des filles de préférence
De grandes journées en Uruguay
Les flammes de la pampa
Je pense aussi à Oloron le gave lèche les pierres
J'y fus voici combien d'années
C'était à la Maison Pommé
Il y mourait des jeunes gens
J'aime ces pays dont vous parlez et qui ont l'allure des femmes
On dit que les chevaux s'emballent
Comme un foulard à la portière du wagon
Pardonnez-moi Jules Supervielle je devais écrire un article
Où j'aurais dit la grande la douce solitude de vos écrits
Et je me laisse soudain aller à quelque chose d'informe comme un poème
Simplement parce que j'ai vos livres sous les yeux et que je vous aime
Ah voyez-vous c'est difficile de s'interdire
Dans cette vie quelques minutes de loisir
Et de parler à cœur ouvert à un ami qui vous ignore
Comme on peut avec les ridicules moyens du bord
Je me suis dit ce soir après l'école ne tarde pas
Il y a un ami qui t'attend
Il est là-haut dans ta chambre avec toutes sortes d'animaux
J'entendais un grand pas partout dans la maison
Et vous marchiez peut-être à ce moment dans la rue Vital
Ou dans un chemin creux de Saint-Germain-la-Forêt
Qui est sûrement un patelin merveilleux
J'ai dit parlant aux ombres qui voyagent Voici la pomme et la statue
Et voici Jules Supervielle
Ah vous voici cher Supervielle dans le miroir à peine éclos de la fenêtre
Ecartelé avec ce monde qui bat en vous sur le côté
Voici Jules Supervielle dis-je et clans la certitude obscure de demain
Enfin voici un grand bonhomme sur le chemin
Une silhouette jeune comme le vent et la luzerne
Voici la haute lanterne là-bas dans le domaine du cheval
Voici l'auberge le rendez-vous de tous les jours et le festin le plus original
Ah saisir Et rien n'échappe à ce grand corps qui se redresse
Aussi haut que la pomme et le sein des déesses
Dans l'étendue lunaire et sans spectacle
A vous seul comme vous en faites des miracles
Bien sûr vous n'attendez rien de moi
Car l'on n'attend rien de personne
Je vous écris depuis longtemps
C'est un bonheur de vous écrire
Il semble un peu qu'on se rapproche de ces pays qui n'ont de sens qu'à travers vous
On marche aux pas des animaux faciles
Parmi tous les amis connus et inconnus
Il y a celui-là si grand qui nous rassemble
L'homme pareil à l'Homme
La trouble effigie
Et malgré tout je n'ai rien dit de mon amour Jules Supervielle
Louisfert, décembre 1947
J'ai choisi de faire référence à ces deux textes de révérence et amitié, fort significatifs de la déférence différentielle entre les deux poètes ; à l'égard de Supervielle pour approcher de ce que je nomme la terre omise de Fombeure à Cadou, la promesse d'une terre échappée des misons que la poésie assure en innocence, d'une génération à l'autre et c'est en la même terre de poésie qui se veut aussi contagieuse que la bonté.
Rien de plus moderne en poésie que l'apparition de la bonté en temps où l'on n'ose plus s'apercevoir de la méchanceté dont les poètes respirent avec délectation et parfois même avec dilection Les Fleurs du Mal. Charles Baudelaire savait fort bien que la lutte des âmes s'accomplit à travers les mensonges des apparences où le Mal démoniaque se donne pour béatitude céleste du Bien et qu'il appartenait aussi aux poètes de «délimiter les traces du Péché originel». Au sens même de Saint-Just, «Le bonheur est une idée neuve en Europe» et nous avons vu les ravages terribles de cette idéologie en faits de guerre civile entre les nations qu'elle engendre. La Terre Promise s'élève dans l'imagination des poètes qui attendent d'elle que la transfiguration des lieux sous le ciel de notre planète. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste sur les misères et les injustices de la condition humaine explorée par les poètes. Entre la réalité du temps vécu et la vérité pleurante à l'Absolu, la poésie est le seuil de la bonté, peut-être même la seule énergie que l'on puisse recevoir de l'autre monde en cette vie où la vérité se fait de la réalité qui n'en finit pas de naître.
Il y aurait tant à méditer sur la bonté de la poésie qui ne se ride sur rien et s'enveloppe de la générosité des allusions répandues entre destruction de la méchanceté naturelle aux vivants et la résurrection des présences absentes. Quelque filament court de la passion des mots innés, recouverts d'une poussière lumineuse qui les allie aux pertes de la mémoire nous abolissons le dur combat acharné qui décharge aussi bien Fombeure sur le long parcours d'une existence patiente que Cadou pressé d’en terminer avec le devoir quotidien de l'extase. Si je les unis dans la taille pour la terre promise, c'est que je ressens combien ils diffèrent par leur approche de l'essentiel et qu'il n'y a rien de plus essentiel que la bénédiction de l'âme et du corps dans la poésie dévorante où nous avançons à la découverte de l'invisible dans le visible qui se résorbe par une infiguration assurément baroque sur le parcours des poètes inspirés.
Je rappelle qu'à 26 ans Julien Lanoë présente dès 1930 le premier recueil de Maurice Fombeure, âgé de 28 ans, Silence sur le Toit, ouvrant la troisième série des Cahiers que les frères Godmé (Jean-Pierre Maxence et Robert Sébastien) avaient fondés à Paris en 1928 par un premier cahier Manifeste avec Stanislas Fumet, Robert Vallery-Radot, André Harlaire, Paul Gilson, Pierre-Jean Robert et Jean Glineur. C'est dire l'orientation spirituelle d'une revue dont le deuxième cahier de la première série Itinéraires accueillait déjà les poèmes de Maurice Fombeure auprès de Jacques Maritain, Max Jacob, T.S. Eliot, Daniel Rops, Jean Vincent-Bréchignac et Roger de Lafforest. Georges Bernanos, Jules Supervielle, Pierre Reverdy, Henri Massis, François Mauriac, Etienne Borne, Henri Ghéon, René Schwob, Charles du Bos, Marcel Brion, Henri Pourrat, Nicolas Berdiaeff, Chesterton notamment écrivirent aussi de 1928 à 1930 dans ces Cahiers qui ont marqué la renaissance catholique après Léon Bloy Paul Claudel et Charles Péguy. Cinquante ans après, il me semble que les contradictions étaient alors aussi vives qu'aujourd'hui entre ces hommes jeunes dont la plupart ont disparu mais dont l'œuvre ne cesse d'être fertile d'une poésie de liberté qui les relie à la tradition et qui unit nos deux instituteurs laïques dont la poésie est profondément terrienne.
Je tiens, en effet, que Cadou et Fombeure, fils de l'Ouest, sont annonceurs de la Terre promise comme Lanoë l'exprimait, achevant la préface de Silences sur le Toit par cette déclaration : «Ici la poésie n'entre dans aucun calcul et les sombres projets lui répugnent. Sa légèreté est cependant sérieuse comme tout ce qui vient de la terre, parce que la terre enveloppe les morts et contient les moissons à venir. Maurice ne reste pas courbé sur elle, mais appelle cet âge d'amour dont nous rêvons tous, le fait descendre des nuages, l'installe sur le seuil de nos portes, et nous presse de l'accueillir avec nos bras ouverts. C'est un poète de la Terre promise». Je retrouve ainsi le poids du monde dans ces prophétiques Constellations qui ont accueilli cette année le jeune Maurice Fombeure en son héritage :
Une souris géante
Trotte entre les montagnes
L'autre face du monde
Est une face claire.
C'est sur la face d'ombre
Que nous cherchons nos yeux
Moi je vais vers les vôtres
Au soleil soucieux.
Une truie étincelle
Constellée de mes doigts
Mais le ciel s'amoncelle
Au silence des toits.
J'ai retrouvé la rive
Où ma vie s'écoula,
L'amour, et je meurs là
Entre les cris des grives.
Et j'ajouterai encore ce passage à l'ancienne mode :
O mon Dieu, le berger des prairies de ma vie...
Les feux sont à l'affût, les oiseaux sont couchés
Et je pourrais sortir la nuit sans me mouiller
Promener sur les prés ma forme immatérielle
Au tumulte soudain et glacé des étoiles
C'est la fuite des cerfs, sous les forêts de givre,
L'aurore éclairant ses églises de verglas,
Puis le soleil d'oseille et ses vapeurs de cuivre...
Thesse, frappe au cœur noir des grottes de la mort.
Pour en finir avec la Terre promise de Fombeure, je citerai son Denier à Dieu qu'il dédie à René Char qui venait de publier son premier livre Artine :
Roses, rochers, murmures
Où donc est votre loi ?
Où donc est votre loi
Poissons de ma mémoire
Qui filez plus brillants
Qu'une poignée de sel
Armoires, clés sonnantes
Où donc est votre loi
Le visage du monde
Se penche sur mes yeux,
Me montre une forêt
De cerfs couleur de rouille
Une rivière alerte
Comme un battant de cloche
Et tant de voix s'élèvent
Si je ferme les yeux
Que les lampes m'emportent...
Parlerez-vous de moi
La chandelle allumée
Taupes de mon village
Tout petits habitants
O vous que j'aimais tant
Quand j'avais quatorze ans
Et ma voix d'un autre âge.
Quant à René Guy Cadou, les biens de ce monde ce sont aussi les biens du monde à venir et je ne citerai pas maintenant son merveilleux Nocturne qui l'exonère de son aventure en cette vie de chagrin et de passion pour supplier de recevoir pour vin de table La rosée lustrale des cieux dans le royaume de Dieu, mais c'est sur ce poème inédit du 19 juin 1944 publié par Poésie 1 que je conclurai sa Terre promise en voisinage de Dieu.
Tu peux entrer sortir
T'enfermer dans mon rêve
Jusque sous mes épaules
Tu es partout chez toi
Me crois-tu quand je dis
Seigneur si j'ai des lèvres
C'est pour baiser la bouche
Ecœurante des fleurs
Si j'ai le sang léger
C'est pour que les gazelles
Enfin se désaltèrent
Au niveau de mon cœur
Mon Dieu accepte-moi
Comme un ami facile
Toujours prêt à t'aider
Au transport de la croix
Capable de marcher
Mille ans pour te cueillir
L'edelweiss qui sera
Visage dans les doigts
Je n'ai pas désappris
La fable et la légende
Ni comment le mouchoir
Lumineux s'envole
Véronique est ma mère
Et je vais dans la lande
En proférant ton nom
Pour les oiseaux marins
Tu ne douteras plus
De mes mains secourables
De cette joue creusée
Pour recevoir ton front
Avec le bon larron
Je te veux à ma table
Tu ne peux refuser
Ce qui vient d'un enfant.
Que ces deux poètes aient pénétré dans le royaume des cieux que Jésus-Christ promit aux enfants, je n'en peux douter par la seule vertu de leur écriture, dans la transparence des roses et des lilas qui nous attend au seuil de l'éternité. Cette année, à soixante-dix neuf ans, Maurice Fombeure nous quitte, quand il en a ici quarante ans de moins. René Guy Cadou aurait aujourd'hui passé soixante ans dont trente nous séparent. Je le dis avec mélancolie parce que je me sens de la même génération disparue dans les limbes d'où nous reviendrons à l'Aurore d'une autre vie.
Le Castellet d'Oraison
4. octobre 1981,
en la fête du huitième centenaire de François d'Assise.
Cadou et la poétique de la nostalgie, par Georges Jean
Je tiens à dire tout d'abord que ce thème, je ne l'ai pas choisi pour des raisons «théoriques», j'allais dire «universitaires». Lorsqu'Hélène Cadou et Yves Cosson m'ont prié de participer à ce colloque, et que je me suis demandé sur quoi, concernant Cadou, je pourrais communiquer, le mot nostalgie s'est imposé à moi. Car la lecture, ou mieux comme dirait Marcel Jousse, la «manducation intérieure» de la parole poétique de Cadou déclenche en moi, dans mon corps plus que dans mon esprit, comme le frémissement et le tremblement heureux et presque douloureux de la jouissance amoureuse ; comme si cette parole s'inscrivait à chaque fois dans le passé charnel de ma vie ! Je me demande d'ailleurs si toute poésie ne s'inscrit pas d'abord ainsi dans le corps charnel. Les «poéticiens» qui négligent ce «plaisir», au sens «barthien» du terme, ont beau multiplier les approches ; ils manquent ce que Machado nommait «l'impératif de l'essentiel». Plus que toute autre, la poésie de Cadou est jouissance et regret d'une jouissance physique effacée.
Je me suis alors interrogé sur le caractère obsessionnel de ce «point de vue» qui s'imposait. J'ai dégagé trois raisons :
1)René Guy Cadou, né en 1920) a mon âge. J'emploie le présent et non le conditionnel parce que, précisément, cette poésie est vivante dans mon présent. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la poésie de Cadou est le plus souvent énoncée au présent :
Présente
Loin
Sous les bâches du ciel
Avec le dernier train
Les villages sans téléphone
Et pour celui qui se souvient
Les fumées courtes de l'automne
Je suis là
Où tu sais...
( La Vie rêvée)
Cette parole me contraint donc à descendre de maintenant, de ce présent, dans mon passé. On sent combien déjà la «nostalgie est toujours ce qu'elle était», pour moi !
2) En second lieu, si ma petite musique personnelle a un sens, elle n'a été, elle n'est qu'une espèce de ressassement perpétuellement appelé et rappelé à l'exhumation vive de ce qui est dans ce qui fut. Et cette très banale thématique poétique personnelle me contraint un peu à lire chaque poète comme s'il refaisait ce que je fais. Et les poètes les plus refermés sur leur langage, Mallarmé ou Pound, je ne sais pas les lire autrement d'abord. Mais Cadou plus que tout autre et pour la raison déjà dite. Je me reconnais en lui, multiplié. Car il me cherche et me trouve.
3) Et puis me sont remontés en mémoire les propos d'un philosophe qui compte beaucoup dans ma vie, auteur d'un livre merveilleusement simple et profond sur «la nostalgie». Il s'agit de W. Jankélévitch et de son essai «L'Irréversible et la nostalgie» (1). La réflexion dense, serrée, lyrique de ce philosophe de l'indicible, du «je ne sais quoi et du presque rien» et qui raisonne en s'appuyant sur les poètes et les musiciens, me permettait de comprendre et de saisir ce que la poésie de Cadou disait et contenait pour rendre ainsi la nostalgie dans son effervescence d'actualité. Dans un chapitre intitulé «la musique de la nostalgie» Jankélévitch écrit en effet :
«Devant l'impossibilité d'un revenir du devenir, devant la déception du retour au pays familier, devant la faillite de nos efforts pour obtenir que la coïncidence du point de départ et du point d'arrivée soit aussi la répétition de notre ancienne vie, devant l'échec du rajeunissement et le chimérisme de toute innocence, l'homme désespérant des miracles se met à chanter. Dans la musique et dans la poésie, l'homme nostalgique n'a-t-il pas trouvé son langage ?» (2).
Et l'on peut lire dans les «Conseils et notes» écrits en 1948-1949 par Cadou ceci :
Je n'écris point pour donner ou conserver une position avantageuse mais, entendez-moi bien, pour me situer toujours au-delà de moi-même, pour avoir une raison plus tard de m'accueillir à quelque carrefour perdu dans les bois.
N'est-ce pas là «l'homme nostalgique» justifiant son langage ?
J'avais donc le sentiment de ce que la poésie de Cadou est poésie de présentification ; donc une affirmation implicite de ce que la nostalgie n'est ni l'«éternel retour nietszchéen», ni pure poésie du souvenir mais «épiphanie» dans l'instant de l'énonciation poétique, du tout humble, quotidien ou transcendant de la vie. Ce sentiment méritait sinon de s'argumenter, du moins de se parcourir, méritait pour tout dire une poétique, c'est-à-dire une élucidation, un dévoilement. Et comme il était exclu de dérouler ce cheminement dans sa totalité, je me suis contenté d'en éclairer quelques aspects plus incomparablement visibles.
J'ai, en partie, renoncé à une approche « formaliste » car il faut beaucoup de temps, de doigté, et parce que la sémiotique y devient trop rapidement le système ludique de celui qui regarde. J'ai encore moins consenti à l'approche «biographico-sémantique», celle, hélas, de la critique courante de la poésie qui devient très rapidement glose redondante, inutile, et j'ai tenté naïvement de déterminer :
- Les dimensions métaphysiques et religieuses de «l'actualisation» dans la poésie de Cadou de ce que Jankélévitch nomme «l'irréversibilité du temps».
- Les grandes catégories de «biens de ce monde» que le poète Cadou demande à l'Homme Cadou (ou est-ce le contraire ?) d'immobiliser dans l'effervescence d'un langage.
- Le «travail» par lequel ou mieux les «travaux» par lesquels l'artisan Cadou atteint avec des mots cette «pleine poitrine» où se situe le lieu de tout impact poétique.
Cet ordre n'est peut-être pas naturellement rhétorique, et il aurait fallu peut-être partir des apparences pour atteindre les méditations dernières. C'est que mes intentions sont sur un point polémiques. Je tiens, en effet, à proclamer que toute poésie de haut vol -et la poésie de Cadou en est une-, est une pensée ! Au sens pascalien du terme. Des gens comme Bachelard, Heidegger, Jankélévitch nous disent précisément que la poésie, ce langage qui se constitue en être, mérite d'être perçue comme une densification de tout sens. Car on commence à en avoir assez de ces réductions structuralistes, de ces jeux de mots sur les mots, de cette pédagogie du dessèchement réducteur, à quoi le discours sur la poésie est parfois ramené aujourd'hui. La poésie, et celle de Cadou en particulier, est pensée de Dieu, de la mort, du Temps, de l'Etre, du quotidien que le temps dévore. Non pas d'ailleurs au niveau le plus spontanément émotionnel ; cette «poussée contre la paroi absurde du monde» n'est obtenue que par le travail «distant» du poète : «Contrôler sévèrement son émotion. La larme à l'œil ne fertilise que des plantes sans grâce et sans utilité,» écrivait Cadou. C'est pourquoi je ne parlerai pas de nostalgie sur le mode sentimental mais comme de la réflexion et la quête d'un jeune poète coincé entre le temps, l'instant et l'éternité.
«L'aventure n'attend pas le destin».
Il m'a semblé tout d'abord important de réfléchir sur le sens de certains des titres des ouvrages de Cadou. Et l'un d'eux pourrait constituer un raccourci saisissant de la métaphysique qui me semble sous-tendre toute cette œuvre.
«L'aventure n'attend pas le destin», c'est-à-dire que pour le poète, la «fatalité» n'est pas «fatale». Cette «souffrance du retour», ce «mal du pays» n'est pas pour le poète douleur devant l'impossibilité de retourner l'irréversible ; elle est dans l'acceptation «malgré tout» de ce fait et malgré lui, de la liberté de poursuivre l'expérience de vivre. Cette «expérience» ne serait-elle pas en ce qui concerne Cadou tout entière décrite par Jankélévitch : «notre effort, écrit-il en effet, pour susciter à nouveau l'apparition d'une expérience ancienne aboutit en fait à une expérience nouvelle».
Mieux encore. La dernière aventure. La mort qui parle derrière presque tous les poèmes, la mort n'est pas «solitaire» ; la mort chez Cadou, «l'arrêt brutal du train» qui réduit au néant de la totale solitude ce que nous avons été, est encore une aventure à vivre, si l'on peut dire :
... Et qui viendrait te chercher là
Quand tu disposes de toi-même
Secrètement pour un destin
Qui ne peut plus te laisser seul
N'appelle pas
Mais entends ce cortège innombrable de pas.
(Art poétique. Le Diable et son train)
Ces pas, ce sont les autres, les lecteurs, les poètes ; et, sur un certain plan, philosophique ou éthique, ce que j'appelle «poétique de la nostalgie» est la démarche qui, s'ouvrant à la mort inévitable et dans son cas personnel, pressentie comme proche, s'ouvre en même temps à la survie. Chez les autres, chez nous, qui parlons d'un poète, et nous sommes ces pas, ces marcheurs et nous devrions peut-être gagner les maisons du silence.
Sans doute devrait-on ajouter que la foi religieuse de Cadou rend pour lui l'Espérance plus forte, plus essentielle que la nostalgie. Mais la singularité de Cadou est de maintenir la foi comme «amour tenace amour tremblant» (Fargue). Et pour lui se réfugier en Dieu, c'est en même temps regretter la vie, et même la vie où l'on doute de Dieu :
... Tu peux bien 'n'accueillir et m'ouvrir tes palais
Tu ne me rendras point cet amour que j'avais
De la vie ni ce doute inné de la Personne
Qui fait que je suis là et que tu me pardonnes...
(Adresse à Dieu)
Pour les agnostiques, dont je suis, Cadou, poète de foi, n'est pas un poète religieux. Toute l'œuvre est méditation sur la vie charnelle à perdre irrévocablement. Mais à regagner, ne serait-ce que dans la fulguration d'un poème. Ce qui est proprement définir une nostalgie fondamentale qui en se nommant se magnifie et peut-être se détruit.
Il reste pour Cadou que la présence divine et très concrètement la présence de Jésus «à sa table», met une sorte de terme transcendant à la nostalgie. Et l'extraordinaire pouvoir de cette «poésie pour tous», comme disait Eluard, fait que ceux qui -comme moi- ne voient Dieu nulle part- sont en la lisant à la fois inquiets et rassasiés. «Qui a vu le présent a tout vu, le passé immémorial et le futur à l'infini» disait déjà Marc Aurèle.
Voir le présent.
Toute poésie est, en effet, défi au temps. La poésie de Cadou, comme celle de Nerval, inscrit le temps dans cet être de parole qu'est le lecteur, le lecteur poète. Et il y a chez eux nostalgie au sens de «recherche du temps perdu» et non pas renversement de l'irréversible et de l'irrévocable. Et cela parce que Cadou, comme le Nerval de Sylvie, «voit le présent».
Dans un poème comme «La Cloche de mai », Cadou exprime bien son obsession, non pas d'un «éternel retour» à la manière de Nietzsche, mais bien plutôt «d'éternel présent» :
... Je ne suis pas parti
Tout est là
Je tourne autour de toi
Et ta voix me retient.
(Bruits de coeur)
La poésie de Cadou me touche de ce fait parce qu'elle est le contraire d'une poésie de «circonstance». Le charme de certains symbolistes, ou sur un tout autre registre de Paul Morand ou du Valéry Larbaud de Barnabooth, est que leur appel au passé date et est daté. Cadou, lui, présentifie un monde qui de nos jours «a de moins en moins cours», mais qui demeure parce que le poète nous invite à le regarder de maintenant et à saisir dans «le regard des paroles» des moments.
«Or qu'est-ce qu'un moment, écrit Jankélévitch, sinon un jalon temporaire dans la succession temporelle, un mode d'être provisoire continuellement refoulé par le devenir, continuellement invité à céder la place, continuellement empêché de coexister avec le suivant et avec le précédent».
Relisant en vue de ce colloque la presque totalité de l'œuvre poétique de Cadou, j'ai vécu ma lecture, j'ai existé en elle, en lui le poète, comme si je multipliais une multitude de «moments» immobilisés, retenus, et cependant en mouvement. Ce qui n'est plus est encore puisque des mots le disent maintenant, à ce moment. Je connais peu de poésie qui donne à ce point le sentiment de ce qu'Eluard nommait la «Vie immédiate». Et si je ne crois pas que Cadou soit un poète de la nostalgie «romantique», je suis persuadé que sa saisie des êtres et des choses dans le présent de sa parole est pour tout lecteur qui se «mouille» dans cette poésie, intense présentification du temps soi-disant «perdu», donc regagné et de ce double regard fait de la nostalgie une poétique.
Roland Barthes écrit dans son dernier livre (3) que la photographie comme le «haïku» était «une immobilité vive». Ainsi je vis comme des «immobilités vives», c'est-à-dire intensément vivantes, les moments de Cadou. Le psychanalyste François Gantheret traduisant à propos des poètes cet étrange sentiment qui nous fait concevoir le temps comme une présence, écrit : «Le poète s'absente et l'objet parle et sa parole est la bouche nouvelle du poète».
Cadou, le poète, s'est absenté. Et «l'objet parle», encore, et la nostalgie est cette mort vivante au coeur du temps.
Les «Biens de ce monde».
Et de quoi parle le poète absent, dont la parole tord ce qui nous fait hurler en pleine poitrine ?
De son enfance, certes, qui «est à tout le monde» et dont on a parlé dans ce colloque. Et de ses parents toujours inscrits. Je ne reviendrai pas sur ces «évidences poétiques» consubstantielles à Cadou.
Je me contenterai de souligner que pour Cadou le retour et le recours presque constants à l'enfance, ne doit pas être confondu avec le sentiment romantique d'une «nostalgie» sentimentale le l'enfance, qu'il reprochait, par exemple, au Grand Meaulnes d'Alain Fournier. Dans ses «notes inédites» Cadou a ce mot étonnant : «Il importe au poète de conserver intactes les vertus de l'enfance, de les conserver et de les utiliser. Que ses réactions en face des prodiges quotidiens soient celles de l'enfant. L'enfant se souvient de l'avenir».
C'est en nous rendant nos yeux d'enfants -la poétique de Bachelard dit exactement la même chose- que le poète nous fait mesurer une déchirante évidence : nous sommes parfois capables, à travers, et à l'aide des mots, de retrouver un regard, une odeur («Odeur des pluies de mon enfance»...) du passé, mais nous savons que cette enfance existe en nous et est perdue. Ce que j'appelle la «nostalgie» se situe dans cette distorsion entre ce possible et cet impossible :
L'enfant pécoce
Une lampe naquit sous la mer
Un oiseau chanta
Alors dans un village reculé
Une petite fille se mit à écrire
Pour elle seule
Le plus beau poème
Elle n'avait pas appris l'orthographe
Elle dessinait dans le sable
Des locomotives
Et des wagons pleins de soleil
Elle affrontait les arbres gauchement
Avec des majuscules enlacées et des cœurs
Elle ne disait rien de l'amour
Pour ne pas mentir
Et quand le soir descendait en elle
Par ses joues
Elle appelait son chien doucement
Et disait :
«Et maintenant cherche ta vie».
(Tout amour)
Le Règne végétal.
A partir de là, on pourrait dresser l'inventaire des «biens de ce monde» qui constituent cette «présence absence» qui, comme dans l'imaginaire sartrien, fait des «choses» de Cadou des «natures mortes», comme le sont, par exemple, les natures mortes de Chardin ou de Braque qu'il aimait tant.
Il convient auparavant de souligner que «le sentiment de survie» qui me saisit en lisant Cadou provient de la présence constante et toujours masquée, pour ne pas dire pudique, de la femme aimée.
Hélène ici présente, permettez-moi dans le cadre de ce colloque universitaire -mais que reste-t-il d'universitaire en moi ?- de vous redire ce que le poète vous disait :
... Quand tu es loin de moi tu es toujours présente
Tu demeures dans l'air comme une odeur de pain
Je t'attendrai cent ans mais déjà tu es mienne
Par toutes ces prairies que tu portes en toi.
(Hélène ou le Règne végétal)
Je m'adresse donc à vous tout simplement parce que votre présence incarne l'essentiel de ce que je m'efforce de dire ici. La présence du poète absent vous traverse, nous traverse, vous attend, nous attend. Et cette douleur heureuse, ce déchirement bienfaisant, c'est cela ma nostalgie. Et je me souviens du moment ancien où je vous ai rencontrée pour la première fois, où vous ne m'avez presque rien dit, où votre silence m'apportait toute la présence du poète.
A partir de vous, «l'ami incomparable» comme dit Luc Bérimont dévoile toute sa poétique de «l'absence présence». Car il me semble que la survie exceptionnelle de Cadou tient précisément à l'intensité avec laquelle les mots du poème redonnent aux «biens de ce monde» leur présence dans l'absence.
Pour éviter une longue énumération de cette «surrection des choses» chez Cadou, je renvoie les lecteurs à un poème pour moi central et très connu :
«Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète...»
Ce texte me paraît, en effet, exemplaire et s'inscrit au cœur même de mon propos. Il ne contient aucune expression de la «distance temporelle», si l'on peut dire. Un grammairien dirait qu'il s'agit là d'un usage rigoureux du présent de «vérité générale». Le poète est l'absent. Et pourtant sa présence est d'une obsédante et tranquille densité.
Les «biens de ce monde», en l'occurrence, les choses, les meubles témoignent du «pouvoir» de métamorphose des paroles. Et renvoient à d'autres lieux. A des lieux d'origine. Les meubles contiennent la forêt, la lumière de la lampe ce sont les abeilles, les cerisiers et leur odeur «odeur de pain frais», matin, maison du matin que l'aube rappelle. En glosant rapidement je me trouve une fois encore ramené à cette «présence dans l'absence». Et une fois encore, le sentiment de «nostalgie» que j'éprouve est double. Peut-être parce qu'un jour Hélène m'a montré la table de bois sur laquelle écrivait le poète ; et que le poète n'est plus là pour réveiller l'essence vivante des choses. Mais également parce que je découvre dans ce texte de l'immobilité «peuplée» tout ce que Cadou notait lorsqu'il écrivait dans «Usage interne» :
«Une poésie qui ne ferait appel qu'à la méditation risquerait de demeurer longtemps sur place. Toutes les grandes batailles ont toujours été des luttes de mouvement».
Et ici, ces luttes partent et remontent de et vers l'immobilité.
J'ai pris volontairement un texte «de méditation» et dans lequel la plénitude du sens immédiat, la richesse «close» des métaphores (dans la mesure où elles se suffisent à elles-mêmes), et le caractère «impersonnel» de l'énonciation créent une certaine distance apparente entre le poète et le lecteur. Et il apparaît que la «nostalgie» est ici expression extrême et extrêmement maîtrisée du lyrisme.
Mais que dire des innombrables textes où le retour vers des lieux anciens est «présentification» de l'irréversible ? La courte expérience de vie de Cadou paraît ainsi longue comme l'éternité. Peut-être parce que le thème du «retour» est obsessionnel dans son œuvre. On peut lire ainsi des «Brancardiers de l'Aube» le premier recueil :
Dans les ornières profondes, qui drainent sous la peau
Toute une colonie de souvenirs...
Et en 1938 dans «Forges du vent» :
Un jour il faudra te dire
La blessure de la première aube
Au cœur sonore de mon enfance
Et tu crois que je me souviendrai... ?
Dans «Retour de Flammes» (1938-39) le début du poème intitulé «Episode», énonce ceci :
Je ne sais rien de plus de vous
J'arrive de la ville le cœur barbouillé
Je parle seul et vite
Je suis pressé de tout dire
Comme si j'allais perdre la mémoire...
Ces deux derniers vers méritent qu'on s'y arrête. J'y lis une réponse à la question que me pose la poésie de Cadou : l'extraordinaire densité et étendue de l'œuvre d'un poète mort à 30 ans ne s'expliquerait-elle pas en partie par l'urgence tôt pressentie de «tout dire» ? Comme si la nostalgie s'inversait, comme si le passé, un objet, un amour, les amis, les rencontres, Dieu constituaient déjà les promesses d'un avenir malgré la mort imminente.
Je n'ai pas, à ce sujet, le temps de présenter un inventaire des innombrables affirmations par lesquelles toutes les choses du monde sont littéralement sommées de s'inscrire dans le poème et comme hors du temps. Le poème devient alors «le ballet qui se passe entre le présent et le déjà vu ou le pas encore» (Jankélévitch).
Le poème devient le prisme où se réfractent le passé, le présent et l'avenir dans une saisie qui les fige et les met «à distance». Et les inscrit à la fois dans le présent et l'irréversible. Je me suis souvent demandé pourquoi Cadou aimait tant Reverdy (si différent dans ses tensions plus minérales que charnelles). C'est sans doute que chez Reverdy également la poésie «donne» à saisir l'impossible conjonction de ce qui n'est plus, dans ce qui est. Et ce qui est, ce qui demeure, c'est le texte du poème !
Le texte de la nostalgie.
Le texte de Cadou constitue une sorte de «palimpseste», une vaste fresque étalée entre 1937 et 1950 formée de couches temporelles successives, présentes en même temps. Comme si l'œuvre tout en s'inscrivant naturellement dans la durée s'établissait dans l'espace de notre présence et nous pliait toujours vers «avant».
Le texte de Cadou est presque constamment, je le répète, un texte au présent.
Lorsque l'attaque est au conditionnel (imparfait de supposition), lorsque le texte passe au futur, il y a presque toujours un retour au présent. Comme si le texte de Cadou ne pouvait nous interpeller que maintenant :
Si la terre s'arrêtait de tourner
Si les ailes n'allaient plus jamais se refermer
Si l'homme reprenait l'enfance au premier geste
Le plus clair de son temps
Pour satisfaire l'amour
La neige coulera comme un beau marbre antique
Mais le ciel gardera ses ardoises dorées
Il y aura les hauts visages
Les signes blancs de ceux qui dressent les moissons
Le bruit de pas feutrés derrière la cloison
Le sortilège des mansardes
On parlera de toi
Et beaucoup de retour
Les mains s'aligneront un soir sur le rivage
Le meilleur de nous deux retenu pour longtemps
Déjà je parle aux arbres
Et mes doigts me suffisent
Déjà les torses flambent au bord du lendemain
Et le soc d'une étoile nous ouvre le chemin.
(Genèse. Bruits de cœur)
Le texte de Cadou est, sur le plan lexical d'une extrême cohérence. Si l'on constitue les quelques champs sémantiques principaux de son œuvre, on découvre que reviennent le plus souvent les occurrences de mots qui parlent du corps et du sang, et non seulement lorsque le poète évoque l'homme mais encore lorsqu'il interpelle les choses :
Ce qui n'affleure plus
La neige au fond des mines
Le sang bleu de l'acier dans le cœur de l'usine
La paupière du toit •
Les couleuvres jolies qui glissaient dans ta voix
Les algues de la terre
C'est l'épaule du ciel qui retombe en poussièr
Et les arbres se couchent
Dans les rues de la mer passent des hommes louches
De lourdes cargaisons
On ne sait plus si c'est l'étoile
Ou la prison
Rien ne passe
Sans qu'elle soit partie
On a perdu sa trace
Belle main que ton souffle achève de ternir
(L'Enfer de chaque jour. Morte saison)
Le lecteur qui ne se contente pas de lire «des yeux» mais qui reçoit ces poèmes dans la chair partage une sorte de battement vivant. Et tout ceci, qui revit comme un corps) est cependant effacé et pourtant inscrit, gravé, marqué ; la nostalgie est dans l'être des mots.
Un autre exemple significatif est constitué par les mots qui disent les villages. On remarque un détail, mais capital : ces mots très souvent sont associés à des termes qui évoquent les routes, les chemins, les sentiers ; ce sont des villages (et des maisons) ouverts et d'où l'on «s'enfuit vers la grande chaleur».
Il faudrait également montrer comment les mots qui désignent la mer, le ciel, les oiseaux, le vent, la neige, les pierres, disent moins des choses et des êtres vus que des moments. Et surtout montrer que dans les poèmes d'amour, les mots de Cadou qui appartiennent aux univers lexicaux signalés, et à quelques autres, s'imbriquent, se croisent, s'affirment et débouchent sur des termes abstraits concrets dont la conjonction, au sens syntaxique de ce terme) figure précisément cette dialectique simple où s'engouffre toute la nostalgie du monde entre l'instant et l'éternité :
Telle tu m'apparais que mon amour figure
Un arbre descendu dans le chaud de l'été
Comme une tentation adorable qui dure
Le temps d'une seconde et d'une éternité...
(Quatre poèmes d'amour à Hélène.Hélène ou le Règne végétal)
Figures.
Ce qui rend extrêmement complexe l'analyse lexicale de la langue d'un poète comme Cadou, est, d'une part, que ce lexique est peu étendu et, d'autre part, que son impact sémantique et son pouvoir connotatif sont multipliés à l'infini par la densité métaphorique. Et je pense toucher là un point nodal dans mon exposé : la métaphore chez Cadou est rarement ornementale ; elle est presque toujours nécessaire et signifiante, sursignifiante même ; et, dans une certaine mesure, elle sublime toujours la sensation première. Comme le dit BACHELARD :
«On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former les images. Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images... Si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d'images aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas d'imagination...» (L'Air et les songes).
Or, il me semble que chez Cadou, la fonction majeure de l'image est presque toujours de ramener dans le présent du poème les images premières à jamais perdues dans l'obscurité de la mémoire affective. Et cette réactualisation des sensations perdues permet mieux que certains procédés élocutoires, comme dirait Mallarmé, de mesurer l'irréversible, l'irrévocable, et de nourrir la nostalgie.
Dans un très beau poème intitulé «Malgré tout», Cadou dit même implicitement que le présent du poète est véritablement le «silence de la mer» peuplé de tout ce qui l'habite. Et il use pour le dire d'une sorte d'image «ontologique» :
Je suis fermé à la parole
Je suis un grand silence qui bouge..,>
Pour moi, la nostalgie résulte donc d'une confrontation entre les images intériorisées, les images de lanterne sourde du poète dans son énonciation actualisée et le point d'origine, l'image première. S'ajoutent à cela le cheminement imaginaire du poète dans le temps, son aventure personnelle concrète et mes cheminements à moi, les petits et grands événements de ma propre vie.
A tel point que l'on pourrait établir en prenant par exemple appui sur les thématiques bachelardiennes, des classes de métaphores d'images, de comparaisons qui feraient apparaître le passé à exhumer comme du feu, de la lumière et le passé à anéantir comme de l'eau noire :
Il est des souvenirs bavards qu'il faut noyer
Tout de suite dans un morceau de grosse toile
Au plus creux de la mare avec un gros caillou
Que ça touche le fond sans faire de remous
De tous mes souvenirs...
Le seul souvenir à sauver dans ce texte s'énonce ainsi :
La seule aux pieds d'enfant qui marche comme on danse
A dix ans dans les cours d'école d'autrefois
En jetant vers le ciel des écorces d'oranges
Qui brillent si dangereusement sur le toit...
(Traduit de l'amour. L'Aventure n'attend pas le destin)
Cette opposition se retrouve bien souvent. Par exemple, dans le poème intitulé «La poésie » on peut lire :
Je plonge doucement mes mains dans la lumière
Sans penser un instant à les en retirer...
et ailleurs :
J'écris pour dépasser la crue noire du temps
Tandis que les oiseaux et les fleurs me précèdent
A cette auberge au bord du ciel où les passants
Trouvent des couches étoilées et des vaisselles
Pleines de fruits et des soleils encourageants
Mais reste au fond de moi le plus clair de ma vie
Qui ne supporte pas le poids de la parole
Ces mots d'amour qui ne seront jamais écrits
Et la lumière de mon cœur toujours plus haute
Aveuglante comme une poignée de sel gris.
( Les Secrets de l'écriture. Les visages de solitude)
Et ce que j'ai, sans doute, maladroitement nommé la nostalgie résulte dans cette aventure au fil de quelques images de l'eau noire et de la lumière, de ce que ce discours ne dit rien de ce qui parait essentiel mais tout sur ce qui est en fait essentiel : la déchirure ouverte sur la plénitude de ce que nous ne savons plus dire. Et il importe de constater que cette parole «muette» comme «atone» est bien comme la rose mallarméenne «l'absente de tout bouquet» et chaque lecteur avec elle, à partir d'elle transforme le non dit en son «cœur définitif». Comme l'écrit le philosophe :
«Ce n'est pas en tant qu'il est ceci ou cela, ce n'est pas à cause de son contenu que le passé est objet de nostalgie ; le passé est objet de nostalgie parce qu'il est, si médiocre soit-il, notre passé, notre irremplaçable passé... Ce charme immotivé, inexprimable de l'avoir été se dégage au fur et à mesure par le seul effet de la prétérition ; car le charme est le piège du temps ; il germe dans le présent et fleurit dans le passé.» (Jankélévitch. L'Irréversible et la nostalgie).
Et un poète comme Cadou nous conduit, précisément, et parce que l'alchimie métaphorique est métamorphose concrète, au bord de cet inexprimable que sans un poète nous ne percevrions pas.
Pour finir très provisoirement sur ce thème, disons que l'on rencontre chez Cadou une poétique du renoncement à l'image pour elle-même ; chez lui, l'image conduit au dur noyau du langage tu. La nostalgie, l'impossible retour à l'enfance, évoqué dans ce colloque, na î t moins de l'irréversibilité du temps que de l'impossibilité de nommer vraiment ce que les mots masquent :
... Les chevaux et les chiens
Parlent mieux que les hommes
Et savent de très loin
Reconnaître le ciel
Ils n'ont pour eux que l'herbe
Et la grave tendresse
Des bêtes qui remuent
Tristement le passé
Mais dans leurs yeux inquiets
Des choses et des hommes
Passe parfois l'éclair
D'une saison future.
Cet éclair, image de clarté, encore une fois, est ce que je nommerai la nostalgie pour vivre autrement. Comme Cadou dans sa mort parle bien de notre vie !
Musiques.
Il resterait à lire la partition. Il resterait à entendre cette musique. J'y renonce ici et pour l'instant parce que cette musique) chacun la secrète. Peu de poètes comme Cadou laissent au lecteur le soin de trouver une tonalité, des timbres, des interprétations. Et je me demande, en fin de compte, si mon propos, propos de linguistique que dévorent des activités poétiques, n'est pas en réalité mon interprétation (au sens propre). La poétique de la nostalgie ne serait donc que cela. Mais je crois sans orgueil que ce peu justement est une vraie, une bonne lecture !
Le retour au présent.
Et ici, je retrouve mon philosophe :
«De même que chez Platon réminiscence et regret sont les formes rétrospectives du désir, de même l'espérance d'un passé à venir et d'un futur déjà advenu sont deux formes paradoxalement réciproques d'une même nostalgie. En ce point, l'âge d'or du passé le plus lointain ne fait qu'un avec l'avenir le plus chimérique. L'homme qui retourne vieilli à ses sources, à son origine, à son innocence revient où il n'est jamais allé ; revoit ce qu'il n'a jamais vu ; et cette fausse reconnaissance est plus vraie que le vrai.» (Jankélévitch, op. cité).
Chez Cadou, ce jeune poète qui retourne perpétuellement à ses, à nos origines, la nostalgie, en fait, s'efface et nous fait voir) à nous, ce que nous n'aurions jamais vu. Maintenant, dans le présent (lu poème. Sur ce plan, la poétique de Cadou est une conjuration, une conspiration contre l'irréversible. Les «Fusillés de Châteaubriant» qui, au moment de tomber, vivent intensément la nostalgie de leur enfance et de leur vie, le poète les quitte sur une affirmation :
... Puisque toute liberté se survit...
La leçon de Cadou est dans ce défi que la poésie jette à la mort.
... Marche un peu dans la rue sans ombre
Vers la flamme !
Redresse-toi un peu que j'accède à présent
Par le puits de tes yeux aux sources de ton âme
Où n'ont jamais plongé les racines du temps.
(Journal inachevé. Les Biens de ce monde)
Le feu des mots brûle la nostalgie. Quelque chose échappe au temps et le poème est éternité.
Notes
Wladimir Jankélévitch : L'irrésistible et la nostalgie, (Flammarion).
(1) W. Jankélévitch, (op. cit. p. 304).
(2) La chambre claire. (Gallimard).
Ma bibliographie se réduit aux Œuvres complètes de Cadou et à l'ouvrage Vladimir Jankélévitch : L'Irréversible et la nostalgie. (Flammarion).
Métamorphoses féminines : de «la vie rêvée» à «Hélène ou le Règne végétal», par Eulalia Lombeida
The Pennsylvania State University McKeesport U.S.A.
La publication relativement récente des œuvres de René Guy Cadou (1) n'a pas seulement contribué à le faire connaître d'un plus grand public, mais permet désormais à tous les amateurs de poésie d'en prendre aisément une vue d'ensemble et offre particulièrement à ceux qui possédaient quelques-uns de ses recueils de poésie devenus rarissimes l'occasion de tenter une synthèse, de découvrir l'unité du continent Cadou malgré la diversité de ses paysages, de le connaître «tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change».
C'est cette édition, en tout cas, qui m'a donné l'audace d'inscrire une thèse de doctorat sur «L'Univers de René Guy Cadou», thèse que je prépare actuellement sous la direction du Professeur Michel Dassonville et que je compte soutenir d'ici quelques mois à l'Université du Texas à Austin.
Le titre de ma thèse peut paraître ambitieux. Il s'agit en fait d'étudier la nature et la fonction de la comparaison et de la métaphore dans l'œuvre de René Guy Cadou. Il va sans dire que la métaphore, véritable cristal du langage, est de tous les procédés d'expression celui que les poètes modernes, disons depuis Baudelaire, affectionnent le plus. Bien loin de n'être qu'une simple figure de style, un truc, un procédé d'expression, un «stratagème de surface», la métaphore est un diamant noir extrait des profondeurs de l'inconscient qui révèle non seulement ce que Charles Mauron appelait les mythes personnels, mais fait pénétrer le lecteur diligent dans l'univers propre à chaque poète, un univers qui a son soleil, ses horizons, son atmosphère, ses paysages, ses créatures familières et ses propres lois de gravitation.
J'ai tout particulièrement essayé d'étudier dans ma thèse toutes les formes sous lesquelles se présente la métaphore : nominale, verbale, adjective, ..., etc. Le temps qui m'est alloué aujourd'hui ne me permet que de présenter un seul exemple de la nature et du fonctionnement de la métaphore, mais un exemple caractéristique, me semble-t-il, puisqu'il va nous faire entrevoir quelques-uns des avatars d'«Hélène».
Ce qui apparaît le plus souvent dans les poèmes de René Guy Cadou sont des séries de métaphores reliées les unes aux autres par la syntaxe et par le sens : chacune d'elles exprime un aspect particulier d'un tout, d'une chose ou d'une attitude que représente la première métaphore de la série. Cette première métaphore, appelée métaphore primaire, sert de modèle à celles qui la suivent et qui en dérivent. Elle permet aussi leur décodage. C'est elle qui pose l'équivalence des termes A et B auxquels les métaphores dérivées seront apparentées (2). Chaque terme A des métaphores dérivées est apparenté au terme A de la métaphore primaire. Il en est de même pour les termes B. Il y a donc un déroulement parallèle de deux systèmes associatifs, l'un composé de mots apparentés à A, l'autre de mots semblablement apparentés à B. Chacun des systèmes suggère, évoque, décrit la réalité autour de laquelle il s'organise. Le déroulement de la séquence est limité sémantiquement, ce qui implique que la suite de sèmes doit avoir une certaine logique, et que le choix de A et de B doit garder une certaine réciprocité dont le but est de minimiser les différences entre les deux réalités rapprochées. Par ailleurs, l'effet spécifique des métaphores que je me propose d'étudier aujourd'hui est de transformer la femme en un monde imaginaire dont les éléments savamment (ou inconsciemment) choisis dans la réalité quotidienne la plus familière, de plein air, rustique mais essentielle, sont pour le lecteur de Cadou une véritable invitation au voyage immobile et comme l'affirmation indubitable que le bonheur est à la portée de qui sait aimer.
Un bel exemple de métaphore se trouve dans le premier poème (3) du recueil «Hélène ou le règne végétal» et servira à illustrer le travail du poète. La métaphore primaire, qui n'est ici qu'en formation, est donnée dans les deux premiers vers :
A la place du ciel
Je mettrai son visage
Elle indique nettement le travail de décodage auquel le lecteur est invité puisque le poète remplace le ciel par le visage de la bien-aimée. Les réalités qui promeuvent les métaphores dérivées et qui définissent les systèmes associatifs sont le ciel et le visage) suivant l'analogie :
Visage : poète - ciel : terre
Elles seront développées parallèlement tout en gardant des relations si intimes qu'elles apparaîtront parfois absolument identiques, puisque tel est le désir du poète qui souligne cette identité aux vers 3 et 4 par la personnification des oiseaux «Les oiseaux ne seront même pas étonnés».
A partir de la deuxième strophe, Cadou détaille les correspondances entre les deux univers :
yeux : femme - printemps : saisons
A partir de l'identité établie dans les premiers vers, le soleil se lèvera à l'horizon. C'est-à-dire dans la profondeur des prunelles. Le topos : soleil, source de vie, transforme la femme en commencement unique, début par excellence de toute création. Un autre topos : le cycle de la vie universelle est introduit par cette image du soleil levant. et le début du cycle de la nature, le printemps, est mis en relation directe avec les yeux de la bien-aimée :
yeux : femme - printemps : année solaire
Et le jour se levant
Très haut dans ses prunelles
On dira «le printemps
est plus tôt cette année»
Pour marquer encore une fois l'identité établie entre les deux univers, le poète les juxtapose :«beaux yeux belle saison», ils sont modifiés par le même adjectif qualificatif, procédé syntaxique qui a aussi une valeur sonore. Ce modificateur banal, appartenant au vocabulaire quotidien, joint au parallélisme syntaxique, transforme la femme en un univers aussi familier que le Cycle de la nature. Grâce aux pluies qu'il amène, le printemps est source de vie. Les rivières sont aussi sources, et dans les viviers les poissons naissants confirment l'unité de l'image.
Si le soleil est source de vie, il est aussi source de lumière. Cette qualité lumineuse est transmise à la femme qui à son tour devient lumière, flambeau, lampe (4). Les yeux deviennent source de vie et de lumière dans une synthèse métaphorique : «Viviers de lampes claires». La femme rejoint ainsi l'univers, elle est ciel, terre, lumière et eau. Elle est renaissance, début et fin du monde, mais une fin qui n'arrive jamais car l'horizon est sans cesse reculé. Le principe féminin devient cyclique, renaît continuellement, comme les saisons qui se suivent dans la nature. Ce passage cyclique du temps est bientôt renforcé par l'arrivée de l'automne.
On fait déjà les foins
Le long de ses paupières
L'analogie qu'établit cette métaphore est parallèle aux métaphores qui la précèdent, et à la métaphore primaire :
paupières : yeux - fenaison : automne
Un tableau des réseaux utilisés dans chaque système associatif permet d'isoler les relations qui existent entre les deux et permet de dégager quelques caractéristiques de l'univers cadoucéen :
Ciel - Visage
soleil - prunelles
saisons - yeux
foins - cils (le long de tes paupières)
Il est aisé de distinguer aussi un mouvement opposé dans la séquence des termes A et B. Tandis que les «teneurs» révèlent une progression du concret à l'abstrait, de la représentation latente à la représentation métaphorique, du général au particulier, la progression des «véhicules» est opposée, passant de l'intérieur à l'extérieur, du particulier au général. C'est ainsi que la femme prend forme et couleur tandis que la nature se volatilise jusqu'à devenir uniquement passage du temps, représentation d'un mouvement cyclique.
Cet exemple de métaphore n'avait pour but que de nous préparer à assister aux métaphores les plus fréquentes dans l'oeuvre cadoucéenne, celles d'Hélène. Ces métamorphoses révèlent une progression tout au long de l'oeuvre, un développement qu'il est intéressant de suivre non seulement pour prendre une meilleure connaissance du poète lui-même mais aussi et surtout pour préciser les limites de l'univers cadoucéen. Hélène est le soleil de l'univers de Cadou, l'amour sa principale loi de gravitation. Amour platonique, érotique, à la fois conjugal et fraternel. Timide par tempérament autant que par formation chrétienne, Cadou est, cependant, homme du XXè siècle, et il voit en Hélène, non seulement la libératrice de son âme angoissée,
Sans t'avoir jamais vue
Je t'appelais déjà
(p. 127)
et la figure de ses rêves,
Tu étais la présence enfantine des rêves
Tes blanches mains venaient s'épanouir sur mon front
(p. 260)
mais aussi la réponse à ses désirs charnels,
Soumise à mes deux mains tremblantes à mes lèvres
(id. )
Il sait dès le premier moment qu'il arrivera à se confondre avec la bien-aimée, qu'ils ne feront qu'un seul êtres et bien qu'il l'orne de toutes les beautés, il ne la place pas pour autant sur un piédestal. Sa bien-aimée est réelle, tangible, il aspire à la posséder. C'est en la transformant en univers végétal qu'il participera le mieux à ses bontés sans violence.
Dès leur première rencontre cette certitude du contact amoureux est présente. Le poète sait que son amour triomphera.
Je t'atteindrai Hélène
A travers les prairies
A travers les matins de gel et de lumière
Aucune barrière ne l'arrêtera, rien n'empêchera leur union. Certes, il n'oublie pas que la femme est mystère et, dans son essence même, antithétique.
Tu es de tous les jours
L'inquiéte la dormante
mais elle n'en est pas moins proche. Dès ce premier instant, cette femme qui n'était encore que rêvée lui apparaît comme le seul refuge possible.
Tu étais l'auberge
Aux portes des villages.
Si dans ses rêves, bien avant leur rencontre, le poète sentait la présence de cet amour inconnu dans le monde qui l'entourait, dès leur deuxième rencontre cet univers est complètement transformé par la présence de la femme aimée. Dans «La visiteuse» (5) c'est elle, déesse de la nature, qui lui permet l'intrusion dans ce monde végétal dont il avait été exclu jusque là. Sa vision du monde a déjà changé : «Maintenant le soleil Comme tout va changer», Cadou sort du monde obscur de ses premiers recueils pour pénétrer en un univers lumineux. Ce sera le monde où il habitera grâce à la bonté d'Hélène :
En partant tu m'ouvris la porte et la forêt
Etranger jusqu'alors à ce monde, le poète s'y habitue lentement. Les habitants en sont des animaux doux, le renard même ne se livre à aucune ruse. Tous s'approchent de lui légèrement pour l'aider à explorer ce monde naturel. Il participe passivement à ce miracle dont la seule artisane est Hélène.
D'un geste tu soufflais le toit du paysage
Et tu venais vers moi derrière la saison
Tu pétrissais le feu la neige le gazon
Le pouvoir de cette déesse est tel qu'il ne peut ni ne veut y échapper.
Alors j'ai tout compris ta bonté la première L'étincelle de sang qui fait battre les pierres La peur et le secret panique des vergers Quand tu fermes sur toi les vannes de lumière
Bien que les amants soient encore deux êtres séparés, éloignés même par la distance, l'influence de la «visiteuse» est désormais inévitable. Toutefois si l'amant vit sous sa domination elle reste encore étrangère à cet amour, ignorante même du pouvoir surnaturel qu'exerce sa seule présence.
Le principal intérêt du poème intitulé «Bergère» (6) est, croyons-nous, de présenter la première métamorphose de la femme en paysage naturel. L'équation primaire de cette transformation est donnée dès la première strophe sous forme de comparaison :
Je m'approche de toi
Comme d'un haut pays
Ces vers traduisent le sentiment du poète : vénération, respect, espoir mais aussi frayeur car elle est génie oraculaire. Cette componction ne reviendra qu'à la fin du poème, après les métamorphoses de la femme qui la feront tour à tour campagne, fleuve, forêts, labours, plaines, lac. Le poème se termine par une métaphore qui n'est, avec quelques variantes, qu'une reprise de la comparaison initiale :
Mais tu ne comprends pas
dans la nuit où tu veilles
Les mots d'amour seront
toujours des bruits d'abeilles
Dans «La Cinquième saison», (7) l'amant jouit de la compagnie de la femme désirée, quoique ce soit en imagination. Comme dans le poème «Bergère») la métaphore primaire est donnée dès le premier vers : «S'il faut nommer le ciel je commence par toi». Bien que le poète se sente encore inférieur à la femme, leurs relations ont subi un progrès sensible. La réciprocité est implicite dans l'alternance de «Je» et de «tu» dans les huit premiers vers :
Sil faut nommer le ciel je commence par toi Je reconnais tes mains à la forme du toit
L'été je dors dans la grange de tes épaules
Les hirondelles de ta poitrine me frôlent
Dressées contre ma joue les tiges de ton sang Le rideau de ta chevelure qui descend
L'amante subit ici une nouvelle transformation. Si elle est encore gigantesque, la caractéristique principale de cet avatar est d'être refuge, encore que cette fois-ci le refuge soit réel et non rêvé : Grange, arbre où les hommes et les oiseaux trouvent également abri. Redevenue femme et amante, le contact est établi, la douceur féminine évoquée pour la première fois :
Tu traverses la nuit plus douce que la lampe Tes doigts frêles battant les vitres de ma tempe
Et l'union des amants est scellée par l'emploi du pronom «nous» : Lentement le soleil s'est approché de nous
Un rendez-vous à Lormont, comme l'indique le poème qui porte ce titre, permet à l'amant de connaître Hélène, et dans «Feuillages» il décrit la vision du monde tel qu'il le voit après avoir fait l'expérience de l'amour. Ce monde appartient maintenant aux deux amants et l'idée de foyer y est introduite.
Faites qu'il soit pour nous un calme domicile
Au fond du ciel avec les brouillards du matin.
Ensemble, ils envisagent l'avenir, désirent commencer une vie nouvelle qui leur permettra d'oublier les «sillages» des années passées, plus «profonds dans nos cœurs glacés». Ils espèrent trouver de «nouveaux visages». La conquête de la femme n'a pas diminué l'ardeur de l'amant, ni son admiration, ni sa flamme. Il la désire plus encore, il ne peut plus vivre désormais sans qu'elle soit présente :
Calme poitrine que décorent
La racine la flamme nue
Plus désirée d'être conquise
Tu dissimules tes oiseaux
(p. 200)
A partir de cette union amoureuse., les métamorphoses de la fem¬me en univers naturel non seulement se concrétisent mais sont de moins en moins nombreuses. Après avoir atteint l'objet de ses désirs, après avoir vécu la fièvre de cet amour unique le poète est entièrement absorbé par la présence féminine. Il est obsédé par l'amour. Toute vision, tout mouvement est hanté par la présence d’Hélène.
Es-tu là |
|
Elle est pour lui présent, passé, futur, elle a supprimé pour lui la nécessité de «choisir entre avenir et souvenir». La dernière strophe de «La Fleur Rouge» (8) résume les transformations subies et l'importance capitale donnée à la femme toujours présente, à la fois initiatrice de tous les processus, comme l'indique la répétition de «premier» : unique dans sa vie d'homme (De ma première enfance), elle est renaissance du monde (De la première fleur) et continuité de la vie (du premier été).
Ce premier poème de recueil «Hélène ou le règne végétal» introduit le ton et le nouveau monde cadoucéens. Monde doux, aimable, simple qui est transformé en merveille par l'échange de lexèmes entre la femme et la nature :
Je vous fais voir un pays sans horizon possible mais maintes fois reconnaissable au chef orné de garance et de pourpre.
La vision de la femme dans les poèmes de ce recueil est bien différente de celle qu'on trouve dans «La Vie rêvée». Le poète qui se sait aimé par Hélène est libéré de ses incertitudes, de ses angoisses. La femme est devenue médiatrice entre le poète et l'univers qui l'entoure, elle le sera bientôt entre l'homme et Dieu. Le poète lui fait confiance et se soumet à son pouvoir :
Je te confie mes mains pour que tu dises
A Dieu de s'en servir pour des besognes bleues
Car tu es écoutée de l'ange
(p. 259) Innocence et bonté, elle possède le pouvoir de tout transformer, et connaît même l'avenir du monde :
Penche-toi à l'oreille un peu basse du trèfle
Avertis les chevaux que la terre est sauvée
Dis-leur que tout est bon des ciguës et des ronces
Qu'il a suffi de ton amour pour tout change (id.)
Proche des animaux, elle leur parle comme à des amis ; elle n'est plus la géante muette, éloignée des êtres de la terre, elle est devenue leur égale et leur protectrice. Elle sauvera aussi l'homme, et
Ouvrant les hauts battants du monde afin que l'homme
Atteigne les comptoirs lumineux du soleil
(id.)
elle devient la rédemptrice qu'il avait depuis longtemps souhaitée. C'est ainsi qu'après avoir transposé les beautés de l'univers extérieur en monde intérieur elle laisse entrer dans l'univers quotidien l'aspiration la plus sublime de l'homme, le ciel.
Dans «Toi» (9) poème du recueil qui présente la plus complète transformation de la femme, elle ne devient pas un seul univers immense et complet, mais se transforme en d'innombrables réalités. Ce poème incantatoire répète la construction verbale «Tu es» 7 fois en 24 vers; de plus elle est sous-entendue au moins deux fois. Le verbe copule adoucit les images. La rapidité, la force du mouvement des chevaux, par exemple, semble être présentée au ralenti. La métaphore copule ajoute ici une dimension dynamique qui caractérise la plupart des images cadoucéennes. Placée en tête de poème la métaphore copule sert de tremplin au déroulement de l'univers des métaphores :
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux
Un port de mer tout entouré de myosotis
Et la rivière où le nageur descend
A la poursuite de son image
Tu es l'algue marine et la plante sauvage
Comme l'arnica
Tu es toute pleine de poissons dans ta chevelure
Tu es une belle figure
L'anaphore suscite un enchaînement sémantique qui permet le passage rapide d'un avatar à l'autre. Hélène est une plaine «parcourue de chevaux». La course de chevaux implique un voyage qui mène au «port de mer» lieu de départ. Pourtant, il n'y a pas voyage, le port est ancré dans les «myosotis». La mer devient «rivière» et Hélène participe à la fois du monde aquatique et du monde terrestre : «Tu es l'algue marine et la plante sauvage». La répétition de la formule crée un système syntaxique et un système phonique dont les échos parcourent le texte. Le mouvement lyrique imposé par la syntaxe amplifie l'émotion et en accentue l'intensité.
Bien que la femme continue à être transformée en univers quotidien, ses métamorphoses sont dans ce recueil «Hélène ou le règne végétal» bien différentes de celles qu'elle connaissait dans les recueils précédents. Les objets naturels choisis pour les transformations sont ici limités, connus, attachants pour le poète. La belle n'est pas seule, mais toujours accompagnée, entourée. Un certain dynamisme anime les transformations elles-mêmes : la plaine avec les chevaux est en mouvement, le port implique voyage, la rivière coule incessamment. La femme est donc source de mouvement, cause du développement de la vie mais, par ailleurs, elle n'est plus une géante, elle est «la petite voisine» : de plantes et d'animaux insignifiants, connus, quotidiens (trèfle ou lézard). De géante insensible dont le seul mouvement bouleversait le monde elle est devenue «muse» aimable qui transforme le monde, elle est rédemptrice de l'univers.
En fait, toutes les transformations subies par Hélène ou par le monde du poète sont dues à l'écart introduit par la métaphore entre les niveaux de dénotation et de connotation. Il semble que le poète refuse de suivre les classifications établies par la raison. Tout se passe comme si ces classifications n'existaient pas. Dans le monde qui l'entoure tout est en «correspondance», l'univers est continu, tout s'interpénètre. En violant les classements habituels :
animé inanimé
homme animal
concret abstrait
en confondant les sensations spécifiques à chacun des sens, comme en ce dérèglement des sens baudelairien ou rimbaldien, Cadou accomplit une véritable transsubstantiation par des transferts plus souvent . involontaires que volontaires. Dans l'universelle analogie l'homme, l'animal, le concret, l'abstrait ou vice-versa se confondent pour créer un univers qui lui est propre.
Notes
Cadou et l'esprit d'enfance, par Régis Miannay
Il serait tentant de ne voir en René Guy Cadou que le poète-instituteur mêlé, à l'âge adulte, au monde de la jeunesse et perpétuant par une existence campagnarde le bonheur des premiers émerveillements devant la nature. Qui n'a pas été ému par les vers où il fait revivre une Brière de rêve, battue par la pluie et le vent et où il suggère de nombreuses ressemblances entre le pays de son enfance et la Sologne, entre lui-même et le Grand Meaulnes ? Mais l'auteur de «Mon enfance est à tout le monde» ne nous invite pas à un simple retour vers le passé ni à une évocation nostalgique d'un univers à jamais perdu. Il cherche, dès ses premiers écrits, une voix qui lui permette de rejeter le malheur, la souffrance et la mort à l'extérieur de l'être, là où est sa vraie place. S'il aime, chez Meaulnes, l'esprit d'aventure, le goût de la liberté, la soif des amitiés inconditionnelles, d'un amour absolu, la connivence avec la vie de la nature, il ne peut s'identifier totalement à un héros tourmenté et solitaire qui se sent vaincu d'avance. L'esprit d'enfance, c'est au contraire, pour Cadou, une existence donnée, partagée (pensons à l'admirable titre de son livre de souvenirs), c'est l'affirmation d'une continuité, d'un échange constant entre le poète et le monde, le poète et les autres. Sans cet esprit d'enfance, la poésie, acte d'amour, ne peut exister.
L'expérience douloureuse d'un arrachement à ce monde de l'enfance (le départ de Sainte-Reine-de-Bretagne dans sa douzième année puis la disparition de sa mère et de son père) aurait pu détruire définitivement chez Cadou tout espoir en la vie. Lorsqu'il s'est engagé dans la voie de la création poétique, il a répondu au défi que lui lançait le destin en affirmant le pouvoir libérateur des mots.
Mais ses premiers vers, s'ils nous empoignent par l'énergie du verbe, offrent aussi le constat d'une vie trop tôt saccagée et d'une attente impatiente. Le poète dans plusieurs pièces nous apparaît de dos, immobile, anonyme et solitaire. Dans sa conscience, il ne découvre que le silence et le vide :
Je cherche un homme en moi
A qui parler. (1)
Parfois, cependant, des rêves d'aventure et de voyage traduisent son aspiration à un départ, des allusions au passé sont de pudiques rappels de souffrances récentes. Le poète souhaite retrouver un monde perdu :
Un jour il faudra te dire
La blessure de la première aube
Au cœur sonore de mon enfance,
Et tu crois que je me souviendrai ? (2)
Comme guide et garant du succès final, il a son cœur («Le cœur au bond», «Plein cœur», «Cri du cœur»). Dans la voie difficile où il ose s'engager, celui-ci lui donne la force de surmonter la déception et le découragement :
Dix heures dans les feuillages têtus de mon enfance
Dix heures
Et le manteau troué de la souffrance Pour poser mon regard pas un coin de ciel bleu
Chacun de mes retours plus triste qu'un adieu Tous ces demi-silences
Vous êtes là je sais
Au plus clair de moi-même
Penchés sur mon remords et sur mes lendemains
Puisque vous revenez dans cette chambre noire
O mon père et ma mère
Partagez-vous mes mains. (3)
Ce voyage intérieur vers l'enfance commence donc dès ses premiers recueils et s'impose peu à peu comme une véritable recherche initiatique. Le poète doit affronter le silence et découvrir le pouvoir de la mort mais les échecs n'entament en rien son ardeur. L'esprit d'enfance réside d'abord dans la soumission à cet élan, dans le refus d'une banale résignation. Ce n'est donc pas une coïncidence si le lyrisme triomphe à partir du recueil Bruits du Cœur. Le poète qui a fait confiance au pouvoir des mots cherche à restituer au monde sa transparence originelle. Libéré d'une relation douloureuse avec son enfance, il devient le chantre de la vie.
L'esprit d'enfance, pour Cadou, exclut toute complaisance pour le malheur et ne peut se concevoir sans humour -humour qui s'interdit le pessimisme et la dérision. Parfois, on discerne clans ses premiers vers une présence diffuse de Corbière et de Laforgue, des thèmes ou des rythmes qui font penser aux Amours jaunes ou aux Complaintes, en particulier dans l'évocation des réalités familières et quotidiennes, des saisons et des voyages. (4) Pour ces poètes blessés par la vie, l'enfance est un refuge séduisant mais inaccessible. S'ils utilisent souvent pour masquer leur désespoir ou combler le vide d'une existence médiocre des mécanismes ou des expressions du langage des enfants, leurs compositions ont un caractère parodique et présentent leur nostalgie comme une sorte de régression vers une monde de protection maternelle. L'intérêt de Cadou pour ces poésies s'explique sans doute par la découverte d'expériences très proches des siennes et d'une même volonté d'originalité dans l'expression poétique. Mais il n'est pas pleinement satisfait par des œuvres qui mêlent à l'évocation de l'enfance des sarcasmes et des blasphèmes contre la vie. Cet humour, jeu complexe qui permet de parer un désenchantement fin-de-siècle, ne convient pas à son choix de l'«athlétisme». (5) Il paraît le manifester parfois assez nettement : son poème «Symphonie de printemps» (6) est comme une reprise anti-laforguienne de «L'Hiver qui vient». Aux vers de Laforgue, il préfère sans doute ceux de Corbière qui, d'un son plus vigoureux et plus direct, appartiennent davantage à la poésie qu'il aime, poésie « de pleine poitrine, forte et balancée comme une pierre de fronde». (7) Si ces premières lectures se répercutent à travers toute son œuvre, elles n'ont pas eu une influence aussi déterminante que celles de Reverdy, Max Jacob et Apollinaire. L'esprit d'enfance se nourrit d'un besoin d'émerveillement devant la vie, d'une soif de bonheur. Il se traduit par un humour involontaire que l'on pourrait qualifier, par comparaison avec l'humour triste de Laforgue, d'humour innocent. A l'enfant, explique Cadou, «tout (...) est permis, tout (...) semble normal : de s'envoler soudain comme une mésange ou d'épouser son grand-père». (8) Il ajoute que l'enfant «se souvient de l'avenir» : «On aurait une maison, (...) on serait mari et femme». (9) Et il invite les poètes contemporains à mériter «ce miracle d'innocence». (10) Sur ce point, un rapprochement avec Apollinaire (songeons à sa devise «J'émerveille») nous paraît s'imposer. Le poète sait découvrir dans une réalité d'apparence banale les force-secrètes de la vie.
La présence de Meaulnes qui transfigure tout ce qui l'entoure va incarner pour Cadou le lien qui unit étroitement la poésie à l'enfance : il y avait en lui : «le tremblement merveilleux du poète» (11) écrit-il à propos d'Alain-Fournier. Dans l'œuvre de Cadou, Meaulnes fait quelques apparitions rapides mais éclatantes :
O vieilles pluies, souvenez-vous d'Augustin Meaulnes
Qui pénétrait en coup de vent
Et comme un prince dans l'école
A la limite des fééries et des marais. (12)
A une réalité terne qui fait penser aux paysages d'automne de Laforgue, Meaulnes apporte la communication avec le rêve. S'imposant immédiatement par une sorte de suprématie native que tous reconnaissent, relié au monde par l'amour et l'amitié, il représente le poète dans son rôle déterminant mais assez secret de médiateur. Cadou s'identifie un peu à Meaulnes comme il s'identifie à Serge Essénine
Essénine Augustin ! Le Serge du Grand Meaulnes. (13)
Ce vif intérêt pour Meaulnes est apparu à un moment où le poète, après les recueils marqués par l'influence de Reverdy, évolue vers les effusions lyriques de La vie rêvée. Moment aussi où est né le grand amour de sa vie et où se crée le groupe des Amis de Rochefort. Réconcilié avec sa vie, Cadou affirme son moi et s'oriente vers une poésie attentive aux résonances mystérieuses du monde immédiat.
Parce qu'il n'est qu'un révélateur, Meaulnes devrait cependant s'effacer pour laisser la place à la réalité qu'il a éveillée. Cette présence ne joue pleinement son rôle que dans la mesure où elle se fond dans la poésie secrète et tendre du «domaine mystérieux». Cadou regrette donc que Meaulnes poursuive la destinée d'un héros marqué par la fatalité et détourne le lecteur de la véritable poésie du roman. A la fin de sa vie, confrontant ses idées à celles d'Alain-Fournier, il écrit même qu'il ne convient pas de «rendre» l'enfance, mais plutôt «de la préserver, de la retrouver dans chaque geste de l'âge mur». (14) Il discerne aussi dans «Le Grand Meaulnes», un mépris du monde urbain contre lequel il réagit dans un de ses derniers poèmes :
J'ai trop parlé de Meaulnes et des routes d'enfance
Des bohémiens et du Domaine Mystérieux
Poète que fais-tu de cette pestilence
Qui embaume Paris son faubourg et les cieux ? (15)
Cet adieu à Meaulnes témoigne en fait d'une fidélité à l'enfance. Cadou veut la perpétuer sans chercher à revivre le passé, par l'acte d'amour du poème
Voici que l'acajou verdit que la chambre s'emplit
De la marée inaugurale d'un poème
Et que cet enfant d'autrefois
Se met à vivre à la fenêtre. (16)
«(...) Il importe au poète de conserver intactes les vertus de l'enfance, de les conserver et de les utiliser».
Cette déclaration de Cadou dans sa réflexion sur les idées d'Alain-Fournier nous paraît résumer les conclusions du poète confronté à son enfance et offrir une des clés de sa poésie -affirmer une permanence pour mieux s'ouvrir à l'illimité-.
Jamais plus les oiseaux n'entreront dans la chambre
Ni le feu
Ni l'épaule admirable du soir
Et l'amour sera fait d'autres mains
D'autres lampes
Oh mon père
Afin que nous puissions nous voir. (18)
Poésie de l'échange qui ne cesse d'étendre ses ramifications vers l'avenir et qui, paradoxalement, trouve dans l'attention et la fidélité à l'enfance les instruments de sa liberté.
Notes
Approches rhétoriques du sourire cadoucéen, effets d'analogie et de distance, par Christian Moncelet
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il n'est pas mauvais d'avoir une fois de plus en mémoire les moqueries généreuses de Cadou à l'égard des professeurs, des universitaires et des professionnels de la critique. Son ombre rayonnante s'interroge peut-être à notre égard, à la façon du père étonné dans Tout Amour : «se peut-il que je figure à leur palmarès ?» Si Cadou avait parfois la certitude intime d'un jour «se faire entendre» éprouvait-il pour autant la jubilation anticipée de se faire expliquer disséquer, anatomiser, par les chiens savants que nous sommes professionnellement ? La situation du poème Juge est renversée : nous sommes des agrégés (finauds ?) devant l'impétrant monté en grade jusqu'au sommet du Parnasse. Comment ne pas lui prêter quelques réactions emportées, quelques rires (qui, à la lettre, contiennent des ires) à propos d'analyses trop sérieuses, surtout -comble de contradiction- au sujet de son humour, avec en prime une formulation pédante. Il est aisé de jargorgonner pour méduser le public, mais peut-on vraiment échapper à ce mal d'expression nécessaire parce que technique ? Ainsi en soit-il ! Croyez-vous que ce soit facile ? Je fais néanmoins le vœu pieux que ma dissection ne soit pas dessication.
L'homme Cadou aimait jouer avec les mots. Sa conversation et sa correspondance étaient émaillées de calembours, d'à-peu-près, d'anagrammes, de contrepèteries : l'éditeur René Debresse était surnommé par lui «la poularde», un hebdomadaire devenait «hebdromadaire» (Cadou-Bouhier, 224-45), ou bien il donnait son avis à Bérimont «sans couper les poils (du Luc) en quatre» (Lettre du 25-2-47) ou bien il confiait à Bouhier (1-10-42) «Racine et Shakespeare c'est peut-être cela aussi (bémol) la poésie !», ou, enfin, à propos d'Orphée, revue poétique que Rousselot voulait lancer, il écrivait : «Orphée le me le, dis !».
Que le nom du parangon des poètes soit l'objet d'un jeu de mots (jeu de Vermot même) n'étonne pas quand on sait la place des associations verbales plaisantes dans l'œuvre tant prosaïque que poétique de Cadou. Certes, il ne calembourre pas ses poèmes à tour de pieds, certes il n'est pas un spécialiste des triturations de vocables dans le goût d'un Max Jacob, d'un Prévert, d'un Vian, d'un Queneau ou d'un Tardieu, mais il assaisonne son lyrisme d'assez de jeux sur les mots pour qu'on ne sous-estime pas cette forme d'expression.
On peut traiter la question en s'intéressant plus particulièrement aux rapports de l'analogie et de la distanciation humoristique. Il est prudent de rappeler que rien n'est plus tributaire de l'humeur que l'appréciation de l'humour. De plus, on constate des incompatibilités d'humour entre les individus et les communautés ; elles sont inévitables, impondérables, caractérielles ou culturelles : c'est dire si de telles approches sont entachées de subjectivité et vouées, plus que d'autres, à la contestation.
I. Analogies plaisantes entre les signifiés.
Cadou excelle dans l’art des rapprochements analogiques insolites. C’est un des aspects non négligeables de sa création métaphorique.
Veut-il brosser le portrait d’un poète, il établit prestement des parentés tout en soulignant avec humour les différences. Max Jacob apparait alors comme « une madame de Sévigné en pantalon » ou en « Pascal mâtiné de Jarry » et Audiberti devient « un Hugo marseillais orné du toupet provocant de Mayol, un Hugo brasseur d’affaires… »
De semblables sourires apparaissent en poésie sous la forme d’arrangements lexicaux comme celui-ci : « Un collège de bœufs qui part en promenade ». Le troupeau se voit conférer, avc une pointe légère de burlesque sympathique, un surcroît de dignité, par assimilation à un groupe d’écoliers.
Ces rapprochements analogiques sont empreints de gentillesse, d’autres ont un discret parfum de moquerie. L’attelage du « coq » et du « sergent » qui « font respecter le règlement » (OC 344) est piquant. Le premier, dressé sur ses ergots, l'autre, à cheval sur des principes et, en bon patriote, respectueux du coq gaulois, sont effectivement faits pour s'entendre et surtout pour faire entendre leur organe vocal fortement impératif. Cette chute caricaturale termine le poème Dur a vivre qui n'est rien moins qu'une prophétie fatale et pathétique. Caricature aussi, et même caricat-hure, lorsque Cadou donne à voir l'a-hurissement des «gens de Paris» devant la dévotion du cher Max Jacob dans l'église de Saint-Benoît sur-Loire (O.C. 311) :
On voit beaucoup gens de Paris
Hocher la hure quand il prie.
C'est sans doute dans la correspondance qu'on goûte la verve métaphorique la plus pétulante. Même si l'on ne partage pas le jugement critique de Cadou, comment ne pas déguster des formules dont la rosserie est presque digne d'un Léon Bloy ? Comment résister par exemple à la jubilation juvénile de cette mise en pièce : «La prose poétique d'Armand Robin est pleine d'enflure et de ridicule, spasme quotidien de vieille fille éthylique.» (Lettre de Cadou à Bouhier, 5 mars 1942). (Sur cet aspect de la question cf. mon livre Vie et Passion de René Guy Cadou, édit. BOF 1976).
La charge souriante des rapprochements analogiques vient presque toujours d'un grand écart de registre entre le comparé et le comparant. Cette «disconvenance» qui caractérise assez généralement l'humour n'es pas dédaignée, bien au contraire, lorsque Cadou évoque sa condition de poète ou de chercheur du divin. Loin de prendre la pose, à la façon romantique et surtout hugolienne, il ne «s'empêche pas de sourire» (cf Article sur le «surromantisme») précisément quand il parle de la poésie e du poète. Certes, la modulation humoristique n'est pas toujours éclatante mais elle se traduit par une inflexion surprenante d'expression. Ici, Cadou est fier de se comparer à un roitelet (O.C. 340) qui chante sans s'embarrasser de rhétorique alambiquée, là, il crée l'image originale qui renvoie autant à la zoologie qu'à une fable célèbre de La Fontaine
Que la grenouille de ma voix s'enfle jusqu'à chanter
Ce bol de larmes au pied de l'éternité» (O.C. 334)
Le grandiose cosmique se conjugue avec l'autodérision, l'humble lucidité d'un poète qui veut être à la hauteur mais connaît ses limites à la différence de la grenouille de la fable. Max Jacob se représenta en crapaud. Cadou en grenouille. Voilà une coïncidence qui cache un lien ténu mais supplémentaire de parenté ! Plus sérieusement on peut souligner le refus d'enfler le ton hérité de Corbière et surtout de Laforgue. Ce dernier exprimait à sa sœur une opinion que Cadou aurait pu faire sienne : «Je trouve stupide de faire de la grosse voix et de jouer de l'éloquence» (Lettre de 1883). C'est dans cet esprit qu'on peut apprécier la comparaison rustique et sapide du Chant de Solitude :
Voici que je dispose ma lyre comme une échelle à poule contre le ciel
Et que tous les paysans viennent voir le miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles.
L'instrument prestigieux du poète, devenu le digne symbole du lyrisme, se trouve comparé à un objet banal, usuel, pour animal. La verticalité réelle des cordes, celle imaginaire et dynamique de l'incantation sont remplacées par l'horizontalité des barreaux. Certes, l'instrument sert toujours à quelque élévation, mais l'aventure poétique est humblement réduite à l'escapade d'un homme qui fait le mur du ciel et réalise modestement l'escalade, ailleurs mentionnée, des deux Jacob (le biblique et le cher Max) Le mélange souriant de la grandeur et de la familiarité répond bien à l'idéal de «noblesse en manche de chemise» que le poète préconise par ailleurs dans ses notes. Ici, la référence à «l'échelle à poule» signifie en somme le refus du style ampoulé.
L'image finale du Chant de Solitude présente un mixte semblable de dignité et de réalisme rural. Est-ce faire preuve d'un excès de subtilité que de voir un avatar de Pégase, mouture symbolique des poètes, sous les traits de ce «cheval à l'humeur insolite» qui «posera son museau de soleil dans les vitres» de Cadou, comme s'il revenait d'un ailleurs, ivre des espaces traversés, en état, pour ainsi dire, d'ébriéther.
Cadou semble affectionner ces figurations volontairement modestes qui jurent plaisamment avec l'emphase traditionnelle et qui ont. par là-même, une légère saveur de provocation. Ainsi met-il allègrement les pieds de ses vers dans les plats de l'habituelle autocélébration poétique. C'est encore la justification d'une image comme celle-là :
Qu'est-ce après tout qu'un poète acagnardé dans la campane
Sinon l'édifice de liège au sommet d'une bouteille de champagne. (O.C. 325).
Quelle vigoureuse façon d'exprimer la fragilité et la force du poète, soumis à des concentrations de flux cosmiques, «écho sonore» des mille murmures des âmes et des choses ! En l'occurrence, le sourire est très discret, à la limite du perceptible : sourire blanc, comme on parle d'une voix blanche.
C'est avec la même constance que Cadou refuse de monter sur ses grands chevaux, lyriques et ornés, quand il confie, à plusieurs reprises à la fin de son œuvre, les péripéties de sa quête religieuse. Le «chant» de Dieu est «jeté là comme un bock sur le comptoir de l'harmonium» (O.C. 346) : dictée par des similitudes concrètes de formes, la fusion métaphorique oblige deux univers opposés à s'unir. Ici, le spirituel, là, le corporel ; ici, la prière, là, la bière ; ici, le sérieux sacré, là, une réjouissance gourmande et des plaisanteries diverses voire d'ivresse. L'image crée l'équivalent pour la boisson de ce qu'est la Sainte Table pour le pain.
L'écart de l'abstrait et du concret, du haut et du bas (voire du gras) est parfois renforcé par des oppositions d'ordre connotatif :
Que ma foi soit une vieille brouette oh ! c'est assez de la pousser comme je peux
L'oreille du Seigneur est exercée suffisamment pour distinguer son grincement mélodieux.
(O. C. 349)
On imagine la tête d'un bien-pensant en face d'une image aussi incongrue. La communauté verbale de la foi et de la brouette pourrait passer pour scandaleusement déplacée. La foi n'est-elle pas la plus haute expression de l'activité spirituelle de l'homme vis-à-vis du divin ? La connotation de grandeur et de sacré contraste fortement avec celle de terre-à-terre, d'instrumentalité fruste et démodée ! Pour corser le tout, Cadou se paie le luxe de renforcer l'expression de sa pauvreté religieuse par l'alliance «grincement mélodieux» qu'on peut qualifier d'oxhumoristique.
Ces expressions analogiques, criantes de justesse et de contraste, sont d'autant plus fortes qu'elles n'obéissent pas à un désir de provocation gratuite. De tels renversements subversifs de hiérarchies établies s'accompagnent d'une discrète jubilation intérieure, semblable peut-être à celle que le Christ éprouvait quand il proposait ses paradoxes : «Les premiers seront les derniers...»
Refus de la pose, délicate et mâle pudeur : telle est la fonction bémolisante de l'humour qui baisse d'un demi-ton (parfois plus) l'expression du sérieux. On peut appliquer à Cadou la distinction qu'aime répéter René de Obaldia : «il ne faut pas confondre gravité et pesanteur». L'aventure poétique et la quête spirituelle (souvent réunies métaphoriquement par Cadou) sont profondément «graves» mais elle n'exigent pas une formulation sans détente, empesée, lourdement hyperbolique.
II. Analogies plaisantes au niveau des signifiants.
Dans cette nouvelle et abondante série de plaisanteries cadou-céennes, il faut d'abord compter quelques rimes cocasses dont l'effet repose sur l'écart sémantique des mots plus ou moins homophones :
Tu broutes les vitraux, le gaz et l'édelweiss
Tranquillement. Puis tu remues les fesses. (O.C. 258)
e rapprochement, en fin de vers, de la beauté florale et du derrière chevalin est d'une joyeuse incongruité qui annonce l'éclat de rire de l'animal. Ainsi des rimes «novicescomplices» (O.C. 303) «absinthessaintes» (O.C. 315). L'alcool, liquide «temporel» et l'eau bénite, consacrée, sont forcés de se côtoyer : drôle de mariage d'oraison, entre le spiritueux et le spirituel !
L'humour est celui de la promiscuité dépareillée. Ainsi quand deux personnes fort opposées de tempérament, de condition et de maintien, sont placées côte à côte dans un repas, intentionnellement ou par hasard. L'effet de rapprochement des contraires est semblable à celui des métaphores amusantes étudiées, plus haut, mais ici, c'est l'homophonie qui cimente la liaison dissonante.
Tout à fait comparables sont les jeux de similitudes phoniques, au fil d'un article ou à l'intérieur des vers. Ainsi, le métagramme («On y voit l'âne on y voit l'âme»O.C. 338) condense avec une justesse détendue ce qui est la renommée d'Epinal de Francis Jammes, chantre de l'âne (animal humble et moqué) mais aussi (et parfois en même temps «pour monter au paradis...») des aspirations spirituelles de l'homme.
Ici, un métagramme, là, une paronomase caractérisée, ou un à-peu-près. On pourrait appliquer à ces jeux sur les mots la distinction dont on use pour la métaphore, tantôt in absentia, quand les deux membres sont formulés.
In absentia serait l'à-peu-près d'Après dieu le déluge :
Oh ! pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncé
Dans la poitrine ce goût de vivre comme un clou rouillé
(O. C. 325)
In absentia, en effet, puisque «enfoncés» remplace «offensés» qui reste comme un moule vide, rempli par des phonèmes presque identiques (à la nasalisation près de «o») mais dans un ordre légèrement différent (interversion des deux premières voyelles). In praesentia au contraire est la paranomase «NazaréenNazairien», ainsi que les mots ou expressions-valises, produits de la condensation de deux formulations normalement indépendantes : L'art pour ladre (O.C. 434), Comment mieux désigner cette conception esthétique et exclusive d'un art pour esprit sans chaleur, qui ne se donne pas maladroitement, ni généreusement. C'est une idée semblable que reprend Cadou en empruntant la bête-à-deux-mots (1) de Max Jacob : Pablo n'est pas artiste - pingre.
Le point ultime du rapprochement analogique des signifiants est la fusion des deux signes en une seule séquence phonographique : il s'agit alors soit d'un jeu d'homonymie (avec seulement une différence de graphie) soit d'un jeu de polysémie réduite le plus souvent à la bisémie.
Jeu d'homonymie in absentia que les conclusions respectives des poèmes Lied et Nocturne :
.. et faisais la foire dans les cafés
Et c'est peut-être et c'est sûrement pour cela que je t'ai aimée
Hélène ! dans mon verre comme une goutte de rosée. (O. C. 335)
Qu'on lui serve pour vin de table
La rosée lustrale des cieux. (O. C. 346)
Dans les deux exemples, la rosée est doublée muettement par un naturel «rosé». Hélène, la pureté, la féminité, la discrétion, la transparence remplace le masculin, l'univerre du bistrot avec ses plaisanteries plus ou moins salaces. A la fin du Nocturne, le jeu de mots en cache peut-être un autre : «rosée» d'ange, contre «rosé d'Anjou» (Qui sait !), Cadou ne perd pas au change.
Les jeux de polysémie sont assez fréquents dans l'œuvre du poète de Louisfert. Les plus simples consistent en une actualisation d'au moins deux sens, également vivants, mais séparés, du point de vue synchronique. Ainsi de l'emploi du verbe voler dans ses deux acceptions. A la suite d'Apollinaire, Cadou produit le même effet à plusieurs reprises :
Est-ce voler que de prendre en ses mains
Des fleurs et de crier ceci est le levain
De toute vie...
Voler ! Mais si j'avais des ailes que serait-ce (O. C. 269)
«Fleur de Rogue (...) nous rend voleurs
Fleur de Rogue comme les Anges et comme Apollonius de Thyane
(!Miroir d'Orphée, p. 6).
Il en va de même du nom de Max qui renvoie à l'auteur de La Défense de Tartuffe mais aussi au héros biblique qui, selon la Genèse, vit en songe une échelle relier la terre au ciel :
Et tu ne comprends pas que le Pauvre Jacob
Ait pu grimper au ciel sans échelle de corde. ( O.C. 36)
La même allusion se trouve, avec autant d'à propos, dans un article sur le poète-pénitent de Saint-Benoît-sur-Loire (Cf. Miroir d'Orphée p. 91). Le désir de gravir les échelons de la sainteté se traduit dans un jeu de mots que n'aurait pas dédaigné l'intéressé, si sincère et touchant mystiqueficateuri
L'œuvre de Cadou offre, dès le début et avant une assez longue absence, des exemples de tels dopages sémiques. «Quand le soleil vole en éclats» exige qu'on prenne les mots «vole›; et «éclats» dans des sens différents et indépendants de la signification globale de l'expression «voler en éclats». «Voler» s'applique très bien à l'astre solaire, empenné de rayons éclatants et se déplaçant dans l'air.
Dans le poème Saint Antoine, Cadou déroule son poème en dévidant progressivement les sens du verbe «perdre» avec une disparate allègrement pathétique :
Saint Antoine bien aimé de Jésus
Faites moi trouver ce que j'ai perdu
Un jour aux courses de Craonne
Perdu mon Dieu en trois personnes
Perdu la tête par boisson
Pour des Marie pour des Louison. (O. C. 302)
Plus intéressantes, parce que plus créatrices, sont les bisémies au moyen desquelles le poète réactive un sens originel, souvent métaphorique : s'il veut, par exemple, évoquer son initiation musicale manquée, dans Mon enfance est à tout le monde, il exploite la métaphore lexicalisée «clé de sol» en soulignant une analogie entre l'oreille qui reçoit les notes (désignées métonymiquement par la clé de sol) et la serrure où l'on introduit une clef. Le résultat de cette rhétorique instinctive est d'une souriante densité :
La clé de sol grince dans mon oreille comme au fond d'une vieille serrure.
Paris du Souvenir offre une riche illustration de cette bisémie qui allie invention poétique et humour verbal, avec en l'occurrence une pointe de moquerie amère à l'égard des poètes urbanisés, voire capitenlisés
«Comme la Seine fait son lit Paris se couche
Et Paris sous Paris fait chavirer Paris
Et l'enquête aboutit à des portes cochères
A de petites rues sans nom à des logis
Où dans la société d'une fille de chambre
Ariel devenu vieux trompe la poésie.»
Le jeu sur le proverbe et sur le mot «lit» (de chambrede fleuve) s'enrichit d'analogies diverses : échos sonores («couches»«cochères:»), détails d'un adultère pitoyable («fille de chambre» «trompe la poésie»).
Plusieurs critères d'ordre sont possibles. On peut étudier les éléments de cet inventaire de rhétorique en tenant compte de la dimension des unités de signification qui entrent dans les analogies : le mot entre des blancs, une locution, une phrase proverbiale, plusieurs phrases. On peut aussi classer en tenant compte de la banalité (proverbe, locution) ou de l'originalité (phrase historique, citation d'auteur) du texte de référence. Il est enfin possible d'envisager le degré d'altération subi par le modèle que le poète a reproduit.
Les œuvres d'extrême jeunesse de Cadou contiennent plusieurs locutions reprises sans altération formelle, mais avec soit un détournement de sens, soit un effet de double sens.
Silence
On tourne dans la chambre
Où l'hiver nous rassemble
Autour des mêmes craintes. (O.C. 38)
Dans ce cas, le sens technique de la formule cinématographique est abandonné pour évoquer une conjuration collective de l'angoisse chez les «poètes prisonniers». La dislocation de l'expression sur deux vers et son expansion syntaxique soulignent visuellement la liberté prise par Cadou à partir de la phrase originelle.
Ailleurs, c'est un mot composé, repris tel quel, qui est le point de départ de la réanimation d'une métaphore lexicalisée :
Comme elle était danseuse-étoile
Elle s'éteignit un beau matin (O.C. 48)
La justification poétique, non réaliste, de la mort matinale, redonne à l'expression stéréotypée un regain de vigueur et voile d'un sourire verbal le pathétique du deuil.
Ce type de reprises d'expressions s'accompagne toujours d'un enrichissement de sens :
Le soleil en met plein la vue
On a l'air d'avoir bu
La terre coule sous les talons. (O.C. 31)
L'expression figée conserve son sens figuré mais le mot «plein» est exploité concrètement avec de plus un calembour caché : «sous les» (saouler ?). L'exploitation peut se faire au moyen d'une métaphore explicative qui, sans éliminer le sens courant, greffe un second signifié :
Un ciel cousu de fils blancs
-Fils de la Vierge- (O. C. 26)
La coïncidence des mots «fils blancs» «fils de la Vierge» se double d'une analogie des connotations : cielViergeBleuDivin, Blancspureté. L'intrication régulière des échos de sens avive, comme une sève montante, la floraison verbale de surface. C'est particulièrement réussi dans ce vers de calme plat (O.C. 37) :
Les graines de soleil triées sur le volet
La locution, dopée sémantiquement, décrit très bien une impression visuelle (les grains de poussière en suspension, dorés par les rayons du soleil filtré par un volet) sans perdre pour autant son sens de «tri prestigieux». L'emploi approprié de l'expression (avec le glissement de «grains» à «graines», comme si le soleil avait donné vie à la poussière par transmutation) conduit d'une part à une transfiguration heureuse du réel et d'autre part à une fertilisation sémantique d'un groupe de mots. Le sourire est ici celui du bonheur qui procure l'adéquation heureuse d'une réalité et son expression neuve, sourire de la joie recréatrice, sourire d'une préciosité moderne.
Le plus souvent, Cadou change un ou plusieurs éléments d'une locution. A quels seins vouer ses bras (O.C. 27) joue sur une altération orthographique et sur le remplacement du pronom réfléchi par le complément «ses bras». Cette suggestion souriante d'un culte érotique désordonné apporte une petite note de détente dans un climat de violence, d'interrogation et de tâtonnement.
Dans un autre poème, Toute voix dehors Je suis là (O.C. 70), une légère altération phonographique permet de créer en arrière fond l'image d'une solitude mâle au milieu d'une immensité marine. Le poète, tel un Isaïe, parle de toutes ses forces dans un désert mythique dont les dunes sont des vagues. Le jeu de mot enrichit donc le message explicite d'une importance suggestion poétique.
Tout aussi important est le rôle du jeu de mots dans les vers suivants :
Je t'offrirai un beau gâteau de ciel
O mariée d'équinoxe
Et vous conterai à tous
Des guerres civiles d'étoiles.
Qu'importe, à la limite, si l'on n'identifie pas cette mariée énigmatique à laquelle l'à-peu-près phonique donne un statut cosmique (confirmé par les «guerres civiles d'étoiles») ! Le remplacement de «marée» par «mariée» n'est pas un simple lapsus du hasard puisque la femme et la mer sont unies par des relations métonymique (le vieux mythe de Vénus sortant de l'eau) et métaphorique (les marées comme la femme sont soumises à la lune). Qui sait, de plus, si le calembour très audible n'est pas renforcé par un second jeu de mots camouflé : équinoxe = équinoces, union égalitaire de l'homme et de la femme, du jour et de la nuit, du yin et du yang, diraient les Orientaux.
De la même veine sont les expressions du genre «La nuit les bras sont gris» (O.C. 70) ou «On entend le ciel rire à cloches déployées» (O.C. 35). Cette dernière trouvaille est particulièrement exquise et juste. Les éclats sonores des cloches -qui sont elles-mêmes comme des bouches grandes ouvertes- animent la brillance éphémère d'une joie dominicale.
Comme il est impossible de faire un sort égal à tous les jeux verbaux dans l'œuvre de Cadou, signalons rapidement que le poète change parfois un mot par un autre, à l'intérieur d'un moule syntagmatique reconnaissable, comme dans ce vers qui plut à Max Jacob : «Je n'ai pas changé ma douleur d'épaule» (Esthétique de Max Jacob, p. 43).
Cadou ne remodèle pas seulement les locutions courantes, il réutilise, avec des aménagements de son cru, des proverbes, des sentences, voire des phrases passées dans l'Histoire.
Mais la vie la plus courte
Est souvent la meilleure. (O. C, 36)
Ainsi s'exprime avec un humour noir foncé, comme dirait Beckett, le sentiment tragique (et romantique ?) d'une mort précoce. Ailleurs, Cadou trouve une séduisante formule pour faire l'éloge de Picasso grand conquérant de terres inconnues, véritable Attila des Arts ; «Où le pinceau de Picasso a passé la peinture ne repoussera plus.» (O.C. 323) Le grand poème mystique NOCTURNE n'est pas exempt d'un tel humour :
Le plus beau pays du monde
Ne peut donner que ce qu'il a
Myosotis ici et là
Et beaucoup d'herbe sur les tombes.
(O.C. 344)
Il convient de s'attarder plus spécialement sur des clins de plume dont la discrétion est variable et la charge humoristique importante. J'entends par clins de plume des références à des textes le plus souvent très connus du grand public et réquisitionnés, de façon surprenante et moyennant des adaptations, dans les poèmes, voire dans les articles de critiques.
Tirons le premier exemple de la prose cadoucéenne : «L'œuvre de Whitman exalte à grands cris la nudité du sexe ; si elle est une grande bouche gourmande, c'est pour mieux dévorer la routine mon enfant.» Appliquer à l'érotisme d'un poète la réplique célèbre d'un conte pour enfants ne manque pas de sel comique, même pour nous, lecteurs modernes, habitués, depuis quelques années, à des interprétations libridineuses
Dans l'œuvre poétique, les clins de plume renvoient aussi bien à La Fontaine qu'à la tradition chrétienne, à Villon qu'à Gaston Leroux.
Rien ne sert de partir
Il faut vivre
Être là (O. C. 44)
Cette intrusion d'un autre discours détend l'atmosphère du début de Partie perdue et annonce la suite plus rassurante.
Dans Saint François, (O.C. 303), l'expression «le laboureur à ses enfants» ajoute au sourire généralisé de la contribution cadoucéenne aux «fiorettis» du «pitre du Seigneur». On serait impardonnable d'oublier le ton des plaisanteries tremblées qui, grâce au sel des larmes et du comique, assaisonnent certains poèmes religieux. Qu'on se souvienne du pastiche :
Bénis soient de la gare
Les bistrots pour t'avoir redonné la mémoire !
(O.C. 314)
Et surtout d' Après Dieu le déluge ! Non seulement le titre est le démarquage arrangé d'une phrase célèbre devenue proverbiale, mais encore le poème est le commentaire très personnel, sans sacrilège aucun, du Pater Noster des catholiques, restitué dans sa presque totalité. En effet, Cadou se rend gentiment coupable d'un sourire par omission quand il escamote, pour les besoins de la cause d'un hédoniste croyant, la négation «ne» dans Et nos inducas in tentationem (au lieu de «Et ne nos... »). Cet effet, qui risque de passer inaperçu, renforce l'atmosphère de familiarité mystique qui caractérise ce poème et d'autres de même inspiration.
Humour pour les connaisseurs, pour les dégustateurs de textes ? Peut-être. C'est aussi la saveur de ces vers initiaux qui contiennent une réminiscence destinée à voiler pudiquement l'aveu de quelque intempérance :
Me voici dans la vingt neuvième année de mon âge
Avec beaucoup de litres vides derrière moi
Compte jamais réglé sur l'éternelle ardoise
Qui masque de son mieux la misère du toit
De feuillage investi comme un enfant posthume.
(O.C. 313)
La similitude avec le début du Testament de Villon est audible : «En l'an trentième de mon âge»... Cadou se plait à établir sans crier gare une coïncidence : 29 et 30 ans, presque le même âge que ce grand frère lyrique qui avouait «rire en pleurs». L'humour grave fleurit au second vers où l'on entend l'écho plus déformé du deuxième octosyllabe du même Testament : «Que toutes mes hontes j'eus bues» devient Avec beaucoup de litres vides derrière moi.. Comme si cet effet de distance humoristique était insuffisant, Cadou ajoute celui du mot «ardoise» qui, comme dans la syllepse, a un sens pour le vers en amont et un autre pour le syntagme en aval.
Pour clore cette étude des analogies au niveau des signifiants, il reste à citer deux emprunts à Gaston Leroux, maître du roman policier populaire, très aimé de Cadou. La Lettre à Pierre Yvernault contient une citation caractérisée, extraite du Mystère de la Chambre jaune :
Le presbytère n'a rien perdu de son charme
Ni le jardin de son éclat.
L'imitation est ici poussée à son comble puisque la phrase est reproduite telle quelle. Le collage n'est pas pour autant artificiel. L'intégration se fait en douceur : le mot «presbytère», adressé à un prêtre, tombe bien et des liaisons phoniques assurent les sutures indispensables (assonances «charmes arbres» et rimes pauvres «éclat seringas»). Quant à l'atmosphère d'étrangeté, elle a été préparée par la mention surprenante des «inquiétants personnages» «comme Rimbaud, Max Jacob ou Jésus Christ» qui, bravant les lois de l'espace et du temps, sont les hôtes successifs du prêtre-poète.
«Inquiétants» ils le sont en effet au sens propre parce qu'ils obligent chacun de nous à vivre pleinement, dangereusement, généreusement. C'est dire si se cache un éloge sérieux derrière la qualification apparemment désobligeante : là est le sourire du poète qui imagine les commentaires d'un béotien qui ne comprend pas son sien abbé.
L'autre emprunt est encore plus étrange. Il s'agit du poème Possibilité du corps en trop (O.C. 349) où Cadou fait la relation d'une expérience quasi mystique dans un style de littérature policière. La quête spirituelle est traduite en terme d'enquête. La nuit de feu de Cadou c'est en somme du Pascal revu et très corrigé par Gaston Leroux. Le titre du poème en effet, à la nuance près de la préposition («de trop» chez Leroux, «en trop» chez Cadou) renvoie à celui du chapitre X du Parfum de la Dame en noir : «Démonstration corporelle de la possibilité du «corps de trop» !»
La plupart des «clins de plume» produisent une inflexion plaisante) même discrète. Dans quelques cas néanmoins, le sourire est contrarié par le pathétique. Ainsi des allusions à la Sœur Anne du conte («Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?» ...) : la distance créée par la réminiscence est comblée par l'émotion.
Ce genre d'intrusion n'est pas un parasitage nihiliste. Point ici de dérision amère, point de burlesque ironique, dégradant, pour balafrer négativement le lyrisme de confession. Cadou n'est pas Corbière (qui passait son temps à souffriramèrement) il ne remue pas le crayon dans la plaie de son rictus. Le lecteur goûte au contraire le soulignement pudique de l'humour qui, au plus fort de l'aveu, ménage une marge de lucidité, de doute sur soi, et finalement d'humilité. Rien ne serait plus dangereux que de se complaire dans une trop fière élévation religieuse. Cadou ne peut s'empêcher de ramener les plus hauts sentiments à des mesures humaines, très humaines, à ras de terre (humour et humus ont des points communs !), à ras du quotidien. Ajoutons à cela cette jubilation, souvent rencontrée, de mélanger cavalièrement les genres en favorisant allègrement des promiscuités interdites par la littérature amidonnée, plastronnante sinon plastrognangnante.
III. Parallélisme d'analogies au niveau des signifiants et des signifiés.
Dans cette ultime partie, plus courte mais plus riche du point de vue de la création poétique, il reste à examiner les systèmes parallèles d'analogies aux niveaux des signifiants et des signifiés. On a déjà rencontré, dans quelques cas de bisémie, une exploitation métaphorique séduisante comme dans le vers
Le lit-cage toujours privé de chants d'oiseaux (O. C. 275)
En jouant sur le mot «cage», le poète revivifie, une fois de plus, une métaphore étouffée sous le boisseau de l'habitude.
Cadou a très tôt réussi ce genre d'épanouissement poétique d'un simple fait de lexique. Dans ce vers de La Chambre ardente (O.C. 28), «Reste la chambre noire où l’âme se développe», il a su fortifier, de plume de maître, la comparaison de la chambre de solitude nocturne du poète avec la chambre de la chimie photographique. Comment ? En l'exprimant par deux mots à double entente «chambre noire» et «développe». Avec un sourire lesté de gravité, le poète formule la nécessité de croître douloureusement en un séjour symboliquement ténébreux, stade obligé de toute initiation ou mieux encore terreau constant d'une perpétuelle montée d'âme.
Au fond, si la parole poétique est capiteuse c'est parce qu'elle conduit le lecteur à voir double etou à entendre double. A voir double grâce aux surimpressions des images (cf. plan des signifiés, métaphores ou comparaisons), à entendre et comprendre double, grâce aux jeux divers des mots (cf. plan des signifiants). Dans certains cas, les deux ébriétés sont simultanées.
L'œuvre d'Apollinaire, si appréciée par Cadou, offre en ce domaine quelques joyaux. Qu'on songe au poème du Bestiaire, «Le lapin» qui est une constellation d'allusions érotiques :
Je connais un autre connin
Que tout vivant je voudrais prendre
Sa garenne est parmi le thym
Des vallons du pays du Tendre.
Le jeu sur les mots (connin con), renforcé par les homophonies (connais connin) et par le sens euphémique de «connaître» (connaitre une femme = la connaître sexuellement) ou de prendre (idem), entraîne une métaphore, filée avec quelque préciosité dans les trois vers suivants, tandis que rétroactivement le titre se colore érotiquement de sous-entendus («lapin(e)» «être un chaud lapin»).
C'est une complémentarité semblable qui donne une brillance exceptionnelle à cette image du poème Fusée Signal :
Ta langue
Le poisson rouge dans le bocal
De ta voix.
Aux analogies concrètes nombreuses (couleur, souplesse ondulante, consistance, « cavité humide, tourner sa langue dans sa bouche», «le poisson tourne et retourne dans son bocal» ...) qui unissent d'une part la langue et le poisson et, d'autre part, la bouche et le bocal, aux métaphores usuelles qui confondent l'eau et la parole («débit» «flot de paroles», «intarissable»..) s'ajoute un jeu sur le mot «bocal» qui, sans perdre sa morphologie normale, devient une manière de mot-valise, c'est-à-dire la condensation phonique de «vocal» et de «buccal».
J'ai eu la joie de découvrir que, chez Cadou aussi, les jeux de mots et les métaphores faisaient bon ménage, bon manège même puisqu'il y avait circulation d'effets des uns aux autres. Qu'on en juge par ce premier exemple :
Avec cette lampe aux œufs d'or
Sur la desserte de la neige (O.C. 306)
Ici, la métaphore (oeuf d'or ampoule électrique jaune de forme ovoïde) est exprimée dans un à-peu-près phonique réalisé («lampe aux» la poule ...) et dans un calembour implicite (la poule l'ampoule).
Soit maintenant le vers de Hors de moi :
L'étoile d'araignée brille dans la serrure
Le jeu de mot (l'étoile La toile) exprime une double métaphore l'araignée avec ses pattes peut faire songer au rayonnement sombre d'une étrange étoile, mais il est aussi possible de penser au tissage de la toile elle-même qui figure un ensemble de rayons stellaires.
Exploitation métaphorique aussi dans Les Circonstances du Drame :
... et la lampe Pigeon
Becquète tristement les graines du plafond.
(O. C. 300)
Les derniers exemples sont tirés de trois poèmes d'inspiration religieuse. Dans Après Dieu le Déluge, l'à-peu-près «enfoncé offensé» se complète pertinemment d'une allusion au Christ :
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncé
Dans la poitrine ce goût de vivre comme un clou rouillé.
Certes, mes références sont diffuses, mélangées, mais comment ne pas penser à la Passion ? Les clous de la croix, la lance qui transperça le flanc du Christ et ses paroles «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font» : ces détails amalgamés, tronqués, suggèrent l'idée d'une passion de vivre dans les deux sens de l'expression, amour fou et douleur. A noter aussi qu'une paronomase («goût» «clou») renforce le rapprochement.
L'admirable Nocturne contient plusieurs inflexions humoristiques. Deux jeux de mots, vers le début et vers la fin, encadrent une méditation sur la fringale et la soif du divin chez le poète. La polysémie des mots «office» -dépendance d'une cuisine, service religieux, officine (2) pharmacieux-tique - et «ardoise» (addition à régler : ciel gris-bleu comme l'ardoise du toit) correspond à une eucharistie très personnelle :
Que la cuisine soit bonne ou fade nous ne sommes point ici à l'Office
Sur l'ardoise du ciel
Si l'on tient compte de ce pays sans charme où je suis née...)
Seigneur, je suis exonéré !
(O.C. 346)
La communion lyrique se fait sous les deux espèces du solide et du liquide. La Sainte Table devient cosmique et gravement comique puisque «l'Hôtelier Sublime, le Préparateur des Idées Justes et des Plantes» apparaît familièrement dans un décor d'auberge rurale. Il est convié humblement par le poète à effacer de la grande «ardoise du ciel» l'addition lourde laissée par un gourmand des «biens de ce monde».
Une semblable familiarité mystique se rencontre dans Si c'était lui (O.C. 337). La paronomase «Nazaréen Nazairien» bipolarisé une profonde analogie, facilitée implicitement par le nom «Saint Nazaire» qui introduit dans le domaine religieux. La coïncidence des sonorités est indissociable de l'identification «marin Jésus». On songe au Christ qui se disait «pêcheur d'hommes», qui était homme parmi les hommes et qui proclamait : «Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez».
L'invitation à reconnaître Jésus sous des apparences peu avantageuses est spécifiquement évangélique. On voit pourtant que la différence est grande entre le Fils de Dieu et ce marin saoul qui, titubant et zigzaguant, demande (comble du paradoxe !) «la route toute droite de la mer» ! D'un côté, la voie, la vérité, la vie, de l'autre, la soif, le verre têté et vide ! Quelle transfiguration !
En ce domaine, Cadou, avec ses moyens propres, entre dans la petite confrérie des grands chercheurs de Dieu, qui, comme Max Jacob, présentent leur plus vibrante prière entre les parenthèses de leurs commissures labiales souriantes.
Conclusion.
Cadou s'en tient à la séparation des niveaux du signifiant et du signifié. La Cratylie, si chère à Gérard Genette (3), n'est pas son terrain d'élection poétique. On ne le voit pas établir des liens de similarité entre les signifiants et les signifiés. Mais, quand il joue sur les deux tableaux distincts des phonèmes et des sèmes, il ajoute à la trame plus ou moins serrée des analogies concrètes quelques ressemblances verbales bien venues. Les rapprochements des sons et des sens conjuguent leurs effets poétiques grâce à de délicats échos.
Les jeux avec les mots, même s'ils surprennent parfois comme un bref pizzicato de chanterelle sur une partie violoncélégiaque, ne tombent pas, pour parler à la manière truculente du Cadou épistojamilier, «comme des cheveux sur un bidet». Les sourires de vocables font des ronds dans l'eau, ils participent au surcodage poétique dans la mesure où se produit, presque toujours, un dégorgement judicieux de sens latent. Pourquoi ne pas parler, à ce propos, de «jeux de mots créateurs» en élargissant la formule «calembour créateur» que Marie-Jeanne Durry puis Jean-Claude Chevalier (4) ont si finement utilisée pour Apollinaire ? N'est-ce pas dans sa pratique mesurée des modulations verbales détendantes que Cadou est le plus pleinement poète puisqu'en démiurge accompli il impose au monde des signes un surcroît de cohésion ?
Jeu de mots, jeu d'images, jet d'émoi, bref, poésie mélancomique : la poésie cadoucéenne la plus achevée combine ces trois éléments, donnant tantôt à apprécier quelques pitreries de langage, voyantes comme le nez rouge d'un clown sur le jet de l'effusion lyrique, tantôt à s'émerveiller de l'arc-en-ciel renversé d'un sourire esquissé, instable, fugace, sur fond de lyrisme baigné de larmes très pures comme la pluie. Telles sont certaines des manifestations de la maîtrise d'un poète aux mètres irisés et parfois souririsés. Gloire à Cadou humo(t)riste qui chantait pour des oreilles certes «poilues» mais aussi fines et dont le sourire était aussi éloigné d'une dérision destructrice que d'une sensiblerie sans distance.
Notes
( 1 ) Cf. mon ESSAI SUR LES MOTS CROASES, Editions BOF, 1979.
La présence de Dieu dans la poésie de René Guy Cadou, par Jean Charles Payen.
A François Lapine, qui m'a révélé Cadou, et au poète François Lescuns.
Les remarques qui suivent sont celles d'un profane, qui n'a connu l'œuvre de René Guy Cadou qu'après la mort du poète ; qui pis est, ce profane est un spécialiste de littérature médiévale, et donc un chercheur qui, par la force des choses, interroge les textes et non la biographie des auteurs. Quelle était la sensibilité religieuse de Chrétien de Troyes ? Aucun élément biographique ne peut nous renseigner sur ce point, et force nous est, pour y répondre, d'analyser les textes que nous avons gardés de lui, sans pouvoir recourir à d'autres sources. Il n'en va évidemment pas de même pour un contemporain, mais de toutes façons, la trace qu'entend laisser dans la mémoire des hommes un créateur est moins le souvenir de sa vie que le témoignage de ses œuvres. C'est pourquoi c'est dans les seuls poèmes de René Guy Cadou que je veux mener mon enquête, quitte à renvoyer à la discussion de mon exposé la question de savoir si le Dieu qui est présent dans sa poésie est bien le même Dieu qu'il cherchait dans sa vie réelle. Ses amis sont nombreux ici, qui pourront m'éclairer sur ce point. Ce que je note d'ores et déjà, c'est qu'à lire ses écrits, René Guy Cadou m'apparaît comme un croyant engagé dans un long dialogue intime avec Jésus-Christ ; mais je dirai que ce croyant n'est pas très catholique, parce que sa religion est une religion sans Eglise et sans prêtre. Son Dieu est celui de l'immanence, le Dieu sensible au cœur, que l'on atteint dans le silence et le dépouillement. C'est aussi le Dieu qui se révèle à travers l'autre, dans la charité. C'est enfin le Dieu de la nature, qui se révèle à travers la beauté du monde créé. Mais ce qui me frappe le plus chez René Guy Cadou, ce n'est pas l'idée qu'il se fait de Dieu, et qui est assez simple (on y retrouve la Trinité du Père créateur, du Fils rédempteur et de l'Esprit qui fait aimer les gens, les êtres et les choses). Beaucoup plus significative est la démarche du poète pour rencontrer le divin : elle commence par une attente, par une soif de Dieu qui s'exprime sans cesse chez lui, et qui aboutit à une découverte de Dieu comme une parole au fond de soi et à travers l'autre que l'on rencontre. C'est alors que René Guy Cadou s'avère extraordinairement fidèle à l'esprit évangélique, même si sa religion occulte les aspects ascétiques du message chrétien. Trop sensuel, trop friand de vivre pour adhérer à une dévotion fondée sur le renoncement, il retient d'abord, dans la parole sacrée, la parénèse de l'amour. Mais il est aussi un poète, qui vit son art comme une joie et comme un calvaire. La poésie continue l'ouvrage des six premiers jours ; elle est don, souffrance, communion avec le crucifié ; à la limite -ô scandale pour les bien-pensants ! -, Arthur Rimbaud est un autre messie qui projette sur l'Histoire une poésie renouvelée... Ce sont ces aspects-là que je voudrais retenir, même s'ils sont partiels et fragmentaires, à partir d'un pèlerinage qui traversera quelques pièces d'anthologie : à de meilleurs spécialistes, le soin des inventaires et des confrontations exhaustives !
Celui qui a écrit dans Moineaux de l'an 1920 :
Je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement
définit sa foi dans ce poème qui est à la fois une quête de l'identité, une confession générale et un véritable credo. Son Eglise est celle du souvenir et de l'amitié :
J'ai revu cette nuit les compagnons de mon enfance
Qui pourraient vivre chantournés avec des barbes comme des crédences
Ce sont les prêtres de ma religion
Mais leurs fils ne sont pas dans le secret de notre Opération
Tu t'es fait des copains partout dans ta mémoire
René Guy Cadou ne se fait pas d'illusions sur lui-même, ni sur les épreuves qui l'attendent :
Je suis là pour tout accepter et je ne plaide pas innocent
Il sait que le Dieu qu'il cherche ne l'épargnera pas, et s'il affirme plus loin dans le même texte :
J’appareille tout seul vers la face rayonnante de Dieu
il sait ce qu'il en coûte de se mettre en quête, et d'attendre une parole qui tarde à venir. Cette longue et douloureuse écoute, il la chante dans Place Bretagne :
Mais la fée qui chantait dans la serrure est morte
Rien ne remplira plus mes paumes délabrées
Attente de l'ami, de la muse, de Dieu : tout se confond dans cette nostalgie où l'autre mystérieux, qui est à la fois Michel Manoll, le compagnon absent, le poète lui-même penché sur son enfance et le Christ mort, tragiquement lointain, devient comme irrémédiablement inaccessible et fuyant :
Où es-tu maintenant à quel anneau d'auberge
Auras-tu attaché ton cheval de bonheur
Pour quel Orient nouveau as-tu quitté la berge
Pour quel siècle doré laisses-tu passer l'heure
Je ne te cherche plus dans les ports et les bouges
Ni devant cette table où s'allumait ta main
Tu es loin dans la nuit et le ciel est tout rouge
Parce que ton beau corps saigne aux quatre chemins...
... Tu ne jailliras plus au tournant de la lampe...
Prunelles endormies de la Place Bretagne
Où vacillait jadis le cœur de mon ami
L'ombre a tout effacé lentement je m'éloigne
Celui que j'attendais ne viendra plus ici
Place Bretagne développe d'autre part dans sa strophe IV le motif du poète crucifié sur lequel je reviendrai plus tard. Ce poème énigmatique, né de la déception de René Guy Cadou devant la maison vide d'un ami dont il est sans nouvelles, se situe au carrefour de sentiments divers et d'images multiples qui tissent leur réseau sur un fond de vacuité désespérante et de disponibilité à la souffrance poétique. Je retrouve cette attente cette souffrance, et même ce mot réseau, exprimé en clair, mais avec un tout autre sens, au début de Nocturne :
Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance
Pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance
Oh ! je crois bien que ce sera à genoux
Mon Dieu ! que je me rapprocherai de vous !
Et il ajoute cinq vers plus loin :
O mon Dieu ! j'ai tellement faim de Vous tellement besoin de savoir
Qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires
Que la cuisine soit bonne ou fade nous ne sommes point ici à l'Office
Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lys !
Je crois en Vous Hôtelier Sublime ! Préparateur des Idées justes et des plantes
N'allez pas redouter surtout quelque conversion retentissante
Et qu'un tel ait choisi le pain dur et le sel
Soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel
Ce texte aussi est une profession de foi. Son « fonctionnement » poétique se déclenche en quelque sorte à partir du mot « faim ». Dieu est celui qui apaise la famine spirituelle, dans ses réfectoires d'hôtelier sublime qu'il ne faut point confondre avec l'Office. Le terme prend alors un double et même un triple sens : celui de local aménagé pour la cuisine, celui d'office religieux, voire celui de laboratoire où opère le Préparateur des remèdes qui guérissent les maux de l'être. Mais l'adhésion au divin n'est pas une ascèse : le poète hume de tous ses sens les fleurs qui décorent les tables, et ce n'est pas lui qui choisirait la pénitence du pain et du sel. Il vient à Dieu avec son passé de dissipation qu'il confesse ingénument :
Ah ! Je me suis conduit de façon ignoble dans les cafés...
... Pardon Seigneur ! Pardon pour vos églises
Et si j'ai galvaudé dans les champs
Si j'ai jeté des pierres dans vos vitres
C'est pour que me parvienne mieux Votre Chant !
ce chant qui est à la fois celui de la liturgie et aussi la poésie que Dieu souffle au poète comme une autre révélation. Mais le poète est comme inhibé dans sa quête, à cause de sa propre pesanteur, et à cause du respect humain :
Car maintenant tout est devenu subitement si difficile
A cause de cette pudeur en moi et de l'orgueil également imbéciles
Que je voudrais ramper vers Vous j'en serais encore empêché
Par cette dérision de l'Acte qui est dans l'ordre de la Société.
Mais Vous quand Vous mourûtes sur le Golgotha
Dites ! Qu'est-ce que ça pouvait Vous faire le ricanement de ces gens-là ?
Le Christ crucifié offre son amour à travers la beauté du monde :
O mon Dieu que la nuit est belle où brille l'anneau de Votre Main !
Tous ces feux mal éteints dans l'air et ces yeux de matous en bas qui leur répondent
Ce cri d'amour fondamental qui est celui de notre pauvre monde !
C'est pourquoi la miséricorde l'emportera sur la colère lorsque comparaîtra devant le Souverain Juge celui qui a souffert :
Heureux celui qui naît en juin parmi les nielles
Il connaît la beauté des choses éternelles !
Oh ! sur l'ardoise du Ciel si l'on tient compte
De ce pays sans charme où je suis né
Si l'on juge à propos mes larmes
Seigneur ! je suis exonéré !
Qu'il soit coupable, non-coupable
Toujours en peine de son Dieu
Qu'on lui serve pour vin de table
La rosée lustrale des Cieux !
René Guy Cadou a-t-il le sens du péché ? Oui, dans la mesure où il se découvre dans ses faiblesses ; non, dans la mesure où il s'encombre peu de repentir. Il va à Dieu comme il est, sans chercher à revêtir l'habit des noces. Il fait en lui le vide, s'enferme dans la nuit et guette la parole :
Je cherche un homme en moi
A qui parler
écrit-il dans La Solitude après avoir fermé sa porte sur le monde :
Bel arbre noir dans cette chambre
Je te pare de tous mes soucis
Derrière moi
C'est le bruit d'ailes des portes
Qui se referment.
Son Dieu est alors le Dieu caché, le Dieu intime, le Dieu de l'oraison. René Guy Cadou est, en effet, à sa manière, une sorte d'orant : il contemple le Christ en croix ; toute une part de son être tend vers cette contemplation ; mais le poids de sa fragilité le ramène vers lui-même et lui permet de se juger sans concessions, quoique dans l'espérance. Il y a là un christianisme authentique, christianisme de l'immanence, qui n'est pas contradictoire, loin de là, avec l'ouverture aux autres et au monde. Mais le dialogue du poète avec le Christ signifie aussi autre chose : que René Guy Cadou n'est pas panthéiste, malgré sa conception d'un univers pétri et traversé par le divin. Sa foi est avant tout une relation de personne à personne, comme le manifeste entre autres le dialogue : Lilas du soir qui est une conversation familière entre le poète et Jésus. Je n'insisterai pas sur ce texte, sauf pour dire qu'une fois de plus, le visage christique y apparaît simple, accessible, nimbé de souffrance. C'est celui de Jésus enfant à Nazareth :
La petite cour d'école à Nazareth. Et ce camarade qui te ressemblait ô mon poète...
C'est aussi le visage de Jésus jeûnant dans le désert, et l'obsession de la Croix :
Ah ! Cette croix devant mes yeux sur mon dos, devant mes yeux, ici, très loin et pour toujours.
En réponse, René Guy Cadou se contente de se dire, dans son amour de la vie et dans sa multiplicité :
... Je ne suis pas un, mais tout ce qui rampe, qui danse, qui dort.
Je suis le chèvrefeuille brûlant de la lampe, la parole des ramiers, le pas des sources. Je suis présences...
Le Christ monologue, le poète monologue, et ces deux discours pourtant s'enchevêtrent et se compénètrent. La communication se renoue sans cesse entre l'homme et son Dieu, même si ce Dieu n'est pas toujours immédiatement perceptible. Souvent, on ne s'aperçoit de Sa présence que lorsqu'il est passé, comme à travers une trace de lumière et de bonheur. Il a illuminé ce qui était ombre et silence :
La porte est ouverte
Les rideaux sont tirés
Ta place est retenue sous la lampe déserte
Laisse ton cœur avant d'entrer
Parle bas
Regarde
Le Seigneur a dû passer par là
(La maison riche)
Celui qui a pu écrire :
Le Christ est devenu mon plus proche voisin
savait par expérience que son Dieu était d'abord son prochain, celui que la Providence avait placé sur sa route. Et en premier lieu certaines figures transfigurées par le souvenir d'enfance, comme celui de sœur Chantal qui avait donné à Cadou sa formation religieuse :
Ah ! Sœur Chantal qui êtes près de Dieu
Et si bien me connûtes
Dites-lui que mon enfance est tendue sur moi
Comme les cordes d'un luth
(Mémoires. Hélène II
Sœur Chantal qui intercédera pour lui, selon le mystère de la communion des saints, avec d'autant plus d'efficacité que Dieu aime les hommes qui ont su préserver leur esprit d'enfance. C’est ce que dit d’une autre manière Pour plus tard, où René Guy Cadou feint de se citer au cours d'un dialogue imaginaire entre le poète et son lecteur :
Mon Dieu pardonnez-moi d'être sans volonté
Je suis malade de luzerne et je fréquente les cafés
J'ai bu bien davantage que de coutume des absinthes
Mais Bernadette et Sœur Chantal sont les Saintes.
Je me permets de citer pour le plaisir la fin de ce texte : le discours intime du lecteur en face du poème et la conclusion que Dieu lui-même tire de ce singulier dialogue :
... O mon Dieu se peut-il que ce poète
Me mette des douleurs de ventre dans la tête
Que je m'enfante et que je vive en moi comme un posthume enfant
Qui souffre de rigueur et renifle en plein vent
Et le Seigneur dira : Bénis soient de la gare
Les bistrots pour t'avoir redonné la mémoire.
Mais le Christ est aussi partout où l'homme souffre et meurt. Il est au milieu des Fusillés de Châteaubriant qui périssent dans l'amour :
Ils sont bien au-dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du martyre...
... Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose simple
Puisque toute liberté se survit.
Le Christ s'identifie à tout persécuté, comme l'exprime le poème Si c'est cela qu'on fait au bois vert :
Si c'est cela qu'on fait au Roi des Juifs
Que fera-t-on au Pauvre Nègre ?
L'un brillait avec les planètes
L'autre n'a qu'une chandelle de suif
Encor l'a-t-il volée ! Et c'est cela justement qu'on lui reproche
Mais le Christ s'identifie aussi à ceux que l'on appelait au XVIIe siècle les malotrus et qui sont devenus les handicapés, comme Le Jeune homme de l'hospice affligé d'un strabisme monstrueux qui le rend presqu'aveugle.
Très beau de la beauté spéciale des apôtres
C'est un simple d'esprit dont le visage niais dissimule bien des mystères :
Que viens-tu me conter ? Que comptes-tu m'apprendre
Que je ne sache point qui me fasse descendre
Un peu plus dans la nuit et l'abandon de soi
Jeune homme de l'hospice au visage de roi ?
Ce poème sur un portrait de Roger Toulouse manifeste la pitié du poète pour les déclassés et les marginaux, cette pitié qui est sensible aussi à la fin de Rue du sang :
Un doux clochard abrite en ses mains un oiseau
Ivre à midi il se signe dans le ruisseau
Il éclabousse tous les yeux de ses prunelles
Quand il veut repartir c'est le Christ qui chancelle
Dieu, pour René Guy Cadou, est partout, dans l'autre, dans la nature. Mais il est surtout présent dans la démarche poétique elle-même qui est recherche d'une vérité à la fois immanente et transcendante. La vraie religion de notre poète, ce n'est pas seulement l'amour, mais c'est également la poésie c'est-à-dire, peut-être, une forme privilégiée de l'amour...
Cette poésie, René Guy Cadou la ressent comme une urgence. Ses jours sont comptés, et il en est conscient. Pas une minute à perdre : il faut obéir sans tarder au devoir de glorification. C'est ce qu'énonce de façon bouleversante la part de Dieu :
Fais vite
Ton ombre te précède et tu hésites
Derrière toi on marche sur tes jeux brisés
On referme la porte
Et les heures sont comptées
Mais la vie la plus courte
Est souvent la meilleure
Tu diras au Seigneur
J'apporte mes mains vides
Le peu de sang liquide
Qui frôle encore mon cœur
Ces regards sans fierté
Ce manque de chaleur
La croix que vous m'offrez
N'est pas à ma hauteur.
Le poète est à sa manière un crucifié, mais un crucifié indigne, un élu qui assume sa vocation dans la gloire et l'humilité. Il rampe en quelque sorte vers l'infini, dans un état de doute fondamental sur soi-même et sur sa propre parole. Nous retrouvons ici Place Bretagne, et la strophe que nous n'avions pas citée tout à l'heure :
Poète crucifié par ta volonté même
Pâle de ta pâleur amoureux de tes clous
C'est ta croix que je porte en portant le poème
Et je n'avance pas si je marche à genoux
Le devoir de poésie est une tâche messianique : il s'agit de capter les voix de l'univers, de les prendre en charge et de les hausser jusqu'à Dieu comme une prodigieuse offrande. C'est ce que dit Le Chant de solitude : il s'ouvre sur une audacieuse référence au sermon sur la montagne et se transforme en hymne à la nature :
Laissez venir à moi tous les chevaux toutes les femmes et les bêtes bannies
Et que les graminées se poussent jusqu'à la margelle de mon établi
Je veux chanter la joie étonnamment lucide
D'un pays plat barré d'étranges pommiers à cidre
Voici que je dispose ma lyre comme une échelle à poules contre le ciel
Et que tous les paysans viennent voir ce miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles
Etonnez-vous braves gens ! car celui qui compose ainsi avec la Fable
N'est pas loin de trouver place près du Divin dans une certaine Etable !...
Que mon Chant vous atteigne ou non ce n'est pas tant ce qui importe
Mais la grande ruée des terres qui sont vôtres entre le soleil et ma porte...
Ce qui frappe dans ce passage, c'est aussi le contraste entre la démarche du poète, qui confère au monde sa dimension de sacré, et la simplicité de son langage, qui s'adresse à des humbles avec des termes et des images délibérément empruntés aux réalités les plus familières. La lyre est une échelle à poules, et l'alchimiste du verbe grimpe après les voyelles. Le délire satanique de Rimbaud devient un artisanat rural, à hauteur d'homme. Point de saison en enfer, Cadou se proclame disciple de son grand devancier. Il l'affirme dans son poème La nuit lorsque les femmes très pieuses où il fait de Rimbaud un nouveau Christ
Jésus comptait trente-trois ans
Quand tu revins d'Abyssinie
Trente-trois ans le Paradis !
Trente-sept la sépulture !
Dis ! Jean Arthur es-tu mon Christ ?
Tes quatre membres sur la croix
Fusées de ce feu d'artifice !
Et le poème s'achève sur une sorte de cri :
0 poésie !
Rimbaud ! Rimbaud !
Autre maître vénéré : Guillaume Apollinaire. Comme lui, René Guy Cadou a été tenté par la vocation religieuse, et comme lui, il a choisi une autre voie royale, celle qui va vers le chant en passant par la femme
Je ne suis plus ce que j'étais et si je m'écoutais je me ferais prêtre ou religieux
Voilà ce qu'écrivait Apollinaire à Madeleine d'adieu
Tant il est vrai que si l'amour vient à manquer il n’est nul héritage
Qui puisse combler la vacuité des sens et cette absence de corsage
Ni les approches de la gloire ni les caresses des amis
Qu'est-ce qui peut germer du sol quand on a piétiné les semis
O mon amour ! ce n'est pas seulement à travers mon Lied que je te chante
Mais dans la pousse de ces mains levées vers toi comme une promesse de plante...
... Je me suis retrouvé plus d'une fois dans l'aube
Avec tout juste ce qu'il faut de corde pour se pendre
Et c'est peut-être et c'est sûrement pour cela que je t'ai aimée
Hélène ! dans mon verre comme une goutte de rosée.
( Lied)
L'amour de la femme, source principale de poésie et de salut : le dossier qui s'ouvre ici est considérable, et je ne l'aborderai pas, sauf pour réaffirmer qu'aux yeux de René Guy Cadou, le désir charnel, loin d'être contradictoire avec l'oraison, participe de cette adhésion au monde qui est hymne à la gloire de Dieu. Le poète est le découvreur de l'univers, dans sa totalité confuse de grâce et de péché. C'est ce qu'exprime La Découverte de l'Amérique, ce nouveau Bateau ivre très rimbaldien que le poète écrivit en 1942, où le mythe, cher à Paul Claudel, de Christophe Colomb pèlerin de l'espace) se déploie dans un fourmillement de métaphores violentes :
Amour mon compagnon que s'allume la voile
Que cet horrible sein la fasse monter haut
L'étrave de nos fronts a fendu les étoiles
Et jamais notre ciel n'a connu de repos
Buvez voici l'alcool ô lèvres mensongères
Pour ton ventre voici le doux venin du blé
La mort n'a pas franchi les noirs embarcadères
Et rien ne troublera ces hommes attablés
Mais qui pleure ce soir quand la fièvre me gagne
Quelle gorge si belle où planter le couteau
Peaux rudes vous faut-il la misère d'un pagne
A vous que j'ai cousues dans les plis d'un drapeau...
... Vois c’est ma propre main qui fouille tes entrailles
Océan maladif aux pâles intestins
L'écume est sur ma bouche et quand je fais ripaille
C'est ton sang que je bois pour clore le festin...
... Déjà j'en ai trop dit et ces oiseaux qui passent
Portent dans leurs duvets les odeurs de là-bas
De mes yeux lentement les tiges bleues se cassent
Et j'agrandis le ciel pour la première fois
Merci à toi Seigneur et que je vous bénisse
Douces plaies éclairées par l'astre de la croix
Seigneur il est bien temps que ces larmes finissent
Que tu marques nos fronts du grand signe des rois
Ce texte est lui aussi une confession lyrique où René Guy Cadou chante l'errance et l'ivresse et la quête indéfinie d'un ailleurs. Mais tout à coup le ciel incertain et tourmenté du poète se déchire et s'élargit à des horizons insoupçonnés. Contre la fièvre, contre l'angoisse, contre les larmes, l'illumination d'un soleil qui n'est plus la « céréale de sang » évoquée dans la strophe I (non citée), mais une lumière intérieure éblouissante, celle de l'astre de la croix. Cet astre est à la fois celui de l'oraison et celui du poème. Et le dernier vers se souvient peut-être de la première épître de Saint Pierre :
... Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière... (II, 9).
Mais ce sacerdoce royal est aussi celui du poète glorificateur, écho sonore, mage, phare (et René Guy Cadou assume sans réserves cet héritage romantique et baudelairien). Le destin d'abord chaotique de ce prophète malgré lui passe par une déchéance relative et provisoire qui s'achève du jour où la parole s'investit dans la totalité de son sens. Le calvaire de la création qui est un calvaire mortel, au sens propre) aboutit au don du poème qui se célèbre en termes mallarméens :
J'ai trop vécu sous le boisseau et dans l'attente
D'une nuit d'Idumée que de patients oiseaux
Feraient neiger sur les décombres de ma chambre
Comme un miroir promis à des soleils nouveaux
Mais voici qu'aujourd'hui un homme entre les hommes
A choisi par-delà ses astres préférés
La planète déchue tombée comme une pomme
Sur la dernière marche de l’éternité
On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison (Mats., V, 15). La planète déchue n'est pas seulement la terre livrée au péché originel ; elle métaphorise aussi le poète que les anges, ces « patients oiseaux » -ou n'est-ce pas plutôt la colombe du Saint Esprit ? - n'ont visité qu'à son insu, alors qu'il se croyait indigne d'une quelconque révélation. Mais le miroir enfin reflète des soleils nouveaux. Que la lumière soit, par le don du poème.
Je disais tout à l'heure que René Guy Cadou n'était pas un poète très catholique. Catholique, il l'est pourtant, si l'on donne à ce mot son sens étymologique, qui implique la prise en charge d'une totalité. René Guy Cadou est bien un chantre de l'univers, mais cet univers n'est pas celui du vertige cosmique. Il se saisit dans sa réalité familière, à partir du paysage proche, avec ses arbres noueux, ses animaux placides, et la foule des gens que l'on croise et que l'on interpelle. Ce regard sur le monde est celui de l'enfant, dont les yeux simples n'ont pas encore perdu la vertu d'émerveillement. Préserver en soi l'enfance, malgré les chutes et les compromissions...
C'est ainsi que se découvre Dieu, dans la nature et dans les êtres. Ce Dieu qui est partout et qui est d'abord au fond de soi, comme une voix qu'on ne veut pas entendre. Comme une voix qu'il faut ensuite retrouver par le silence intérieur, et par une douloureuse écoute qui passe par l'expérience de sa propre faiblesse.
Le poète a le privilège insigne de traduire sa prière en chant. Il peut donc transmuer le sensible en cantique de la Création. Ma référence à frère François n'est pas du tout arbitraire : Cadou se souvient de sœur Chantal qui lui lisait les Fioretti, et lui-même, dans son humilité comme dans son ambition, est une sorte de Poverello profane et charnel qui refuse le contemptus mundi. Au contraire, il concilie l'attente de Dieu et le dérèglement de tous les sens prôné par son maître Rimbaud.
C'est pourquoi son Eglise n'est pas celle des Papes et des Conciles. A la rigueur, elle serait l'Eglise des sanctuaires campagnards qu'il aimait visiter au cours de ses promenades. Mais elle est avant tout une Eglise du dialogue intime et de la communion des saints, autour d'un Christ qui n'a plus rien du Pantocrator. Aux mystères glorieux de la foi, René Guy Cadou préfère les mystères douloureux, ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, qu'une grande partie de son œuvre n'ait pas été rédigée ad majorem Dei gloriam.