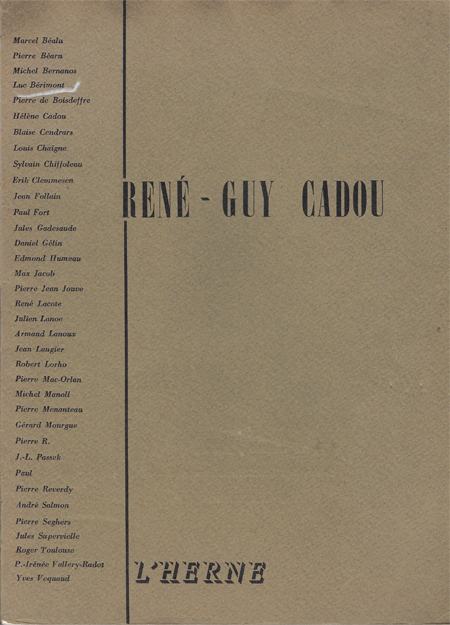
Avril 1961
Cahiers de l'Herne numéro 1 consacré à Cadou
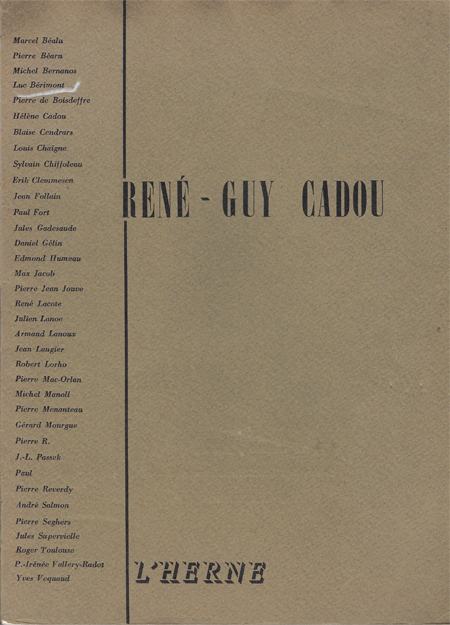
Avril 1961
Les biens de ce monde
L'Herne, page 3
Je suis las de fêter l'anniversaire de ma naissance
Avec de très vieilles gens et des amis de connivence
Te souvient-il de tes six ans
En sarrau noir et les genoux saignants
Tu pleurais dans les cours navrantes du collège
A cause du soleil du ciel et de la neige
J'ai oublié tes premiers vers Tu m'écrivais
Sur des feuillets couleur saumon que tu volais
A tes parents Nous fûmes du même voyage
Marins du même bâtiment Dans la peine et dans le naufrage
Gardiens des mêmes sentiments
Mais à quoi bon renouer
A quoi bon revenir à pas lents dans l'allée
Et susciter au bord de l'ombre du mystère
Il s'agit aujourd'hui d'un autre anniversaire
Et par avance de fêter ce jour ah! ce jour
Où je glisserai dans la terre ainsi qu'en un pantalon de velours
Mais n'étant pas exactement fixé
Sur la date du jour et le mois de l'année
Trois cent soixante-cinq ou six fois je célèbre
Le chapitre dernier et la mort du poète
Chaque jour de ma vie donne lieu à des joies
Qui ne sont pas celles des mourants et si j'en crois
La vigueur de mon sang et les anciens prophètes
Beaucoup de routes passeront sous ma fenêtre
Longtemps je marcherai à travers bois et champs
Avant perquisition finale des agents.
René Guy Cadou
Lettre de Pierre Seghers.
L'Herne, page 4
Chère Hélène Cadou,
C'est par vous — et par Jean Rousselot — que j'ai connu René Guy Cadou, je ne l'ai jamais rencontré.
Ceux qui furent ses amis diront mieux que moi quel homme il était, encore que la poésie de René Guy Cadou donne de l'homme une image aussi vivante, aussi juste, aussi vraie que devaient l'être sa poignée de mains et son regard.
J'aime, vous le savez, cet accord entre l'homme et sa poésie. Une motte de terre, un être humain, un langage, ce sont pour moi des équivalences auxquelles je me réfère. Il y a dans Cadou un tel accord que c'est la terre même qui pourrait se mettre à murmurer, à fleurir. Rien chez lui qui soit du bon faiseur, ou maladroit : sa poésie est comme une plante, comme un arbre en elle circule une sève, franche comme le sang, et sous cet arbre, Cadou, c'est à la poésie qu'on rend justice.
Cadou est d'ores et déjà un poète classique. Il a franchi en quelques années cette distance dans le temps qui sépare les poètes de leur public, il a conquis d'emblée une audience populaire : cela n'est pas un miracle, je trouve que c'est tout naturel.
Il y a dans la poésie de Cadou une musique qui est pour moi un enchantement, je veux dire une sorte de philtre qui m'enchante. En un temps où l'insolite, le discontinu, l'amertume et les drogues, veulent faire passer les annexes de la poésie en place du château, n'est-il pas surprenant qu'un poète mort, il y a quelques années, soit l'un des plus vivants et l'un des premiers sur la scène poétique. La France est le pays du val d'Enfer mais aussi le pays du val de Loire et les livres de René Guy Cadou sont, pour moi, à l'image de cette diversité française, chant et tendresse, cette force aussi qui font de lui l'un de nos poètes les plus représentatifs.
Qui donc mieux que lui aura suggéré tout ce qui nous tient à cœur, qui mieux que lui aura évoqué par les sortilèges du langage l'odeur d'une veste de garde-chasse, la pendule, le vaisselier, et ce torrent de la vie qui soudain passe dans le cœur, ce cœur solitaire qui chante pour tous et qui voudrait tout irriguer. Sa poésie est chaude, humaine, frémissante. Elle est aussi admirablement écrite, avec un langage qui sait être fluide ou fort, nourri d'incantations, un langage qui s'est fixé dans la mort et vous tient compagnie. On n'oublie pas un poème de Cadou.
Cette poésie se fait sans cesse des amis nouveaux : œuvre d'amour, elle reçoit l'amour.
Je crois, Hélène, que Cadou devait être comme ça, et que vous demeurerez avec lui un peu de cette terre qu'il aura fait fleurir.
« L'Enfance et autres lieux », Hélène Cadou
L’Herne, page 6
En cet avant-printemps 1961, nous sommes quelques-uns à nous souvenir. Comment parler ? Comment livrer au jour les plus secrètes réserves du cœur. L'horloge ne bat plus. Le temps s'est arrêté. C'est avec des silences qu'il faudrait te nommer, ou bien simplement t'approcher avec des noms de choses quotidiennes.
On n'ose s'aventurer dans l'anonymat qui est douleur. Mais ici, le pain, la table nous rassurent. Tu nous apprends à voir le ciel dans la fenêtre. Tu donnes à l'objet toutes ses chances.
Si le mot jour m'étonne chaque matin, la réalité même du jour en est renouvelée. Où trouver place pour la mort, ce mot dont tu n'as pas voulu ?
*
La table n'est jamais, pour aucun de nous, la seule table débonnaire de l'étude ou du repas familial. Dès l'enfance, comme une infraction aux « vains travaux du temps », le Pourquoi des choses nous est posé, et, toute la vie, nous cherchons la réponse.
Réponse était la neige sur la mer, réponse l'aéroplane dans le ciel.
J'allais m'asseoir au fond du jardin dans une enceinte de planches dérisoires ou l'on entassait la provision de charbon. Là j'invoquais en tâtonnant, l'ordonnateur des « idées justes et des plantes ».
Seul un vrombissement détruisait le silence. Mais que la technique eût conçu un outil volant dont le raffinement égalât presque celui d'une aile d'ange suffisait à mon ravissement.
A sept ans, comme tous les jeunes êtres, j'avais la fantaisie de l'absolu. I.es assomptions, les échelles de Jacob, les tentatives icariennes me séduisaient.
Aujourd'hui je songe (mais tout est facile quand on déroule le film à l'envers) qu'un autre enfant s'essayait alors aux mêmes jeux à quelques vingt kilomètres de moi.
Une heure à peine aurait suffi pour la distance et pourtant il fallut de lentes années d'attente et de mûrissement pour que ces deux enfants des années 1920-1930 fussent enfin prêts pour la rencontre.
Nous habitions au bord du même océan des grèves très voisines, nous avions au fond de l'âme les mêmes paysages et nos premiers châteaux furent bâtis dans le même sable. Cette fraternité qui nous liait comme des algues, comme les pluies de la Brière, nous devions aussi la partager un jour avec le cher Michel Manoll.
A Pornichet où j'habitais, les marais s'étendaient à deux pas de l'école, passé une sorte d'étier-frontière. A Sainte-Reine, René esquissait déjà le départ en poésie, apprivoisant ses rêves, convertissant de nouveaux territoires à la seule réalité.
Je frappais des poings aux portes, attendant la subite clarté. Comme la petite marchande d'allumettes, j'aurais voulu brûler d'un coup toutes mes réserves d'espoirs pour mieux dérober l'éclatante vision.
Mais, seule, je tentais eu vain de soulever le rideau des nuits
*
Plus tard, à Nantes, j'eus quinze ans. Dans le Jardin des Plantes, luisaient doucement les feuillages exotiques des magnolias et des tulipiers. Sous leur ombre, achevaient de s'académiser les bustes de Jules Verne, de Sophie Trébuchet et d'Elisa Mercœur, cette poétesse dont le nom seul était pour moi tout un programme.
Ai-je jamais donné à l'absolu un autre visage que celui de l'océan, qui battait nos portes ? Rue Crébillon, le jeudi, il me semblait percevoir une odeur de marée. Je me laissais emporter à perdre cœur vers les hautes contrées de la ville où le havre d'une petite chambre accueillait les premiers murmures, les premières tentatives pour rendre l'univers plus transparent, plus cohérent.
Un jour, en 1937, pendant le repas du soir, mon père, ne sachant-pas qu'il se faisait le messager du sort, me tendit un mince recueil de poèmes que j'ouvris. Et soudain, les « Brancardiers de l'aube » me tendirent cette échelle de soie que j'avais attendue toute mon enfance.
Je me souviens des larmes que je versai ce soir-là parce que mes frères, tels Thomas, refusaient de voir « la lampe s'enfoncer dans la table », et « le silence broyer ses doigts ».
Ce fut la guerre et les années 40. De René Guy Cadou, je ne connaissais qu'un nom et des poèmes. Puis vint le 17 juin 1943, par un matin maussade et triste ; il pleuvait comme il pleut toujours au mois de juin dans ma mémoire.
Arriverai-je à temps pour le train de 7 h. 25 ? En ai-je même le désir ? Je me retrouve, endormie et sans un sou, dans un tramway qui monte à regret vers la ville. A cet instant, j'ai l'impression aiguë que le destin m'offre une chance d'échapper à ce voyage, décidé la veille, qui m'apparaît tout à coup, lourd de sens. Je descends, reviens à la maison, repars sans conviction vers la gare, tickets en poche. Dans le hall un employé interrogé, me répond :
-« Le train de Clisson ? Il démarre ».
Alors, une envie irrésistible de partir me prend. Je cours vers le guichet, bouscule un jeune homme maigre, qui se retourne furieux:
- Où allez-vous ?
- A Clisson.
Silencieusement, il prend nos deux billets. Comme le convoi s'ébranle, nous échouons dans le dernier wagon, sur des sacs postaux. J'apprends alors que le jeune homme s'appelle Lozach'meur. Il va, comme moi, à Clisson, voir le poète René Guy Cadou.
Sur le quai d'arrivée, il nous fut facile de retrouver quelques amis avec lesquels je devais faire le voyage. Il y avait là une étrange polonaise nommée Irène et qui sortait des prisons allemandes, un très jeune garçon aux cheveux gris, un autre plus âgé qui avait organisé l'expédition pour discuter avec Cadou d'une collaboration à une plaquette nommée « Sillage ».
Nous ne fîmes pas cinquante mètres, Cadou s'avançait vers nous, de sa démarche chaloupée. Combien de fois, en souriant, avons-nous depuis revécu cette minute où nous nous sommes d'emblée « reconnus » !
Il avait un complet gris, une chemise verte, d'épais cheveux blonds ondulés, une belle tête assez lourde, des yeux très bleus qui le livraient d'un seul coup, dans toute sa vérité d'homme et de poète. Nous nous regardâmes, je lui tendis la main. Ce fut très court et définitif. Nous n'avons jamais oublié ni l'un ni l'autre ce regard.
Il avait pris le bras de son copain Lozach'meur, nous laissant ostensiblement par derrière.
Cadou habitait une mansarde perdue au troisième étage d'un hôtel réquisitionné par les Allemands, l'hôtel Milaguet.
O Milady, les Trois Mousquetaires, les vieilles auberges à l'odeur d'écurie et de jambons ! Pourquoi ce morne relai de la soldatesque, nous dit-il irrésistiblement penser à de glorieuses aventures, des bijoux de la Reine au Palais de Buckingham ? Nous étions loin du compte L'hôtel dressait ses lourds bâtiments derrière une poterne qui n'avait même pas l'audace d'être sinistre.
Dans la grande salle, les Allemands jouaient aux cartes, en avalant d'innombrables omelettes. Et là-haut, il y avait une petite chambre blanche, soigneusement rangée, avec une commode de campagne aux tiroirs pleins de mystérieux dossiers, une chaise, un pot d'émail une fenêtre ouverte dans le toit, sur un grand jardin en pente, et tout là-bas, derrière le château du Seigneur Olivier de Clisson, la longue prairie aux Chevaliers.
Mais dans la petite chambre blanche, même pas une table pour écrire ! Et, le jour comme la nuit, les bottes martèlent l'escalier. Il n'y a qu'un pauvre poète exaspéré à qui son bien le plus cher, la solitude, est interdit.
*
Vers le soir, notre bande se trouva échouée, au fond d'une salle à manger rose, derrière un bistrot couleur d'anis, où nous dégustâmes de frauduleux pernods qu'il fallait bien trouver délicieux puisqu'ils étaient si rares.
Il y avait là Kierkegaard, les frères Karamazov, et trois petits chats dans un chapeau. L'équilibre de mon cœur était affreusement précaire.
Lorsque Cadou me dit au-revoir, sur le quai de la gare, au crépuscule, la pluie avait enfin cessé, quelques rayons très doux doraient les toits. Nous n'avons pas échangé trois paroles au long de cette journée mais j'emportais l'approbation muette de ses Amis les Anges et nous avions bu, sans le savoir, au même verre, le philtre enchanté.
*
Puis j'ai vécu à l'ombre de René. Je l'ai vu sans cesse à l'écoute du monde. Il m'a toujours semblé que, pour lui, le mot de vocation, porté à sa plus intense signification ait voulu dire non seulement être appelé, mais être appelé à donner une voix. Ainsi René aura été aux aguets de l'univers pour ensuite donner une voix à cet univers. C'est, je crois, la vocation de tout poète. Chez lui, elle fut exemplaire.
Il a offert à certaines choses, à certains êtres dont je suis, et qui, sans lui, n'auraient pas été, une existence et un langage.
Les chiens qui rêvent dans la nuit, la calville qui est une espèce de pomme, le lit-cage privé de chants d'oiseaux, le wagon rose orné d'un panier à salade, sont, de par sa volonté, sorti du néant, pour trouver une existence dans le monde des choses animées et nommées.
Mais ce don est un don d'amour qu'il aura payé de sa vie même.
L'artisan-poète œuvre sur une matière divine et cette brûlante réalité use peu à peu, tel un radium, les forces de qui ose l'affronter.
René, en toute lucidité, a donné sa vie pour nous laisser les Biens de ce monde. Il nous a révélé dans la souffrance, leur poids et leur beauté.
Parce qu'il les a nommés, les arbres prennent désormais racine au fond des siècles, le mur à la chaux ne peut être celui d'une prison, le jour est là debout comme un ami et mille mains se tendent afin que la tristesse soit aussi fraternelle et généreuse que la joie.
Parce qu'il avait dit :
« Mille tendresses à vous tous
Que je ne connaîtrai jamais... »,
son sacrifice ne fut pas vain. Sa vie fut si pleine d'amitiés, de poésie, de connivence avec les êtres, qu'elle se perpétue aujourd'hui aux quatre points cardinaux.
Hélène Cadou. 15 Février 1961.
Découverte de Cadou par un intellectuel scandinave, Erik Clemessen
L'Herne, page 11
Rien à faire. Le trajet de Nantes-Copenhague fut trop long, pour être fait dans un seul trait. Il fallait abréger le voyage et descendre une nuit à Paris. L'occasion d'anabase fut les noces d'or de mes parents « de contrebande » à Nantes. Bien sûr, selon les enregistrements officiels mes aïeuls depuis des siècles sont des scandinaves, mais depuis l'invention des carte-postales et des ans, où mon père faisait service militaire au Saint-Cyr, chaque semaine des lettres, des petits-mots, ont volés entre la France et le Danemark. Les familles se connaissent et s'aiment, durant les premiers quarante ans seulement par les lettres griffonnées. Plus tard en vrai bidoche. Drôle d'amitié. Sans reproche, pendant quatre générations déjà —que de tendresse.
Eh, bien, certainement vous connaissez « Breize » et la ville de Nantes, cette chère vieille demeure d'édict, (Lefêvre Utile et inutiles), ses tramways, déjà historiques, ses bombardements, ses chantiers, le transbordeur (aussi disparu), ses boîtes de conserves. Mais rien change plus vite, que le visage d'une ville, hélàs ! Et pourtant ! J'ai jeté mon cigare dans la Loire, apparemment avec un mouvement ridicule de respect, car les femmes âgées m'ont
regardé. Leur étonnement me rappelle à la prudence… le passé déjà fini, car c'était d'abord Henri Beyle, qui jeta son cigare en 1837, je n'ai que suivi son exemple 130 ans plus tard mais exactement avec le même effet. Qu'ils sont entêtée que les Bretonnes...
Le soir du séjour à Paris se passait au théâtre. La pièce avait comme titre « L'honneur de Dieu ». Mais vainement on se demandait de quel dieu il s'agitait. Et encore, si on préfère les déesses ? Le repas fut bien maigre. Evidemment c'était vendredi. Il n'y était seulement Matine Sarcey, qui avec sa guitarre chantait : « Beau Sire Gilbert, s'en allait en guerre », au Danemark les gamins des rue pour la mi-carême chantent encore « Mallebrocque... » au lieue du nom sollenel feu duc de Marlborough, aïeul digne dû illustre consommateur des cigares de notre époque. Mais l'évènement de la représentation fut la première sortie officielle de Fara Diba. Récemment fiancée avec le shah de Perse elle était là au balcon, encore avec l'espoir des vingts d'étés comme auréole. La durée de la pièce devenait un orage sans tonnerre — que des « éclairs et Blitz » sans arrêt pendant des heures. On s'en fichait complètement des amours douteux de Henri II et de ses créatures et ses caricatures. « Qui es ? » demandait la voisine tout bas. « C’est la future impératrice de Perse », je fis. « Oh, je ne savait pas, qu'il avait fait divorce ! Mais l'amitié du prince suffira peut-être...? ...! » Devant la vestiaire on se bousculait. En or et soie comme une fée elle traversait la foule — et on enviait Saint Thomas, qui obtenait la permission de toucher — et on se demandait, où s'arrêtait le théâtre et où devait commencer la vie réelle ?
Je passai devant « Gare Montparnasse », tout éteint, avec son réseau des souffrances et jouissances.
L'asphalte de la Rue de Rennes fut humide et noir. Après la journée tumultueuse les artères (rues) beaucoup fréquentées prennent un aspect de sereine respectabilité comme des pauvres honteux en retraite. Les portes et volets sont fermés. Les maisons gardent leurs secrets. Les trottoirs sont taciturnes et muettes. Quelquefois on entend une auto, les pneus chantent vers la bitume, on dirait des baisers en séries. Vers minuit la ville semble complétement morte, seulement deux clochards sont endormies sur les grilles d'aérage du Metro. Ils dorment leur sommeil sur un humble pelouse, il avait raison le roi Saloman, quand richement vêtu il déclarât : Les riches et les pauvres ils se rencontrent... Taxi !
Et le petit hôtel près de la Bourse est accueillant avec ses couloirs bien chauffées, silencieux et bien velourisée, tout n'est calme et sécurité. On est surveillé, on n'est pas dans un hôtel quelconque, on est chez Madame Gleizal de Provence, et madame est et directeur et patronne. La chambre d'hôtel n'est point une chambre d'hôtel, — c'est une chambre d'amis. avec des fleurs, avec quelques broderies. L'être féminin a mis son empreinte, qui évoque une ambiance de douceur et d'éducation. Ohlala, ces gens du Midi, ils savent bien garder l'attitude convenable. Les portières sont fermées, mais les fenêtres donnent à une ruelle, aussi étroite que l'auteur, dont il porte le nom, fut illustre et large d'esprit. Voisin d'en face c'est l'opéra comique, mais il n'y est rien de comique dedans dans ce bâtiment morose, et en plus on y donne « Médée ». Mais évidemment, quand on se souviens la boucherie « Mozart » dans le seiziéme ca soit bien que Macbeth soit comique. On n'y est pour rien dans ces trucs-là. C'est seulement le cafard qui soit sans abri. Mais la chambre est luisante et infiniment propre. On vient d'avoir débordé le lit, comme tous les jours d'autrefois â la maison paternelle, maintenant ils sont passées ces temps des esclaves et des domestiques.
Au chevet du lit je retrouve les achats de l'après-midi. Il m'avait fallu demander « Les cocus du vieil art moderne » de Salvator Dali chez « Stock ». La vendeuse fut fort jolie, et ce titre me renda assez embarrassé. On ne souhaite point une censure, mais tout de même, il y a devoir des limites ! La belle n'a pas bougée. — Voici le livre demandé. Mes yeux cherchaient un objet, comme une sorte de repassage nécessaire. — Tenez, voila : René Guy Cadou de chez
Seghers, Les poètes d'aujourd’hui, ca ne peut pas blessé personne et le nom de René Guy Cadou me sonne bien familier — petit fanfare de la Bretagne. S'il vous plait, Mademoiselle ?
Je le feuillette.
« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? » Eh bien mon vieux, je suis là pour le moment — exactement. Combien des fois a-t-il du entendre cette question ce cher René Guy Cadou. « Pourquoi n'allez-vous pas â Paris », au lieu de rester dans votre coin ici dans la Loire Inferieure ? — où il n'y a que des prés, des vaches et le ciel ? Il a du entendre cette question encore et encore, presque comme une reproche. Et comment répondre. Il y restait, voila la réponse —mais apparemment pas suffisante.
Surtout dans les moment de départ des amis — où avant de se quitter on pense au revoir et â se revoir. Pour éviter de répondre dans le dernier moment il est allé chercher des fleurs pour les partantes. Il n'a eu q'un instant pour cueillir le bouquet... L'instant d'après fut celui du silence doublement silencieux. Dans le jardin moissi sous les vieilles arbres seulement l'odeur des lys parlait, — fort et empoissonant.
Pouquoi n'allez vous pas â Paris ?
Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys
« René Guy, c'est tard, ne viens tu pas ? »
Les rives de la Seine ont aussi leurs fleuristes... Damm sure. Il y en a des vraies palais des fleurs, il y en a, il y en a des marchées, des temples roulantes, — des aventures feériques —
« Mais pas assez tristes oh ! pas assez tristes I
Je suis malade du vert des feuilles et des chevaux
De servantes bousculées dans les remises du château. »
Pourtant les châteaux de la Bretagne portent des noms aussi jolis. « La Bretèche » Préfailles, des vrais trouvailles pour quelques monarques, qui cherchaient des noms d'incognito. Eugenie de Montijo s'appelait la comtesse de Pierrefonds — elle avait en du choisir parmi les domaines de la Bretagne... Les augustes personnages, qui habitent les résidences — mais on ne les vit jamais —
Mais les rues de Paris ont aussi leur servantes
Que le Diable tente Que le Diable tente !
Voulez vous un peu d'amour ?
Mais à Louisfert il est bien loin de Paris. Le village dort tranquillement.
Mais moi seul dans la grande nuit mouillée
L'odeur des lys et la campagne agenouillée.
« La campagne agenouillée. » Oui, dans les bruyères et les marées salantes on a souvent cet impression la, d'être Agenouillée. « Dans l'amitié de mes genoux » comme le disait récemment Saint John Perse. La terre est plus bas que la mer. On est au genoux. Le pays est plat comme une crêpe. Stendhal la bien rendu avec ces lignes : La partie de Bretagne où l'on parle breton de Henneton â Josselin et â la mèr vit des galettes de farine de sarrasin, boit du cidre et se tient absolument aux ordres du curè
Cette amère montée du sol qui m'environne
Le désespoir et le bonheur de plaire â personne I
Il paraît que aprés un tremblement de terre la catastrophe s'annonce par un odeur de labime, un odeur atroce et effroyable. Mephétisme de la cuisine infernale de la globe. — Et Cadou est assez sincère pour parler du bonheur de non pas plaire â personne Ce filou de poéte.
Cette amère montée du sol qui m'environne...
c'est un peu fort, la bonne terre de Breize — qu'il na pas honte ? Q'on le pardonne ! Cest dans son âme le tremblement de terre a eut lieue. These et antithése se brisent.
Et dernièrement les répliques des amis partantes :
-- Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil.
Il n'y que ca soit vrai — ils ont raison mais luisante dans la nuit chaude sera la réponse là.
— oui mais l'odeur des lys la liberté des feuilles I
Il avait assez du vert des feuilles, mais la blanche couronne des lys exhale la liberté, la liberté des feuilles, qui se répand partout dans la campagne agenouillée. Parfum de la vie, le vrai parfum. L’être de la poésie. La liberté des feuilles — les feuilles, qui sont bien obligée de rester ou ils sont, mais lors de Cadou, voici ils possédent le passepartout d'aller n'importe où. L'océan, le Golf-stream la nuit sans auqun bruit, la bêtaille et les guêpes remplirent la chambre d'hôtel. Le silence sonne aux oreilles. Toutefois les chrysanthèmes de la patronne ne sont point odorantes, mais l'arôme des lys assaisonne l'espace, la liberté des mots quitte le fond d'oree des calices blanches, il faut ouvrir les portes du balcon, l'odeur des lys est devenu trop fort et accablante.
Et â l'opéra comique les fenêtres sont éclairée, malgré l'heure avancée. On distingue nettement la bagnolle des cygnes de Lohengrin, parmi des décorations d'une forêt vierge. Profondement dans l’abime de la rue parlent des ouvriers bleuâtres, la langue française monte comme perles dans une eau gazeu.
René Guy Cadou — ton or rest encore dans les immenses coffres-forts de chère vieille France. Jour ou l'autre les forces de ta poésie feront sauter les armements de ciment — le montant d'un homme bien va contre le vent, comme l'exprimait Tagore. L'odeur de tes fleurs de poésie iront embaumer l'ère de nos descendantes. La liberté des feuilles.
Jules Gadesaude, Amoulageur à Louisfert.
L’Herne, page 16
A l'aube de ce printemps 1951 mourait notre très cher ami René-Guy Cadou.
Dix années, déjà, se sont écoulées. Sa présence parmi nous est toujours là aussi vivante. En évoquant son souvenir, j'entends encore sa voix, son rire gouailleur. C'était l'ami sincère, au cœur généreux sur qui l'on pouvait compter en toutes circonstances.
Un jour, une de ses collègues, institutrice à l'école des filles, ayant eu son changement pour une localité près d'Ancenis, demanda à René qui pourrait lui faire son déménagement.
Tout de suite, René répondit :
-Mais Jules, bien sûr !
-Vous rigolez, bien sûr
-Vous rigolez, il n'a qu'une 202.
-Et sa remorque ? Qu’est-ce que vous en faites ? Venez. Nous allons le trouver.
Sans sourciller, j'acceptai et le dimanche suivant nous nous mettions au travail. René n'était pas le moins actif. Bientôt, la remorque avait son dû et René se demandait où logerait le reste, c'est-à-dire l'armoire, tout simplement Le sommier était déjà sur la galerie, il fallut bien y mettre aussi l'armoire.
-Et maintenant, s'écrira René, il ne manque plus que la cage à serins et le panier à salade !
J'entends encore son rire sonore, car il riait de tout son cœur.
Comme nous n'étions pas très pressés, le verre du départ s'imposait. Inutile de vous dire que ce fut le traditionnel verre de muscadet.
-Cela m'est égal, dit René, mais mon vieux Jules, tu t'arrêteras toutes les dix minutes. Tant pis pour toi !
Ce n'est qu'un souvenir parmi tant d'autres tous aussi vivants. Lorsque j'appris la terrible maladie puis la mort de mon ami, j'en fus très affecté. J'aimais René Guy Cadou comme un frère et sa mémoire restera gravée en moi.
Pour Cadou, par Robert Lohro
L’Herne, page 17
La critique de Cadou n'existe pas encore. Nous ne disposons guère que de portraits, de biographies ou d'hagiographies dus à l'amitié fraternelle et parfois jalouse de quelques-uns. Combien d'hommages aussi, sous la forme de poèmes dédiés à son ombre, n'ont-ils pas paru dans les revues de l'Ouest, signés par tant d'inconnus de bonne volonté, amoureux de plantes et de villages, attentifs comme Cadou aux Bruits du Cœur, touchés par la voix sincère du poète d'Hélène ou le Règne Végétal. Une sentimentalité irritante semble s'être emparée de cette œuvre ; celle-ci, en conséquence, n'a pas dépassé les frontières trop précises que nous lui connaissons. Rien d'étonnant au fait que René-Guy Cadou pendant les dix années qui ont suivi sa mort soit demeuré le poète d'une province et d'une famille spirituelle. L'audience qu'il mérite ne lui a pas encore été accordée.
Attachante province que celle du cœur, dangereuse province que celle qui risque de borner le rayonnement d'une poésie.
Pourtant, ce poète a plus voyagé dans sa mémoire que Blaise Cendrars autour du monde. De là, sans doute, sa difficulté à se situer dans le présent. Dans ses pièces, les plus réussies, Cadou se place délibérément, avec une facilité déconcertante, soit dans le passé, soit dans le futur. Souvent il confond les époques avec la même aisance (ou la même impuissance à vivre au présent):
« Je voudrais vous rejoindre ainsi qu'un parent oublié et sans fixer de date,
Mais votre continent est inconnu et les eaux sont trop profondes sur les cartes ».
Cadou a-t-il rejoint Francis Jammes, Max Jacob, Claudel, et pourquoi pas Serge Essenine et Lorca avec qui il ne manque pas d'affinités ? Affinité plus inattendue certes que celle que l'on pourrait découvrir entre Supervielle et Cadou. Mais de qui croyez-vous que soit ce vers :
« J'ai un grand besoin de villages ».
celui-ci :
« Et vos mains onduleront comme au vent les marguerites ! »
et cet autre encore que je relève sur une feuille manuscrite et que son auteur finalement a refusé :
« Qui nous apporte des nouvelles de chez vous ».
« …fait un petit vent de songe »
Serait-ce de Cadou ? Non de Supervielle.
Cadou proche d'un poète russe, d'un poète espagnol, d'un poète mi-uruguayen, mi-français, « ami inconnu » de tant d'artistes différents par le pays, par la vie et les songes, voilà qui lui donne des dimensions auxquelles la critique devrait s'intéresser.
D'autre part, je ne vois personne jusqu'à présent qui nous ait parlé honnêtement de l'art de Cadou, de son naturel, de son pouvoir incantatoire. Il est des décasyllabes, des octosyllabes de Cadou qui « voyageurs seuls et sans bagages », traversent le poème incognito, en toute simplicité. Curieuse utilisation des possibilités orchestrales de la prosodie, très particulière à Cadou, et dont une étude systématique nous livrera peut-être un jour le secret.
Oui, il conviendrait que l'on nous parle moins de la vie de Cadou, de sa province, de ses amitiés, de sa mort et que l'on nous parle plus souvent de son œuvre, de ses affinités, de ses thèmes, de son art. Ce serait là défendre enfin une poésie qui nous est chère.
Pierre Reverdy
L'Herne, page 19
Mon cher Cadou,
Que ce soit le silence ou que ce
soit la nuit
Que ce soit la lumière ou que ce
soit le bruit
Quand la substance de l'amour
est assez dense
Quand l'amitié plante ses griffes dans l'absence
Rien ne change
Rien ne fléchit
Le moindre signe de l'esprit
En déclenche la renaissance
Par conséquent, soyez le bienvenu toujours dans vos lettres... ...Très amicalement vôtre.
1945
Lui, et le surromantisme, par Roger Toulouse
L'Herne, Page 20
Le poète a le pouvoir d'échapper au poids des mots. Il ressuscite les idées mortes, dépasse le néant, perçoit l'unité du monde sous le désarroi des chocs, et capte les ondes qui naissent de l'autre côté du Grand Mur. Cadou avait toutes ces divinations, celles aussi du destin, de la maladie et de la mort.
La flamme d'une bougie blanche provoquait chez lui la même émotion intense que chez d'autres la vue d'un homme mort. Le carré blanc d'un oreiller sur un lit, l'odeur d'un sapin fraîchement scié, les planches s'entassant près d'un mur faisaient lever l'angoisse en lui, même au milieu d'une belle journée bretonne.
Cadou redoutait la tristesse des gares. L'idée de départ est capitale dans ses poèmes. L'inconnu lui faisait mal. Ses lettres de vacances trahissent son anxiété. Il craignait pour son œuvre. Il n'était plus chez lui. C'était comme s'il avait été chassé de lui-même.
Il avait besoin d'un véritable refuge et savait que le temps lui était mesuré. Il ne pouvait regarder le monde en touriste, mais seulement se confronter à lui en « voyant ».
Il fallait que son œuvre fût bouclée à temps. Ses rêves précis, ses rêves incessants le conduisaient et l'empêchaient d'errer au hasard des rencontres, c'est pourquoi il n'y a jamais la moindre gratuité dans ses poèmes.
René, hors de sa maison, se trouve sans défense. La cuisine, c'est pour lui une citadelle. Je pense à Juan Gris construisant son œuvre immense près de la poêle à frire ! à Max Jacob séjournant de longues heures dans la cuisine de mes beaux-parents en inventant un nouveau poème, dans le fumet des ragoûts ou la poussière de farine.
René cherchait à retrouver la sécurité initiale, celle de la première enfance de Sainte-Reine, avant tous les malheurs.
Mais, dès cette époque, il apercevait l'autre côté de la grande Façade. Il rêvait de son père mourant, « une énorme racine plantée dans le ventre ». C'était alors non seulement la mort physique de son père qu'il pressentait, mais aussi la sienne ; cette branche étant l’affreux mal tordu comme elle dans son ventre.
Et sa mort répondit à l'image trop souvent entrevue dans les poèmes... était dans un train, la nuit, et demandait qu'on allât plus vite.
Cette cruauté de l'image fut sans cesse la lame qui entrait dans sa chair au milieu des plus belles joies. Ses visions devenaient de plus en plus précises, c'est pour cela qu'il demandait sans cesse l'amitié. Il voulait qu'on l'entourât pour le rassurer. Il avait besoin de cette correspondance qui lui donnait l'impression d'exister, de vivre comme les autres. Si parfois, nous restions plusieurs jours sans répondre à ses lettres, c'était en lui le tourment, l'insécurité, presque le naufrage. La chaleur de l'amitié passait avant tout, lui permettant de poursuivre son œuvre.
Toujours Cadou se sentait menacé. Une pendule arrêtée lui faisait peur... Il fallait que la fenêtre fût ouverte sur l'été, ou bien fermée, mais un feu bien vivant allumé dans la chambre.
A Louisfert, son repos, c'était d'aller dans les celliers, à la recherche des vieux meubles chargés de passé, sentant la pomme à cidre, la poussière et le temps. Le neuf le paralysait, le nouveau le plongeait dans la désolation. Il se méfiait d'un nouvel arrivant dans le cercle de l'amitié. Il me confiait que si l'encrier n'était pas à sa place, le poème n'avançait pas.
L'ordre lui était nécessaire comme une discipline. Ses pensées, son travail de poète devaient faire bloc avec l'emploi du temps imposé par la vie pour que ses craintes et ses démons ne pussent entamer son être.
« L'ordre, la propreté, la beauté et même un certain luxe sont indispensables au développement de la pensée. Mais que tout cela vienne à disparaître... et je suis le premier à m'en réjouir parce que tout peut recommencer », écrivait-il dans son journal.
Oui, cet ordre est la garantie contre tout ce qui le tente ou le menace. Il conjure ainsi le sort, mais aime pourtant au-delà de tout l'insolite, déteste la convention les apparences mortes de la vie.
Les objets bizarres, démantelés, les vieux fers à repasser, les légendaires phonographes, les ustensiles de cuisine de nos ancêtres provoquent chez lui l'étonnement fécond et le doute.
La forme détériorée lui offre le moyen de découvrir, d'exploiter, de conquérir des espaces interdits. Sur ses étagères s'alignent des assiettes et des plats aux couleurs naïves, des santons modestes mais innocents devant notre vie enfumée.
Bien sûr, ses livres sont l'objet d'une chère passion. Avec un soin jaloux, il les range dans sa bibliothèque assemblée par le menuisier de l'endroit. Rares sont ceux qui ont le droit de les toucher. Le livre est sacré. On doit le tirer de sa place dans le recueillement.
En 1949, avant d'aller veiller le corps de Max Jacob dans la crypte de Saint-Benoît, Louis Guilloux, Michel Manoll, Julien Lanoë et Cadou visitèrent mon atelier. Je venais de terminer quatre portraits : le Jeune homme à la médaille, l'Homme au képi de garde-chasse, le Jeune homme de l'Hospice, l'Homme au tablier de boucher. René ne dit rien, mais après quelques minutes, me tendit la main. Dans les semaines qui suivirent, il m'adressa quatre admirables poèmes sur ces toiles. Il retrouvait là l'Homme simple, avec son univers, toutes les possibilités d'évasion.
Un poème comme une peinture doit être ouvert, s'il y a fermeture il y a froideur. C'est pourquoi Cadou aimait les idiots de village, leur vision primitive qui a plus de fraîcheur que celle de l'homme apprêté. Cadou aimait les humbles parce qu'il était lui-même foncièrement humble, dans son orgueil de poète.
Dans les livres, sa préférence va aux auteurs qui parlent de vies effacées, comme la sienne, repliée sous la lampe. Oui, la lampe, c'est à la fois la sécurité et l'appel vers des Centres inexplorés où seul le Poète, à coups d'audaces intérieurs, se promène.
C'est pourquoi René aime tant Dabit, Guilloux, qui parlent de toutes les détresses et des illuminations de l'aventure. Cendrars aussi est son ami, car ce vieux routier atteint tous les sommets du risque (Cadou, très jeune, ne perdait-il pas de fortes sommes au poker ?) mais lui, n'a pas besoin de prendre un billet pour le Transsibérien, sa table de travail en pichepin est le plus sûr guichet.
Malgré cela, il retrouvera Blaise là-bas, bien loin à l'autre bout du monde.
Cadou marche donc avec certitude à travers ces contrées de l'aventure. Il a mis, dès le début, toute sa vie dans ses bagages, et il accepte le combat contre le temps.
Les acrobaties du surréalisme, sa gratuité, l'irritent. L'Essentiel est le but, il le préservera. Et l'essentiel, ce sont les routes tristes sous la pluie, les wagons abandonnés, les rencontres dans les auberges, les instants privilégiés où tout peut arriver. Les minutes hypnotiques trop savamment préparées sont tellement conventionnelles que la vie ne s'y arrête pas.
Cadou tourne le dos avec violence au nihilisme intellectuel de Breton.
Entendons le préciser : « J'appellerai surromantisme toute poésie... audible en ce sens qu'elle est une voix aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle surréalistes » (1)...
Du surréalisme il rejette le parti-pris démolisseur, la facilité ; du romantisme la complaisance théâtrale aux solitudes sans échos, le retour navrant au seul pittoresque du passé.
« Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, dit-il, doit en effet se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire, par un phénomène de prémonition se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore, mais sûrement deviendra » (2).
C'est à ce poste avancé que Cadou devait résolument se tenir, guettant et traduisant tous les signes, établissant un avenir définitif au-delà des apparences mortelles.
Des « Brancardiers de l'aube » aux « Biens de ce monde », le destin terrestre se ferme. Il va falloir partir. C'est fini. Cadou s'efface. Mais le Cercle est immense. Il appartient à d'autres hommes et les aide à vivre.
P.S. — En 1940, Michel Manoll écrivait : « S'il faut croire en la poésie, je crois en René Guy Cadou ».
Notes :
(1) Usage interne.
(2) Le Miroir d'Orphée.
La saison René-Guy Cadou, Marcel Béalu
L’Herne, page 24,
La poésie était pour René ce qu'est pour l'herbe la rosée de chaque matin. Il avait la candeur de la jeune herbe qui ignore, en songeant à son destin, que doit venir le farouche été qui fera d'elle une autre herbe géante et folle pour incendier la forêt.
La plus simple phrase de ses lettres, prise au hasard, acquiert depuis sa mort un sens plus riche. Comme j'ai hâte de quitter ce pays d'ennui où rien n'est fait pour l'amour... m'écrivait-il en juin 1941. Qui pourrait penser aujourd'hui qu'il s'agissait seulement de Saint-Aubin-des-Châteaux, la maussade bourgade où s'ennuyait alors le jeune instituteur ?
La poésie de René-Guy Cadou a incendié beaucoup de cœurs, depuis dix ans. Sa légende monte et brille comme une flamme pure dans notre trouble et sévère automne, sans effacer cependant le souvenir aigu de sa présence — ton de la voix, toucher de la main, lumière du regard. Ses trente années de vie n'auront été qu'une saison en poésie. Cette unique saison René-Guy Cadou, saison de l'amour, bien que s'y mêle à la fraîcheur de la source, la sauvage grandeur des villes calcinées, elle ressemble de plus en plus au printemps de notre vie, pour nous qui avons eu le privilège d'accompagner ses pas.
Une larme de verre, par Armand Lanoux
L’Herne, page 25,
Le dimanche 11 janvier 1958, je contais sur les antennes de Paris-Inter une histoire, Le rayon vert de Saint - Michel Chef - Chef. C'était une « larme de verre ». Sous ce titre, j'évoquais une ville, ou une bourgade telle que je l'avais vue, au travers des larmes de verre qui illustraient les porte-plumes d'os de mon enfance, irisée et fragile, et je comparais ce souvenir en sarrau noir avec la même ville, telle que je l'avais vue, adulte. Le dimanche précédent, c'était Ostende masquée, le dimanche suivant ce serait Vérone et ses marchands d'oiseaux morts. Ce dimanche-là, c'était Saint-Michel-Chef-Chef, la bourgade atlantique.
Nicole Vervil chanta :
Au pont de Nantes un bal est assigné
La Belle Hélène voudrait y aller...
Je me souvenais que le prénom d'Hélène était celui de la femme de René-Guy Cadou. Hélène, Tombelaine, Morlaine… Je revoyais Saint-Michel, entre Préfailles où le cœur défaille et Nantes, où meurt la Loire lente. C'était mon premier voyage. J'avais douze ans. Exactement en été 1925. Mon père, pantalon rayé et chapeau melon, habillé comme le sont aujourd'hui les employés de la City, était venu me conduire au train qui dépendait encore de la Compagnie de l'Ouest. Et il m'avait laissé seul. Tout seul. Illuminé.
Ainsi, je traversai la France du Couchant pour arriver au petit jour à Saint-Nazaire prendre le vapeur poussif qui était peut-être le Saint-Christophe... Et puis, franchi l'estuaire du fleuve d'or gris, je montai dans un tacot départemental, zébré par le soleil du jeune jour d'été, un petit tacot griffé par les genêts et les branches des pins, qui suivait la côte, Saint-Brévin-l'Océan, Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à Saint-Michel-Chef-Chef, où ma grand-mère m'attendait, ma grand-mère aux joues de pomme et au cœur de satin, mon grand amour, perdu depuis l'An Quarante.
Je vois un caniche un ruban une diva
Un loup des genêts un baigneur nu
Un casino où tourne la mazurka
Des mortes reines
De ce pays-là
Province de mes chaînes.
La mazurka ! On était bien d'un tiers de siècle en retard. en 1925, à Saint-Michel-Chef-Chef et à Saint-Brévin-les-Pins...
Voici sur le mur cloué
Saint-Brévin-les-Pins
où j'ai peint
la mer
en outremer
numéro un.
Je me croyais peintre alors. Ça m'a tenu longtemps. Vingt ans ! L'odeur de l'huile lin se mêle dans mon souvenir à l'odeur violente et violette des varechs ramassés par des marins-mousquetaires à bottes gomme-gutte, et l'odeur de la térébenthine à celle des pins...
C'est alors qu'un garçon de la plage, maigre, dominateur, les yeux fiévreux, m'apprit le secret de la Côte. Il était fabuleux. Sur l'Océan, à l'heure où le soleil se couche, il arrive parfois que tout s'embrase, à l'instant même où la grosse orange s'enfonce dans les flots vers le large. Alors, un inoubliable rayon vert illumine la terre... Je l'ai cherché le soir même... Je l'ai cherché tous les jours... Je l'ai cherché jusqu'à maintenant. J'ai cru parfois le voir. Je le chercherai toujours.
J'entrai ainsi dans la société secrète des bons enfants du Rayon vert.
Beaucoup plus tard, par Jean Rousselot, je connus les poèmes de René-Guy Cadou. Et je sus, dès la première lecture, que, s'il n'avait pu être matériellement mon initiateur de 1925, mon Grand Meaulnes anonyme, parce qu'il était né sept ans après moi, il appartenait pourtant à la Confrérie :
« Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires
Dans les années de sécheresse quand le blé
Ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe
Qui écoute apeurée la grande voix du temps... »
En juillet 1950, seulement, la vie me permit de retrouver la plage du Redois, Saint-Michel-Chef-Chef, son église, ses galettes et ses villas, les Algues, les Goémons, la Rose des Vents. ...Quel été Je demeurais à la Bernerie. La guerre se rallumait à l'autre bout du monde, en Corée. Saint-Michel-Chef-Chef était devenu tout petit. Un autocar avait remplacé le tacot départemental de mes westerns sentimentaux... Le souvenir de ma grand-mère de pommes et de satin me saisissait la gorge... Saint-Michel-Chef-Chef avait rétréci comme une tête des Jivaros. Toute la vie était une Bernerie.
Alors, j'écrivis la première version d'un poème, clair quand on a les clés, quand on sait que Le Lit du Roi est un lieudit de la Bernerie, où vivait Cadou :
Le lit du roi
Ce lit d'un vain Roi où sont endormies mes ombres
deux fois le jour drapé d'algue et de goémons
ce lit du Roi ne veut d'autre songe que contre
la joie des jours verts et des heureux saumons.
Sur ces rocs rongés par mes ferveurs abolies
les marabouts pêcheurs des poissons morts d'ennui
tendent les carrelets de la mélancolie
filets mensongers songeurs filets de la nuit.
Mais voici que le vent de la plage des Dames c
abrant dans les ciel les cerfs-volants des gamins
troussant les parasols les voiliers et les femmes
abandonne un oiseau pour signer de sa main.
J'écoute j'écoute la mouette
au ciel du Lit du Roi
dérisoire girouette
j'écoute grincer ses gonds mouillés.
Mes châteaux ensablés
avaient leurs oubliettes
en moi en moi
trop de portes
mes couloirs mes corridors mes mortes
sont encore verrouillées.
« Aux cruels carrelets de la mélancolie
entre étoile et genêt
entre anémone et plie
sur la côte aux cailloux par l'Océan polis
trop de vent et peu d'eau, trop de mots peu de vie
si les pêcheurs du Roi pouvaient pêcher l'oubli
je reviendrais enfant dans cette Bernerie. »
On ne revient pas enfant.
Cette année 1950, l'atroce année coréenne, je ne rencontrai pas René-Guy Cadou, dont j'aimais pourtant les vers, mon frère inconnu, mon cadet, mon copain du Rayon vert. Pendant un mois, nous croisâmes nos pas sans que je trouvasse jamais cet autre Apollinaire ou sans que je le reconnusse.
J'avais guetté tant de fois le rayon vert, le regard de la Mélusine des sargasses, sans savoir que j'avais un frère cadet et sans savoir qu'il ferait un mort plus vieux que moi, que j'ai maintenant inguérissable, le mal de l'Ouest, de ses quais, de sa rose des vents, de ses cerfs-volants, le mal de Préfaille et de la Bernerie.
Je repartis avec les premiers jours d'août, sans imaginer qu'il était trop tard. René-Guy Cadout mourut avant qu'aient refleuri les œillets rouges des sables, œillets de la solitude et de la mélancolie. Je ne l'ai pas plus vu de mes yeux vu que le rayon vert, s'il m'est arrivé souvent d'avoir cru le voir.
Parfois, les poètes arrangent leur vie pour en faire d'attachantes complaintes. Ici, je n'ai pas triché d'un mot. Reste cependant un accident mystérieux, un menu fait imperceptible, irréductible et déraisonnable. Ce poème du Lit du Roi, je l'ai publié en 1952, au Mercure de France. J'y tiens. Beaucoup. Pourtant, il ne figure pas dans le recueil que Pierre Seghers publia plus tard, La Tulipe Orageuse. Je ne sais pourquoi. Et je n'y suis pour rien ! Je l'y ai mis Alors ? A-t-il glissé ? Est-il resté sur le marbre ? Ou n'a-t-il pas voulu paraître ?
A moins que…
A moins que René-Guy Cadou ne soit passé à l'imprimerie ce jour-là ?.. J'imagine que sa main d'ombre ait pris ma larme de verre et l'ait emportée... J'en serais si heureux... Ah, si les pêcheurs du Roi pouvaient pêcher l'oubli...
Une partie de chasse avec René, par Paul
L’Herne, page 29,
Vous souvenez-vous Hélène, d'un certain jeudi d'octobre ?
Odette s'occupait du linge, vous étiez assise près d'elle dans la cuisine, René m'avait proposé une promenade dans la campagne. J'avais décroché le fusil et nous étions partie avec Up, le pointer. René aimait m'accompagner ainsi, non pour la chasse, mais pour les rencontres que nous faisions et qui l'enchantaient.
Un bâton à la main, sans tenue particulière, comme il était venu, il m'avait suivi dans le tertre. Après le pont, nous avions pris le chemin de la brûlerie puis débouché dans un bois de pins.
René m'entretenait de ses cueillettes de champignons. Des nombreux « nids » qu'il connaissait. Il frappait les fourrés en vrai rabatteur, lançait un juron au chien qui s'éloignait ; ou bien me racontait « la dernière », prélude de beaucoup d'autres.
Nous allions ainsi plus occupés de nos propos que d'un éventuel gibier.
Après le bois de pins, un landier et nous étions remontés vers un pâturage bordé de ronces et de touffes d'ajoncs. En bordure, un autre bois de pins nous avait attirés. René y avait fait une magnifique récolte de coulemelles. Les fougères étaient nombreuses et la marche difficile avec les branches mortes.
C'est presque au bout qu'eut lieu la rencontre. Nous parlions pêche... Tout à coup à dix mètres de nous, dans un grand bruit d'ailes, une quinzaine de gros oiseaux prirent leur essor à travers les arbres, pour aller se poser à environ 150 mètres dans un bosquet de saules, bordant la rivière. J'avais épaulé mais n'avais pas tiré, et maintenant René ironisait : « Je parie que tu as laissé tes cartouches à la maison !... Quelle cible ! Rien qu'avec mon bâton je pouvais en descendre. Ce n'est peut-être pas assez gros pour Monsieur I»
J'expliquais alors la nature et la provenance du gibier que nous venions de lever. « Ça ne fait rien, dit René, j'aurais bien aimé en voir un de plus près ». La tentation était trop forte...
Avec de grandes précautions, nous avons dû franchir deux haies de barbelés et ce fut l'approche silencieuse... René ne me quittait pas d'une semelle, retenant le chien. Il vivait ces instants avec émotion, attentif à ne pas donner l'éveil, pris intensément par le jeu.
Encore une fois, il y eut cette envolée magnifique et le tonnerre d'un coup de feu que l'écho amplifia démesurément. Nous nous étions précipités et oh ! Stupeur, c'était deux oiseaux qui gisaient là. René en ramassait un, j'attrapais l'autre qui se débattait et à toutes jambes nous remontions la pente. Le chemin que nous avions parcouru si lentement avec beaucoup de difficultés était refait en sens inverse à une allure record. Et le bois et le pâturage nous voyaient toujours courant. Ce n'est qu'à l'autre bout, essoufflés, les jambes molles, que nous avons lancé nos deux oiseaux au milieu d'une touffe d'ajoncs pour les dissimuler.
Nous étions face à face reprenant notre souffle un peu surpris de ce qui nous arrivait. Soudain, dans un grand éclat de rire, René me lança : « Ah, figure de moi-même ! ».
Nos deux faisans étaient deux jeunes paons qui pesaient jusque dix livres chacun.
Il n'était pas question de les emporter. Nous sommes rentrés à la maison avec des airs de conspirateurs éludant toutes les questions.
La tombée de la nuit nous voyait repartir munis d'un sac, résistant à toutes les sollicitations. Notre retour fut un triomphe.
Vous êtes rentrés tard ce soir-là, et peut-être sans lumière, mais nous avions un beau souvenir à ajouter à tant d'autres.
Et le lendemain, malgré les consignes de prudence, René faisait goûter du paon à ses amis de Louisfert.
Lettre de Paul Fort
Le 25 Août 1947
Mon cher René Guy,
J'allais justement vous écrire pour vous annoncer que dans un prochain livre, « Le Pèlerin de la France », je m'était permis d'épingler votre nom en tête d'une « série » intitulée « Ballades angevines ». Ne m'envoyez pas de témoins. Je suis brave, mais je n'aime pas les duels.
Et maintenant ne bondissez pas. Et comprenez tout ce qui suit.
Je viens de recevoir votre lettre confiante. Vous avez bien fait de vous adresser à moi.
Attention, comprenez ! Parce que j'aime d'amour votre Poésie. Vous aussi vous l'aimez d'amour, ou vous ne seriez pas poète. Mais c'est moi qui pousserai le cri d'amour, et qui dirai — comme mû par un supérieur instinct — que vous êtes un grand poète, faisant au surplus entendre que vous êtes de votre génération, le plus grand...
Embrassons-nous sur le cœur.
Paul Fort.
Et pas de modestie de faux aloi ! La modestie c'est funèbre. La gloire ne l'est pas.
René-Guy Cadou, Gérard Mourgue.
L'Herne, page 32,
C'est René Guy Cadou qui a dit que la simplicité était l'antithèse du vulgaire. Les rois devaient être simples — parce qu'ils naissaient rois. Aujourd'hui, nous n'avons d'autres rois que les artistes. Quelques princes de l'intelligence et de l'action leur font escorte, sans se confondre avec eux.
Quel temps gagné, avec la simplicité ! Elle ne s'embarrasse pas de détours. Elle nivelle les montagnes factices que la société voulait nous faire prendre pour de vraies montagnes. Soudain la richesse et la pauvreté n'ont pas plus d'importance que la nuit et le jour. L'esprit même — oui, vous avez bien lu, le favori de Voltaire — prends, devant la simplicité, des allures de snobisme, ou de coquetterie. A quoi bon perdre ses forces avec tant de mots vains ?
Le temps gagné ainsi sert à pouvoir se taire. C'est un luxe d'aristocrate ; on le goûte entre ami du même bord ; de là naissent les vrais échanges.
Ce ne sont pas nécessairement des dialogues. Le poète parle pour les autres : c'est son travail de faire ainsi. Pour Guy Cadou, il y a les gens du village, du buraliste à l'épicier, en passant par le fossoyeur et le boucher.
« Une table encombrée de feuillage et de mains
Pour chaque ami un lendemain »
« Le vent n'efface pas le bruit de vos paroles
C'est votre sang qui donne une teinte aux saisons ».
On s'imagine un Schubert au petit pied ignorant les musiciens de de son temps — qui devaient lui proposer de l'aider à travailler le contrepoint.
Il s'agit bien du contrepoint ! Il s'agit bien de forme ! Quand la mélodie coule de source, et qu'il écrit son Roi des Aulne ou son Marguerite au Rouet.
C'est Dieu qu'il prend à partie, et qu'il tutoie :
« Tu sais ! comme dans ce tableau de Gauguin ou apparaît le peintre
En gros sabots avec sa pèlerine de croquant que les pluies d'automne ont déteinte
Je t'attendrai toi ou ton ange ou quelqu'un de ton cérémonial
Entre les quatre planches de ciel pareilles à un confessionnal ».
(Inédit).
« Si c'est cela qu'on fait au Roi des Juifs
Que fera-t-on au Pauvre Nègre ?
L'un brillait avec les planètes
L'autre n'a qu'une chandelle de suif ».
(Hélène ou le règne végétal).
(Hélène).
C'est venu d'un seul coup en travers de mon sang »
(Hélène).
Le plus beau pays du monde
Ne peut donner que ce qu'il a
Myosotis ici et là
Mais beaucoup d'herbe sur les tombes !
(Nocturne).
« Une femme inconnue les arrête et les baigne
D'un regard douloureux tout chargé de forêt.
Méfie-toi, disent-ils, sa tristesse est la nôtre
Et pour avoir aimé une telle douleur
Tu ne marcheras plus tête nue sous les branches
Sans savoir que le poids de la vie est sur toi ».
(Quatre poèmes d'amour).
Comme un fleuve s'est mis
A aimer son voyage
Un jour tu t'es trouvée
Dévêtue dans mes bras »
(Quatre poèmes d'amour).
Est-ce assez dire le naturel ? Est-ce assez dire la mélodie ? Ils sont, l'un et l'autre, le pain et le ciel de chaque jour.
Mais, le pain, mais le ciel veulent toujours dire autre chose. René Guy Cadou sait ce qui se cache sous l'extrêmement familier ; il ne nous le révèle pas toujours ; il nous fait « Chut ! écoutez... », et puis il passe.
Et dans « Usage Interne », près de sa mort, nous trouvons une phrase que nous voudrions retenir — « Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul ».
Cet homme fut mon ami, par Julien Lanoë
L'Herne, Page 35,
Pierre Reverdy disait que « les poètes gagnent plutôt à mourir jeunes et les peintres à vivre très vieux ». Il est bien vrai que les premiers donnent le meilleur d'eux-mêmes dès qu'ils commencent à manier la plume, dès qu'ils ont découvert qu'ils sont « autres », dès qu'ils ont saisi le fil conducteur qui les guidera dans le labyrinthe de leur solitude. Un poète ne sait pas et ne peut pas vieillir. Son chant est condamné à rester jeune dans une bouche édentée, dans un corps ruiné. Le vrai poète a deviné le mystère de l'être avant même d'avoir vécu. Une existence qui s'étire ne lui apporte plus que de médiocres expériences, la gloire, les honneurs, les voyages, les plaisirs, mesquines compensations aux rêves de ses jeunes ans.
*
René-Guy Cadou est né, est mort dans une maison d'école. Rien ne ressemble plus à un bateau désaffecté, transporté en pleine terre, que ces maisons que l'on visite le dimanche ou pendant les vacances, toutes bruissantes d'une jeunesse enfuie, épaves délabrées au bord d'un horizon bocager, prisonnières d'un village sévèrement groupé autour de son église : une apparence d'abandon et de renfermé tenue en échec par une odeur d'encre violette, de claie, de pommes mûres, un air de grève déserte attendant le retour de la marée... Les maisons d'écoles sont de vraies ruches à poésie : il y a en elles quelque chose d'étroit et de comprimé qui lutte avec une telle promesse d'avenir ; l'usure du temps, la succession des heures y contrastent si fort avec les élans du cœur, la vie la plus domestique et la plus terre à terre y est traversée par de tels songes que nous pouvons affirmer : René-Guy Cadou est un tendre Virgile qui a puisé le meilleur de son inspiration dans les salles de classe et d'auberge de nos humbles villages, au milieu de « la grande ruée des terres ».
*
Mais pourrions-nous recréer l'atmosphère et le décor et les témoins de son œuvre que nous n'aurions encore rien dit d'essentiel. Il faudrait parler de son père, il faudrait parler d'Hélène, sa femme. C'est pourquoi je m'arrête, à l'exemple d'André Breton, à qui l'on demandait un article sur Jacques Vaché « Il y a des fleurs qui éclosent spécialement pour les articles nécrologiques dans les encriers. Cet homme fut mon ami. »
Lettre à René pour le dixième anniversaire de sa mort, par Luc Bérimont
Cahiers de l’Herne, avril 1961
Qui me fera jamais croire que tu es mort depuis dix ans ?... Qui même me fera jamais croire que tu es mort ? C'est comme au temps de notre séparation, après la guerre, à cette époque où j'habitais l'Allemagne, quand tu m'écrivais sur du papier bleu, de ta belle écriture en forme de liane. Aujourd'hui, tu ne réponds plus matériellement à mes lettres, mais je ne t'en veux pas. Souvent, dans ta vie de ce côté-ci du décor, il m'arrive de me demander : « Est-ce que René aimerait celà ? ». « Est-ce que René m'approuverait ? ». Non pas que je te prenne pour juge, mais pour conseiller. Car tu es irrémédiablement mêlé à ma jeunesse et c'est toujours à sa jeunesse qu'il faut demander de temps en temps si l'on est encore digne de vivre, si l'on se tient toujours debout ! Depuis ces dix années que tu es parti chez les morts, j'ai fait bien des expériences décevantes et j'ai pu expérimenter cette chose que nous pressentions en filigrane Vivre n'embellit pas les vivants I... Vivre salit et vivre prostitue...
Pourtant, quand je suis par trop écœuré, par trop fatigué des autres et de moi-même, c'est dans ta poésie que je viens prendre une leçon d'optimisme et de cosmos. Je redécouvre ce que nous avons aimé ensemble, dans le grenier de Rochefort, ces poèmes que tu t'arrachais dès le petit réveil et que tu venais me lire dans ma chambre, humides d'encre encore, avec ce petit tremblement de la voix qui trahissait chez toi l'émotion ou la tendresse. Ceci se passait en pleine guerre, à l'époque où l'Europe flambait. On ne saurait dire que nous étions indifférents à la souffrance des hommes. Tu serrais les poings et tu étais prêt à mourir avec les fusillés de Châteaubriant, mais — sans que nous l'exprimions en clair — nous savions bien que ce n'était là qu'une atroce mascarade et que la grande affaire était en nous, au fond de chacun de nous, enfermée au plus secret du noyau et du silence. Ce qui compte, c'est la racine des hommes, le cheminement sous-jacent des forces qui les irriguent, ce qui s'élabore au fin fond des profondeurs. Nous appelions cela, toi et moi, « la poésie ». Le terme est peut-être impropre, ou mal entendu, mais ce qui compte en définitive, c'est la démarche mystérieuse de l'être, l'exploration de soi-même tentée, la délimitation de son cadastre singulier. Du fouissement, de la nourriture trouvée par les racines, dépendent les feuillages chanteurs. Parce que nous ne voulions, ni l'un ni l'autre, être des poètes de tour d'ivoire, des « intellectuels du vers », des cérébraux de l'image, nous nous tournions naturellement vers le soleil et l'amitié. Nous savions non seulement, comme le dit Novalis, que « la philosophie est l'hôpital de la poésie » niais aussi que le poète est une espèce de boulanger qui ne consent à travailler que la fine fleur des mots, qui cuit pour le village des vivants et qui, sa journée terminée, laissé en repos par son combat, vient bavarder sur le pas de la porte et boit le vin de l'amitié. Il m’importe beaucoup que tu aies été là pour ouvrir la porte de la maison de La Noue, au domaine de Piedgüe, avec la clé rouillée. Dans cette maison, bâtie dans un fond d'herbe, à 4 kilomètres de Rochefort-sur-Loire, abandonnée et remplie de foin jusqu'au toit, personne ne voulait plus habiter. Le propriétaire du domaine nous ayant cédé les lieux, Jean Bouhier ayant mis à ma disposition les meubles de son grenier, il restait d'atteler un chariot à un cheval, de remplir la voiture de matelas, de sommiers, de buffets, de chaises, et d'effectuer le transport. L'équipage passait dans les vignes où crissait la chaleur de juin. Les vipères s'enfuyaient dans les herbes. Je crois bien qu'il fallut la journée pour déblayer la paille qui encombrait les pièces, aux murs chaulés. Tu prenais les bottes à bras-le-corps : paille - foin !... On se vautrait dans l'odeur de la terre, dans ses cheveux, dans ses poils follets. Mais quand la nuit tomba, la porte ouverte sur les étoiles, le spectacle des bêtes et des mondes volants, atteignit la magie. Les perdrix, les lièvres, revinrent coucher sur le seuil, en cet endroit qu'ils avaient élu et où personne ne les dérangeait jamais. Le renard, les ramiers coulaient dans les branches et dans les hautes herbes. J'essayais de ne pas déranger cette paix nerveuse, cette cohabitation fragile. Pourtant, une nuit que je rentrais d'une de nos beuveries à l'auberge, je marchai sur une compagnie de perdrix, en plein champ. Les claquements, les gifles d'ailes dont je fus entouré me glacèrent les sangs sur le moment, avant que je ne pense à Shakespeare !
Tout cela, vois-tu, René, c'était notre jeunesse. Une jeunesse dont je guéris mal. D'autant plus mal, peut-être, que tu n'es plus là pour la ressusciter avec moi devant un verre. Tu connaissais des villages extraordinaires, des gens taillés en pleine pierre, en plein bois. Le paysage que l'on voyait de la fenêtre de ta chambre-bureau du premier étage à Louisfert, là où « tu allumais tes feux », ne me sortira jamais des yeux. Au fond, tu n'as jamais triché avec les herbes. Jamais triché avec le marin saoul qui demandait sa route vers Nantes. Jamais triché avec ceux qui tendent l'oreille en espérant entendre le bruit du sang. De ta vie, qui a été courte, tu as su faire une somme de poésie. En trente années, tu as vécu beaucoup plus longuement et plus intensément en poésie que ces beaux vieillards symbolistes, lauréats du Nobel et membres de diverses Académies, qui agonisent sur un Himalaya de reniements et de mondanités. Tu sus, en souriant et en riant, être ce moine franciscain de l'âme, celui qui ne se permit jamais la moindre complaisance, le moindre manquement envers l'ordre de la poésie. Je n'ai pas toujours compris cette rigueur intérieure, ni cette hâte, qui te poussaient à accumuler des poèmes sur la table, à perdre toutes tes feuilles la même saison :
— Tu écris trop René !... Tu te ruineras vite...
Je tiens qu'il ne faut jamais solliciter le poème, qu'il faut le laisser agir secrètement, se nouer en soi comme un enfant dans une femme, l'attendre à l'accouchement au moment le plus imprévu, en quelque sorte qu'il faut que le poème tombe du poète comme d'un poémier ! Pourquoi secouais-tu l'arbre avec une telle rage ? Pourquoi cet acharnement de récolter en toute saison. Tes pommes étaient toujours des pommes d'or ! Le miracle avait lieu devant moi, mais je continuais de prodiguer les bons conseils :
-- Attention, René !... Attention à l'essoufflement, aux tics, à la fabrication...
Je n'avais pas compris qu'il te fallait dépenser ton trésor, donner des fêtes quotidiennes, écrire plus vite que nous. Je n'avais pas compris ce que la plus obscure molécule de ton corps savait déjà : qu'il te faudrait mourir à trente ans.
A présent, René, les choses sont toujours ce qu'elles sont sur la terre. Les hommes se déchirent entre eux. Les saisons passent. Les années font toujours leurs petites boules de fleurs d'amandiers et de neige, de bleu de juillet et de gibiers roux. Je vais chercher des champignons sans toi dans les forêts d'automne. La prairie de Rochefort, que je suis allé revoir l'autre jour, est toujours le plus beau paysage du monde avec ses peupliers qui se reflètent dans l'eau, ses collines grasses, ses barques, son horizon de forêts. Un aviateur y a une statue. On a élevé une chapelle, assez laide, à je ne sais plus quelle Notre-Dame de l'envol ! Nous sommes souvent venus là, à bicyclette, sous le soleil d'été. Nous regardions la tapisserie de haute-lice étendue sous nos yeux et nous disions en soupirant, en détournant la tête :
-- C'est le plus beau paysage du monde !..
C'est là que je te donne rendez-vous pour mon envol personnel, le jour où j'estimerai que ma vie est une porte retombée. C'est là que je retrouve ta présence vivante, ton sourire, et tes cheveux blonds dans le vent. Essenine se porte toujours bien. Lorca. Max Jacob, Reverdy, tous les autres. Mais j'oublie que tu en sais plus que moi sur leur compte. J'oublie que tu as ton ordre de mission pour les planètes mais que, comme le soldat bleu, le soldat-poète, écœuré du manque d'imagination des guerres et des fonctionnaires d'ici-bas, tu ne rejoindras plus jamais ton corps.
La mort d'un poète m'est plus qu'un chant d'espérance, Jean-Loup Passek.
L’Herne, page 41,
Rien ne serait plus triste, rien ne serait plus vain que d'offrir à la mémoire de René Guy Cadou un de ces éloges funéraires tels qu'une société hypocrite se plaît encore à en psalmodier au bord des tombes des « chers disparus ».
Ah ! il ne s'agit pas de jeter une petite fleur fanée à la mémoire d'une ombre.
Il faut se sentir maladroit, timide, démuni. Il faut que le vertige vous prenne. Il ne faut pas se compromettre, écrire « joliment » des mots menteurs. Il ne faut pas se prosterner devant l'écorce mais aller plus avant la nuit ; il faudrait tenter de rejoindre l'aubier. Qu'importent les chemins obscurs, qu'importent les épines. Si l'amitié est un cri, il faudrait être digne de ce cri.
Je n'ai jamais connu René Guy Cadou. Je l'ai découvert par hasard. Cette rencontre a été essentielle. Mais l'amitié avec les morts peut atteindre une violence insoupçonnée. Peu à peu la mort n'est plus un état définitif, un adieu, mais une transition, une nouvelle naissance. Autant dire tout de suite que pour moi Cadou n'est pas mort. Et ce n'est pas là une formule littéraire — pour une fois ne nous laissons pas trahir par la littérature.
C'était en 1956, je venais d'achever une décevante année d'hypokhâgne au lycée Henri IV à Paris, décevant sur le plan intellectuel (que ne m'étais-je imaginé, trompé par les récits idylliques des normaliens, dont le renom littéraire m'avait séduit) et sur le plan humain. Je préparais une licence en Sorbonne.
J'avais l'habitude d'accomplir chaque lundi matin un rite insolite dont le merveilleux n'a pas fini de me faire rêver. En ce temps-là, existait rue des Ecoles une librairie tenue par un monsieur énigmatique et volontiers sardonique qui offrait pour un prix excessivement modique des livres absolument neufs en service de Presse.
Le charme venait de ce que la devanture n'était fournie que le lundi matin. Tous les autres jours de la semaine, il n'y avait strictement rien à acheter : le libraire passait des heures et des heures sans rien faire, un livre dans la main, assis dans un vieux fauteuil de cuir. La poussière accumulée depuis des années pendait lamentablement des étagères.
Chaque lundi, une queue d'une quinzaine de fanatiques de tous âges et de tous milieux intellectuels mais rapprochés par leur passion commune attendait sagement mais impatiemment l'ouverture de la boutique — certains dont moi-même je l'avoue étaient là parfois depuis 6 heures du matin.
A neuf heures précises, la librairie s'ouvrait et au cours d'une inénarrable foire d'empoigne, chacun se ruait sur les livres qu'il avait auparavant convoités longuement mais qu'il n'était jamais sûr de pouvoir conquérir au nez et à la barbe de ses adversaires.
A neuf heures cinq, seuls quelques livres avaient échappé à l'avidité des barbares.
C'est ainsi qu'un jour j'ai découvert Cadou (le livre jaune de Michel Manoll chez Seghers) abandonné au milieu des restes d'un véritable champ de bataille.
La lecture de la biographie de Cadou, je l'ai faite au fond d'un petit café breton perché sur la Montagne Sainte Geneviève.
Il est inutile d'ajouter quoi que ce soit à cette histoire mais j'ai tenu à la raconter car elle n'est pas loin de ressembler à celle que vécut Cadou qui à Nantes fut un jour « poussé par le hasard d'une promenade vers une romantique bouquinerie » : celle de M. Manoll.
Les découvertes doivent se refuser à l'explication comme les poèmes. Toute beauté vient du mystère qui la crée.
Cadou n'est pas un homme à facettes. Il n'est pas affublé d'un masque à l'instar de Max Jacob qu'il aimait tant. C'était un homme étranger aux compromissions, étranger au jeu truqué de la Société. Cela n'a l'air de rien. Tout ce qui est simple n'a l'air de rien. Mais quel auteur contemporain peut-il s'enorgueillir d'une telle auréole ?
« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?
Mais l'odeur des lys, mais l'odeur des lys ! »
L'essentiel c'est l'aubier et aussi la sève de l'arbre qui est son poème, son chant. L'essentiel ce n'est pas le brouhaha, ce marais où l'on s'englue lentement et si spectaculairement.
L'essentiel c'est peut-être un visage, une herbe, un caillou.
Je suis libre de dire que pour moi, Cadou a toujours été le porte-parole d'une certaine forme de bonheur, de ce que j'appellerai le « bonheur triste » sans donner à cet adjectif son sens pessimiste.
Ce n'est pas une attitude. Ce n'est pas un alibi. La gaieté la plus intense peut être triste. En sera-t-elle moins belle ?
Le cri de Cadou, cri d'un homme parmi les saisons, parmi le murmure des hommes est un chant de la houle, un chant panthéiste peut-être, mais combien humble, combien humain.
Il ne s'agit pas de tresser une couronne : les couronnes se fanent vite. Il ne s'agit pas de se créer des illusions, de faire de quelqu'un ce qu'on eût aimé qu'il fût.
Personne ne doit tirer à soi la couverture. Cadou est Cadou. Pour ceux qui l'ont aimé et surtout pour ceux qui l'ont aimé à travers son œuvre, Cadou est quelque chose de plus qu'un poète si grand soit-il, ce quelque chose ne nous leurrons pas, est inexprimable.
« Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul ».
Cette phrase je l'entends sans cesse bourdonner en moi comme une abeille à la recherche de sa ruche.
Jamais la solitude n'est masochisme, jamais abri, jamais misanthropie. La solitude à travers l'amitié est un chant. Le chant de Cadou vient d'un rivage solitaire, un rivage que la corruption n'a jamais atteint, n'atteindra jamais car la corruption est une maladie de l'esprit et non un cancer du cœur.
Cadou dans ses poèmes apparaît comme un enchanteur. Non pas un de ces « enchanteurs pourrissants » dont le charme est indéniable mais un enchanteur dont le langage minutieux et ailé est à lui seul une émouvante tentative pour apprivoiser le monde.
Le pays que parcourt cet homme ne connaît ni la rhétorique ni la sécheresse. Ce n'est pas un pays constellé de temples marbrés, hanté par des personnages délicats et cérémonieux.
Le pays de Cadou, c'est la Brière cet Eden du rêveur où la beauté se cueille le soir « à la limite des féeries et des marais », où la vie se transforme soudain parce que l'instituteur d'un petit village accorde sa lyre aux bruits qui l'entourent : l'enclume du forgeron ou les hue-dia du charretier.
Comme dit Michel Manoll « il n'y a jamais eu de question pour lui. Ce que l'on peut nommer la réussite de Cadou, sa vérité, c'est ce va et vient incessant qui donne à ses poèmes une rumeur insolite et pourtant familière, un mouvement allègre et mystérieux : celui d'un homme qui fait un pas dans l'ombre, un pas dans la lumière ».
Actuellement, en France et ailleurs, la profession d'écrivain est encombrée d'individus trop intelligents qui cherchent à démystifier l'univers, à violer le mystère et qui plus est à l'expliquer. Nous manquons vraiment d'humilité : nous sommes au bord du sacrilège.
Si je crois en la poésie — et pourtant avec quelle réticence j'écris ce mot si souvent symbole hypocrite, label facile et impur qui recouvre une marchandise avariée — c'est parce qu'elle ne sera jamais une explication du monde mais bien plutôt un chant, un cri essentiel que ni la torture ni même la mort ne peut abolir.
Le mystère comme l'amitié s'apprivoise.
Il me semble que la chance de Cadou a été de trouver la clef qui permet d'entrebâiller la porte d'un certain royaume (qu'il se nomme Absurdie, Utopie ou Paradis) royaume où chacun peut voir sa place sans pour cela montrer patte blanche politique ou religieuse.
Le seul piège serait alors peut-être un mot de passe, lentement élaboré au cours d'une vie terrestre humble et triomphante.
C'est en ce sens que j'aime à déclarer sans fausse honte ni retenue que la mort d'un poète m'est plus qu'un chant d'espérance.
Hélène ou le règne végétal, Jean Laugier.
Une partition que le siècle peut lire
L’Herne, page 44
La poésie comme la musique ne se prouve pas : on la reçoit, on la subit, à condition toutefois que le cœur s'offre à elle. Il est une question que depuis des années je me pose : pourquoi craignons-nous tant en ce siècle d'en référer à notre cœur, comme si le cœur signifiait nécessairement débordements et guimauves, alors que l'esprit le plus sec et le plus calculateur commande aux moindres mouvements des hommes de cette vie.
Ces mêmes gens pourtant, nos contemporains, qui suivent d'un œil attentif les cours de la Bourse et les variations de cote de leur peintre, vous les verrez l'œil lyrique et enfantin se rengorger d'art aux concerts du dimanche. Redécouvrent-ils une partition qu'ils avaient su lire ? Non pas... Depuis 1789, savoir entendre par les yeux une croche pointée et un bémol sent son ci-devant. Le cœur et l'esprit doivent se suffire afin d'entrevoir les intentions de l'artiste. La lecture du programme compensera les manques de la culture. Le soliste et la masse des instruments feront le reste !
Je ne critique point cet état de choses. L'accord spontané du cœur et de l'esprit crée des miracles dont le musicien heureusement profite. Et ce siècle, j'en conviens, a son mérite : une minorité hier lisait la musique, une majorité aujourd'hui lit tous les livres. Mais dès lors, pourquoi cette majorité n'ouvre-t-elle pas aujourd'hui un livre de poésie comme la minorité d'hier ouvrait et entendait un livre de musique ? Ce siècle qui se veut d'esprit, car il croit faire ses comptes, pourrait bien n'être à l'heure de l'échéance, si je m'en réfère au cycle des civilisations déjà mortes, qu'un siècle de dupes. Un siècle qui n'honore pas ses poètes, est un siècle déjà mort.
Quelle injustice patente motive ces réflexions ? Je viens comme à l'accoutumée d'ouvrir ce grand livre d'heures et d'amour dont le titre seul pourrait être la devise d'un blason, « Hélène ou Le règne Végétal », et qui pareil à ces portes de campagne prises en plein bois nous annonce une demeure heureuse car divinement simple : partition où les voix de l'homme et de la nature concertent, partition que le siècle peut lire et que trop peu de gens encore connaissent.
Nous rendons, nous poètes, un hommage à René-Guy Cadou. Mais les hommages que les poètes se rendent, ne sont que lettre morte jetée à la mer dans une bouteille, si le navire sombre, si les hommes quotidiens d'établi, de charrue ou même d'épée, si tous ceux pour qui ils chantèrent sans ostracisme jusqu'à en mourir, même à trente et un ans, ne les entendent pas, ne les récitent pas comme on radote par naturelle offrande ses joies et ses peines.
Il ne m'appartient pas de dire ce qu'était « de son vivant » René-Guy Cadou. Ceux qui le connurent, témoigneront. Que Villon ait été coquillard, Claudel chargé d'ambassades ou Cadou instituteur, seul le dialogue d'homme à homme compte.
En camp de concentration, des hommes très dissemblables, qui ne se seraient point salués la veille, se retrouvèrent fraternels. Devons-nous admettre qu'en état de paix, et d'une paix qui n'est toujours qu'apparente, les hommes craignent les poètes ? Auraient-ils à ce point peur de la fraternité ?
Dans une mansarde qui se voudrait un village, des amis périodiquement sont venus. Je leur ai lu Cadou. Les uns pleurèrent comme moi, sans se soucier d'où venaient ces larmes. Les autres sourirent d'un air entendu : sans doute souhaitaient-ils que l'on pleurât d'amour sur leurs propres œuvres.
Ceux qui veulent à tout prix sourire, nous disent : visons à l'universalité. Ceux qui pleurent, ne visent pas : ils ont trop de joie pour calculer la gloire. Un homme comme René-Guy Cadou leur parle, et cela suffit. L'universalité n'a pas d'uniforme !
Nocturne
Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance
Pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance
Oh! Je crois bien que ce sera à genoux
Mon Dieu! Que je me rapprocherai de Vous!
Le plus beau pays du monde
Ne peut donner que ce qu'il a
Myosotis ici et là
Mais beaucoup d'herbes sur les tombes!
O mon Dieu! J'ai tellement faim de Vous tellement besoin de savoir
Qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires
Que la cuisine soit bonne ou fade nous ne sommes point ici à l'Office
Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lis!
Je crois en Vous Hôtelier Sublime! Préparateur des Idées justes et des plantes
N'allez pas redouter surtout quelque conversion retentissante!
Et qu'un tel ait choisi le pain dur et le sel
Soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel
Considérez que je vous suis parent par quelque femme de village
Et par quelque vaurien d'ancêtre
L'une adorait Votre Visage
L'autre s'est payée votre tête
Je fais effort! Je voudrais marcher à vos côtés et vous lire des vers
Mais il y a ces relais si reposants dans l'ordre de la Terre
Ah! Je me suis conduit de façon ignoble dans les cafés
En présence de Vous j'eus toujours l'air impatienté
C'est pourquoi me voici plus seul encore plus veule
Avec ce masque d'Arlequin trop triste sur ma gueule
Pardon Seigneur! Pardon pour vos églises
Et si j'ai galvaudé dans les champs
Si j'ai jeté des pierres dans vos vitres
C'est pour que me parvienne mieux Votre Chant!
Qu'il fût porté par des oiseaux ou à vois d'homme
Jeté là comme un bock sur le comptoir de l'harmonium
Ou dans l'air comme un col de violon
A neuf heures du soir qu'elle était belle la religion!
Ah! J'aurais pu tout comme un autre être choriste
Et grappiller de long en large le corps du Christ!
Mais tous ces blés en feu dans les cristaux du soir se reflétant
C'était Vous si intimement
Qu'il suffisait alors de pousser la fenêtre
Pour que la joie pénètre et pour Vous reconnaître
Que n'ai-je su Vous arrêter
Quand vous alliez entre les saules
Les bois de justice à l'épaule
Comme un pêcheur au carrelet?
Car maintenant tout est devenu subitement si difficile
A cause de cette pudeur en moi et de l'orgueil également imbécile
Que je voudrais ramper vers Vous j'en serais encore empêché
Par cette dérision de l'Acte qui est dans l'ordre de la société
Mais Vous quand vous mourûtes sur le Golgotha
Dites! Qu'est-ce que çà pouvait vous faire le ricanement de ces gens-là?
Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre
Laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources
Et tirer quelque note sauvage de la grande forêt d'orgue des pins
O mon Dieu que la nuit est belle où brille l'anneau de Votre Main!
Tous ces feux mal éteints dans l'air et ces yeux de matous en bas qui leur répondent
Ce cri d'amour fondamental qui est celui de notre pauvre monde!
En d'autres temps j'eusse été moine ou bien garder les vaches
Et pourquoi pas dans une léproserie de village
Maniant les doigts dans le soleil
Heureux celui qui naît en juin parmi les nielles
Il connaît la beauté des choses éternelles!
Oh! Sur l'ardoise du Ciel si l'on tient compte
De ce pays sans charme où je suis né
Si l'on juge à propos mes larmes
Seigneur! Je suis exonéré?
Qu'il soit coupable non-coupable
Toujours en peine de son Dieu
Qu'on lui serve pour vin de table
La rosée lustrale des Cieux!
Pierre Jean Jouve
L'Herne, page 49,
9 Mars 1951
Cher Monsieur,
J'ai admiré plusieurs pièces de votre petit livre et particulièrement « Nocturne », je désire vous le dire. Il est très rare que je réponde à un ouvrage de poésie parce qu'il est tellement rare que je sois touché par un accent authentique. Je vous remercie donc pour un moment d'admiration et d'affection.
Croyez, je vous prie, à ma bien sincère sympathie.
Lettre de P. Irénée Vallery-Radot
L'Herne, page 50,
Mon cher Dominique,
Vous me demandez mon témoignage sur René Guy Cadou Retiré de ce monde depuis plus de quinze ans, j'ignorais tout de ce poète authentique et jusqu'à son nom. Depuis que, par vous, je connais ses vers, chaque fois que je reviens à lui, ils me sont une nouvelle surprise. A la première lecture, j'avais bien reconnu une voix amie, mais telle espièglerie, telle embardée extravagante m'avaient d'abord un peu déconcerté : je n'en trouvais pas la clé. J'étais devant certaines associations d'images comme au jeu de cache-cache, un enfant, quand il cc brûle, sans arriver à tomber juste sur un de ses compagnons rendus invisibles. Maintenant, je sais pour toujours ce qui fait chanter Cadou, aussi naturellement qu'une mésange : c'est l'enfance du cœur qui, par l'amour humain, l'accorde à toute la création. J'imagine que tel est le sens du titre de son livre : Hélène ou le Règne Végétal. Pour lui, les hommes, les plantes et les bêtes sont de la même famille puisqu'ils sont formés du même limon par la même main divine, et ils ne sont là que pour échanger leurs dons. Ils ont entre eux des regards de connivence et si le poète les prend les uns pour les autres, c'est qu'ils sont nés du même Père qui est dans les Cieux et destinés à la même louange. L'Amour métamorphose toutes choses et les unit dans la même prière.
Cette fleur dans la main devient source et cheval
chante Cadou. Et quand il allume, comme autrefois, son feu de bois dans l'âtre, toute la forêt native y ressuscite, transfigurée, en branches et en feuillages de flammes où ronfle et galope le vent ivre de joie. Le Paradis est retrouvé.
Un seul grand jour de vérité avant la chute
ainsi le définit-il profondément. Chacun de ses poèmes est le jour d'avant la chute, précisément, fut-il le plus désenchanté, le plus amer, car l'ironie chez lui n'est jamais cruelle : elle est le masque que prend la compassion pour entrer partout. Et la misère elle-même arrive à sourire, comme dans les Béatitudes.
Mais je sais que je n'aurai jamais fini de le découvrir. Il ressemble au printemps lorsqu'il est revenu dans le jardin de notre monastère et qui m'étonne chaque année lorsque réapparaît le merle dans son impeccable habit noir éclairé de son seul bec jaune et que, vif et prudent tout ensemble, il s'élance pour danser son ballet solitaire devant le parterre des pâquerettes émerveillées...
Propos de Daniel Gélin sur la poésie de Cadou
L’Herne, page 52,
J'ai besoin de la poésie, aussi organiquement que de l'air que je respire. Elle est ma raison de respirer. Mon excuse de respirer. Elle est ma providence, mon cheminement. Elle est ma permanente question posée, mon secret, mon cœur, ma révolte indispensable, mon sang. Elle est ma respiration elle-même.
Les poètes ont trouvé les mots sacrés. Les rythmes qui fixent cet impalpable. Et ma joie profonde est de les prononcer à haute voix de les faire parvenir. De nombreux poètes me sont familiers. Mais l'interprète existe toujours, il y a la transaction, conscience à peine endormie d'être le véhicule, l'instrument.
Avec René-Guy Cadou, c'est tout à fait autre chose. J'oublie tout, je deviens, je respire le même souffle. Il y a identification totale.
Il serait vain, et pour moi impossible, d'expliquer ce phénomène. Il faudrait rechercher dans les plus profonds secrets de mon enfance en Bretagne. Il faudrait analyser ma solitude et ses caprices. L'instant présent qui se consume et vacille. Et même cet avenir qui me concerne, me contourne et sait, déjà peut-être. Manier tous ces filtres m'indispose et m'effraie.
Les mots de Cadou me conviennent tellement qu'en les murmurant, j'ai l'impression de les trouver moi-même. De les avoir munis, vécus. Ce rythme, ces odeurs, cette joie, cette infinie tendresse, cette démarche entre le réel et l'infini se servent de ma voix. Je ne suis plus qu'une voix. Je me suis senti au premier mot, dissoudre. Je suis anéanti et pourtant j'existe. Comme j'existe.
Hommage à René-Guy Cadou, par Pierre Ménanteau
L’Herne, page 53,
Il y a dix ans que René Guy Cadou nous a quittés, et depuis, sa gloire n'a fait que grandir. Certes, la mort prématurée d'un poète — il n'avait que trente et un ans — s'accompagne toujours d'une émotion qui se prolonge en échos de tristesse, mais pour qu'une réputation survive aux années qui passent, il faut qu'elle soit bien fondée, car les générations rapidement, se succèdent, et plus encore en un temps comme le nôtre ou « l'accélération de l'histoire » a gagné l'histoire littéraire. D'où vient donc que la poésie de Cadou ne se soit pas fanée, comme ces primevères que les enfants de Louisfert posèrent sur le cercueil de leur régent ? D'où vient qu'au contraire, elle ait gagné en vertu incantatoire et qu'elle ait de plus en plus élargi son public d'amis, d'admirateurs ?
Cela vient d'abord, me semble-t-il, de cette rencontre, assez rare, d'un poète inspiré et d'un artiste accompli. Trop souvent, le poète se fiant à ses dons naturels, néglige de les servir par une forme méditée. Inversement, l'artiste, maître de sa facture, oublie parfois de prendre appui sur ses racines : la tige, privée alors de nourriture, laisse s'étioler la fleur, qui se découpe, sans parfum, comme une corolle artificielle.
Or, René Guy Cadou, homme des pays de l'Ouest, après un précoce et long apprentissage poétique, n'a jamais cessé de vivre dans l'intimité du règne végétal ou animal, très près de ces artisans, de ces paysans qu'il aimait. Comme Francis Jammes et Ramuz, comme le très regretté Henri Pourrat, il s'est imposé la résidence rurale. Il eut d'ailleurs pleinement conscience du bienfait que son art recevait de cet apparent sacrifice :
Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?
Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys !
Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil
Oui, mais l'odeur des lys la liberté des feuilles !
René Guy Cadou est un poète qui chante. Ses vers ont non seulement cette force de choc qui subjugue l'attention ; fortement scandés, ils possèdent, grâce à la magie du rythme, des sonorités, le pouvoir de se fixer dans le souvenir. On les retient aisément ; on se les récite par cœur, et ils deviennent une part durable de ces biens poétiques qui appartiennent, au plus haut titre, aux « biens de ce monde ». Grande, belle leçon pour ceux qui seraient tentés d'oublier que la poésie est fille de Mnémosyne.
Toujours concret et dru dans le choix des vocables, toujours évocateur dans celui des images, Cadou « bénéficie » également —douloureux privilège — d'une aura prémonitoire qui naît de son expérience d'orphelin, de la prescience qu'il eut, très tôt, que sa vie serait brève. Dès ses premiers poèmes, on entend déjà, comme, dans la Ve Symphonie de Beethoven, le frappement des quatre notes.
La diane doucement poignante du destin...
De là le pathétique de cette poésie qui, tout enfiévrée du désir de vivre, a franchi aisément « ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible »,
Etrange indétermination ! Il est fréquent que, dans nos pays d'Ouest, l'âme, traversée d'intersignes, soit à la fois fille de la terre et de l'air, qu'elle se meuve dans l'entre-deux. Il en est ainsi de celle de Cadou.
Le jour où l'on publiera la correspondance, on saura mieux quel crédit le poète accordait à la foi chrétienne comme aussi à la foi communiste. « Mixte et contradictoire », charnelle et spirituelle, éprise avant tout de liberté, une nature si riche ne saurait s'enfermer dans d'étroites limites. Aucun conformisme en elle. Si Cadou préféra l'esprit de la prairie à l'esprit de la chapelle, « l'église habillée de feuilles » à l'église de pierre, il n'en est pas moins vrai que son Nocturne est l'un des plus beaux chants d'amour religieux qui soient dans la poésie française :
Oh ! sur l'ardoise du Ciel si l'on tient compte
De ce pays sans charme où je suis né
Si l'on juge à propos mes larmes
Seigneur ! je suis exonéré !
Et quels accents fraternels, quels dons du cœur partout prodigués ces recueils qui sont comme autant de livres d'amour !
René Guy Cadou, voix qui chante, ne cesse de nous émouvoir, de nous enchanter. Il n'était pas cependant fils de Merlin. Il était fils de l'homme et de la femme. Il était homme — et c'est son humanité qui emplit jusqu'au bord ces vases d'élection que sont ses poèmes — ses poèmes nés dans la douce présence d'Hélène, dans la solitude de Louisfert-en-poésie.
...Car tel est le bonheur de cette solitude
Qu'une caresse toute plate de la main
Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes
La légèreté d'un arbre dans le matin.
Le 18 Février 1961.
Pas d'hommage pour Cadou, du respect, Michel Bernanos
L’Herne, page 56,
Sur l'étang au miroir trop mince
La route en hiver était belle
Et vivre, je le désirais
Comme un enfant qui veut danser
Il est mort après de lourdes souffrances, rongé par les tripes. Ça, c'est René Guy Cadou. Que m'importent les mille autres belles choses de sa poésie, quand son « Moineaux » peut tout dire de lui le rêve de vivre sur une vie qu'il savait déjà fragile. Cette fragilité, il nous la jette au visage.
Buvez quand même, ô fils ingrats !
Buvez mes larmes, et dans l'instant désaltérés
Crachez sur moi
Crachez bien droit
Comme des hommes
Cadou s'en moque.
Nous avons beau vivre dans une époque de châtrés et de poètes préfabriqués, nous ne pouvons songer à lui sans larmes au cœur. René Guy Cadou a d'abord dû jouir de nous voir si con, puis très lentement il a dû souffrir.
Peut-être un jour à la faveur soudaine d'un orage
Sous les coups de poing sourds d'un astre impatienté
Seras-tu de nouveau cette graine d'espace
A la recherche d'un ciel plus ferme pour germer.
Vois-tu, Jegoudez, toi qui sus si bien me chanter l'ami qui fut pour toi peut-être, un rêve, tu voulais que je le place dans le monde végétal, hideux de vert ainsi que de méchanceté naturelle. Cadou n'était pas seulement un très grand poète, il était, chose plus rare encore, un homme foncièrement bon.
Ah! Pauvre père ! Auras-tu jamais deviné quel amour tu as mis en moi
Et combien j'aime à travers toi toutes les choses de la terre
Quel étonnement serait le tien, si tu pouvais me voir maintenant.
Je ne veux surtout pas paraître maître en la matière, mais nom de Dieu, comment ne pas vibrer du corps au membre qui m'a créé, lorsque je lis comme une fin de prière, ces simples mots trop beaux pour être lus par nous.
Triste vie
Auras-tu fermé la porte
A temps.
La mort a fait de Cadou un chef de file, par Pierre Béarn
L’Herne, page 58,
Cadou, notre ami
Je n'ai pas eu la chance de vivre avec Cadou à Louisfert, mais il ne venait jamais à Paris sans passer me voir au quartier latin.
I1 m'arrivait frais comme un maraîcher, les épaules heureuses, la main loyale. Nous devenions aussitôt deux frères.
Nous vivions sur les mêmes longueurs d'ondes, car l'amitié restait notre pain quotidien. Il m'appelait : Dabit-poète ! estimant que mes « Couleurs d'usine » étaient l'expression posthume en Poésie du grand poète en prose que fut le créateur de l'Hôtel du Nord.
Lorsque, en 1950, je fus chargé par Gaul Gilson, de présenter chaque semaine à la Radio -- et cela dura quatre ans — les meilleurs poètes de notre époque — car j'étais las de n'entendre vanter au micro que le talent des morts — ce fut évidemment Cadou qui prit la tête de ces 150 émissions.
Hélas, il ne pouvait déjà plus se déplacer, et il m'écrivit : « Ta proposition me va au cœur, d'autant plus que ce serait avant tout l'occasion de t'embrasser et d'embrasser quelques amis : mais, mon pauvre cher vieux, tu ignores que je suis perclus de rhumatismes (après deux opérations, cette année et le temps humide de cet été) et sans argent, sans costume autre que du gros velours à côtes de paysan, que c'est la veille de la rentrée des classes et enfin que je suis sûr de bafouiller au micro, ni ayant jamais parlé, ni causé. Mais je te remercie bien fort quand même mon cher Béarn. Si tu voyais un moyen d'arranger cela, je pourrais répondre à tes questions, et quelqu'un, que tu désignerais, dirait mes réponses au micro... »
C'était une idée, en effet, mais combien dangereuse pour la première émission d'une longue série. Si cette combinaison venait à être connue, c'en était fait des 150 futurs quarts d'heure !
Heureusement, j'ai trouvé tout de suite le complice qu'il nous fallait, Luc Bérimont ! et nous avons dialogué durant un quart d'heure comme si Cadou me répondait !
Bérimont, ce grand bavard, obligé de répondre au micro selon un texte qui n'était pas de lui, ce fut là le côté comique de cette tromperie charitable. Bérimont, un autre grand poète, qu'il faudra bien auréoler un jour.
Quelques mois plus tard, Manoll ayant posé le problème « Comment venir en aide à Cadou ? » J'ai inventé et mis en marche Le Mandat des Poètes qui est devenu, grâce à Cadou son phare, une manifestation fraternelle de sa survie.
La mort a fait de Cadou un chef de file. Il eut certainement préféré continuer de vivre obscurément dans la compagnie de ceux qui l'aimaient.
René-Guy Cadou : il est impossible de parler de lui comme d'un autre poète, par Louis Chaigne
L’Herne, page 60,
René-Guy Cadou : il est impossible de parler de lui comme d'un autre poète. Je ne cherche ni à le comparer ni à le situer. A partir du moment où nous classons — et certes il est des classements indispensables, mais il faut y procéder avec humilité—, nous détruisons quelque chose de notre émotion et de notre plaisir. Chaque poète est unique pour moi. René-Guy Cadou, plus que beaucoup, détient ce privilège d'unicité.
Il tend vers la communion et vers l'universalité du don. I1 s'exprime au nom de tous et pour tous. Mais aussi bien fait-il entendre un chant personnel, destiné mystérieusement à chacun, comme si chacun était seul à l'ouïr. On a pu parler des étranges musiques de Loti, composées avec les mots de tout le monde. Les mots tout simples de René-Guy Cadou s'associent en une musique ineffable, que tous peuvent goûter, mais qui semble procéder d'un seul cœur pour un seul cœur. J'y insiste parce que je reconnais là comme une sorte de pouvoir miraculeux.
« Je vis pour mieux mourir » : celui qui a articulé cette parole, si riche de sens et si vaste de portée, a résumé ainsi les aspirations d'un être choisi et comblé. Certes, il vécut intensément, se nourrissant des objets de sa vision quotidienne avec une avidité singulière, mais non pas comme quelqu'un qui sait ses jours comptés et n'en veut rien perdre. Il pressentait que l'homme « passe infiniment l'homme », que la vie terrestre est une sorte de noviciat, initiant à une vie plus complète, dans laquelle on pénètre à la manière du ruisseau aboutissant au fleuve. Son éblouissant Nocturne le révèle attentif à ces sources où l'amour humain s'enchante de découvrir ses origines éternelles.
Nous aimons ses cantiques de la patrie retrouvée et nous aimons sa louange permanente des plus modestes réalités, des objets les plus infimes, de ces choses jugées par d'autres sans valeur et que son regard rendait belles. René-Guy Cadou nous fait désirer les suprêmes béatitudes sans cesser de nous attacher à l'instant présent et aux humbles bonheurs. L'infiniment petit et l'infiniment grand sont sensibles, dans son œuvre, jusqu'à la plus surprenante proximité.
Samedi 25 février 1961.
Cadou présent, par Yves Vequaud
L’Herne, page 61,
Nous sommes de mauvaise foi. La poésie de Cadou est limpide, lumineuse plutôt, minérale plus que végétale, elle a la clarté et les jeux de clarté des cristaux naturels. La poésie de Cadou est naturelle, nous l'aimons spontanément et c'est ce qui nous gêne. Nous avons peur, l'aimant ainsi, de pécher par naïveté. Nous refusons de nous laisser séduire. C'est trop simple. à la fin, et nous disons : « C'est trop facile ».
Mais la vraie poésie n'est jamais facile et les vers de Cadou peuvent être aussi riches que les vers les plus — formellement — hermétiques. Nous craignons que la lumière ne soit que le reflet du vide, or, celle de Cadou n'est pas près d'être tout entendue, elle est riche. Ces deux vers :
« Mais donnez-moi la route droite de la mer
Et pas d'autres explications »
ne rappellent-ils pas par leur ampleur cette phrase des « Illuminations » :
« Je suis réellement d'outre-tombe,
Et pas de commissions ».
Pourquoi, sans scrupules, tenons-nous Cadou à l'écart. Il est temps de reconnaître la richesse de son héritage. Nous avons si peu de poètes lyriques, si peu de poètes de la joie.
Nous savons combien de temps « Les Nourritures Terrestres » ont dû attendre un public, et combien ce public trouvé a mal compris le livre. Cadou le comprit et comprit. Ses vers ont :
« Ce goût de lait de fruits de feuilles traversées
Par les tendres ruisseaux de sève végétales ».
Il a su « toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu » comme souhaitait le faire Gide.
« Simplement » est le grand mot de la loi de Cadou. Avec lui, nous partons de plain-pied. Chaque mot tient et marque sa place. Il se perd ni ne nous trompe.
Sa poésie est bonne, elle a le goût du pain partagé, la fraîcheur aussi des chansons anonymes. Eh quoi I Rochefort sur Loire n'est pas si loin d'Orléans de Beaugency ou de Vendôme.
En Andalousie, les chanteurs aiment modifier à l'improviste un vers de leur fandanguillos pour saluer un invité, pour le faire participer, pour le mêler au sacré. Ils s'emparent de son nom ou évoquent en deux mots un fait qui eut cet homme pour acteur et le village pour décor. Le poème n'en est pas affadi pour autant, les autres vers suffisent pour que l'ensemble conserve sa grâce inexplicable. Il y gagne seulement une dimension. Si le nouveau vers est bon, un autre chanteur le reprendra, le nom de l'étranger, parti depuis longtemps, continuera d'être chanté. Nul ne saura plus alors de qui il est question. Le vers de circonstance sera devenu incantation.
Cadou procède de la même façon quand il parle du garde Pacifique Liotrot, du passant Max Jacob, d'Anonyme Chatelain.
Il prend appui sur la terre franche, rien d'étonnant à ce que ses vers montent si droit.
Dans les cafés de Grenade ou de Cordoue, les garçons savent et disent les couplets du « Romancero Gitano » dont sont si proches parfois ceux de « Hélène ou le Règne Végétal ».
« Dans le ciel un enfant pêche
Les ablettes du soleil ».
Un jour peut-être, dans les cafés de l'Atlantique, on entendra ces mots, n'en soyons pas surpris. Cadou comme Lorca connaissait la formule. Ils étaient de provinces où la terre a gardé son poids, son odeur, la musique. Ils savaient l'importance des choses.
Un jour les hommes-morts retrouveront le courage et la voix pour dire les poèmes, sans faiblesse. Cadou sera présent.
Lettre de Max Jacob
L’Herne, page 63,
23 Octobre 1941, St-Benoît.
Cher Ami,
La notoriété est la connaissance du nom, sans amour. La gloire est une notoriété universelle mêlée de respect, de reconnaissance, d'admiration et d'amour... La vogue est une notoriété passagère due à la convenance de l'expression de M. Un tel, avec les préoccupations d'une époque. Oui ! Trenet a la vogue... La gloire suppose une part d'éternité dans le talent, la notoriété suppose un remarquable talent. La vogue est une amourette du public, Cocteau a la vogue et la notoriété.
Tu ne peux pas plus découvrir parmi tes confrères celui qui marquera l'époque que nous ne pouvions nous douter qu'Apollinaire serait le plus grand. Encore nous en doutions- nous quelque peu mais sagement on tenait compte de la sympathie. Je ne crois pas qu'on puisse juger la future gloire des gens qu'on n'apprécie que par l'imprimé. Notre opinion d'Apollinaire ou de Reverdy venait de la fréquentation de leur personne. Aie confiance en toi I... je n'ai pas à te conseiller, c'est à toi de me conseiller. J'ai confiance en Manoll. Je ne sais pas si Eluard et Reverdy ont fait leur temps : c'est difficile à dire. Je prends Au... pour un blagueur ainsi pour tous les surréalistes : ils s'amusent : c'est bien. Ils amusent les autres, c'est mieux mais la poésie, c'est Lorca ou Kafka. Il y a plus de poésie dans le sincère Salmon ou dans Milosz que dans aucun surréaliste.
Je t'embrasse.
Max Jacob.
Ne m'en veuille pas de mystères obligatoires. Il faut se taire. Ne doute pas, ne doute pas de l'amitié jusqu'au trépas, depuis la nuit jusques à l'aube de celui qui signe Max Jacob.
Je t'embrasse.
1942.
René-Guy Cadou ou la statue végétale, par Michel Manoll
L’Herne, page 66
Dix années se sont écoulées depuis la disparition de René-Guy Cadou. Mais, comment croire qu'il ne soit plus parmi nous ? N'est-il pas le plus vivant de ce petit groupe de poètes, engagés sur la voie d'une restauration de la poésie, à partir de ses données sensibles ?
Si René-Guy Cadou occupe le tout premier rang, il le doit bien sûr, à la force rayonnante de son verbe. Mais il ne s'agissait pas moins, pour ses compagnons et ses amis, d'unir leurs efforts, afin d'attirer l'attention du public sur son œuvre, tant il est vrai que la poésie qui le mérite trouve un jour ou l'autre une audience. Ce public existe, mais il n'entend pas être dupé et il préfèrera toujours aux rebus et aux jeux du langage, cette vibration mystérieuse, cette émotion directe et perceptible, qui le relient, de toutes ses fibres, à ce courant humain et hauturier qui l'emporte sur tout le reste.
Cadou est le type du poète à l'état pur, pour lequel aucune autre assignation n'avait de sens. Il est né à la poésie -- à une poésie qui contient, dans sa totalité, notre univers. Et, n'ayant jamais vu en elle que sa source unique, il s'est appliqué, avec une constance et une ferveur de tous les instants, à en remonter le cours.
Lorsque je l'ai connu, alors qu'il était élève du Lycée Clemenceau, à Nantes, il n'avait guère plus de quinze ans. Mais déjà, le poète en lui était parfaitement constitué. Tout le ramenait à son impérieuse vocation, sans la moindre forfanterie, et sans qu'il eut besoin de prendre une attitude. Telle fut la merveilleuse organisation de cette destinée qu'il se trouvait de plain-pied avec ce domaine intérieur, aux larges baies aériennes ou, de salle en salle, il allait passer tour à tour, y peignant à la fresque, sur des murs chaulés, une imagerie où Giotto et le Poverello eussent reconnu, parmi les or frais et ductiles, des visages d'orants et d'orantes, transfigurés par une lumière d'outre-terre.
Cette religion poétique de Cadou ne se différencie guère de l'autre, pour être issue de la même Main de Gloire, qui anime le clavier de Nocturne, et faisant sourdre dans ce cœur charnel ses hautes tonalités et son murmure d'abeille.
Cadou a vécu au sein d'un miracle perpétuel et il était de ces hommes prédestinés, qui n'ont à conduire qu'un seul attelage, à travers des campagnes sylvestres aux pénétrantes senteurs de fougère et de mousse et toutes baignées de cette clarté suave que le printemps, sur des fonds de verdure éternelle, modèle en bourgeons ou découpe en copeaux scintillants — animant la transparence et y inscrivant toutes les lueurs du prisme.
Il n'a pas eu besoin de préparer sa palette, puisqu'il ne puisa jamais dans l'ombre ou le bitume, se donnant tout entier à sa tâche de maître d'œuvre des saisons, n'y cherchant que la modulation la plus accessible, selon un accord préétabli et qui le reliait à ces pollens voyageurs qui imprègnent sa poésie de leur pouvoir fécondant.
Mais quel était l'aspect physique de cet homme ? me dira-t-on ? Celui d'un Celte râblé, à la forte et ronde caboche, à la carnation fraîche et rose. Il ressemblait à ces saints bretons, taillés au couteau, avec leurs traits vigoureux, mais nimbés par la douceur et la sensibilité.
Et il avait, donnant à son visage son aimantation, des prunelles d'un bleu pâle et lustré, qui semblaient lavées par les embruns. Ces yeux, perdus dans un rêve perpétuel, et portant sur toutes choses un regard grave et serein, ne faisaient que vous effleurer.
Il avait encore un haut front granitique, un nez fortement charpenté, des cheveux fins et ondés, aux teintes de sous-bois automnal et de genêt.
Sans nul doute, il appartenait bien à cette race, de très vieille chrétienté, qui a toujours identifié ses croyances à sa destinée et qui, dans la pérennité, demeure ancrée à ces paysages des confins de l'Occident, où chacun naît et meurt à la même place.
Cadou ne pouvait échapper à l'emprise de cette terre, dont il se fit le merveilleux harpeur. Il aima, par-dessus tout, le sol où ses pas résonnaient et avec lequel il formait bloc. Et il connaissait, certes mieux, le geste du donateur, se frayant une voie parmi labours, semailles et moissons, que les lourds traités de philosophie et de métaphysique de nos savantasses.
Il faut l'imaginer, s'avançant à grandes enjambées, d'un pas sûr et allègre de chasseur, au-devant de ces « horizons plats » où germe le silence ; parcourant une levée de lande, humant cet air vif, chargé de vent, de sel et de soleil dont il n'aurait pu se passer. Ne lui dispensait-il pas cette plénitude et cette joie de vivre qui étaient sa respiration naturelle ?
Il était l'homme des futaies, des demi-jours verts ou dorés, des sous-bois dispensateurs de paix, où le vent tisse sans cesse sa mélopée. Il se blottissait dans cette enveloppante tiédeur végétale, au sein de ce recueillement, à l'infinie quiétude, d'où s'élève, parfois, le bourdonnement d'une batteuse ou ces lentes rumeurs feutrées qui animent lentement les pinèdes et la feuille sauvage des châtaigniers.
Je ne puis retrouver Cadou que dans une brume bleue, traînant sur l'herbe des talus, à la lisière des bois, dans ces combes où rutile l'or éclairci des hêtres, pour l'avoir accompagné, tant de fois, à Rochefort-sur-Loire, aux Forges, à Saint-Marie-sur-Mer, à Saint-Brévin, à Bourgneuf-en-Retz, à Saint-Aubin-des-Châteaux, à Louisfert enfin, aux avancées de cette terre douce et maternelle qui semblait toujours lui murmurer à l'oreille ses plus secrètes rêveries.
Il était le reflet même de ces paysages, épandus dans une lumière ouatée, où tout est reflets, profondeurs, mates sonorités et qui, interminablement, se recommencent, comme dans cette Brière, aux verts herbiers mouillés, où il scandait le rythme d'un poème au bruit d'un aviron, creusant la pénombre close des eaux dormantes.
C'est là, et non ailleurs, que je verrai toujours René Guy Cadou, à ces rendez-vous de la lumière et de l'espace, parmi l'innombrable murmure ailé des campagnes solennelles dont il était l'ordonnateur et dont il connaissait tous les visages et les secrètes féeries — commensal de ce monde « à part », hors des mouvements humains, où le flux de la durée trouve sa pierre d'achoppement.
Je sais bien que, parvenus tous deux au terme de ces dix années de séparation, il m'attend, parmi ces landes en fleurs d'où se détache une longue ligne de forêts, de prés familiers, de taillis, de champs, éclatants de rhododendrons, dans la tiédeur humide des combes et l'immortalité d'un monde de bruyère et de chênes anciens, aux branchages gainés de mousse en ces mystérieuses retraites du pays breton où stagnent les lents crépuscules de l'automne, et où il demeure, comme Prospero, aux abords d'une île enchantée.
Propos d'André Salmon
L’Herne, page 68,
René Guy Cadou ? Je n'ai pas connu l'homme. J'ai tout de suite reconnu le poète. Que ceux qui l'ont approché et aimé humainement me pardonnent. Je l'ai écrit plusieurs fois : La Mort donne à l'artiste, au poète, d'immenses avantages. Bien sûr, René Guy Cadou nous quitte trop tôt, quittant jusqu'à ceux qui ne l'ont pas connu, rien que reconnu. Il n'avait pas tout dit. Il nous manquera tout ce qu'il nous promettait. Nous en demeurons fâchés, tristes. Oui, tous les poètes devraient-ils mourir dans leur fleur ? Rimbaud s'est tué en s'étouffant entre les pages du Grand Livre. Bien joué, en somme. Mais René-Guy Cadou que j'aimais bien sans l'avoir rencontré, est, je crois, mort en souffrant. Je ne m'en saurais consoler.
L'œuvre à la fois aérienne et puissante de René-Gay Cadou a ouvert la voie à une génération de poètes. Il est mort. Il se tait. On le continuera.
Donné à l'Art par le Peuple, René-Guy Cadou a le rare mérite, l'honneur, de n'avoir pas été populiste. Le Prince des Poètes de son âge.
Sanary, février 1961.
René-Guy Cadou, Points et Virgules, Pierre R.
L’Herne, page 69,
Les vers ne sont pas faits pour rester aux pays des livres mais pour chanter dans la mémoire et sur les lèvres de ceux qui s'enchantent aux rythmes de la vie. Sensibles au mystère de l'alliance, toujours nouée, toujours dénouée, des hommes et des choses, nous demandons aux mots d'être la musique qui l'évoque dans sa joie et dans ses douleurs. Laissons ceux qui refusent l'incantation. Nous ne sommes jamais seuls quand nous lisons les vers que nous aimons. Les ombres accourent et le rêve unit les visages attentifs.
Mais le chant est toujours ponctué. La voix s'arrête, reprend et le silence n'est parfois qu'un éclair et parfois une vraie plage de lumière — ou d'ombre, Pourquoi négliger les signes de ces arrêts, de ces repos, qui marquent le rythme de la pensée, de l'émotion, comme d'une marche qui peut être une course, un vol, mais qui a ses haltes !
Je sais maintenant que je reprendrai toujours quelque poème de Cadou, que tel de ses vers surgira en moi au détour d'un chemin, au déclin d'une journée, et que ce sera René Guy Cadou lui-même qui m'apparaîtra quelquefois
...Avec pour unique équipage
La caille, la perdrix et le canard sauvage.
Plus souvent, avec tous ses souvenirs d'école et de marais et, cette tendre présence qui continue d'animer l'œuvre qu'elle a inspirée
Dis-leur que tout est bon des cigües et des ronces
Qu'il a suffi de ton amour pour tout changer.
Ecrivant ces vers tels que je les dis, j'ai été tenté de mettre une virgule après « ronces », mais il n'y en a pas dans le livre. Ce n'est pas à nous de faire des retouches aux lignes à jamais écrites. Comment ne pas nous demander du moins pourquoi manquent ces signes, que la voix du récitant inscrirait à sa manière dans la cire.
Cadou n'est pas l'homme de l'affectation, du système. Il découvre chaque jour d'un regard amoureux, un monde à la fois merveilleux et simple et ce sont des mots simples qui nous ramènent le merveilleux, comme lui-même
« Ensoleillé dans les cordages d'un poème »
Il n'est pas d'une « école ». Michel Manoll a rappelé cette réponse : « Le jour où tu apprendras que je suis inféodé à une chapelle, retire-moi ton amitié »; et il a précisé ce qu'avait été l'Ecole de Rochefort, sa rencontre avec Cadou et Bouhier : « Rochefort a signifié et signifie une immense saison d'amitié, un soleil de communion fraternelle qui n'est pas prêt de s'éteindre ».
Quand Cadou parle d'école, c'est de la maison d'école où enseignait son père, de celle où il a appris, de celles enfin où il a enseigné lui-même.
Je n'ai pas oublié...
Les vieux murs à la chaux ni l'odeur du pétrole,
Dans la classe étouffée par le poids du jardin.
Fils de maître d'école, maître à son tour, il a respecté ce beau métier, il l'a aimé d'un amour filial, et je l'imagine corrigeant les dictées. Sérieusement. Rigoureusement. Il enseignait les points et les virgules. Il reprenait ceux qui les oubliaient. Pas un d'ailleurs qui manque à la Préface d'Hélène où le Règne Végétal. Pourquoi les méprisait-il dans ses vers ?
Sans doute, René Guy Cadou marquait-il par-là simplement sa filiation. De tous les poètes qu'il aimait, Apollinaire ne fut-il pas le plus aimé. Il n'a pas seulement lu et relu ses vers. Il ne les a pas seulement sus et récités. Il a été hanté par son destin.
Ah qu'en dis-tu Apollinaire en ce jour blême
De novembre dix-huit quand sonne l'Armistice.
La chanson du Mal Aimé, le Pont Mirabeau sont sans points ni virgules. Comme Apollinaire écrivait, Cadou écrivit son propre chant, sans calcul, d'instinct. Son art poétique ne tient-il pas dans un vers ?
Enfonce-toi comme un noyé dans la nuit rageuse qui grise.
Mais Apollinaire est homme de la ville ; il aime la virtuosité jusqu'à la cocasserie. Il y a du défi dans sa manière d'écrire. Il n'y en a pas chez le terrien de Sainte-Reine. Le défi est devenu tradition. Dans l'héritage de l'aîné, Cadou n'a pas choisi. Il a tout accepté en bloc, même ce dont il n'avait pas besoin pour l'œuvre très personnelle qui murissait en lui et qui s'est inscrite en nous.
Lettre de Pierre Mac Orlan
L’Herne, page 71
28 Septembre 1945
Monsieur,
Je vous remercie pour votre gentille pensée. J'ai lu d'un seul élan votre très beau livre sur Guillaume Apollinaire. Je l'ai très bien connu. Je ne vois pas que l'on puisse faire mieux que vous, car Apollinaire est vu ici par un poète. Je le retrouve vivant et entre ciel et terre, dans ce royaume de la liberté absolue qui est celui de la poésie, J'ai lu tous les livres écrits sur ce grand poète. Dans le vôtre, je le retrouve et pour cette raison aussi le don de votre livre m'est cher. Votre connaissance de celui qui écrivit « Alcools » est d'une sensibilité telle qu'il me semble difficile de dire mieux à mon goût.
Votre tout dévoué.
Présence de René-Guy Cadou, par Jean Follain
L’Herne, page 72,
Il faut bien croire à vingt ans écoulés depuis la mort de René-Guy Cadou, alors que la présence de son œuvre ne cesse de nous circonvenir de plus en plus. En 1961, il se refuserait encore à céder aux maléfices de l'histoire et, avec un entêtement justifié, persisterait à nous montrer ses voies soleilleuses.
Cet homme, qui gardait sur son visage les modelés de l'enfance, ne s'en laissa jamais accroire. Fervent de l'amour et de l'amitié, il portait en lui une force d'exigence : Il restait avant tout pris par les nécessités de la poésie. Maître d'école de campagne, en velours de chasse, il ressentait son appartenance à un terroir sans grâces de convention, mais dont il haussait les secrètes merveilles jour après jour découvertes à la mesure de l'universel.
Quand ses amis de Paris n'arrivaient pas près de lui, il goûtait la compagnie d'un ancien garde-chasse « survivant des derniers feux d'artifice », et d'un compagnon du Tour de France. Près d'Hélène Cadou, aux gestes d'offrande, il vivait intensément sa solitude peuplée, la fenêtre de la chambre de travail ouverte sur une contrée de pleine terre.
J'étais allé le voir à Nantes fin 1939, au temps que la vraie guerre n'avait pas encore débuté ; il rayonnait alors de jeunesse. Nous nous assîmes sur des tabourets, à une des tables de bois d'un de ces vieux cafés du port où l'on se place l'un en face de l'autre, les yeux dans les yeux. Après, nous marchâmes longtemps portés par l'air marin.
René-Guy Cadou, dans sa campagne, garda le goût de ses promenades sans but précis. A Paris, il ne vint que rarement : Le Paris de surface des cafés littéraires lui faisait peur, bien qu'il devinât, comme en témoignent certains de ses poèmes, un Paris secret, discret, souvent douloureux.
La poésie de René-Guy- Cadou apparaît comme empoignée par la joie diffuse du monde, par son innocence. Pleine d'hommes méditant, de bêtes, de végétaux, de terres en pleine vie, elle réconcilie les trois règnes de la nature.
On n'a peut-être pas assez dit la force de son sens religieux. Il a écrit de fort beaux poèmes religieux qui, par leur saveur d'ailleurs différente, rejoignent parfois ceux de Max Jacob. Les derniers parmi ces poèmes de Cadou accèdent au Dieu personnel. Sourdement, mais avec ténacité, sans pourtant jamais céder aux illusions, mu par le sentiment d’une mort prochaine, il ne cesse de vouloir incorporer cette mort à sa vie la plus haute.
René-Guy Cadou ne s'est jamais laissé prendre à la terreur sévissant dans les lettres : il a souvent expliqué qu'il voulait se laisser aller sans ambages aux dictées de la poésie du cœur, qu'il appelait poésie habitable.
Bien entendu, il connut parfaitement en quoi consistait le style. « A chaque poète son drame, à chaque drame son style », a-t-il écrit aussi superbement qu'humblement ?
Un poète qui parle à tous les hommes, par Pierre de Boisdeffre
L’Herne, page 74,
Aujourd'hui, en poésie comme en peinture, rien n'est sûr, rien n'est clair, rien n'est stable. Les mots se trouvent emportés par un tourbillon d'idées, d'images, de forces, et ils ont du mal à trouver un équilibre et un centre de gravité. Entre les sages litanies de Marie Noël et les stances orgueilleuses de Saint-John Perse, entre les chansons de Maurice Fombeure et les églogues de René Char, entre les vers olorimes de Louise de Vilmorin et le lettrisme, comment imaginer un commun dénominateur ?
« Les oeuvres d'art, a dit Rainer Maria Rilke (1) sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles .» Encore faut-il qu'il s'agisse d'œuvres d'art, non d'ectoplasmes ou de cris. Un observateur né vers 1850, pourrait encore ouvrir, sans être frappé de stupeur, les romans les plus lus aujourd'hui ; mais la plupart de nos recueils poétiques seraient pour lui de l'hébreu. Comment reconnaîtrait-il la poésie de Racine ou de Musset dans cette langue chiffrée dont chaque auteur possède la clé ?
Le mot du Corrège devant la sainte Cécile de Raphaël - « Et moi aussi, je serai peintre » - qui, selon Malraux, « pourrait être l'expression rageuse de toutes les vocations » (2), s'applique aussi aux poètes. En rappelant ce qu'il devait à Pierre-Jean Jouve (3), Pierre Emmanuel a défini à la fois la vocation du poète et la dette qu'il contracte à l'égard de ses maîtres : « Un jour que je furetais chez mon libraire, je fis tomber un livre du rayon. C'était Sueur de Sang, de Pierre-Jean Jouve. Machinalement, je feuilletai le livre. Il était beau, aéré comme un temple... Je fus investi par les images, d'elles battu de toutes parts... Je fus converti, c'est-à-dire mué en moi-même... La vérité que j'avais cherchée hors de moi, comme une donnée que je reconnaîtrais à certains signes, elle était en moi, maintenant, implicite mais entière : c'était le langage de l'être, langage d'autant plus universel qu'il est davantage singulier. Je n'avais pas encore reçu le don des langues, cependant, je me sentais né pour cette vérité que la poésie porte en soi. Dussé-je être un poète muet, je n'en serais pas moins un poète : un homme qui prend chaque mot dans sa plénitude, qui met sa vie dans ses mots, et ses mots dans sa vie ».
Tel fut, au sens plein du terme, René-Guy Cadou, telle est la dette que nous avons contractée à l'égard de ce jeune poète qui apprit humblement à parler le langage de l'être, et qui mérite par-là de prendre place à la suite d'autres grands intercesseurs, venus de tous horizons : Ségalen. Milosz. Apollinaire — sans qui ni Aragon ni la chanson d'amour ne seraient ce qu'ils sont aujourd'hui...
René-Guy Cadou reste, malgré sa disparition prématurée, la plus haute présence de cette école qui n'était pas une école, « tout au plus une cour de récréation », mais qui garde pieusement son souvenir : l'Ecole de Rochefort. Ce poète mort à trente et un ans, sans avoir jamais quitté son bocage natal (si ce n'est pour un voyage à Saint-Benoît-sur-Loire, chez Max Jacob, ou pour des vacances en Auvergne), fut l'héritier naturel des grands poètes de la province française, d'Alain-Fournier à Patrice de la Tour du Pin. Son œuvre — fleur unique au milieu d'une poésie urbaine et cérébrale — chante la campagne, les halliers et les humbles — et, par-dessus tout, l'amitié. Avec lui, l'humanisme cesse d'être un mot éloquent et vide pour désigner tout l'amour qu'un homme peut porter aux autres hommes. Chaque poème de Cadou est rempli de cet amour pour le prochain, fût-il inconnu de lui :
Je suis là enchaîné à la fenêtre ouverte
Au bord du monde bleu qui porte ma maison
Le soir n'allume plus les campagnes désertes
Rien ne peut plus fixer le toit de l'horizon
Je songe à des printemps étouffés d'aubépine
A ces amis d'un jour qui puisaient dans mon cœur
Mais ceux que j'attendais sont morts sans les usines
Et le vent verse au loin sa corne de malheur
O sang frais du matin inonde mon visage
Homme jamais aimé demeure mon tourment
Je cherche dans ma nuit des rêves de mon âge
Qui me rendra jamais mon butin de froment.
Le second thème de Cadou est l'amour conjugal : Hèlène inspire « la vie rêvée »:
Mon amour tu es là comme une herbe qui penche
Sa longue écriture douce sur la page
Et je lis dans tes yeux et tu peux bien baisser
Ta paupière pareille à du genêt mouillé...
Mais son dernière thème, le plus poignant, c'est la mort qui le lui inspire c'est son triste alphabet qu'il décline, avec un demi-sourire :
O mort parle plus bas on pourrait nous entendre...
Je te reconnais bien c'est ton même langage
Les mains, que tu croisais sur le front de mon père
Pour toi j'ai délaissé les riches équipages
Et les grands chemins bleus sur le versant des mers
O mort pressons le pas le ciel est en retard…
La métamorphose du poète est remarquable : parti d'un certain « tohu-bohu verbal », hérité du surréalisme, il a été gagné par le rythme, puis par la rime, et enfin par ces « grandes laisses d'alexandrins » (5) qui donnent à sa poésie un mouvement presque lamartinien. Et ce poète communiste devait retrouver au seuil de la mort un Dieu sensible au cœur, auquel il adresserait le bouleversant appel de son Nocturne :
...Considérez que je vous suis parent par quelque femme de village
Et par quelque vaurien d'ancêtre
L'une adorait votre visage
L'autre s'est payé votre tête...
Cadou ne nourrit point la folle ambition de refaire le monde, l'homme et son langage ; il ne demande qu'à collaborer à l'œuvre de la création. Sa poésie ne se nourrit pas de rêves, ni d'idées, parce qu'elle a pour objet « cette sainte réalité, donnée une fois pour toutes, au centre de laquelle nous sommes placés, dont parle Claudel, cet univers des choses visibles qui fait la matière inépuisable des récits et des chants du plus grand poète comme du plus pauvre petit oiseau ; Et de même que la philosophia perennis... se contente des termes fournis par la réalité... de même il y a une poesis perennis qui n'invente pas ses thèmes, mais qui reprend éternellement ceux que la Création lui fournit, à la manière de notre liturgie, dont on ne se lasse pas plus que du spectacle des saisons. Le but de la poésie n'est pas, comme dit Baudelaire, de plonger « au fond de l'Infini pour trouver du nouveau », mais au fond du défini pour y trouver de l'inépuisable. C'est cette poésie qui est celle de Dante (4). »
Cadou aurait pu contresigner ces lignes : au fond de la nature, il avait trouvé Dieu.
Notes:
(1) Lettres à un jeune poète.
(2) Psychologie de l'Art.
(3) Dans « Qui est cet homme ? » (G.L.F.).
(4)Positions et Propositions, I (Gallimard).
(5)Bouquet et Menauteau, Florilège poétique de R.-G. Cadou (l'Amitié par le Livre).
Lettre de Jules Supervielle
L’Herne, page 76,
Le 18 Novembre 1947
Mon cher poète,
Votre poème est sur ma table. Il l'illumine et l'humanise. Son accent me touche beaucoup et je l'entends en moi qui chante et j'entends aussi « un grand pas partout dans la maison ». Il monte l'escalier avec les moyens du bord. Bref, je suis sous le charme et vous adresse mon affectueux merci.
Votre.
Jules Supervielle.
René-Guy Cadou, par René Lacote
NB — N. 867 des Lettres Françaises. (Reproduit avec l'autorisation de l'auteur).
Les Cahiers de l’Herne – Numéro1.
Mardi prochain, il y aura dix ans qu'est mort René Guy Cadou, poète de trente ans parmi les mieux doués, et aussi parmi les moins grégaires de sa génération. Sa génération ? A vrai dire la mienne. Car Cadou n'aurait même pas aujourd'hui l'âge auquel François Monod vient de disparaître comme lui dans le premier soleil du printemps. Mais il avait été aussi un poète extrêmement précoce, avec une gentillesse qui ne se fait guère à cet âge et qui l'avait fait adopter d'enthousiasme par un groupe où l'on approche ou dépasse aujourd'hui la cinquantaine sans avoir récolté d'autre gloire que celle, fort illusoire, de « l'avoir connu ». Ce groupe n'a pas porté chance à Cadou depuis dix ans. Il m'est particulièrement dur d'avoir à le dire, mais il est temps, désormais, que ceux qui ont découvert Cadou dans ses vers imposent aux amis abusifs une certaine discrétion.
Depuis dix ans, en effet, il s'est célébré autour de Cadou une sorte de culte mystico-poétique qui masque, avec la réalité de l'œuvre, celle du jeune homme singulièrement attachant qui s'y est exprimé tout entier. Il s'est créé, il s'est cultivé une légende. Celle-ci a fini par agacer une bonne partie du public. Elle a éloigné du poète des lecteurs qui étaient faits pour bien le recevoir. Elle s'est d'autre part répandue, dans les jeunes revues notamment, où l'on voit souvent en Cadou un poète foncièrement différent de ce qu'il fut. Le culte, aussi, s'est répandu. Pour une œuvre à laquelle on sait depuis dix ans que je suis autant que quiconque dévoué, le péril me paraît, en ce dixième anniversaire qu'on va célébrer à l'aveuglette, extrêmement menaçant.
Une journée d'hommage s'annonce d'autre part au Mont-Saint-Michel dont le caractère sacré convient à la manifestation prévue. L'Ecole de Rochefort doit s'y déplacer en effet au grand complet pour y être célébrée conjointement. Car on la sait attachée au souvenir de Cadou. Elle l'est sincèrement. Mais elle l'est aussi comme les wagons le sont à la locomotive — encore les wagons sont-ils inconscients et muets, admirablement muets.
Quel authentique chercheur, parmi les nouveaux venus à la poésie, nous donnera sur l'œuvre de Cadou l'étude attentive et précise dont le public, après dix ans, a besoin ? Et quel groupe d'études organisera, pour l'avènement du printemps, la journée de discussions qui n'admettra pas les interprétations préconçues ? Car je n'entends certes point empêcher que l'on célèbre Cadou. Je pense au contraire que tout le monde a le droit de le faire sans demander de permission à quiconque. Mais j'entends qu'on retrouve enfin l'homme vivant, et bon vivant, les deux pieds enfoncés dans les biens de ce monde, qu'un zèle singulier, parfois très bien intentionné d'ailleurs, s'acharne ainsi à défigurer. L'œuvre de Cadou, de nouveau accessible pour l'essentiel en deux volumes d'inégale diffusion qui viennent de paraître, doit assez rapidement le permettre.
Je n'ai pas un goût très prononcé pour les messes d'anniversaire. Ce n'est pas la date à laquelle Cadou nous a quittés, il y a dix ans, et qui est précisément celle du printemps, qui me donnera ce goût. Si le temps persiste, il fera bon, mardi, relire, dans les jardins de Paris et dans les bois de partout, Hélène ou le Règne Végétal, réédité par Seghers en un seul volume.
Dans ce livre, où sont réunis les poèmes écrits dans les sept dernières années de sa vie, Cadou est tout entier. On peut prononcer des discours, donner des témoignages vécus auquel le témoin a quelque intérêt personnel, la plus réelle présence du poète n'en est pas moins dans ce recueil, où sont aussi tous ses meilleurs poèmes et tous ceux qui me paraissent appartenir désormais au patrimoine de la poésie française. Aussi longtemps qu'Hélène ou le Règne Végétal se trouvera en librairie, il ne sera plus possible de trahir et de censurer impunément Cadou en se proclamant le meilleur et même le seul dépositaire de sa pensée, non sans en référer toutefois aux pires ennemis de cette pensée. Cadou avait d'ailleurs adopté des positions et il avait des conceptions dont l'ensemble complexe lui était personnel. Pour beaucoup de ses amis, il y a toujours chez Cadou un aspect gênant qu'il s'agit de masquer. C'est pourquoi nous assistons depuis dix ans, autour de lui, à ce déploiement de fumée à l'abri de laquelle on se déchire. Et c'est pourquoi aussi, parler de Cadou, pour les gens de Rochefort, revient presque automatiquement à célébrer le petit vin blanc des bords de la Loire. Il ne faudrait toute de même pas que le lecteur en vienne à imaginer ce joyeux garçon comme un poivrot, qu'il n'a jamais été, pas même occasionnellement.
Personne, aujourd'hui, ne peut rien changer à ce qui fut et qui, dans Hélène ou le Règne Végétal, demeure. Cadou, tel qu'il était, peut être gênant pour quelques-uns. Mais c'est ainsi qu'il était.
Hélène ou le Règne Végétal est un livre d'une prodigieuse et saine vitalité, plein à craquer de toute la réalité quotidienne dont le poète s'émerveille dans son existence d'instituteur rural. La savoureuse expression de la joie de vivre, celle de la tendresse et de l'amour, dans la poésie de Cadou, ont suscité des enthousiasmes très justifiés et qui ne créaient point, entre ses admirateurs divers, de problème particuliers.
Il en va autrement du sentiment chrétien dont cette œuvre est imprégnée et auquel on ne peut faire dire ce qu'il ne dit pas. Je croirais indigne, à chaque fois que j'ai à parler de Cadou, de ne point donner la grande place qui lui revient, dans cette œuvre, à ce sentiment que je ne partage pas. Mais que les gens qui exploitent ce sentiment-là laissent au lecteur le soin d'entendre le poète s'expliquer lui-même sur ce sujet, jusque dans cet admirable Nocturne qu'il écrivit peu de jours avant sa mort et qui refuse toute conversion. Ce croyant est mort comme il était né et comme il avait toujours vécu, sans jamais passer par l'église. Il demande qu'on respecte ce choix très personnel. Il le redemande enfin dans ce livre qui vient de reparaître et dont les plus beaux vers sont encore d'une éclatante nouveauté parce qu'ils sont de ceux qu'on ne citait jamais.
C'est le chrétien, dans sa foi libre et personnelle, qui parle contre le crime racial aux Etats-Unis, et je n'ai pas la moindre peine à mettre au compte de cette foi ces accents que pourtant je fais miens :
« Si c'est cela qu'on fait au Roi des Juifs
Que fera-t-on au pauvre Nègre ?
L'un brillait avec les planètes
L'autre n'a qu'une chandelle de suif
Encore l'a-t-il volée ! Et c'est cela qu'on lui reproche
De s'éclairer avec les quarante sous des autres sous un porche
Et le flic qui habite une chambre cossue
Dans la six-cent-soixante-sixième avenue
S'est arrangé pour le surprendre et pour le pendre
A un bec électrique
A ce moment où la lumière du jour se fait plus tendre
Joseph d'Arimathie était bien bon qui dans l'aube sévère
Coucha Jésus comme un enfant dans un morceau de serpilière
Mais qui reprendra ce corps doublement calciné par la Race et par la Souffrance
Et qui bat là comme un volet mal fermé sur la bouche de l'Espérance
Oh ! Dites ménagères en pilou et vous jeunes gens du petit matin
Enroulés dans les fourrures du sommeil et dans la buée chantante d'un refrain
Aurez-vous pas pitié de ce cadavre balancé au milieu de la rue
Et dont la tête contre les murs est bien le plus redouble angelus. »
Cadou sait bien qu'il est en désaccord avec presque tous ses amis quand il cherche à réaliser l'unité entre sa foi et ses idées, et quand il dédie, par exemple, à Jean-Richard Bloch, qui venait de mourir, le souvenir de Max Jacob, à propos de ces Ides de Mars qui nous ont pris, depuis René-Guy Cadou et François Monod.
Ce poète, qui donne à l'amitié une si grande part de sa vie, sait fort bien pourtant combien il est différent de ceux qu'il aime, et que ceux-ci le comprendront toujours mal :
« Je songe à vous auprès d'Hélène en le fouillis de ma maison...
Et tout à l'heure je vais jaillir du sol comme une tulipe
Vous achevez vos palabres aux Deux Magots ou au Lipp
Je monte dans ma chambre et prépare les feux
J'appareille tout seul vers la Face rayonnante de Dieu
Ah ! Croyez-moi je ne suis pour rien dans ce qui m'arrive
J'ai vingt-neuf ans et c'est un tournant suffisamment décisif
Je connais vos journaux et vos grands éditeurs
Ça ne vaut pas une nichée de larmes dans le cœur. »
Comment s'étonner si ceux-là, non seulement ne veulent pas voir, mais sont aussi incapables de saisir la ferme résolution qui gouverne l'activité de Cadou et qui fait de lui, dans les dernières années de sa vie un grand poète. Je pourrais ici citer bien des pages, qui sont à la fois exemplaires et d'une stupéfiante originalité. Qu'il me suffise de rappeler que pour l'histoire Cadou est avant tout le poète des Fusillés de Châteaubriant. C'est un thème qui a inspiré d'autres poètes de la Résistance, aussi sincères que l'était Cadou. Mais ce texte s'est imposé spontanément à lui comme un devoir auquel il ne se serait pas reconnu le droit de se dérober. C'est l'hommage aux martyrs communistes de la Sablière que le poète, militant d'une cellule de Châteaubriant, se sentait tenu d'écrire pour affirmer pleinement sa pensée au-delà même de ce que les mots peuvent dire. Il n'est pas possible de le situer autrement. Et voilà ce que Michel Manoll n'acceptera jamais de dire.
Que chacun, acceptant de bien situer Cadou comme il doit l'être dans la complexité de ses conceptions, prenne ensuite son bien où il le trouvera de préférence dans l'œuvre, il n'est rien de plus légitime. Cette œuvre ne nous a pas été laissée pour être accaparée par quelques-uns, et personne n'a reçu d'autorité particulière pour nous dire ce qu'il faut en penser. La poésie de Cadou, comme toute autre, appartient à tout le monde.
Pour le dixième anniversaire de sa mort, les « Amis de Rochefort », dans une collection qu'il avait fondée, ont réimprimé pour la première fois, sous le titre Poésie la vie entière, les poèmes qu'avait publiés Cadou de 1937 à 1942. 11 s'agit donc de ses toutes premières œuvres. On ne les mettra pas en parallèle avec Hélène ou le Règne Végétal dont elles ne pouvaient avoir la richesse et la maîtrise. Mais l'heure est aujourd'hui venue d'étudier Cadou dans son évolution, et nous avions besoin de ce livre, qui sera suivi, prochainement je l'espère, d'un second volume. Les « Amis de Rochefort » auquel j'ai, comme on sait, beaucoup de critiques à faire, ont réalisé avec beaucoup de scrupule cette édition, présentée par une simple et nécessaire note historique et non point par la préface dans le style de « l'Ecole », que l'on pouvait craindre. Cadou s'est expliqué sur les raisons qui l'ont fait rejoindre le groupe de Rochefort, où la compagnie disparate était joyeuse et d'agréable rapport. J'espère qu'on retrouvera ces textes dans le second volume de Poésie la vie entière.
On y verra que l'« Ecole de Rochefort » n'a jamais été pour lui, et n'a jamais été en réalité, le mouvement littéraire qu'on veut aujourd'hui nous montrer. Avec le recul, devant l'image qui nous en est laissée, on pourrait s'étonner que Cadou ait donné dans cette sorte de félibrige. Mais les choses reprendront un jour leur aspect véritable. Et l'on comprendra bien que Cadou soit allé vers les amitiés qui s'offraient, comme je l'aurais fait moi-même, qui me suis toujours détourné de l'Ecole de Rochefort, si j'avais vécu, loin de Paris, sur les bords de la Loire.
C'est seulement après la mort de Cadou, dans le nouveau climat que l'on sait et pour les raisons que l'on sait, que les entreprises de Rochefort sont devenues si déplaisantes. La publication de Poésie la vie entière se présente dans des conditions nouvelles, infiniment plus saines. Si l'on a enfin compris quel mal a été fait, il sera possible d'espérer, de nouveau, l'apparition d'activités plus sérieuses et moins tapageuses, consacrées au rassemblement des documents et des études dont nous avons besoin, et qui sont tout ce que les jeunes peuvent attendre désormais des « amis de Cadou », votre serviteur y compris.
Une écriture de l'amitié, par Edmond Humeau
L’Herne, page 85
Quand je revois l'horizon des années où les carcasses d'Hiroshima restaient maléfiques et qu'il était chaque jour naturel de se demander si notre petite planète n'allait point se désintégrer en un gerbier effervescent de terres ignées, je ne manque jamais de songer qu'avec Emmanuel Mounier et Albert Camus les citoyens du monde allaient paraître, mais qu'il y avait déjà, en novembre 1947, alors que je bâtissais, dans un pré des Charentes, sous le commandement d'Adrian Miatlev, le géanthrope de la Favolière et de l'Aubrée qui figurait les vestiges de l'humanité gisante, à Louisfert, René-Guy Cadou écrivant une « Lettre à Jules Supervielle » que publia Sylvain Chiffoleau dans une collection qui devait se nommer « Le miroir d'Orphée » et justement de transparentes jeunes filles y filigranaient leurs effigies comme autant de statues plantées au portail :
Ah ! saisir Et rien n'échappe à ce grand corps qui se redresse
Aussi haut que la pomme et le sein des déesses.
Le saisissement invoqué par Cadou dans son appel à Supervielle, c'est vraiment l'acte qui signifie le plus spontanément ce que la poésie de Cadou est capable de susciter par une écriture de l'amitié. Que l'on prenne ce saisissement à la lettre, je dis qu'il opère en ravisseur, illuminant le revers des mots d'une outre-lumière foudroyant les passages d'ombre que tout inspiré franchit à la brume, comme sans y voir goutte. La sympathie n'est pas le ravissement mais elle le préfigure et l'investit de multiples griffes. C'est pourquoi je reprends ici les nominations de La vie rêvée et du Règne végétal ainsi que d'Usage interne pour tenter d'approcher l'acte du vif Cadou qui n'oublie point de rendre à quelques-uns de nos anciens comme Augustin Meaulnes, van Gogh, Henri Rousseau, Max Jacob, Reverdy, Picasso, Serge Essénine. Apollinaire, Eluard, Jouve, Fargue, Cendrars, Milosz, Jammes, Aragon, Cocteau, Saint Pol Roux, Claudel et Lorca — sans oublier le chemin qui va de Villon, Rutebeuf, Ronsard et les hommes de la Pléiade, La Fontaine, Musset, Baudelaire, naturellement à Rimbaud et Lautréamont, mais aussi « les compagnons de la première heure » au Gué du Loir : Lucien Becker, Jean Rousselot, Michel Manoll, amis venus à la parole — l'hommage d'une ferveur qui ne semble bien avoir été étendue à des contemporains comme Artaud, Henri Michaud, Maurice Langlois, Louis Parrot, Pierre Yvernault, qu'au-devant, disait-il, de
Mes copains qui bourlinguent encore et toute ma kyrielle de copines (Compte d'auteur).
Cette fois, à travers les nominations, nous y sommes et je veux tenter d'exposer pourquoi René-Guy Cadou rayonne aussi généreusement de génération en génération et je ne m'avance plus guère à prévoir qu'il se trouvera un nouvel Etiemble pour s'alarmer de la contagion de ce qu'il nommera le mythe Cadou qu'il confondra avec celui de Reverdy, je le comprends d'ailleurs et Cadou n'écrivait-il pas justement :
On découvrira la poésie de Reverdy dans cinquante ans et, à cette époque, il y aura désaccord entre les poètes d'alors et le Public d'alors de Reverdy. Je n'avance rien. Ceci est dans l'ordre des choses. (Usage interne).
Nulle confusion dans cet ordre mais la pleine et vivante contradiction qui nous écartèle. Car il est certain que le règne de Cadou a commencé, comme nous fûmes quelques-uns à le prévoir, dès son passage parmi les vivants de l'autre monde. A l'inverse, il se produit brusquement une désaffection qui n'épargne point Valéry, Gide, même Eluard et Claudel, pour ne rien dire de quelques-uns qui s'imaginent encore présents à nos battements de cœur. Cette baisse de tension que l'on assimile à un purgatoire risque d'être fatale aux œuvres survoltées mais il semble aussi qu'elle permet de mieux éprouver la réalité des pouvoirs d'enchantement qui décident de la durée agissante d'une œuvre, de sa validité.
Il en va ici de Cadou comme d'Artaud et de Rimbaud, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini avec des présences qui sont proprement radioactives Par la simple vertu de l'œuvre qui se désintègre à mesure qu'elle nous recompose et que, de génération en génération, elle se charge de nouveaux pouvoirs d'enchantement qui ne sont nullement d'un rayonnement mortel mais de la nourriture vivifiante. Ce rapprochement d'avenir avec un réprouvé-supplicié et un déserteur-trafiquant s'oppose à la vision de la justice que l'on attend. En quoi d'ailleurs Cadou ne serait-il point du Golgotha fantastique où chaque poète est crucifié entre des larrons en foire, je vous le demande ? Disons qu'il n'y a point de justice et que tout est adorable, suivant la formule du « Pèlerin de l'Absolu » qui revient nous fouailler en pleine contradiction. Oui, l'on n'aura rien compris à la contradiction tant que l'on ne ressentira point que la condition du poète s'expose au déclin de l'écriture et à sa transfiguration dans l'univers imaginaire qui l'assaille au plus près de la vie.
Qu'il n'y eut rien là que de fort raisonnable, c'était bien l'avis de Cadou qui ne trouvait « dans aucune littérature d'exemple de poète plus raisonnable que Rimbaud qui, à vingt ans, de peur de tout compromettre, ferme la porte et brouille les clés » et ce qui l'enchantait dans Artaud venait du même tonneau. Cette idée de porte fermée et de clés brouillées aurait de quoi tenter un exégète alors que l'on prétend assez généralement que Cadou avait inauguré le temps d'une poésie ouverte sur les saisons mais c'est la cinquième qu'il chante dans La vie rêvée et que, bien entendu, il n'existe aucun rapport entre Gilles de Rai et le prisonnier de la Tour de Nantes qui, dans la Loire, a sauté.
La contradiction vaut raison assurément mais je tiens que c'est la raison ardente, brûleuse d'Alcools, cette chère lampe Pigeon qui se renverse et fait flamber une chambre de solitude et c'est bien ainsi que l'entendait Cadou montant après l'école, au gouvernail de la nuit étoilée et des écritures aux amis. Je voudrais reprendre ici ce que l'écriture de l'amitié dévore dans les scories de la vie et qu'elle mue dans l'épaisseur du sang qui passe sur les mots comme une nuée flamboyante. Il s'agit bien de la terrible brume de l'Ouest, des vents atlantiques, des marées celtes, des chemins creux entre les haies d'aubépines et de cette unique Brière qui relaie la forêt des Ardennes et le Rouergue d'Artaud qui se reproduit en Irlande et au pays des Tarahumaras. Voilà pour la hauteur du lieu qui demeure, à l'approche des tempêtes, analogue à une mine d'uranium et au déplacement des meubles qui font cortège de noce aux poètes qui ne savent jamais où retrouver leurs propriétés.
Quant à l'écriture elle-même, je dis qu'elle fait de l'amitié non seulement lorsqu'elle s'acharne à transcrire l'esprit du lieu qui l'inspire mais surtout, à ce moment unique, lorsqu'elle permet de ressentir la présence d'une graphie généreuse. C'est vraiment l'effet de la main qui se retrouve. La façon d'écrire chez Cadou ne s'est point démentie depuis « Les brancardiers de l'aube » aux chers cahiers de l'Ilôt jusqu'aux derniers poèmes qu'il ait publiés : « Les biens de ce monde », juste un mois avant de quitter la campagne de Louisfert. Sa façon d'écrire, ce n'est pas le tour de main, ni la méthode, mais l'affirmation consciente de l'appareillage que les mots reçoivent pour entraîner la communication des secrets d'herbe et de nuit, de pomme et de couteau, qui se déposent sur le poème, l'envoûtent et le disposent aux longs voyages du cœur. Le mystère du rayonnement grandissant de l'œuvre de Cadou tient peut-être dans l'alliance du nocturne et du végétal. Il me semble que Cadou s'entoure des argiles et des silex nécessaires à l'obscure prise du poème sur le courant des rêves, à la greffe des mots familiers sur l'ample nature innommée. Une lumière est donnée qui se reflète sur l'âme attentive aux variations d'intensité et il arrive alors que l'on se reconnaisse dans un poème de
Cadou comme dans le texte d'un mystique anonyme du vieil Occident paillard et chrétien.
Cadou dit que Les Poètes sont les aristocrates du peuple (Usage interne). Cela me paraît essentiel si l'on veut bien admettre que le peuple envoie ses aristocrates à la lanterne et que néanmoins il les aime entiers, précieux, fantasques, magnifiques et forcément généreux. Belle contradiction que l'on met habituellement sur le compte des variations de l'amour mais je suis persuadé qu'elle exprime, bien plus profondément que l'on ne se l'imagine, la nature même des relations qui s'établissent entre l'univers solitaire du poète avec les mots qui lui chantent et l'univers multiple des autres qui le reçoivent en pleine expansion. Des communications s'établissent ou se perdent suivant que l'écriture du poète demeure plus ou moins explosive. Pour ma Part, j'estime qu'une écriture de l'amitié, telle que je la salue dans l'œuvre de René-Guy Cadou, possède une force de dissuasion assez pure et enrichissante pour qu'elle ne cesse d'attirer ceux que hante la tristesse quotidienne et qui lui opposeront l'odeur des lys. J'ai bien dit qu'il s'agissait d'une dissuasion parce qu'elle est nécessaire à la persuasion qui se découvre aux frontières de l'attrait singulier qu'un prince exerce en se perdant et qu'un peuple éprouvé lui fait recouvrer, l'un ne va pas sans l'autre, certes, mais je ne vois croître le règne de Cadou, depuis dix ans, que par son enracinement d'essence blonde avec des boucles de soleil. C'est l'embellie diaphane qui triomphe des suies et le cœur ne manque Point de se réjouir que le lilas refleurisse.
Lettre de Blaise Cendrars
L'Herne, page 89
Vendredi 9 Mars 1951
Cher René-Guy Cadou,
Vos Biens de ce monde. la meilleure plaquette publiée depuis longtemps !... Merci et ma main amie...
Blaise Cendrars
A propos d'une coupe, par Sylvain Chiffoleau
L'Herne, page 90
17 Mars 1951.
Tu te retournes sur ton lit, pour la millième fois sans doute. Je viens de vider ma coupe de champagne. Le champagne et les oranges. Un signe. On dépose sur la table de nuit, vous êtes condamné à mort... Tu nous reçois bien. Tu écoutes Nédelec, sagement. Il te dit que tout est mieux, que le printemps pousse déjà la fenêtre et que les Amis t'attendent. Tu acquiesces de la tête, t'appliques à bien faire semblant de vivre ; t'es poli... comédien !
Nous allons rejoindre Nantes, te quitter. Je cueille au passage la coupe laissée par la femme du chirurgien. Tu te retournes à nouveau, grognant, mauvais. C'est sévèrement que tu me dis au revoir. Je sais que c'est adieu. Tu es indigné ! Tu diras à Hélène, le soir, combien Sylvain est malapiat. Toi qui m'appelais « Siffle-Vin », cette coupe t'agace. J'ai vu. Depuis des mois, l'eau à la petite cuiller, et tu la rends. Alors tu préfères ne plus te souvenir, t'indigner, faire ça au pontif, à l'heure où l'on pèse, classe ! Et pourtant...
« Chiffoleau fils de Sylvain père
Le passé tient dans notre verre ».
Pas de la poésie gratuite, ça ! Pas de l'art pour l'art. Maintenant que tu somnoles, apaisé pour un instant, fais effort : c'était hier — voilà dix ans — Ta classe terminée, tu me rejoignais, sifflotant, les mains aux poches. Par centaines, les barriques s'alignaient sur le quai de la gare. Tu avais fort bien appris le maniement de la pipette. Je faisais une croix sur les meilleurs fûts. Le Gros-Lot de St Marc, le Gros Plant, le 54-55. Tu connaissais. Souvent, avant notre départ, tu passais à contre-voie, de la craie plein les poches. « Vin Chiffoleau, garanti moitié eau ». En lettres d'un mètre, bien blanches, sur la tôle goudronnée des réservoirs. C'était une tradition...
Puis nous partions quelquefois profitant des heures douces de la soirée. Nos vieux vélos, tes pantalons de golf. A cette époque tu aimais la bicyclette ; tu avais toujours un parent dans un coin, du côté de Pornic, de Paimbœuf, de Frossay. Tu découvrais : urgent d'aller voir la vieille tante ou besoin évident de savoir ce qu'était devenu cet arrière-cousin de ton grand-père. Tu partais le jeudi, moulant patiemment les kilomètres.
Donc, nous filions dans le soleil couchant. La Bernerie. Un grand bistrot de planches vertes. On nous servait sous la tonnelle, face à la jetée. Champagne. Mousseux les jours sans. Nous restions là jusqu'à la tombée de la nuit. Tu me lisais ton dernier poème, nous en discutions. Face à nous, le ciel s'effilochait en nappes mauves, enveloppant sournoisement l'île de Noirmoutier qui se défendait de tous ses feux. C'était notre heure exquise. Maintenant ce café, on soupçonne même pas. Plus rien. Tous les cataclysmes du monde concentrés là, myriatonnes de guerres sur ce coin de plage ! La municipalité seulement, je crois..., le tourisme..., l'argent !
Nous rentrions pour dîner, roulant l'un derrière l'autre sur l'étroite bande sableuse, le long de la voie ferrée, plus courte. Au passage en gare des Moutiers, nous fleurissions nos boutonnières.
21 Mars 1951.
La dernière fois que je t'ai vu, tout juste trois jours, tu oubliais notre champagne hebdomadaire. Tu étais furieux ; alors je raconte pour justifier. L'habitude. Aujourd'hui, tu est toujours là, dans ton coin, à droite de la fenêtre d'où tu assistais à « la grande ruée des terres » contre les murs de la maison d'école. La bouteille que nous avons vidée, un peu Nédelec, beaucoup moi, est restée sur un rayon de ta bibliothèque des titres de Cendrars dansent dans son verre. Tu ne marmonnes plus. Bien horizontal, campé confortable, tu observes... Un regard blanc perce sous tes cils, glisse jusqu'à nous, mouvant. Tu souris étrangement. Presqu'un ricanement. Tu te fous de nous, visible. On s'agite, de ci de là, dans la chambre, le jardin, la salle de classe. Ça sanglote ferme, mais tu ne cilles même pas. T'en fous. Je pleure. La courageuse Hélène me console. Elle dit ta dernière nuit, tes projets confiés à Jean Rousselot. A Paris, voir les copains. Tu faisais ton possible, par bouts de phrases. Comédien, je jure ! Je suis écrasé. Chagrin, fatigue aussi. Toute cette nuit j'ai travaillé. T'avais fait tes malles, mais je savais pas. Le « Nocturne ». Achevé d'imprimer le 21 Mars 1951, au petit matin. Un dernier plaisir, une joie je voulais. Joie pour nous deux. T'apporter ce grand format, me hâter, arriver avant Elle. Tu parles ! T'as pas attendu, impatient. Trop lourdeau je suis. Battu de vitesse, toujours. Et toi parti comme tu voulais, en douce... Pas régulier Cadoudal-en-pente. Quelqu'un !
7 Février 1961.
Ce soir, dans cette grande demeure que tu ne connus pas et qui est toujours tienne, à quelques centaines de mètres de toi gîté en la maison du père, ton bleu regard chaviré du côté de l'ombre depuis tant de saisons, de toi, glissé dans ton velours, sous une pourriture de pervenches et de roses, de toi, déjà vieux mort, bien atroce, ah ! frère ! ce soir, tu me fais rire...
Conseils et Notes, par René Guy Cadou
L'Herne, page 92
1948-1949
Conseils et notes
Il est bien rare qu'à votre âge l'invention ne précède pas la découverte. Or il vous faut d'abord réunir tous les morceaux du puzzle quitte à tout remettre en jeu par la suite. Il est faux de croire que la poésie est avant tout une question d'inspiration. Elle est en effet cette merveilleuse clairière dans les bois, mais quelle longue marche avant d'y parvenir.
*
En poésie comme en art il ne sert de rien d'employer les moyens d'investigation moderne. La baguette du sourcier fait merveille là où la foreuse automatique ne découvre qu'une excavation béante. Il faut apprendre à marcher avant de courir. L'idée de compétition n'entre point dans le système solaire de l'art. Au contraire tout est parfaitement réglé. C'est une question de lunaison, d'équinoxe. La plus formidable entreprise de machinisme moderne n'égalera jamais cette horlogerie délicate des marées.
*
La poésie ne devra jamais être pour vous une surcharge si délicate soit-elle mais s'inscrira en filigrane dans la page, comme une onde à longue portée en plein ciel. Et dites-vous bien que plus vous aurez mis de vous en elle plus elle vous portera loin, plus vous aurez de chance d'atteindre l'anonymat notre seule gloire.
*
J'aimerais sans impudeur une fois au moins parler de ma poésie ou du moins de ce que j'entends par ce vocable. On peut être original à peu de frais. Je l'ai dit, j'entendais par là une certaine façon de jeter des cailloux dans les vitres. Cela réussit toujours. Une descente de police vous assure une demi-colonne des journaux. On peut l'être encore à moins et c'est ici que je m'explique.
Puisqu'il faut à tout prix de l'originalité montrons-nous original en ne l'étant point. Soyons un original posthume, c'est-à-dire de telle sorte que bien des années après le crime on se soucie enfin du cadavre. Et quoi ! Pas d'empreintes ! Pas de coffre-fort vide ! Pas de mégots ! Non ! rien ! Simplement il n'y avait pas de crime. L'assassiné s'est éteint de vieillesse.
Dites-vous, si cuistre que puisse vous paraître le conseil, que la réussite est le fait d'une longue patience et avant tout d'une longue présence.
*
Il ne s'agit point de décourager les jeunes gens. J'ai passé des heures inoubliables, toutes lumières éteintes, à cette fenêtre qui donnait sur la Loire. A seize ans j'écrivais des drames ; il me manquait de les vivre. Par la suite il me fut donné de regretter cette fenêtre. Les jeunes poètes d'aujourd'hui sont comme ces dames de la cour de Louis XIV (j'ai pris ces renseignements dans les admirables romans d'Alexandre Dumas) qui s'honoraient de partager les restes du dîner de la reine. Les repas de Reverdy comportaient d'excellents reliefs : je m'en suis vite rassasié.
Il est à remarquer que ces miettes furent pour beaucoup dans le jugement qu'on porte sur mon œuvre.
*
De plus en plus et contrairement à ce que je pouvais penser voilà dix ans, il m'arrive de considérer la poésie comme un bien, c'est-à-dire comme une singulière fortune qui vous allège, héritage de l'avenir et si l'on veut faillite, clé sous la porte d'une maison roulante.
*
J'attends toujours qu'un journaliste indiscret me pose la question:
« Que pensez-vous de la poésie ? » Remarquez ! Cela arrivera ! Le dommage est qu'en ce temps-là le journalisme ne sera plus indiscret ou bien moi.
Quelle est votre conception de l'art ?
Que répondre ?
Que je n'ai point souci de la beauté. Que celle-ci s'impose ou se refuse.
Une réussite ne vaut justement que par son pouvoir de refus.
On ne reconstitue point un crime.
La victime fait toujours défaut : on la double.
Evitez le doublage.
Le tort de la justice en art est toujours de vouloir reconstituer, de se mettre dans la peau du poète.
Au poète donc de changer de peau.
J'appelle changer de peau non point cette vertu - ou ce caprice - que possède le caméléon de changer de milieu ambiant, mais ce sentiment d'écorché vif qui doit être la sauvegarde du poète, sa façon de se confondre avec l'éternité.
Il n'est pas mauvais lorsqu'on a seize ans de compter sur ses doigts, de refaire, toutes maladresses mises à part, les poèmes de Lamartine ou de Musset.
Vous me direz : il est plus dangereux d'imiter Eluard que Lamartine, nous aimons le danger. Je vous répondrai qu'il y a des morts stupides et qu'il n'y a aucune gloire à mourir inutilement. Vos sacrifices n'en valent pas la chandelle. Vous vous trouvez devant un mur déjà percé. Ce n'est pas parce que vous l'aurez percé d'un second trou à dix mètres du premier que la perspective entrevue en sera plus belle.
*
Le respect de la chose écrite ne doit point vous faire oublier que le poète est avant tout un homme. Que m'importe un mauvais vers si celui-ci me libère d'un cortège de souvenirs ! Je n'aime point à revenir sur les buttes de derrière. Il y a tellement mieux à faire sur cette longue route où vous n'allez qu'à pas comptés.
Je n'écris point pour me donner ou conserver une position avantageuse mais, entendez-moi bien, pour me situer toujours au-delà de moi-même, pour avoir une raison plus tard de m'accueillir à quelque carrefour perdu dans les bois.
*
Qu'est-ce que la poésie ? Je n'ai point l'habitude de répondre à de telles questions. Si je le savais, serais-je encore poète. Peut-être ! Peut-être point ! Je ne m'interroge pas. Certains se suffisent de l'interrogation, y répondent par avance. Les gloses ne manquent pas sur les dernières paroles de Max Jacob : « J'ai donné toute ma vie à cette passion. » Il s'agit bien en effet d'une passion et telle qu'il ne nous est point donné de mesurer l'étendue du miracle, l'étendue du malheur.
*
Voyez je ne vous donne point conseils d'avare. Prodiguez mais que cette dissipation soit chair de votre chair, que vous ayez largement de quoi au lieu de vous trouver singulièrement démuni au moment de ce mouvement de foules sous vos fenêtres.
*
A la politique de Sœur Anne combien préfèrent celle autrement plus reposante de l'égorgé vif. En proie au verbe, à l'image, à la démonstration lyrique ils n'ont point cette ruse terriblement humaine du mouchoir agité vers l'avenir
« Je ne vois que le soleil qui verdoie
Et la route qui poudroie ! »
Et quand bien même il n'y aurait point au bout du compte - ou du conte - la promesse de ces deux cavaliers accourant à bride abattue, il resterait au lieu de redescendre un à un les degrés de la faute, de se balancer soi-même par-dessus bord.