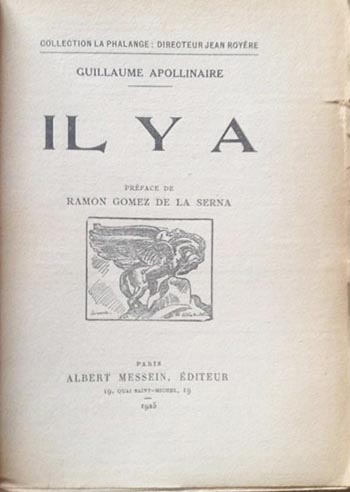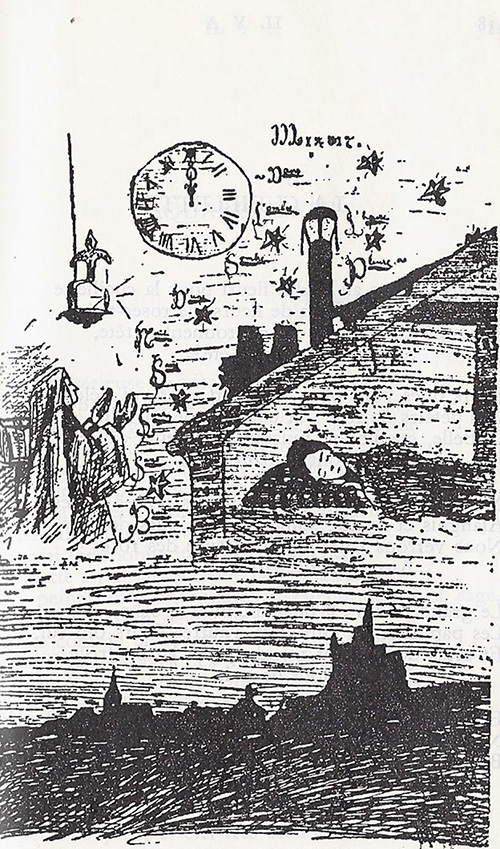Minuit
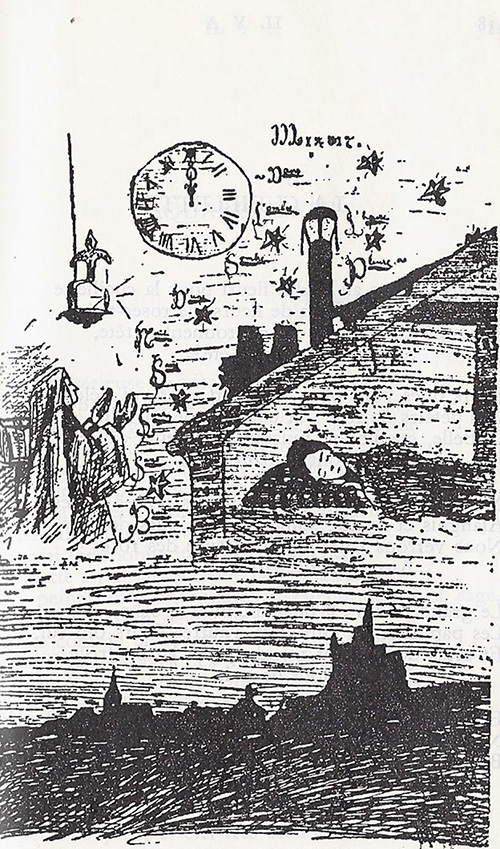
La Cueillette
Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette.
Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé,
Roses pâles d'amour qui couronnent ta tête,
S'effeuillent chaque été ?
Leurs tiges vont plier au grand vent qui s'élève.
Des pétales de rose ont chu dans le chemin.
Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve
Se faneront demain !
Mets-les dans une coupe et toutes portes doses,
Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts,
Nous verrons l'agonie amoureuse des roses
Aux râles de parfums.
Le grand jardin est défleuri, mon égoïste,
Les papillons de jour vers d'autres fleurs ont fui,
Et seuls dorénavant viendront au jardin triste
Les papillons de nuit.
Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane.
Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur.
Belle, sanglote un peu... Chaque fleur qui se fane,
C'est un amour qui meurt !
Aquarelliste
À Mademoiselle Yvonne M…
Yvonne sérieuse au visage pâlot
A pris du papier blanc et des couleurs à l’eau
Puis rempli ses godets d’eau claire à la cuisine.
Yvonnette aujourd’hui veut peindre. Elle imagine
De quoi serait capable un peintre de sept ans.
Ferait-elle un portrait ? Il faudrait trop de temps
Et puis la ressemblance est un point difficile
À saisir, il vaut mieux peindre de l’immobile
Et parmi l’immobile inclus dans sa raison
Yvonnette a fait choix d’une belle maison
Et la peint toute une heure en enfant douce et sage.
Derrière la maison s’étend un paysage
Paisible comme un front pensif d’enfant heureux,
Un paysage vert avec des monts ocreux.
Or plus haut que le toit d’un rouge de blessure
Monte un ciel de cinabre où nul jour ne s’azure.
Quand j’étais tout petit aux cheveux longs rêvant,
Quand je stellais le ciel de mes ballons d’enfant,
Je peignais comme toi, ma mignonne Yvonnette,
Des paysages verts avec la maisonnette,
Mais au lieu d’un ciel triste et jamais azuré
J’ai peint toujours le ciel très bleu comme le vrai.
Les dicts d'amour à Linda
Votre nom très païen, un peu prétentieux,
Parce que c’est le vôtre en est délicieux ;
Il veut dire "jolie" en espagnol, et comme
Vous l’êtes, on dit vrai chaque fois qu’on vous nomme.
Ce nom devient mélancolique en allemand,
Aux brises d’Avril, il bruisse doucement,
C’est le tilleul lyrique, un arbre de légende,
D’où, chaque nuit, des lutins fous sortent en bande.
Enfin, ce rare nom qui dit votre beauté,
Ce fut le nom d’une antique cité
Qui florissait jadis parmi les roses belles
Dans Rhodes, l’île où roucoulent les colombelles.
Linda
L'ombre de la très douce est évoquée ici,
Indolente, et jouant un air dolent aussi :
Nocturne et lied mineur qui fait pâmer son âme
Dans l'ombre où ses longs doigts font mourir une gamme
Au piano qui geint comme une pauvre femme.
Ville presque morte...
Ville presque morte, ô Cité
Qui languis au soleil d'été,
Toi dont le nom putride étonne,
Tu symbolises la très Bonne,
La très Douce, sans vanité,
Qui n'a jamais compris personne,
La toujours Belle qui se tait,
L'Adorable que je couronne,
La toute Ombreuse dolemment
Comme une ville ombreuse et coite,
La toute Brune jamais droite,
Toujours penchée exquisement.
J'ai vu ses lèvres d'anémone
Mais point son Cœur, à la très Bonne.
Je n'ai jamais vu Carcassonne.
La force du miroir
J'étais, indigne, un jour, en la chambre au lit blanc
Où Linda dans la glace admirait sa figure
Et j'emportai, grâce au miroir, en m'en allant,
La première raison de devenir parjure.
Linda fut non pareille avant, mais aujourd'hui
Je sais bien qu'elle est double au moins, grâce à la glace ;
Mon cœur par la raison où son amour l'induit
Est parjure à présent pour la seconde face.
Or, depuis ce jour-là, j'ai souvent comparé
Dans la chambre où la glace accepte un pur mirage,
La face de Linda, le visage miré,
Mais mon cœur pour élire a manqué de courage.
Si, parjure toujours, pour choisir j'ai douté,
Ce n'est pas qu'au miroir la dame soit plus belle ;
Je l'adore pourtant d'être en réalité
Et parce qu'elle meurt quand veut sa sœur formelle.
J'adore de Linda ce spécieux reflet
Qui la simule toute et presque fabuleuse,
Mais vivante vraiment, moderne comme elle est :
La dame du miroir est si miraculeuse !
Et la glace où se fige un réel mouvement
Reste froide malgré son détestable ouvrage.
La force du miroir trompa plus d'un amant
Qui crut aimer sa belle et n'aima qu'un mirage.
Le trésor
Jadis, jadis vivait m'amie
Une princesse aux cheveux d'or,
En quel pays ? Ne le sais mie.
Jadis, jadis vivait m'amie
La fée Yra, son ennemie,
Qui changea la belle en trésor.
Jadis, jadis vivait m'amie
Une princesse aux cheveux d'or.
En un trésor caché sous terre
La fée, au temps bleu des lilas,
Changea la belle de naguère
En un trésor caché sous terre.
La belle pleurait solitaire :
Elle pleurait sans nul soulas
En un trésor caché sous terre :
C'était au temps bleu des lilas.
De la mousse je suis la fée,
Dit à la princesse une voix,
Une voix très douce, étouffée,
De la mousse je suis la fée,
D'un bleu myosotis coiffée.
Pauvrette ! En quel état vous vois !
De la mousse je suis la fée,
Dit à la princesse une voix.
Par un homme jeune et fidèle
Seront sauvés vos yeux taris,
Dit cette fée à voix d'oiselle
Par un homme jeune et fidèle
Qui vous désirera, ma belle,
Et pour l'or n'aura que mépris,
Par un homme jeune et fidèle
Seront sauvés vos yeux taris.
Cent ans attendit la princesse.
Un jour quelqu'un passa par là,
Chevalier de haute prouesse,
- Cent ans l'attendit la princesse -
Brave, invaincu, mais sans richesse,
Qui prit tout l'or et s'en alla.
Cent ans attendit la princesse.
Un jour quelqu'un passa par là.
La pauvre princesse invisible
Fut mise en la bourse de cuir ;
La pauvre princesse sensible,
Adorable, mais invisible.
Un brigand tua l'invincible,
Prit la bourse et se mit à fuir.
La pauvre princesse invisible
Pleurait dans la bourse de cuir.
Elle pleurait d'être en servage
Et de ne pas pouvoir crier.
Le grand vent du Nord faisait rage
- Elle pleurait d'être en servage -
Mais un homme vit le carnage,
Vint et tua le meurtrier.
Elle pleurait d'être en servage
Et de ne pas pouvoir crier.
Le sauveur, un pauvre poète,
Dit : " Onc homme tel trésor eut ;
Mais j'en fais fi ! Je suis très bête,
Un sauveur, un pauvre poète !
J'aimerais mieux une fillette. "
Alors la princesse apparut.
Le sauveur, un pauvre poète,
Dit : " Onc homme tel trésor eut ! "
Et voilà l'histoire, m'amie,
De la princesse aux cheveux d'or.
Quel est son nom ? Ne le sais mie.
Et voilà l'histoire, m'amie,
De celle que son ennemie
Changea jadis en un trésor.
Et voilà l'histoire, m'amie,
De la Princesse aux cheveux d'or.
Je vis un soir la zézayante
Et presque jamais souriante
Et renversée, un soir, hiante,
Pour quel ennui ? Vers quel soulas ?
S'ennuyait-elle d'une gemme,
D'une fleur bleue ou de l'angemme
Ou plaçait-elle ceci : " J'aime ! "
Trop au hasard des tombolas !
Et dans le soir qui tout nous souille
Le fauteuil qui d'ombre se brouille
Avait des formes de grenouille
Près du lit, tel un tombeau bas.
Ainsi bayèrent par le monde
Viviane auprès de l'immonde
Et dans son palais Rosemonde
Qui fut moins belle que Linda.
Et moi qui tiens en ma cervelle
La vérité plus que nouvelle
Et que, plaise à Dieu, je révèle
De l'enchanteur qui la farda
Du sens des énigmes sereines,
Moi, qui sais des lais pour les reines
Et des chansons pour les sirènes,
Ce bayement long m'éluda.
Car au cœur proche et que je craigne
Ce cœur que l'ennui tendre étreigne.
Au cœur l'ennui c'est l'interrègne
À ne pas être l'interroi.
Ses mains alors s'épanouirent
Comme des fleurs de soir et luirent,
Ses yeux dont soudain s'éblouirent
Les dormantes glaces d'effroi
De voir bayer leur sombre dame,
Princesse ou fée ou simple femme
Ayant avec la mort dans l'âme
La grenouille pour tout arroi.
Lorsque vous partirez, je ne vous dirai rien,
Mais après tout l'été, quand reviendra l'automne,
Si vous n'êtes pas là, zézayante, ô Madone,
J'irai gémir à votre porte comme un chien.
Lorsque vous partirez, je ne vous dirai rien.
Et tout me parlera de vous pendant l'absence :
Des joyaux vus chez les orfèvres transmueront
Leurs gemmes en mauvais prestiges qui seront
Vos ongles et vos dents comme en réminiscence
Et tout me parlera de vous pendant l'absence.
Et, chaque nuit sans lune attestant vos cheveux,
Je verrai votre ennui dans chaque nuit lunaire ;
Mais puisque vous partez l'on me soit débonnaire
Et fixe mon étoile et l'astre que je veux
Dans chaque nuit sans lune attestant vos cheveux.
Quand l'automne viendra, le bruit des feuilles sèches
Sera de votre robe un peu le bruissement.
Pour moi, vous sentant proche, en un pressentiment,
La feuille chue aura le parfum des fleurs fraîches,
Quand l'automne viendra hanté de feuilles sèches.
Madone au Nonchaloir, lorsque vous partirez,
Tout parlera de vous, même la feuille morte,
Sauf vous qui femme et mobile comme la porte
Avant le premier soir de danse m'oublierez,
Madone au Nonchaloir, lorsque vous partirez.
Tierce rime pour votre âme...
Votre âme est une enfant que je voudrais bercer
En mes bras trop humains pour porter ce fantôme,
Ce fantôme d'enfant qui pourrait me lasser,
Et je veux vous conter comme un bon Chrysostome
La beauté de votre âme aperçue à demi
Autant qu'on peut voir une monade, un atome.
Votre âme est dans la paix comme cloître endormi.
Des larrons useront de plus d'un stratagèmePour ouvrir le portail qui forclot l'ennemi.
Et l'un venant de droite avec la claire gemme
L'offrira de dehors à votre âme en dedans ;
Un autre, le sinistre, alors s'écriera : " J'aime !
" J'aime la paix des soirs qui sont des occidents,
" Dans un cloître aux échos longs comme ma mémoire. "
Et contre le heurtoir il brisera ses dents.
Votre âme est un parfum subtil dans une armoire,
Votre âme est un baiser que je n'aurai jamais,
Votre âme est un lac bleu que nul autan ne moire ;
Et l'on dérobera le parfum que j'aimais
On prendra ce baiser dans un baiser trop tendre,
On boira dans ce lac où l'eau, je le promets,
Sera douce et très fraîche à qui saura s'étendre
Au bord du lac et boire comme une fleur d'eau,
Etre au lac de votre âme, homme fleur, ô l'anthandre !
Votre âme est une infante à qui c'est un fardeau
Que porter le brocart de sa robe et sa traîne.
L'infante aux yeux ouverts qui veut faire dodo.
Votre âme est une infante à l'ombre souveraine
Des cyprès à l'instant où les rois vont passer,
Votre âme est une infante et qui deviendra reine,
Votre âme est une enfant que je voudrais bercer.
Adieux
Lorsque grâce aux printemps vous ne serez plus belle
Vieillotte grasse ou maigre avec des yeux méchants,
Mère gigogne grave en qui rien ne rappelle
La fille aux traits d'infante immortelle en mes chants.
Il reviendra parfois dans votre âme quiète
Un souvenir de moi différent d'aujourd'hui
Car le temps glorieux donne aux plus laids poètes
La beauté qu'ils cherchaient cependant que par lui.
Les femmes voient s'éteindre en leurs regards la flamme,
Sur leur tempe il étend sa douce patte d'oie.
Les fards cachent les ans que n'avouent pas les femmes
Mais leur ventre honteux les fait montrer du doigt.
Et vous aurez alors des pensées ridicules.
— C'est en dix neuf cent un qu'un poète m'aima.
Seule je me souviens, moi, vieille qui spécule,
De sa laideur au taciturne qui m'aima.
Je suis laid, par hasard, à cette heure et vous, belle
Vous attendez le ravisseur longtemps promis
Qui déploie comme un mirage du mont Gibel
Le bonheur d'être deux toujours et endormis.
Très humbles devant vous pleureront des Ricombres
Donnant l'anneau gemmal pour l'éternel baiser
Et des pauvres fameux pour vous vendraient leur ombre
Puis, loin de vous, pensifs, mourraient d'un cœur brisé
Il en viendra beaucoup des trouveurs d'aventure,
En galop tout poudreux, des roses plein les mains,
Mais l'un, un soir, dénouera votre chevelure
Et vous crierez : C'est toi!... C'est toi jusqu'à demain.
Car l'endemain viendront des chevaucheurs encore
Moustachus et câlins ou brutaux à souhait
Qui, joie! seront vainqueurs, Ma Joie! vainqueurs encore
Par la caresse lente ou même à coups de fouet.
Et peut-être sera-ce alors temps de tristesse,
Quand vos ongles tachés de blanc déchireront
Votre chair; quand le cœur trop plein de « Quand était-ce »
Vous pleurerez fronçant les plis de votre front.
Intercalées dans l'an viendront les journées veuves,
Les vendredis sanglants et lents d'enterrements,
Des blancs et des tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent
Quand la femme du diable a battu son amant.
Cependant, grâce à vous, merci! ma dessilleuse!
J'ai bien compris que seuls pouvaient vivre en m'aimant
Dans l'ombre originelle où mon repos se creuse
Les bons vers immortels qui s'ennuient patiemment.
Et pourtant c'est bien vrai, je n'eus aucun désir
Sinon téter la lune, ô nuit au seul tétin
Et creuser à jamais mon logique Nazir
Malgré l'amour terrestre aux baisers florentins.
Non, je ne veux aucun de ces cœurs que l'on donne,
NI de l'aumône humaine exquise aux cœurs ingrats,
NI du pieux soulas des grâces des madones,
NI de l'amour humain qui fait trop d'embarras.
Tous les dons sont impurs et les joyaux sont tristes
Et l'amour est maudit pour ce qu'il peut donner,
Il n'y a pas encor de cadeaux anarchistes
Il n'y a que la paix quand finit la journée.
Il y a les yeux bleus des mères inquiètes,
Il y a les grands chiens et les dieux inconnus
Et la rage et le doute et le nom des poètes
Avec l’éternité des marbres toujours verts
Ici finissent les dicts d’amour de Guillaume Apollinaire à Linda la Zézayante.
Ville et coeur
La ville sérieuse avec ses girouettes
Sur le chaos figé du toit de ses maisons
Ressemble au coeur figé, mais divers, du poète
Avec les tournoiements stridents des déraisons.
O ville comme un coeur tu es déraisonnable.
Contre ma paume j'ai senti les battements
De la ville et du coeur : de la ville imprenable
Et de mon coeur surpris de vie, énormément.
Epousailles
A une qui est au bord de l’océan
L'amour a épousé l'absence, un soir d'été ;
Si bien que mon amour pour votre adolescence
Accompagne à pas lents sa femme, votre absence,
Qui, très douce, le mène et, tranquille, se tait.
Et l'amour qui s'en vint aux bords océaniques,
Où le ciel serait grec si toutes étaient nues,
Y pleure d'être dieu encore et inconnu,
Ce dieu jaloux comme le sont les dieux uniques.
Elégie du voyageur aux pieds blessés
Marche le gars ! Marche en gaîté !
Ce calme jour d'un calme été,
Où sauf la source, tout se tait.
Va parmi les grandes fougères,
Les myrtilles et les bruyères
Où tant d'abeilles butinèrent.
La source est là comme un oeil clos,
Pleurant avec de frais sanglots
la naissance triste de l'eau.
L'eau pure deviendra l'eau sale,
La source enfante et pleure ou râle,
Déplorée par les saules pâles.
Roule de vulgaires pensées,
Vieilles et saines et sensées,
Le gars ! Ô l'homme aux pieds blessés !
Au bois tu n'as point vu de faunes;
Des nymphes tu n'eus pas l'aumône
D'un iris bleu, d'un iris jaune.
Tu foules les dieux sous tes pas
Au vert bâton que tu coupas
Un dieu meurt - tu ne le sais pas ! -
Ah ! marche l'homme sans déesses
Ni tutélaires ni traîtresses,
Marche et tue les dieux quand ils naissent.
Tue les dieux nés de nos clairs yeux
Et dans nos âmes; le sang pieux
De tes pieds console les dieux.
Les faunes roux et les satyres
En te voyant feignent de rire
Et troublent l'eau quand tu t'y mires.
Tu marches en saluant les croix,
Du bord des routes qui poudroient.
Tout rouges de ton sang et froids,
Les dieux narquois partout se meurent
Et s'émeuvent les enchanteurs,
Les fleurs se fânent les fées pleurent.
Trois poèmes de Louise Lalanne
Le présent
Si tu veux je te donnerai
Mon matin, mon matin gai
Avec tous mes clairs cheveux
Que tu aimes ;
Mes yeux verts
Et dorés
Si tu veux.
Je te donnerai tout le bruit
Qui se fait
Quand le matin s'éveille
Au soleil
Et l'eau qui coule
Dans la fontaine
Tout auprès;
Et puis encor le soir qui viendra vite
Le soir de mon âme triste
À pleurer
Et mes mains toutes petites
Avec mon cœur qu'il faudra près du tien
Garder.
Chanson
Les myrtilles sont pour la dame
Qui n'est pas là
La marjolaine est pour mon âme
Tralala !
Le chèvrefeuille est pour la belle
Irrésolue.
Quand cueillerons-nous les airelles
Lanturlu.
Mais laissons pousser sur la tombe
O folle ! O fou !
Le romarin en touffes sombres
Laïtou!
Hier
Hier, c'est ce chapeau fané
Que j'ai longtemps traîné
Hier, c'est une pauvre robe
Qui n'est plus à la mode.
Hier, c'était le beau couvent
Si vide maintenant
Et la rose mélancolie
Des cours de jeunes filles
Hier, c'est mon cœur mal donné
Une autre, une autre année!
Hier n'est plus, ce soir, qu'une ombre
Près de moi dans ma chambre.
Per te praesentit aruspex
O mon très cher amour, toi mon œuvre et que j'aime,
A jamais j'allumai le feu de ton regard,
Je t'aime comme j'aime une belle œuvre d'art,
Une noble statue, un magique poème.
Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.
Je te crée à jamais pour qu'après mon départ,
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard
Toi, la vie et l'amour, ma gloire et mon emblème;
Et je suis soucieux de ta grande beauté
Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière:
C'est moi qui l'ai conçue et faite toute entière.
Ainsi, belle œuvre d'art, nos amours ont été
Et seront l'ornement du ciel et de la terre,
O toi, ma créature et ma divinité !
L'enfer
Un homme a traversé le désert sans rien boire
Et parvient une nuit sur les bords de la mer
Il a plus soif encore à voir le flot amer
Cet homme est mon désir, la mer est ta victoire.
Tout habillé de bleu quand il a l'âme noire
Au pied d'une potence un beau masque prend l'air
Comme si de l'amour - ce pendu jaune et vert -
Je voulais que brûlat l'horrible main de gloire.
Le pendu, le beau masque et cet homme altéré
Descendent dans l'enfer que je creuse moi-même
Et l'enfer c'est toujours : "je voudrais qu'elle m'aime"
Et n'aurais-je jamais une chose à mon gré
Sinon l'amour, du moins une mort aussi belle.
Dis-moi, le savais-tu, que mon âme est mortelle ?
Epithalame
Il est trop tard, il est trop tard, l'homme a pris ma soeur
Aux mamelles tentantes en la tristor des soirs,
Et je n'ai pu vouloir sous les étoiles habituelles
Ecouter les baisers que lui donnait l'Amant.
La chasse, ô soeur, la chasse a corné dans les nuits,
Les corneurs au loin ont fait un vain bruit,
Et la tête mourante a déchiré ton sein
Pour réchauffer le front trahi du morne Saint.
Rêvons! Rêvons, ô soeur! -Tes tresses magnifiques !-
As-tu des rêves d'or de femme prolifique ?
Et puis ce rêve est nul avec d'autres comas,
Et c'est à toi qu'il dit que jamais tu n'aimas.
Ô soeur, vierge impudique, qui reviens de là-bas
Ne t'es-tu pas livrée au mage des sabbats ?
Le désir de savoir ce que là tu fis nue,
Dis, ce sera pareil, ce conte inconnu,
Pareil à vos amours, livres non encor lus ?
La volonte, la volonté, oh! de ce que tu voulais.
Enfant aux seins trop durs, pointes-rubis balais;
Ô enfant, ô soeur, pourquoi t'es-tu livrée ? -
A tes pieds, l'aurore jeta ses fleurs de lauriers-roses;
Et ta fleur, et ton sein, et la nuit, et l'hypnose
M'ont fait mourir un peu, ô Belle au bois dormant !
Attendant le galop du cheval de l'amant.
Or, tu partis en croupe, le Mage te baisa,
Sur les yeux, sur les seins, sur la bouche il osa !
Ô dis, ô dis, ô soeur, dis-moi ce qu'il n'osa !...
Et te voilà revenue, pantelante, ô ma soeur !
De ce pays de feu où les femmes vont nues,
Où les membres sont noirs aux hommes qui t'aimèrent,
Où de longs corps se pâment au coin des carrefours,
Où l'on tranche la tête au soleil chaque jour
Pour qu'il verse son sang en rayons sur la terre.
L'ignorance
Icare
Soleil, je suis jeune et c'est à cause de toi,
Mon ombre pour être fauste je l'ai jetée.
Pardon, je ne fais pas plus d'ombre qu'une étoile
Je suis le seul qui pense dans l'immensité.
Mon père m'apprit les détours du labyrinthe
Et la science de la terre et puis mourut
Et depuis j'ai scruté longtemps la vieille crainte
Du ciel mobile et me suis nourri d'herbes crues.
Les oracles, c'est vrai, désapprouvaient ce zèle
Mais nul dieu pour tout dire n'est intervenu
Et pieux j'ai peiné pour achever les ailes
Qu'un peu de cire fixe à mes épaules nues.
Et j'ai pris mon essor vers ta face splendide
Les horizons terrestres se sont étalés
Des déserts de Libye aux palus méotides
Et des sources du Nil aux brumes de Thulé.
Soleil, je viens caresser ta face splendide
Et veux fixer ta flamme unique, aveuglement.
Icare étant céleste et plus divin qu'Alcide
Et son bûcher sera ton éblouissement.
Un pâtre
Je vois un dieu oblong flotter sous le soleil,
Puisse le premier dieu visible s'en aller
Et si c'était un dieu mourant cette merveille
Prions qu'il tombe ailleurs que dans notre vallée.
Icare
Pour éviter la nuit, ta mère incestueuse,
Dieu circulaire et bon je flotte entre les nues
Loin de la terre où vient, Stellaire et somptueuse,
La nuit cette inconnue parmi les inconnus.
Et je vivrai par ta chaleur et d'espérance.
Mais, ton amour, soleil, brûle divinement
Mon corps qu'être divin voulut mon ignorance
Et ciel! Humains! je tourne en l'éblouissement.
Bateliers
Un dieu choit dans la mer, un dieu nu, les mains vides
Au semblant des noyés il ira sur une île
Pourrir face tournée vers le soleil splendide.
Deux ailes feuillolent sous le ciel d'Ionie.
Gratitude
Maître José Théry
Sans vous j’eusse péri,
Vous sauvâtes ma vie :
Je vous en remercie.
En prison, seul et nu,
Je serais devenu
Comme un oisel en cage ;
Il y perd son ramage
Un soir à la Santé
Vous m’avez visité ;
Je n’en menais pas large,
Mais sans rien craindre, car je
N’avais pas mal agi :
Alors on m’élargit...
Que mon Merci soit, Maître,
Plus long qu’un kilomètre,
Et plus sonore encor
Que la voix de Stentor ;
Qu’il dure et qu’il demeure
Jusqu’au jour où je meure.
Puis après mon trépas,
Qu’il ne trépasse pas,
Mais soit devant l’Histoire
Un peu de votre gloire.
Dans le jardin d'Anna
Certes si nous avions vécu en l'an dix-sept cent soixante
Est-ce bien la date que vous déchiffrez, Anna, sur ce banc de pierre
Et que par malheur j'eusse été allemand
Mais que par bonheur j'eusse été près de vous
Nous aurions parlé d'amour de façon imprécise
Presque toujours en français
Et pendue éperdûment à mon bras
Vous m'auriez écouté vous parler de Pythagoras
En pensant aussi au café qu'on prendrait
dans une demi-heure
Et l'automne eût été pareil à cet automne
Que l'épine-vinette et les pampres couronnent
Et brusquement parfois j'eusse salué très bas
De nobles dames grasses et langoureuses
J'aurais dégusté lentement et tout seul
Pendant de longues soirées
Le tokay épais ou la malvoisie
J'aurais mis mon habit espagnol
Pour aller sur la route par laquelle
Arrive dans son vieux carrosse
Ma grand-mère qui se refuse à comprendre l'allemand
J'aurais écrit des vers pleins de mythologie
Sur vos seins, la vie champêtre et sur les dames
Des alentours
J'aurais souvent cassé ma canne
Sur le dos d'un paysan
J'aurais aimé entendre de la musique en mangeant
Du jambon
J'aurais juré en allemand je vous le jure
Lorsque vous m'auriez surpris embrassant à pleine bouche
Cette servante rousse
Vous m'auriez pardonné dans le bois aux myrtilles
J'aurais fredonné un moment
Puis nous aurions écouté longtemps les bruits du crépuscule
Ispahan
Pour tes roses
J'aurais fait
Un voyage plus long encore
Ton soleil n'est pas celui
Qui luit
Partout ailleurs
Et tes musiques qui s'accordent avec l'aube
Sont désormais pour moi
La mesure de l'art
D'après leur souvenir
Je jugerai
Mes vers les arts
Plastiques et toi-même
Visage adoré
Ispahan aux musiques du matin
Réveille l'odeur des roses de ses jardins
J'ai parfumé mon âme
A la rose
Pour ma vie entière
Ispahan grise et aux faïences bleues
Comme si l'on t'avait
Faite avec
Des morceaux de ciel et de terre
En laissant au milieu
Un grand trou de lumière
Cette
Place carrée Meïdan
Schah trop
Grande pour le trop petit nombre
De petits ânes trottinant
Et qui savent si joliment
Braire en regardant
La barbe rougie au henné
Du Soleil qui ressemble
A ces jeunes marchands barbus
Abrités sous leur ombrelle blanche
Je suis ici le frère des peupliers
Reconnaissez beaux peupliers aux fils d'Europe
Ô mes frères tremblants qui priez en Asie
Un passant arqué comme une corne d'antilope
Phonographe
Patarafes
La petite échoppe
Rolandseck
A Rolandseck Je rêvais sur la rive verte
La nonne de Roland dans l'île Nonnenwerth
Semblait passer ancienne parmi les fillettes
Les sept montagnes dormaient comme les bêtes
Enfin lasses qui gardaient les princesses légendaires
Et rêvant j'attendais le bac rectangulaire
Des gens descendant venaient aussi pour passer le fleuve
Trois dames au parler hanovrien
Effeuillaient sans raison des roses dans le Rhin
Qui semble une veine de Ton Corps si noble
Sur la route bordant le fleuve et tachée d'ombre
Fuyaient tremblant de peur
Comme des chevaliers indignes les autos
Tandis qu'au fil du Rhin s'en allaient des bateaux
A vapeur
La grenouillère
Au bord de l'île on voit
Les canots vides qui s'entre-cognent,
Et maintenant
Ni le dimanche, ni les jours de la semaine,
Ni les peintres ni Maupassant ne se promènent
Bras nus sur leurs canots avec des femmes à grosses poitrines
Et bêtes comme chou.
Petits bateaux vous me faites bien de la peine
Au bord de l'île.
Montparnasse
0 porte de l'hôtel avec deux plantes vertes
Vertes qui jamais
Ne porteront de fleurs
Où sont mes fruits Où me planté-je
O porte de l'hôtel un ange est devant toi
Distribuant des prospectus
On n'a jamais si bien défendu la vertu
Donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine
Ange barbu vous êtes en réalité
Un poète lyrique d'Allemagne
Qui voulez connaître Paris
Vous connaissez de son pavé
Ces raies sur lesquelles il ne faut pas que l'on marche
Et vous rêvez
D'aller passer votre Dimanche à Garches
Il fait un peu lourd et vos cheveux sont longs
O bon petit poète un peu bête et trop blond
Vos yeux ressemblent tant à ces deux grands ballons
Qui s'en vont dans l'air pur
A l'aventure
Hyde Park
Les Faiseurs de religions
Prêchaient dans le brouillard
Les ombres près de qui nous passions
Jouaient à collin maillard
À soixante-dix ans
Joues fraîches de petits enfants
Venez venez Eléonore
Et que sais-je encore
Regardez venir les cyclopes
Les pipes s'envolaient
Mais envolez-vous-en
Regards impénitents
Et l'Europe l'Europe
Regards sacrés
Mains enamourées
Et les amants s'aimèrent
Tant que prêcheurs prêchèrent
1904
À Strasbourg en dix-neuf-cent-quatre
J'arrivai pour le lundi gras
À l'hôtel m'assis devant l'âtre
Près d'un chanteur de l'Opéra
Qui ne parlait que de théâtre
La Kellnerine rousse avait
Mis sur sa tête un chapeau rose
Comme Hébé qui les dieux servait
N'en eut jamais. Ô belles choses
Carnaval chapeau rose Ave!
À Rome à Nice et à Cologne
Dans les fleurs et les confetti
Carnaval j'ai revu ta trogne,
Ô roi plus riche et plus gentil
Que Crésus Rothschild et Torlogne
Je soupai d'un peu de foie gras
De chevreuil tendre à la compote
De tartes flans et cetera
Un peu de kirsch me ravigote
Que ne t'avais-je entre mes bras.
L'anguille
Jeanne Houhou la très gentille
Est morte entre des draps très blancs
Pas seule Bébert dit l'Anguille
Narcisse et Hubert le merlan
Près d'elle faisaient leur manille
Et la crâneuse de Clichy
Aux rouges yeux de dégueulade
Répète Mon eau de Vichy
Va dans le panier à salade
Haha sans faire de chichi
Les yeux dansants comme des anges
Elle riait elle riait
Les yeux très bleus les dents très blanches
Si vous saviez si vous saviez
Tout ce que nous ferons dimanche
Souvenir du douanier
Un tout petit oiseau
Sur l'épaule d'un ange
Ils chantent la louange
Du gentil Rousseau
Les mouvements du monde
Les souvenirs s'en vont
Comme un bateau sur l'onde
Et les regrets au fond
Gentil Rousseau
Tu es cet ange
Et cet oiseau
De ta louange
lis se donnaient la main et s'attristaient ensemble
Sur leurs tombeaux ce sont les mêmes fleurs qui tremblent
Tu as raison elle est belle
Mais je n'ai pas le droit de l'aimer
Il faut que je reste ici
Où l'on fait de si jolies couronnes mortuaires en perles
Il faudra que je te montre ça
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S'est en allé
Des plaies sur les jambes
Tu m'as montré ces trous sanglants
Quand nous prenions un quinquina
Au bar des îles Marquises rue de la Gaîté
Un matin doux de verduresse
Les matelots l'attendent
Et fixent l'horizon
Où mi-corps hors de l'onde
Bayent tous les poissons
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S'est en allé
Les tessons de ta voix que l'amour a brisée
Nègres mélodieux Et je t'avais grisée
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Tu traverses Paris à pied très lentement
La brise au voile mauve Êtes-vous là maman
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S'est en allé
On dit qu'elle était belle
Près du Mississipi
Mais que la rend plus belle
La mode de Paris
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S'est en allé
Il grava sur un banc près la porte Dauphine
Les deux noms adorés Clémence et Joséphine
Et deux rosiers grimpaient le long de son âme
Un merveilleux trio
Il sourit sur le Pavé des Gardes à la jument pisseuse
Il dirige un orchestre d'enfants
Mademoiselle Madeleine
Ah! Mademoiselle Madeleine
Ah!
Il y a d'autres filles
Dans l'arrondissement
De douces de gentilles
Et qui n'ont pas d'amants
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S'est en allé
Un poème
Il est entré
Il s'est assis
Il ne regarde pas le pyrogène à cheveux rouges
L’allumette flambe
Il est parti
Le pont
Deux dames le long le long du fleuve
Elles se parlent par-dessus l’eau
Et sur le pont de leurs paroles
La foule passe et repasse en dansant
Un dieu
Tu reviendras
Hi! Ho ! Là-bas
Là-bas
C’est
Pour
Toi
Seule
Que
Le
Sang
Coule
Tous les enfants savent pourquoi
Passe mais passe donc
Ne te retourne pas
Hi ! Ho ! là-bas là-bas
Les jeunes filles qui passent sur le pont léger
Portent dans leurs mains
Le bouquet de demain
Et leurs regards s’écoulent
Dans ce fleuve à tous étranger
Qui vient de loin qui va si loin
Et passe sous le pont léger de vos paroles
O bavardes le long du fleuve
O bavardes O folles le long du fleuve
Avant le cinéma
Et puis ce soir on s'en ira
Au cinéma
Les Artistes que sont-ce donc
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les Beaux-Arts
Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'Art
Art poétique ou bien musique
Les Artistes ce sont les acteurs ou les actrices
Si nous étions des Artistes
Nous ne dirions pas le cinéma
Nous dirions le ciné
Mais si nous étions de vieux professeurs de province
Nous ne dirons ni ciné ni cinéma
Mais cinématographe
Aussi mon Dieu faut-il avoir du goût.
Fusée-signal
Des villages flambaient dans la nuit intérieure
Une fermière conduit son auto sur une route vers Galveston
Qui a lancé cette fusée-signal
Néanmoins tu feras bien de tenir la porte ouverte
Et puis le vent scieur de long
Suscitera en toi la terreur des fantômes
Ta langue
Le poisson rouge dans le bocal
De ta voix
Mais ce regret
A peine une infirmière plus blanche que l’hiver
Eblouissant tandis qu'à l'horizon décroît
Un régiment de jours plus bleus que les collines
Lointaines et plus doux que ne sont les coussins de l'auto
Allons plus vite
Allons plus vite
Et le soir vient et les lys meurent
Regarde ma douleur beau ciel qui me l’envoies
Une nuit de mélancolie
Enfant souris ô sœur écoute
Pauvres marchez sur la grand-route
Ô menteuse forêt qui surgis à ma voix
Les flammes qui brûlent les âmes
Sur le boulevard de Grenelle
Les ouvriers et les patrons
Arbres de mai cette dentelle
Ne fais donc pas le fanfaron
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
Tous les poteaux télégraphiques
Viennent là-bas le long du quai
Sur son sein notre République
A mis ce bouquet de muguet
Qui poussait dru le long du quai
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
La bouche en cœur Pauline honteuse
Les ouvriers et les patrons
Oui-dà oui-dà belle endormeuse
Ton frère
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
Sanglots
Notre amour est réglé par les calmes étoiles
Or nous savons qu'en nous beaucoup d'hommes respirent
Qui vinrent de très loin et sont un sous nos fronts
C'est la chanson des rêveurs
Qui s'étaient arraché le cœur
Et le portaient dans la main droite
Souviens-t'en cher orgueil de tous ces souvenirs
Des marins qui chantaient comme des conquérants
Des gouffres de Thulé des tendres deux d'Ophir
Des malades maudits de ceux qui fuient leur ombre
Et du retour joyeux des heureux émigrants
De ce cœur il coulait du sang
Et le rêveur allait pensant
A sa blessure délicate
Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes
Et douloureuse et nous disait
Qui sont les effets d'autres causes
Mon pauvre cœur mon cœur brisé
Pareil au cœur de tous les hommes
Voici voici nos mains que la vie fit esclaves
Est mort d'amour ou c'est tout comme
Est mort d'amour et le voici Ainsi vont toutes choses
Arrachez donc le vôtre aussi
Et rien ne sera libre jusqu'à la fin des temps
Laissons tout aux morts
Et cachons nos sanglots
Bleuet
Jeune homme
De vingt ans
Qui as vu des choses si affreuses
Que penses-tu des hommes de ton enfance
Tu
connais
la bravoure et la ruse
Tu
as
vu
la
mort
en
face
plus
de
cent
fois
tu
ne
sais
pas
ce
que
c'est
que
la
vie
Transmets ton intrépidité
A ceux qui viendont
Après toi
Jeune homme
Tu es joyeux ta mémoire est ensanglantée
Ton âme est rouge aussi
De joie
Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi
Tu as de la décision
Il est 17 heures et tu saurais
Mourir
Sinon mieux que tes aînés
Du moins plus pieusement
Car tu connais mieux la mort que la vie
O douceur d'autrefois
Lenteur immémoriale
A Luigi Amaro
Deux drapeaux tricolores C’est le lundi
De Pâques
Amaro vous savez que je vous aime bien
Comment réussissent-ils à avoir du crin gris perle
Je me souviens de l'émotion sublime qui nous gagna tous
A la lecture de la proclamation du général Gallieni
Aux Parisiens
Vous chantez Gallieni
Avec cette simplicité
Qu'il faut mettre en toutes choses
L'Italie est venue avec nous
Agitant auprès du ciel de notre drapeau
AMARO LE VERT QUI EST LA VÉGÉTATION
L'ESPÉRANCE
ÉCOUTEZ QUI EST LA HAINE AUSSI
ET L'ENNEMI LUI-MÊME
Amaro écoutez
Le fracas éternel de nos artilleries
Érige un tombeau de rumeurs
Tresse les couronnes faites en fleurs d'éclatements
Amaro écoutez
La Russie chante la Marseillaise
L'Amérique au nom de toutes démocraties
Proclame que tous les Français sont illustres
Et vous Amaro honorez
Tous les soldats français en chantant ce grand pacificateur
France ô Pacifique
O douce ô belle France
Amaro vous savez que je vous aime bien
Et nous aimons tous deux la France et l'Italie
Fagnes de Wallonie
Tant de tristesses plénières
Prirent mon cœur aux fagnes désolées
Quand las j'ai reposé dans les sapinières
Le poids des kilomètres pendant que râlait
Le vent d'ouest
J'avais quitté le joli bois
Les écureuils y sont restés
Ma pipe essayait de faire des nuages
Au ciel
Qui restait pur obstinément
Je n'ai confié aucun secret sinon une chanson énigmatique
Aux tourbières humides
Les bruyères fleurant le miel
Attiraient les abeilles
Et de mes pieds endoloris
Foulaient les myrtilles et les airelles
Tendrement mariée
Nord
Nord
La vie s'y tord
En arbres forts
Et tors
La vie y mord
La mort
A belles dents
Quand bruit le vent
Onirocritique
Les charbons du ciel étaient si proches que je craignais leur ardeur. Ils étaient sur le point de me brûler. Mais j’avais la conscience des éternités différentes de l’homme et de la femme. Deux animaux dissemblables s’accouplaient et les rosiers provignaient des treilles qu’alourdissaient des grappes de lune. De la gorge du singe, il sortit des flammes qui fleurdelisèrent le monde. Dans les myrtaies, une hermine blanchissait. Nous lui demandâmes la raison du faux hiver. J’avalai des troupeaux basanés. Orkenise parut à l’horizon. Nous nous dirigeâmes vers cette ville en regrettant les vallons où les pommiers chantaient, sifflaient et rugissaient. Mais le chant des champs labourés était merveilleux :
Par les portes d’Orkenise
Veut entrer un charretier,
Par les portes d’Orkenise
Veut sortir un va-nu-pieds.
Et les gardes de la ville
Courant sus au va-nu-pieds :
«Qu’emportes-tu de la ville ?»
«J’y laisse mon cœur entier.»
Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier :
«Qu’apportes-tu dans la ville ?»
«Mon cœur pour me marier.»
Que de cœurs dans Orkenise !
Les gardes riaient, riaient.
Va-nu-pieds la route est grise,
L’amour grise ô charretier.
Les beaux gardes de la ville,
Tricotaient superbement;
Puis, les portes de la ville
Se fermèrent lentement.
Mais j’avais la conscience des éternités différentes de l’homme et de la femme. Le ciel allaitait ses pards. J’aperçus alors sur ma main des taches cramoisies. Vers le matin, des pirates emmenèrent neuf vaisseaux ancrés dans le port. Les monarques s’égayaient. Et, les femmes ne voulaient pleurer aucun mort. Elles préfèrent les vieux rois, plus forts en amour que les vieux chiens. Un sacrificateur désira être immolé au lieu de la victime. On lui ouvrit le ventre. J’y vis quatre I, quatre O, quatre D. On nous servit de la viande fraîche et je grandis subitement après en avoir mangé. Des singes pareils à leurs arbres violaient d’anciens tombeaux. J’appelai une de ces bêtes sur qui poussaient des feuilles de laurier. Elle m’apporta une tête faite d’une seule perle. Je la pris dans mes bras et l’interrogeai après l’avoir menacée de la rejeter dans la mer si elle ne me répondait pas. Cette perle était ignorante et la mer l’engloutit.
Mais j’avais la conscience des éternités différentes de l’homme et de la femme. Deux animaux dissemblables s’aimaient. Cependant les rois seuls ne mouraient point de ce rire et vingt tailleurs aveugles vinrent dans le but de tailler et de coudre un voile destiné à couvrir la sardoine. Je les dirigeai moi-même, à reculons. Vers le soir, les arbres s’envolèrent, les singes devinrent immobiles et je me vis au centuple. La troupe que j’étais s’assit au bord de la mer. De grands vaisseaux d’or passaient à l’horizon. Et quand la nuit fut complète, cent flammes vinrent à ma rencontre. Je procréai cent enfants mâles dont les nourrices furent la lune et la colline. Ils aimèrent les rois désossés que l’on agitait sur les balcons. Arrivé au bord d’un fleuve, je le pris à deux mains et le brandis. Cette épée me désaltéra. Et la source languissante m’avertit que si j’arrêtais le soleil je le verrais carré, en réalité. Centuplé, je nageai vers un archipel. Cent matelots m’accueillirent et m’ayant mené dans un palais, ils m’y tuèrent quatre-vingt-dix-neuf fois. J’éclatai de rire à ce moment et dansai tandis qu’ils pleuraient. Je dansai à quatre pattes. Les matelots n’osaient plus bouger, car j’avais l’aspect effrayant du lion...
À quatre pattes, à quatre pattes.
Mes bras, mes jambes se ressemblaient et mes yeux multipliés me couronnaient attentivement. Je me relevai ensuite pour danser comme les mains et les feuilles.
J’étais ganté. Les insulaires m’emmenèrent dans leurs vergers pour que je cueillisse des fruits semblables à des femmes. Et l’île, à la dérive, alla combler un golfe où du sable aussitôt poussèrent des arbres rouges. Une bête molle couverte de plumes blanches chantait ineffablement et tout un peuple l’admirait sans se lasser. Je retrouvai sur le sol la tête faite d’une seule perle et qui pleurait. Je brandis le fleuve et la foule se dispersa. Des vieillards mangeaient l’ache et immortels ne souffraient pas plus que les morts. Je me sentis libre, libre comme une fleur en sa saison. Le soleil n’est pas plus libre qu’un fruit mûr. Un troupeau d’arbres broutait les étoiles invisibles et l’aurore donnait la main à la tempête. Dans les myrtaies, on subissait l’influence de l’ombre. Tout un peuple entassé dans un pressoir saignait en chantant. Des hommes naquirent de la liqueur qui coulait du pressoir. Ils brandissaient d’autres fleuves qui s’entrechoquaient avec un bruit argentin. Les ombres sortirent des myrtaies et s’en allèrent dans les jardinets qu’arrosait un surgeon d’yeux d’hommes et de bêtes. Le plus beau des hommes me prit à la gorge, mais je parvins à le terrasser. À genoux, il me montra les dents. Je les touchai; il en sortit des sons qui se changèrent en serpents de la couleur des châtaignes et leur langue s’appelait Sainte-Fabeau. Ils déterrèrent une racine transparente et en mangèrent. Elle était de la grosseur d’une rave. Et mon fleuve au repos les surbaigna sans les noyer. Le ciel était plein de fèces et d’oignons. Je maudissais les astres indignes dont la clarté coulait sur la terre. Nulle créature vivante n’apparaissait plus. Mais des chants s’élevaient de toutes parts. Je visitai des villes vides et des chaumières abandonnées. Je ramassai les couronnes de tous les rois et en fis le ministre immobile du monde loquace. Des vaisseaux d’or, sans matelots, passaient à l’horizon. Des ombres gigantesques se profilaient sur les voiles lointaines. Plusieurs siècles me séparaient de ces ombres. Je me désespérai. Mais, j’avais la conscience des éternités différentes de l’homme et de la femme. Des ombres dissemblables assombrissaient de leur amour l’écarlate des voilures, tandis que mes yeux se multipliaient dans les fleuves, dans les villes et dans la neige des montagnes.